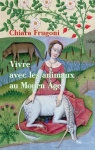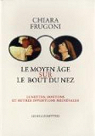Nationalité : Italie
Né(e) à : Pise , le 04/02/1940
Mort(e) à : Pise , le 09/04/2022
Ajouter des informations
Né(e) à : Pise , le 04/02/1940
Mort(e) à : Pise , le 09/04/2022
Biographie :
Chiara Frugoni est une historienne.
Elle a été professeur d’histoire du Moyen Âge à l’Université de Rome La Sapienza.
Elle consacre ses travaux à l’histoire des sensibilités et des représentations médiévales, en utilisant de façon privilégiée l’image.
Elle est l’auteur de plusieurs ouvrages de référence sur François d’Assise, en particulier Francesco. Un’altra storia (Marietti, 1988) et Francesco e l’invenzione delle stimmate. Una storia per parole e immagini fino a Bonaventura e Giotto (Einaudi, 1993).
Chiara Frugoni est une historienne.
Elle a été professeur d’histoire du Moyen Âge à l’Université de Rome La Sapienza.
Elle consacre ses travaux à l’histoire des sensibilités et des représentations médiévales, en utilisant de façon privilégiée l’image.
Elle est l’auteur de plusieurs ouvrages de référence sur François d’Assise, en particulier Francesco. Un’altra storia (Marietti, 1988) et Francesco e l’invenzione delle stimmate. Una storia per parole e immagini fino a Bonaventura e Giotto (Einaudi, 1993).
Ajouter des informations
étiquettes
Videos et interviews (5)
Voir plusAjouter une vidéo
Jusqu’à fin septembre, l’intégralité des fresques de Giotto sont présentées en l’église Saint Pierre du Lac à Montigny-le-Bretonneux. Sous forme de 28 panneaux photographiques le visiteur est invité à découvrir la vie de Saint-François d’Assise. Un chef d’oeuvre de la peinture italienne ouvert à tous.
Citations et extraits (26)
Voir plus
Ajouter une citation
Dans chaque foyer, le sucre, en morceaux bruts, était conservé religieusement dans une boîte en aluminium. Vingt grammes de café et cinquante de sucre,tel était le cadeau que l'on faisait à la femme qui venait " d'acheter", à savoir d'accoucher.
Pour nous , la messe consistait surtout à allumer les cierges et à préparer l'eucharistie, après que nous avions obtenu des domestiques un peu de vin et supplié en douce maman d'acheter les hosties à la pharmacie (nous les savourions, même si elles étaient insipides et collaient au palais)
C'était au " petit coin ", dans un recoin prévu à cet effet, qu'était entreposé le bonnet d'âne. Avec le cahier incriminé fixé sur le dos à l'aide d'une énorme épingle de sûreté, il servait au rite de la " honte " pour une fillette en larmes, menée par la meilleure élève d'une classe à l'autre, où se posaient sur elle des regards étonnés et moqueurs.
Les petits garçons jouaient. Et qu'en était-il des petites filles ?
Les pédagogues conseillaient de les mettre rapidement au travail et de ne pas les envoyer à l'école, sauf si elles étaient destinées à devenir religieuses, parfois dès l'âge de cinq ou six ans. Devenues adultes, seraient-elles nécessairement malheureuses ? Non, d'ailleurs nombre d'entre elles semblaient déjà annoncer le destin espéré par Virginia Woolf dans son célèbre essai "une chambre à soi".
Si elles étaient entreprenantes et intelligentes, elles pouvaient étudier, écrire, copier des manuscrits, enluminer et bien sûr se reposer dans leurs cellules sereines et ordonnées. Leur espérance de vie était plus grande que si elles avaient vécu dans le siècle. Elles évitaient les périls de l'accouchement, les maladies contractées à sa suite, ne connaissaient pas les disettes ni les violences domestiques, si fréquentes.
Les pédagogues conseillaient de les mettre rapidement au travail et de ne pas les envoyer à l'école, sauf si elles étaient destinées à devenir religieuses, parfois dès l'âge de cinq ou six ans. Devenues adultes, seraient-elles nécessairement malheureuses ? Non, d'ailleurs nombre d'entre elles semblaient déjà annoncer le destin espéré par Virginia Woolf dans son célèbre essai "une chambre à soi".
Si elles étaient entreprenantes et intelligentes, elles pouvaient étudier, écrire, copier des manuscrits, enluminer et bien sûr se reposer dans leurs cellules sereines et ordonnées. Leur espérance de vie était plus grande que si elles avaient vécu dans le siècle. Elles évitaient les périls de l'accouchement, les maladies contractées à sa suite, ne connaissaient pas les disettes ni les violences domestiques, si fréquentes.
Au paradis perdu qu’était devenue la terre pour les descendants d’Adam et Eve, les animaux – pour nous imaginaires – étaient eux aussi menaçants : personne ne doutait de leur existence, certifiée par la Bible, par quantité de textes antiques dignes de foi et par des récits de voyage.
Les garçons et les filles qui n'étaient pas envoyés à l'école étaient mis au travail dès l'âge de six ou sept ans, habituellement comme garçon de boutique ou jeune servante, selon leur sexe. [...]
Il pouvait arriver pire encore aux enfants : au XIVème siècle en effet, de petits esclaves, garçons comme filles, travaillaient au domicile des riches. Pétrarque, dans une lettre écrite à Venise en 1367, rappelle qu'à son époque appareillaient dans la cité des Doges des navires "plein d'esclaves que leurs parents, étreints par le besoin, mettent à prix", provenant de la Scythie (région entre le Danube et le Don). Le poète se désole seulement de leur laideur et d'être obligé de se mêler à eux.[...]
Boccace, lui non plus, lorsqu'il parle des esclaves, n'émet pas le début d'une critique devant un tel commerce ; c'est pour lui seulement une donnée de la réalité.
Il pouvait arriver pire encore aux enfants : au XIVème siècle en effet, de petits esclaves, garçons comme filles, travaillaient au domicile des riches. Pétrarque, dans une lettre écrite à Venise en 1367, rappelle qu'à son époque appareillaient dans la cité des Doges des navires "plein d'esclaves que leurs parents, étreints par le besoin, mettent à prix", provenant de la Scythie (région entre le Danube et le Don). Le poète se désole seulement de leur laideur et d'être obligé de se mêler à eux.[...]
Boccace, lui non plus, lorsqu'il parle des esclaves, n'émet pas le début d'une critique devant un tel commerce ; c'est pour lui seulement une donnée de la réalité.
Être destinée à la vie religieuse comportait pour une jeune femme la négation du désir sexuel et de sa satisfaction, la négation de la maternité, imposait des interdits à des jeunes filles qui auraient désiré un époux et des enfants. Mais la fête des noces passée, que restait-il à l'épouse alors même qu'elle n'avait pas pu choisir l'homme avec qui elle passerait sa vie, puisque dans le cadre du mariage, la femme était l'objet d'un don ou d'un échange entre le père et le prétendant ? De quelle qualité de vie bénéficiait une servante, une paysanne, ou même une femme de marchand ? Elles étaient toujours les femmes "de", les belles-filles "de", auxquelles il était seulement demandé d'obéir.
Innocent III, père authentique de l'Église, à l'heure à laquelle il s'était abandonné au sommeil, voit cette église menacer ruine ; quand soudain un homme en loques, hirsute et méprisable lui offre ses épaules pour la soutenir. Le souverain pontife se réveille, voit François et crie : « Est-ce vraiment bien celui qui vient de m'apparaître ; l'Église qui tremble et la foi est prête à la soutenir. » Et il [François] — tout ce qu'il demande lui fut accordé — s'en va heureux et content. Descendant de François, premier parmi les frères mineurs — ainsi le voulut le destin —, celui qui naquit sous la nom de Girolamo se fit appeler Nicolas et monta sur le trône du Saint-Siège : évêque de Rome, il s'aperçoit que dans cette église les murs s'affaissaient et menaçaient ruine. Il la redresse, devant et derrière, et ce qui se décompose, il le refaçonne et le décore, et il la reconstruit en partie depuis les fondations. Enfin, le saint portrait de Dieu qui resplendit en premier aux yeux des hommes, il le remet intact là où il avait toujours été, à sa place. Accueille par conséquent, toi ou Dieu, le voeu que l'évêque a accompli, aime la splendeur de cette maison qui est la tienne. Garde Nicolas, donne-lui la vie, au ciel comme sur Terre, rend-le heureux et sauvegarde-le des mains de son perfide ennemi. Quand, par la suite, le peuple pieux entrera ici, qu'il prenne le don que ce bon berger lui offre en lui accordant avec bienveillance l'indulgence et en lui pardonnant paternellement ses péchés avec une généreuse diligence. Dans l'année de l'incarnation de Notre Seigneur Jésus-Christ 1291, dans la troisième année du pontificat du pape Nicolas IV.
(À propos du Songe du Latran)
(À propos du Songe du Latran)
Dans les westerns, les affrontements entre les cow-boys et les Indiens survenaient toujours dans des paysages ensoleillés, sous un ciel dégagé, sans le moindre nuage. Au Moyen Age, en revanche, on a l'impression que l'été n'a jamais lieu. Souffrir du froid devait être une sensation profondément intériorisée. Par le châssis approximatif des fenêtres s'engouffraient les courants d'air qui pénétraient jusque dans les interstices des poutres en bois du plafond;
(p. 13-14)
(p. 13-14)
Le moine et théologien Guillaume de St Thierry (1085-1148) a décrit en des termes absolument pessimistes la naissance d'un enfant, même s'il ne s'appuyait pas pour cela sur des souvenirs qui le concernaient directement : "Ce malheureux a à peine vu le jour qu'immédiatement des liens et des bandages l'enserrent pour bien lui faire comprendre qu'il est entré dans une prison. Seuls les yeux et la bouche demeurent libres d'accomplir leur tâche, qui du reste ne consiste qu'à pleurer et à crier. Et même si un fils de roi ou d'empereur est entouré par davantage de soins, son sort n'est guère différent. Il vit pieds et poings liés, pauvre animal gémissant, inaugurant ainsi une vie de tourments, par la seule faute d'être né."
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur
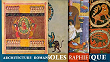
L'art roman et son monde
tourniereric2002
108 livres

Pour découvrir le Moyen Age
Femi
15 livres

Inventions et inventeurs
petitsoleil
45 livres
Auteurs proches de Chiara Frugoni
Lecteurs de Chiara Frugoni (93)Voir plus
Quiz
Voir plus
Juste la fin du monde
Comment commence la pièce ?
Par la scène d'arrivée de Louis chez lui
Par un dialogue entre Suzanne et son père
Par un monologue de Louis
Par la mort du père
10 questions
276 lecteurs ont répondu
Thème : Juste la fin du monde de
Jean-Luc LagarceCréer un quiz sur cet auteur276 lecteurs ont répondu