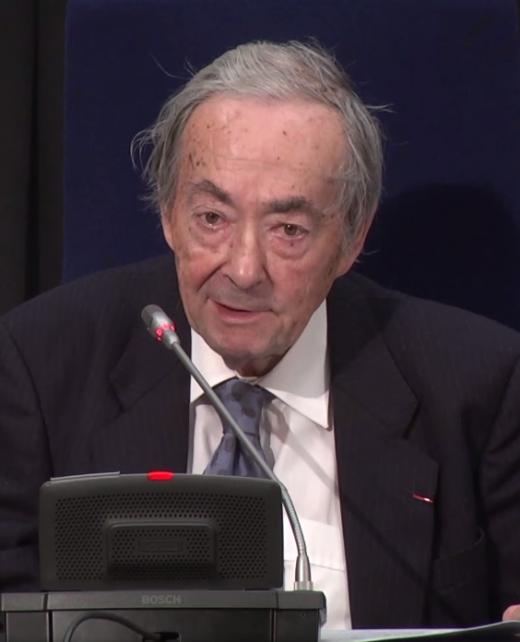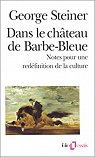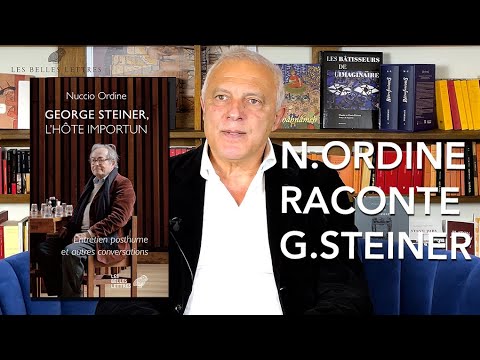Né(e) à : Neuilly-sur-Seine , le 23/04/1929
Mort(e) à : Cambridge, Royaume-Uni , le 03/02/2020
George Steiner est un écrivain anglo-franco-américain.
Spécialiste de littérature comparée et de théorie de la traduction, il est plus connu du grand public comme essayiste, critique littéraire et philosophe. Il écrit généralement en anglais mais a aussi publié quelques œuvres en français.
George Steiner est le fils de juifs autrichiens exilés en France depuis 1917 pour fuir l'antisémitisme qui régnait à Vienne. Il grandit avec trois langues maternelles, l'allemand, l'anglais et le français. Après avoir étudié au lycée Janson-de-Sailly à Paris, il émigre avec ses parents aux États-Unis en 1940 (il devint citoyen américain en 1944). Il poursuit ses études au lycée français de New York, à l'Université de Chicago et à l'Université Harvard où il obtient un MA en 1950.
Il fut entre 1952 et 1956 éditorialiste à l'hebdomadaire londonien "The Economist". C'est à ce moment-là qu'il fit la connaissance de Zara Shakow (1928), historienne et universitaire. Ils se marièrent en 1955, l'année où George passa son doctorat à l'Université d'Oxford.
Après avoir enseigné au Williams College (Massachusetts), à Innsbruck, à Cambridge et à Princeton, il est devenu professeur de littérature comparée à Genève en 1974, où il a enseigné jusqu'en 1994.
Il a depuis lors donné de nombreuses conférences à travers le monde et enseigné quelque temps au St Anne's College d'Oxford (1994-1995) puis à Harvard (2001-2002).
Gourmet de poésie, ardent défenseur de la culture classique gréco-latine, c'est un des penseurs européens contemporains à pouvoir lire dans le texte des œuvres écrites en de nombreuses langues (outre le grec et le latin, il maîtrise cinq langues vivantes). Il est l'archétype de l'intellectuel européen, au sens où il est pétri de plusieurs cultures de par son éducation trilingue. Son universalisme culturel littéraire a amené certains à le comparer à Zweig, Montaigne ou Érasme.
Dans "Errata. Récit d'une pensée" ("Errata: An Examined Life", 1997), il se déclare athée mais de culture et tradition juives. Il est hanté par la Shoah, qui transparaît dans presque toute son œuvre.
Il a écrit de nombreux essais sur la théorie du langage, la théorie de la traduction, la philosophie de l'éducation, la philosophie politique, etc. Dans le monde anglophone, il est réputé pour ses critiques littéraires dans "The New Yorker" et le "Times Literary Supplement". Il a été membre de la British Academy.
Ajouter des informations
Nous venons de publier un recueil d'entretiens entre George Steiner et Nuccio Ordine, intitulé //George Steiner. L'Hôte importun//. Il est précédé par un beau texte en témoignage à Steiner, écrit par celui qui fut un de ses plus proches amis, Nuccio Ordine. Pour en savoir plus : https://www.lesbelleslettres.com/livre/9782251453163/george-steiner-l-hote-importun *** Ce livre est le témoignage de la profonde amitié personnelle et intellectuelle qui a lié George Steiner et Nuccio Ordine. L'amour des classiques, la passion de l'enseignement, la défense du rôle du maître, la fonction essentielle de la littérature qui rend l'humanité plus humaine constituent les thèmes d'un intense dialogue, nourri de plus de quinze années de rencontres et de voyages dans diverses villes européennes. Ordine trace un portrait original de George Steiner, en le peignant sous les traits d'un « hôte importun ».
Pour emprunter une image à un autre domaine de l'art - celui qui a vraiment pénétré une peinture de Cézanne verra désormais une pomme ou une chaise comme il ne les avait jamais vues auparavant.
Un monde qui avait connu Danton et Austerlitz ne trouvait pas nécessaire de chercher dans la mythologie ou dans l'Antiquité les matériaux de la vision poétique.
Entre ces deux formes de servitude peuvent régner de grandes haines.
Cyrano de Bergerac
Qui est De Guiche?
2376 lecteurs ont répondu