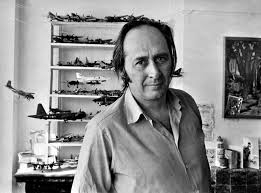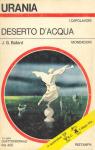Critiques de James Graham Ballard (219)
Critique de la réédition chez Tristram, 2017.
ENCORE PLUS DE BALLARD
Bis : l’excellent éditeur Tristram approfondit encore son catalogue ballardien, déjà conséquent, et comprenant nombre de merveilles – au premier chef l’intégrale des nouvelles en trois tomes, Vermilion Sands, La Foire aux atrocités, etc. Nouveaux titres dans la collection « Souple », donc : deux romans qui avaient déjà été édités en français, il y a quelque temps de cela certes, et qui m’étaient jusqu’alors passés sous le nez, Le Rêveur illimité et Le Jour de la création.
C’est cette fois le second qui nous intéresse, un roman datant de 1987, soit après que le succès d'Empire du soleil et de son adaptation par Steven Spielberg a permis de populariser l’auteur, dès lors moins cantonné que jamais dans son registre originel science-fictif – qui, cela dit, faisait de toute façon hausser des sourcils dans le fandom, et la publication de la « trilogie de béton » et de La Foire aux atrocités avait sans doute déjà démontré que le grand Ballard ne connaissait pas de limites.
Le Jour de la création, dans ce contexte, est un roman assez étrange – et en même temps typiquement ballardien. Riche d’échos à des œuvres antérieures de l’auteur autant qu’à des classiques signés par d’autres plumes (j’y reviendrai dans les deux cas), il sonne tantôt comme du concentré des obsessions de l’auteur, tantôt comme une quasi-parodie – même si, au fond, cette seconde dimension peut être une conséquence de la première. C’est aussi, étrangement, le « roman d’aventures » que décrit la quatrième de couverture, oui – on se contentera d’omettre l’adjectif « pur » qui y est associé. C’est un roman souvent fascinant, mais parfois un brin agaçant aussi. Pertinent de manière générale, mais avec plus ou moins de subtilité.
En fait, ai-je l’impression, comme Le Rêveur illimité justement, c’est un titre un peu bancal dans la bibliographie de l’auteur, disons même « mineur ». Ceci étant, un Ballard mineur vaut intrinsèquement mieux que 98 % des parutions littéraires, j’imagine...
LA SOIF DU MAL
Nous sommes en Afrique centrale, dans une région indécise car fantasmée – entre le Sahel et les débris de l’Afrique Équatoriale Française, le Tchad et le Soudan sont proches. Mallory est un médecin, envoyé par l’OMS à Port-la-Nouvelle, au bord du lac Kotto asséché, pour y tenir un dispensaire – entreprise absurde, car la guerre qui ravage la région, opposant très concrètement le général rebelle Harare et le capitaine Kagwa de la « gendarmerie » locale (aux ambitions de seigneur de guerre pas moins marquées, on en a tôt la certitude – et sa Mercedes adorée en est le plus pathétique des présages), cette guerre donc a fait fuir les non-belligérants. Le bon docteur recoud bien des hommes des deux camps, mais sa situation est des plus précaire : il pourrait très bien être abattu sur un coup de sang, qu'importe de qui – c’est d’ailleurs ce qui lui arrive au tout début du roman, quand nous le voyons mis en joue par une enfant-soldat… Un écho justement du Rêveur illimité, qui pourrait au-delà renvoyer également à Dick ou même à Bierce ? Mais admettons qu’il survive : c’est après tout ce que nous dit le roman…
En dehors des hommes de Kagwa et Harare, la faune locale (non autochtone…) est assez limitée, mais pas inexistante : il y a cette Nora Warrender, triste veuve victime de viol, et dont les raisons de rester sur place, dans cet enfer, sont problématiques. Il y a aussi une équipe de tournage, emmenée par Sanger, un ex-scientifique qui a décidé de faire davantage de sous en tournant des documentaires guère scientifiques, au point d’avoir perdu toute crédibilité auprès des chaînes de télévision occidentales ; déjà has-been, le bonhomme, qui travaille maintenant pour les chaînes câblées japonaises, semble persuadé de ce que le cadre déprimant du lac Kotto pourrait fournir le prétexte à un bon film – ses associés, Mr Pal l’Indien érudit et la très professionnelle photographe et camerawoman Ms Matsuoka, y travaillent. Et ça dépasse complètement Mallory.
Celui-ci, en fait de médecin, a surtout des ambitions relevant de l’ingénierie écologique : son grand projet, c’est de trouver un moyen d’alimenter la région en eau – car le Sahara avance. Une marotte comme une autre… Un rêve qui n’a aucune chance de se réaliser. Mallory le sait bien, et, après avoir réchappé à son exécution, il accède enfin aux injonctions de Kagwa, qui l’incite depuis un bon moment déjà à plier bagage. Mais c’est précisément à ce moment qu’un très improbable « accident » change la donne : un bulldozer, sur ses indications, arrache une vieille souche… et l’eau jaillit. Une réserve bien vite épuisée ? Forcément… Sauf que c’est un véritable fleuve qui apparaît ainsi – un monstre s’étendant sur des kilomètres, et très large : un nouveau Nil pour un continent qui en a bien besoin – un miracle à même de refleurir le désert. Bien plus que ce que le docteur souhaitait ?
Mais voilà : c’est une compulsion de l’homme découvrant un fleuve, il lui faut remonter à sa source. Le Dr Mallory y échappe d’autant moins que, pendant sa convalescence, Sanger a officiellement baptisé le fleuve... Mallory. Rien d’étonnant, dès lors, à ce qu’il s’identifie au fleuve – ce qui va bien plus loin qu’une appropriation. Mallory veut trouver la source du Mallory, oui – pour le détruire ; car c’est en son pouvoir, et c’est finalement une conséquence inévitable de la tendance du médecin à reporter sur son environnement la passion de l’autodestruction. D’autant, avouons-le, qu’il n’est guère aimable : lui-même nous éclaire sur les tendances foncièrement misanthropes de ses semblables, les si généreux médecins au service d’œuvres caritatives… Mais il est vrai que les autres protagonistes du roman ne sont guère plus sympathiques.
Ce que nous aurons bientôt l’occasion de constater, quand, suite à un acte de piraterie bien hardi, Mallory se met donc à remonter le fleuve à bord du vieux ferry Salammbô ; mais pas seul, car il est accompagné par la gamine de douze ans qui a failli l’abattre – cette « Noon » en qui il voit un esprit du fleuve, son fleuve, et en même temps une femme en puissance mais d’autant plus désirable qu’il y a encore en elle de l’enfant, même enfant-soldat…
Et, à leurs trousses, tous ceux qui, dans la région, entendent tirer partir du miracle fluvial – c’est-à-dire absolument tout le monde. Au point, s’il le faut, du massacre généralisé.
APOCALYPSE LOLITA...
Le Jour de la création est un roman sous influence, et qui ne s’en cache certainement pas. Sans doute cela fait-il partie de l’essence même du projet.
Bien sûr, il emprunte à nombre d’histoires reposant sur le topos du fleuve que l’on remonte – et elles sont innombrables. Bien sûr aussi, contexte africain oblige, et tout autant les considérations métaphysiques et éthiques qui s’y mêlent, la référence-clef est probablement Au Cœur des ténèbres, de Joseph Conrad – avec un Mallory qui serait tout à la fois Marlow et Kurtz. Peut-être cependant faut-il tordre quelque peu cette référence ? Car la dimension guerrière du récit peut tout autant évoquer la variation sur le même roman qu’est Apocalypse Now ; j’y suis d’autant plus incité que, via Sanger et son équipe de tournage, la technologie moderne, ici, porteuse de récits, est essentiellement envisagée au travers du petit écran, sinon du grand…
En fait, les références littéraires comme filmiques qu’évoque sans peine Le Jour de la création ont aussi pour fonction de produire une Afrique noire parfaitement fantasmée, et certes pas épargnée par les clichés du « temps béni des colonies » (Michel, franchement, ta gueule) ; délibérément bien sûr, et Noon apprenant l’anglais en se repassant sans cesse les mêmes cassettes d’initiation à la sociologie post-coloniale, entre deux visionnages de vieilles tarzaneries, y offre un très ironique contrepoint – tandis que le « Dr Mal », comme elle l’appelle, incarne à son tour ces diverses manières de s’accaparer l’Afrique, et pas seulement sa représentation mythique.
Noon, justement, tire en même temps le roman vers d'autres références non moins marquées : l'attirance clairement pédophile de Mallory pour la gamine de douze ans (même et peut-être justement parce qu'elle a un flingue) n'est pas l'aspect le moins déconcertant du roman, et ne rend pas exactement le personnage du forcément bon docteur plus sympathique ; dans sa fascination pour la fillette, qui le rend parfois lyrique, le docteur est d'une perversion fleurie et au-delà de la simple suspicion, qui en fait un émule colonial d'Humbert Humbert dans le Lolita de Nabokov (probablement bien davantage, cette fois, que celui de l'adaptation par Stanley Kubrick).
… ET AUTRES RÉMINISCENCES
Mais Ballard, dans Le Jour de la création, ne se contente pas de revisiter et mélanger ces nombreuses références qui lui sont extérieures. C’est aussi, pour lui, l’occasion de produire des variations, plus ou moins ironiques, sur nombre de ses œuvres antérieures. Dans certains cas, cela ne fait pas le moindre doute : l’apocalypse de/du Mallory renvoie presque explicitement à deux des quatre apocalypses originelles de Ballard, celles que je préfère d’ailleurs, Le Monde englouti et La Forêt de cristal. On peut être tenté d’y adjoindre, sur un mode sans doute davantage mineur, Salut l’Amérique ! Dans un autre registre, je tends à croire que la vision particulièrement désenchantée, non, carrément misanthrope et génocidaire des relations humaines autour du fleuve peut être envisagée comme un écho de la guerre civile verticale qui prend place dans l’I.G.H., tandis que la mégalomanie divine d’un héros par ailleurs si détestable ne manque bien sûr pas d’évoquer, réédition concomitante, Le Rêveur illimité.
Le Jour de la création peut aussi être vu comme anticipant quelques titres de l’œuvre ultérieure de l’auteur : ainsi de Sauvagerie, même si ce court roman aux implications terribles initie surtout le pan tardif de l’œuvre ballardienne, avec ses variations sur la Riviera psychopathe ; je serais tenté de mentionner également et peut-être avant tout La Course au paradis, avec ces mêmes Occidentaux déboulant à l’autre bout du monde en débordant des meilleures intentions, mais dont l’action produira presque nécessairement un cauchemar dystopique.
Et là, je m’en tiens aux romans, donc.
Une approche pas inintéressante, mais pas non plus sans inconvénients – dont le principal est probablement le risque de l’auto-parodie. Sans doute l’auteur en était-il très conscient, et d’autant plus désireux de manier l’ironie, mais le lecteur n’en est que davantage porté à la comparaison, et pas forcément en la faveur du Jour de la création. Un roman qui, pourtant, produit assurément des images fortes, typiques de la plume de l’auteur – simplement, « trop typiques », peut-être.
MR SELF-DESTRUCT
Je crois cependant que le principal atout de ce roman, qui n’en manque pas, ne me faites pas dire ce que je n’ai pas dit, réside dans son personnage principal et narrateur, le Dr Mallory. Je ne garantis pas que l’œuvre ballardienne soit si riche que cela en personnages véritablement positifs, mais Mal figure peut-être parmi les plus négatifs.
Cependant, le juger sur le plan moral ne fait pas forcément sens. Sa mégalomanie qui tend vers l’homicide, son arrogance, et bien sûr son attirance (coupable ?) pour Noon empêchent de voir en lui un « héros », mais, comme d’ailleurs dans Le Monde englouti surtout, si je ne m’abuse, le personnage opère d’une certaine manière une transsubstantiation qui rend inaccessible ce démiurge jaloux aux remontrances humaines.
Mais il y a peut-être autre chose qui sauve paradoxalement le Dr Mal – et c’est sa fragilité mentale. Sa quasi-fanfaronnade sur les médecins misanthropes ne dissimule rien du trouble autrement essentiel qui le caractérise : une pulsion autodestructrice de tous les instants. Certes, aux yeux extérieurs du lecteur, le mauvais docteur reporte ainsi sur son environnement ce désir de mort, et, à mesure que les pages défilent, toujours plus dégoulinantes de sang, le tueur de fleuve échappe à toute possibilité de rédemption. Mais lui-même n’est tout simplement pas en mesure de percevoir les choses ainsi : il est le fleuve – dès lors, tuer le fleuve revient à se tuer lui-même (l’inverse n’est peut-être pas aussi vrai ?), et, en tant que tel, Mallory, homme et fleuve, incarne une liberté individuelle poussée à l’extrême, dont la condamnation demeure possible, mais non sans circonvolutions argumentaires malaisées… Mallory suicidaire peut, dans une égale mesure, susciter le dégoût et la compassion, le mépris et l’admiration. C’est un personnage qui me paraît très réussi – tantôt bigger than life, tantôt si humain, très riche en tout cas au-delà de sa seule fonction narrative.
Enfin, le discours pour le moins confus de cet homme qui tire argument de ce qu’il a créé un fleuve pour en déduire la légitimité de son entreprise visant à le détruire, affecte le lecteur, voire le convainc – même dans la douleur. J’imagine qu’on peut ainsi voir en lui une métaphore de l’écrivain revenant sur son œuvre – en général, ou de Ballard lui-même très précisément : le jeu des références n’en est que davantage justifié.
DIEU S’EST REPOSÉ LE SEPTIÈME JOUR POUR VISIONNER LES RUSHES
Ceci ressort également d’une autre dimension du roman, proche, mais probablement moins subtile : la critique des médias, ou peut-être plus exactement et même sereinement du rapport à l’image, qu’autorise l’entreprise documentaire passablement cynique conduite par Sanger. Lui non plus n’est pas exactement un personnage aimable… et pourtant, en certaines occasions, on ne peut s’empêcher de l’aimer. Son discours n’est sans doute pas moins confus que celui de Mallory (son sujet ?), mais l’idée que tout n’est que récit a son importance.
La métaphore est peut-être parfois trop lourde, sa pertinence peut être questionnée à plusieurs reprises, mais elle offre au bateleur quelques occasions de briller avec sa verve d’entertainer ; en tant que telle, cette faconde savamment orientée poursuit la métaphore initiale de la création littéraire, avec le biais utile de la mise en scène : un documentaire ne saurait après tout être objectif, et poser sa caméra ici plutôt que là est déjà un choix, littéralement l’imposition d’un point de vue – mais le récit conscient ne vient peut-être qu’après ? Sanger a son moment de triomphe, quand il assène à un Mallory sceptique cette ultime vérité : « Dieu s’est reposé le septième jour pour visionner les rushes. »
Le déroulé du roman vient-il confirmer ou infirmer cet aphorisme ? À vrai dire, je n’en suis pas bien sûr… Il y a ici une ambiguïté, mais je la suppose bienvenue.
UNE SOURCE TROP LOIN ?
Le Jour de la création débute magnifiquement bien. Dans ses premiers chapitres, habilement colorés, générateurs d’images fortes à foison, et empreints d’une certaine pesanteur léthargique, comme une variation inquiétante et morbide de Vermilion Sands, je tends à croire que le roman se hisse au niveau des meilleures productions de l’auteur – ce qui n’est pas peu dire.
Cette impression, toutefois, ne se vérifie pas sur la durée. En fait, à cet égard, Le Jour de la création m’a en gros fait le même effet… que Le Rêveur illimité, ça tombe bien. Le début est très bon, mais le format est trop long à mon goût, et, passé un certain temps, on patine un peu, au fil de séquences bien trop répétitives.
Dit comme ça, oui, ça ne fait pas forcément envie… Mais je ne prétends pas que c’est un mauvais roman, loin de là. En fait, il est même plutôt bon – simplement moins bon que nombre d’autres romans de Ballard, et on ne saurait faire l’impasse sur ce critère violemment discriminant ; d’autant que, d’une certaine manière, le roman lui-même nous incite à faire cette comparaison. Ceci étant, même de la sorte, il m’a davantage parlé que Le Rêveur illimité, justement – ou que Salut l’Amérique !, et encore quelques autres.
Signé par tout autre que Ballard, Le Jour de la création aurait été plus que recommandable. Alors on y revient : un Ballard mineur vaut intrinsèquement mieux que 98 % des parutions littéraires. Dont acte.
Lien : http://nebalestuncon.over-bl..
ENCORE PLUS DE BALLARD
Bis : l’excellent éditeur Tristram approfondit encore son catalogue ballardien, déjà conséquent, et comprenant nombre de merveilles – au premier chef l’intégrale des nouvelles en trois tomes, Vermilion Sands, La Foire aux atrocités, etc. Nouveaux titres dans la collection « Souple », donc : deux romans qui avaient déjà été édités en français, il y a quelque temps de cela certes, et qui m’étaient jusqu’alors passés sous le nez, Le Rêveur illimité et Le Jour de la création.
C’est cette fois le second qui nous intéresse, un roman datant de 1987, soit après que le succès d'Empire du soleil et de son adaptation par Steven Spielberg a permis de populariser l’auteur, dès lors moins cantonné que jamais dans son registre originel science-fictif – qui, cela dit, faisait de toute façon hausser des sourcils dans le fandom, et la publication de la « trilogie de béton » et de La Foire aux atrocités avait sans doute déjà démontré que le grand Ballard ne connaissait pas de limites.
Le Jour de la création, dans ce contexte, est un roman assez étrange – et en même temps typiquement ballardien. Riche d’échos à des œuvres antérieures de l’auteur autant qu’à des classiques signés par d’autres plumes (j’y reviendrai dans les deux cas), il sonne tantôt comme du concentré des obsessions de l’auteur, tantôt comme une quasi-parodie – même si, au fond, cette seconde dimension peut être une conséquence de la première. C’est aussi, étrangement, le « roman d’aventures » que décrit la quatrième de couverture, oui – on se contentera d’omettre l’adjectif « pur » qui y est associé. C’est un roman souvent fascinant, mais parfois un brin agaçant aussi. Pertinent de manière générale, mais avec plus ou moins de subtilité.
En fait, ai-je l’impression, comme Le Rêveur illimité justement, c’est un titre un peu bancal dans la bibliographie de l’auteur, disons même « mineur ». Ceci étant, un Ballard mineur vaut intrinsèquement mieux que 98 % des parutions littéraires, j’imagine...
LA SOIF DU MAL
Nous sommes en Afrique centrale, dans une région indécise car fantasmée – entre le Sahel et les débris de l’Afrique Équatoriale Française, le Tchad et le Soudan sont proches. Mallory est un médecin, envoyé par l’OMS à Port-la-Nouvelle, au bord du lac Kotto asséché, pour y tenir un dispensaire – entreprise absurde, car la guerre qui ravage la région, opposant très concrètement le général rebelle Harare et le capitaine Kagwa de la « gendarmerie » locale (aux ambitions de seigneur de guerre pas moins marquées, on en a tôt la certitude – et sa Mercedes adorée en est le plus pathétique des présages), cette guerre donc a fait fuir les non-belligérants. Le bon docteur recoud bien des hommes des deux camps, mais sa situation est des plus précaire : il pourrait très bien être abattu sur un coup de sang, qu'importe de qui – c’est d’ailleurs ce qui lui arrive au tout début du roman, quand nous le voyons mis en joue par une enfant-soldat… Un écho justement du Rêveur illimité, qui pourrait au-delà renvoyer également à Dick ou même à Bierce ? Mais admettons qu’il survive : c’est après tout ce que nous dit le roman…
En dehors des hommes de Kagwa et Harare, la faune locale (non autochtone…) est assez limitée, mais pas inexistante : il y a cette Nora Warrender, triste veuve victime de viol, et dont les raisons de rester sur place, dans cet enfer, sont problématiques. Il y a aussi une équipe de tournage, emmenée par Sanger, un ex-scientifique qui a décidé de faire davantage de sous en tournant des documentaires guère scientifiques, au point d’avoir perdu toute crédibilité auprès des chaînes de télévision occidentales ; déjà has-been, le bonhomme, qui travaille maintenant pour les chaînes câblées japonaises, semble persuadé de ce que le cadre déprimant du lac Kotto pourrait fournir le prétexte à un bon film – ses associés, Mr Pal l’Indien érudit et la très professionnelle photographe et camerawoman Ms Matsuoka, y travaillent. Et ça dépasse complètement Mallory.
Celui-ci, en fait de médecin, a surtout des ambitions relevant de l’ingénierie écologique : son grand projet, c’est de trouver un moyen d’alimenter la région en eau – car le Sahara avance. Une marotte comme une autre… Un rêve qui n’a aucune chance de se réaliser. Mallory le sait bien, et, après avoir réchappé à son exécution, il accède enfin aux injonctions de Kagwa, qui l’incite depuis un bon moment déjà à plier bagage. Mais c’est précisément à ce moment qu’un très improbable « accident » change la donne : un bulldozer, sur ses indications, arrache une vieille souche… et l’eau jaillit. Une réserve bien vite épuisée ? Forcément… Sauf que c’est un véritable fleuve qui apparaît ainsi – un monstre s’étendant sur des kilomètres, et très large : un nouveau Nil pour un continent qui en a bien besoin – un miracle à même de refleurir le désert. Bien plus que ce que le docteur souhaitait ?
Mais voilà : c’est une compulsion de l’homme découvrant un fleuve, il lui faut remonter à sa source. Le Dr Mallory y échappe d’autant moins que, pendant sa convalescence, Sanger a officiellement baptisé le fleuve... Mallory. Rien d’étonnant, dès lors, à ce qu’il s’identifie au fleuve – ce qui va bien plus loin qu’une appropriation. Mallory veut trouver la source du Mallory, oui – pour le détruire ; car c’est en son pouvoir, et c’est finalement une conséquence inévitable de la tendance du médecin à reporter sur son environnement la passion de l’autodestruction. D’autant, avouons-le, qu’il n’est guère aimable : lui-même nous éclaire sur les tendances foncièrement misanthropes de ses semblables, les si généreux médecins au service d’œuvres caritatives… Mais il est vrai que les autres protagonistes du roman ne sont guère plus sympathiques.
Ce que nous aurons bientôt l’occasion de constater, quand, suite à un acte de piraterie bien hardi, Mallory se met donc à remonter le fleuve à bord du vieux ferry Salammbô ; mais pas seul, car il est accompagné par la gamine de douze ans qui a failli l’abattre – cette « Noon » en qui il voit un esprit du fleuve, son fleuve, et en même temps une femme en puissance mais d’autant plus désirable qu’il y a encore en elle de l’enfant, même enfant-soldat…
Et, à leurs trousses, tous ceux qui, dans la région, entendent tirer partir du miracle fluvial – c’est-à-dire absolument tout le monde. Au point, s’il le faut, du massacre généralisé.
APOCALYPSE LOLITA...
Le Jour de la création est un roman sous influence, et qui ne s’en cache certainement pas. Sans doute cela fait-il partie de l’essence même du projet.
Bien sûr, il emprunte à nombre d’histoires reposant sur le topos du fleuve que l’on remonte – et elles sont innombrables. Bien sûr aussi, contexte africain oblige, et tout autant les considérations métaphysiques et éthiques qui s’y mêlent, la référence-clef est probablement Au Cœur des ténèbres, de Joseph Conrad – avec un Mallory qui serait tout à la fois Marlow et Kurtz. Peut-être cependant faut-il tordre quelque peu cette référence ? Car la dimension guerrière du récit peut tout autant évoquer la variation sur le même roman qu’est Apocalypse Now ; j’y suis d’autant plus incité que, via Sanger et son équipe de tournage, la technologie moderne, ici, porteuse de récits, est essentiellement envisagée au travers du petit écran, sinon du grand…
En fait, les références littéraires comme filmiques qu’évoque sans peine Le Jour de la création ont aussi pour fonction de produire une Afrique noire parfaitement fantasmée, et certes pas épargnée par les clichés du « temps béni des colonies » (Michel, franchement, ta gueule) ; délibérément bien sûr, et Noon apprenant l’anglais en se repassant sans cesse les mêmes cassettes d’initiation à la sociologie post-coloniale, entre deux visionnages de vieilles tarzaneries, y offre un très ironique contrepoint – tandis que le « Dr Mal », comme elle l’appelle, incarne à son tour ces diverses manières de s’accaparer l’Afrique, et pas seulement sa représentation mythique.
Noon, justement, tire en même temps le roman vers d'autres références non moins marquées : l'attirance clairement pédophile de Mallory pour la gamine de douze ans (même et peut-être justement parce qu'elle a un flingue) n'est pas l'aspect le moins déconcertant du roman, et ne rend pas exactement le personnage du forcément bon docteur plus sympathique ; dans sa fascination pour la fillette, qui le rend parfois lyrique, le docteur est d'une perversion fleurie et au-delà de la simple suspicion, qui en fait un émule colonial d'Humbert Humbert dans le Lolita de Nabokov (probablement bien davantage, cette fois, que celui de l'adaptation par Stanley Kubrick).
… ET AUTRES RÉMINISCENCES
Mais Ballard, dans Le Jour de la création, ne se contente pas de revisiter et mélanger ces nombreuses références qui lui sont extérieures. C’est aussi, pour lui, l’occasion de produire des variations, plus ou moins ironiques, sur nombre de ses œuvres antérieures. Dans certains cas, cela ne fait pas le moindre doute : l’apocalypse de/du Mallory renvoie presque explicitement à deux des quatre apocalypses originelles de Ballard, celles que je préfère d’ailleurs, Le Monde englouti et La Forêt de cristal. On peut être tenté d’y adjoindre, sur un mode sans doute davantage mineur, Salut l’Amérique ! Dans un autre registre, je tends à croire que la vision particulièrement désenchantée, non, carrément misanthrope et génocidaire des relations humaines autour du fleuve peut être envisagée comme un écho de la guerre civile verticale qui prend place dans l’I.G.H., tandis que la mégalomanie divine d’un héros par ailleurs si détestable ne manque bien sûr pas d’évoquer, réédition concomitante, Le Rêveur illimité.
Le Jour de la création peut aussi être vu comme anticipant quelques titres de l’œuvre ultérieure de l’auteur : ainsi de Sauvagerie, même si ce court roman aux implications terribles initie surtout le pan tardif de l’œuvre ballardienne, avec ses variations sur la Riviera psychopathe ; je serais tenté de mentionner également et peut-être avant tout La Course au paradis, avec ces mêmes Occidentaux déboulant à l’autre bout du monde en débordant des meilleures intentions, mais dont l’action produira presque nécessairement un cauchemar dystopique.
Et là, je m’en tiens aux romans, donc.
Une approche pas inintéressante, mais pas non plus sans inconvénients – dont le principal est probablement le risque de l’auto-parodie. Sans doute l’auteur en était-il très conscient, et d’autant plus désireux de manier l’ironie, mais le lecteur n’en est que davantage porté à la comparaison, et pas forcément en la faveur du Jour de la création. Un roman qui, pourtant, produit assurément des images fortes, typiques de la plume de l’auteur – simplement, « trop typiques », peut-être.
MR SELF-DESTRUCT
Je crois cependant que le principal atout de ce roman, qui n’en manque pas, ne me faites pas dire ce que je n’ai pas dit, réside dans son personnage principal et narrateur, le Dr Mallory. Je ne garantis pas que l’œuvre ballardienne soit si riche que cela en personnages véritablement positifs, mais Mal figure peut-être parmi les plus négatifs.
Cependant, le juger sur le plan moral ne fait pas forcément sens. Sa mégalomanie qui tend vers l’homicide, son arrogance, et bien sûr son attirance (coupable ?) pour Noon empêchent de voir en lui un « héros », mais, comme d’ailleurs dans Le Monde englouti surtout, si je ne m’abuse, le personnage opère d’une certaine manière une transsubstantiation qui rend inaccessible ce démiurge jaloux aux remontrances humaines.
Mais il y a peut-être autre chose qui sauve paradoxalement le Dr Mal – et c’est sa fragilité mentale. Sa quasi-fanfaronnade sur les médecins misanthropes ne dissimule rien du trouble autrement essentiel qui le caractérise : une pulsion autodestructrice de tous les instants. Certes, aux yeux extérieurs du lecteur, le mauvais docteur reporte ainsi sur son environnement ce désir de mort, et, à mesure que les pages défilent, toujours plus dégoulinantes de sang, le tueur de fleuve échappe à toute possibilité de rédemption. Mais lui-même n’est tout simplement pas en mesure de percevoir les choses ainsi : il est le fleuve – dès lors, tuer le fleuve revient à se tuer lui-même (l’inverse n’est peut-être pas aussi vrai ?), et, en tant que tel, Mallory, homme et fleuve, incarne une liberté individuelle poussée à l’extrême, dont la condamnation demeure possible, mais non sans circonvolutions argumentaires malaisées… Mallory suicidaire peut, dans une égale mesure, susciter le dégoût et la compassion, le mépris et l’admiration. C’est un personnage qui me paraît très réussi – tantôt bigger than life, tantôt si humain, très riche en tout cas au-delà de sa seule fonction narrative.
Enfin, le discours pour le moins confus de cet homme qui tire argument de ce qu’il a créé un fleuve pour en déduire la légitimité de son entreprise visant à le détruire, affecte le lecteur, voire le convainc – même dans la douleur. J’imagine qu’on peut ainsi voir en lui une métaphore de l’écrivain revenant sur son œuvre – en général, ou de Ballard lui-même très précisément : le jeu des références n’en est que davantage justifié.
DIEU S’EST REPOSÉ LE SEPTIÈME JOUR POUR VISIONNER LES RUSHES
Ceci ressort également d’une autre dimension du roman, proche, mais probablement moins subtile : la critique des médias, ou peut-être plus exactement et même sereinement du rapport à l’image, qu’autorise l’entreprise documentaire passablement cynique conduite par Sanger. Lui non plus n’est pas exactement un personnage aimable… et pourtant, en certaines occasions, on ne peut s’empêcher de l’aimer. Son discours n’est sans doute pas moins confus que celui de Mallory (son sujet ?), mais l’idée que tout n’est que récit a son importance.
La métaphore est peut-être parfois trop lourde, sa pertinence peut être questionnée à plusieurs reprises, mais elle offre au bateleur quelques occasions de briller avec sa verve d’entertainer ; en tant que telle, cette faconde savamment orientée poursuit la métaphore initiale de la création littéraire, avec le biais utile de la mise en scène : un documentaire ne saurait après tout être objectif, et poser sa caméra ici plutôt que là est déjà un choix, littéralement l’imposition d’un point de vue – mais le récit conscient ne vient peut-être qu’après ? Sanger a son moment de triomphe, quand il assène à un Mallory sceptique cette ultime vérité : « Dieu s’est reposé le septième jour pour visionner les rushes. »
Le déroulé du roman vient-il confirmer ou infirmer cet aphorisme ? À vrai dire, je n’en suis pas bien sûr… Il y a ici une ambiguïté, mais je la suppose bienvenue.
UNE SOURCE TROP LOIN ?
Le Jour de la création débute magnifiquement bien. Dans ses premiers chapitres, habilement colorés, générateurs d’images fortes à foison, et empreints d’une certaine pesanteur léthargique, comme une variation inquiétante et morbide de Vermilion Sands, je tends à croire que le roman se hisse au niveau des meilleures productions de l’auteur – ce qui n’est pas peu dire.
Cette impression, toutefois, ne se vérifie pas sur la durée. En fait, à cet égard, Le Jour de la création m’a en gros fait le même effet… que Le Rêveur illimité, ça tombe bien. Le début est très bon, mais le format est trop long à mon goût, et, passé un certain temps, on patine un peu, au fil de séquences bien trop répétitives.
Dit comme ça, oui, ça ne fait pas forcément envie… Mais je ne prétends pas que c’est un mauvais roman, loin de là. En fait, il est même plutôt bon – simplement moins bon que nombre d’autres romans de Ballard, et on ne saurait faire l’impasse sur ce critère violemment discriminant ; d’autant que, d’une certaine manière, le roman lui-même nous incite à faire cette comparaison. Ceci étant, même de la sorte, il m’a davantage parlé que Le Rêveur illimité, justement – ou que Salut l’Amérique !, et encore quelques autres.
Signé par tout autre que Ballard, Le Jour de la création aurait été plus que recommandable. Alors on y revient : un Ballard mineur vaut intrinsèquement mieux que 98 % des parutions littéraires. Dont acte.
Lien : http://nebalestuncon.over-bl..
Le héros, Mallory, est à la recherche du troisième Nil qui ressusciterait le Sahara. Et il le trouve, déclanchant du même coup des guerres d'intérêts.
Mallory remonte son fleuve à bord d'un ferry-boat en compagnie d'étranges personnages (remontée du fleuve de la mémoire vers la vérité des origines).
Mallory remonte son fleuve à bord d'un ferry-boat en compagnie d'étranges personnages (remontée du fleuve de la mémoire vers la vérité des origines).
14 nouvelles de 1960 à 1968 présentées par Robert Loui: Ballard est ,pour moi, un grand écrivain (de SF ou autre) ,créateur d’images fascinantes et crépusculaires comme le prouvent les textes qui suivent. « L'Homme subliminal » (1963) Remarquable dystopie sur une société d’ultra consommation. « L'Homme saturé » (1961) Un couple se délite . Etrange et pas SF « Treize pour le Centaure » (1962) Une histoire dickienne de manipulation d’un groupe par une réalité truquée. Très bon.« Chronopolis » (1960) Dystopie .Dictature portant sur la maîtrise du temps .Peu clair. « Fin de partie » (1963) Huis-clos étouffant entre un condamné et son bourreau. Peu SF mais réussi « Demain, dans un million d'années » (1966) Féminicide dans un contexte de space opera .Etrange et beau . « Le Jour de toujours » (1966) Etrange histoire sur une Terre qui ne tourne plus . Très beau et onirique .« Un assassin très comme il faut » (1961) Paradoxe temporel classique et bien mené « Le Vinci disparu » (1964) Un jeu sur l’histoire de la peinture et une légende religieuse . Plus du fantastique que de la SF. « Perte de temps » (1956) Variante sur « Le jour de la marmotte » « Le Géant noyé » (1964) Fable noire et ultraréaliste sur notre espèce destructrice « La Cage de sable » (1962) Superbe et mélancolique adieu à la conquête spatiale dans les ruines contaminées de Cap Canaveral« Les Statues qui chantent »( 1962) Art ,argent et folie . Une évocation à la « Sunset Boulevard » « Amour et napalm : export U.S.A. » (1968) De la guerre et ses images comme produit médiatique .Féroce et d’actualité . Un recueil de haut niveau.
James Graham Ballard est un de ces auteurs de la science-fiction dite "spéculative".
La science n'étant plus le nœud de l'intrigue, y est souvent négligée au profit d'une atmosphère d'étrange ou de fantastique.
Les 14 nouvelles qui composent ce recueil illustrent trois thématiques principales :
les rapports entre bourreaux et victimes, la recherche d'une dimension intérieure et la description de mondes plombés par des cataclysmes.
"L'homme subliminal", la première nouvelle du chapitre "oppressions subtiles", est la description d'une sorte de gavage psychologique utilisé dans une société de consommation devenue excessive.
Le deuxième texte, "L'homme saturé" décrit un mariage moderne, plus ou moins réaliste, qui augurerait du futur de la confrontation entre hommes et femmes.
Avec "Treize pour le centaure", J.G. Ballard imagine des effets cachés, sortes d'effets indésirables, du voyage dans l'espace.
"Chronopolis" voit s'opposer deux tyrannies et "Fin de partie" est un jeu cruel où l'interrogateur attend patiemment que le coupable présumé prenne conscience de sa possible innocence avant de prononcer sa sentence.
La nouvelle "Demain, dans un million d'années" ouvre une nouvelle partie intitulée "les plis du temps", bientôt suivie par "le jour de toujours", "Un assassin très comme il faut", "Le Vinci disparu" et "Perte de temps".
La troisième et dernière partie, "zones sinistrées" s'ouvre avec "le géant noyé" où l'auteur réinvente le voyage de Gulliver à Lilliput.
L'âge de l'espace est clos, pourtant son décor, dans "La cage de sable" réserve encore de la magie.
L'avant-dernière nouvelle, "Les statues qui chantent", appartient au cycle de "Vermilion Sands". L'auteur y imagine un paradis où le travail serait la dernière forme du loisir.
Dans le dernier texte du recueil, "Amour et napalm : export USA", le titre évocateur parle de lui-même. J.G. Ballard y est éloquent.
Au final, la collection "le livre d'or de la science fiction" nous offre, ici, un bon recueil.
Les textes sont, pour la plupart, de bons textes, intéressants et prenants.
Et même si J.G. Ballard est loin d'être mon auteur préféré dans ce genre de littérature, j'ai pourtant apprécié à leurs justes valeurs ces nouvelles bien écrites, imaginatives et originales.
La science n'étant plus le nœud de l'intrigue, y est souvent négligée au profit d'une atmosphère d'étrange ou de fantastique.
Les 14 nouvelles qui composent ce recueil illustrent trois thématiques principales :
les rapports entre bourreaux et victimes, la recherche d'une dimension intérieure et la description de mondes plombés par des cataclysmes.
"L'homme subliminal", la première nouvelle du chapitre "oppressions subtiles", est la description d'une sorte de gavage psychologique utilisé dans une société de consommation devenue excessive.
Le deuxième texte, "L'homme saturé" décrit un mariage moderne, plus ou moins réaliste, qui augurerait du futur de la confrontation entre hommes et femmes.
Avec "Treize pour le centaure", J.G. Ballard imagine des effets cachés, sortes d'effets indésirables, du voyage dans l'espace.
"Chronopolis" voit s'opposer deux tyrannies et "Fin de partie" est un jeu cruel où l'interrogateur attend patiemment que le coupable présumé prenne conscience de sa possible innocence avant de prononcer sa sentence.
La nouvelle "Demain, dans un million d'années" ouvre une nouvelle partie intitulée "les plis du temps", bientôt suivie par "le jour de toujours", "Un assassin très comme il faut", "Le Vinci disparu" et "Perte de temps".
La troisième et dernière partie, "zones sinistrées" s'ouvre avec "le géant noyé" où l'auteur réinvente le voyage de Gulliver à Lilliput.
L'âge de l'espace est clos, pourtant son décor, dans "La cage de sable" réserve encore de la magie.
L'avant-dernière nouvelle, "Les statues qui chantent", appartient au cycle de "Vermilion Sands". L'auteur y imagine un paradis où le travail serait la dernière forme du loisir.
Dans le dernier texte du recueil, "Amour et napalm : export USA", le titre évocateur parle de lui-même. J.G. Ballard y est éloquent.
Au final, la collection "le livre d'or de la science fiction" nous offre, ici, un bon recueil.
Les textes sont, pour la plupart, de bons textes, intéressants et prenants.
Et même si J.G. Ballard est loin d'être mon auteur préféré dans ce genre de littérature, j'ai pourtant apprécié à leurs justes valeurs ces nouvelles bien écrites, imaginatives et originales.
Je n'avais jamais entendu parler de Ballard avant de voir les excellentes adaptations cinématographiques de ses œuvres. Je parle de Crash, du formidable David Cronenberg, et de High Rise de Vincenzo Natali. J'étais donc curieux de me lire et j'ai mis la main sur ce recueil de nouvelles.
Sauf que voilà, de ce que j'en comprends, Ballard est le genre d'auteur qui a des "périodes". Crash et High Rise sont des livres du début des années 70. On y sent l'ère post-mai 68, guerre du Vietnam et tout ça. On y critique la société de spectacle, de consommation et de vide. Je connais.
Mais ce recueil regroupe plutôt des nouvelles écrites entre 1960 et 1968. L'auteur y dit lui-même que la plupart des nouvelles servent à dénoncer la nouvelle famille et les couples modernes et... Bon, en fait, je ne sais même pas de quoi il parle. Ces couples ont l'air d'être des familles nucléaires ce qu'il y a de plus typique alors, il dénonce quoi? Que la femme travaille? L'entrée de la télévision dans les foyers? Le malheur de l'homme qui doit faire une tâche ménagère de temps en temps?
Sincèrement aucune idée. Et j'ai l'impression que si je le savais, je trouverais probablement cela plutôt réactionnaire.
Mais bon, je pourrais apprécier une œuvre tout en manquant une clef de compréhension, sauf que chez Ballard, la science-fiction fait plus partie du décors que de l'intrigue. Le point central de chaque nouvelle, et sont ces couples un peu boiteux, aliénés par le système.
Par quoi, exactement?
Je ne sais pas.
Sauf que voilà, de ce que j'en comprends, Ballard est le genre d'auteur qui a des "périodes". Crash et High Rise sont des livres du début des années 70. On y sent l'ère post-mai 68, guerre du Vietnam et tout ça. On y critique la société de spectacle, de consommation et de vide. Je connais.
Mais ce recueil regroupe plutôt des nouvelles écrites entre 1960 et 1968. L'auteur y dit lui-même que la plupart des nouvelles servent à dénoncer la nouvelle famille et les couples modernes et... Bon, en fait, je ne sais même pas de quoi il parle. Ces couples ont l'air d'être des familles nucléaires ce qu'il y a de plus typique alors, il dénonce quoi? Que la femme travaille? L'entrée de la télévision dans les foyers? Le malheur de l'homme qui doit faire une tâche ménagère de temps en temps?
Sincèrement aucune idée. Et j'ai l'impression que si je le savais, je trouverais probablement cela plutôt réactionnaire.
Mais bon, je pourrais apprécier une œuvre tout en manquant une clef de compréhension, sauf que chez Ballard, la science-fiction fait plus partie du décors que de l'intrigue. Le point central de chaque nouvelle, et sont ces couples un peu boiteux, aliénés par le système.
Par quoi, exactement?
Je ne sais pas.
Un très bon moment de lecture.
Ballard maîtrise son sujet. Le suspense est bien mené, et monte peu à peu. Le lecteur attentif et un peu imaginatif (mais si peu) va vite anticiper et se figurer la fin. Mais, et c'est là un des génies de Ballard, la chute n'a que peu de sens. Ce qui importe, ce sont les émotions, le dégoût des valeurs, l'abjecte trajectoire de la société..Car on est à peine dans la SF, et totalement dans le fait de société. Cela sent davantage le fait divers que la fiction. Et c'est là que réside la grande force de Ballard.
Ce n'est pas le meilleur Ballard. Mais il se laisse lire et apporte son lot de cynisme et de pessimisme quant à la société et à l'enfance. La structure du récit est tout à fait convaincante et apporte ce petit élément impalpable qui fascine, qui captive le lecteur. Bien vu.
Ballard maîtrise son sujet. Le suspense est bien mené, et monte peu à peu. Le lecteur attentif et un peu imaginatif (mais si peu) va vite anticiper et se figurer la fin. Mais, et c'est là un des génies de Ballard, la chute n'a que peu de sens. Ce qui importe, ce sont les émotions, le dégoût des valeurs, l'abjecte trajectoire de la société..Car on est à peine dans la SF, et totalement dans le fait de société. Cela sent davantage le fait divers que la fiction. Et c'est là que réside la grande force de Ballard.
Ce n'est pas le meilleur Ballard. Mais il se laisse lire et apporte son lot de cynisme et de pessimisme quant à la société et à l'enfance. La structure du récit est tout à fait convaincante et apporte ce petit élément impalpable qui fascine, qui captive le lecteur. Bien vu.
Très très fort.
Je recommande cette centaine de pages à quiconque se pose des questions sur la société contemporaine.
J G Ballard devrait être étudié au lycée!
Je recommande cette centaine de pages à quiconque se pose des questions sur la société contemporaine.
J G Ballard devrait être étudié au lycée!
Paru en Angleterre en 1988 sous le titre "Running Wild", traduit une première fois en français sous le titre "Le massacre de Pangbourne" et réédité en France en 2013 sous le titre "Sauvagerie" aux Éditions Tristram , cette longue nouvelle de J. G. Ballard se révèle être toujours d'une remarquable actualité. Cette actualité "aggravée" interpelle puisque, en terme de société, rien ne semble s'être "arrangé" : laissant vertigineusement ouverte l'hypothèse de Ballard. Que ce soit en termes de rapports de classes, d'ouverture aux autres, d'éducation, de "dialogue intergénérationnel", tout s'est au contraire prodigieusement alourdi. L'occultation des "problèmes" est devenue la règle la plus commune d'une société qui n'ose même plus se regarder en face; même lorsqu'il s'agit de ses propres enfants. Préférant croire, probablement, que "Ce dont l'on ne parle pas, n'existe pas." et restera donc sans conséquence. Ballard envisage donc ici l'une de ces conséquences possibles : assez sinistre sans doute, mais si étrangement probable quand l'on y réfléchi.
Ballard ne nous prend pas par la main et ne nous donne pas toutes les clefs pour percer immédiatement les secrets de son roman. De courtes ellipses d'action et de nombreuses métaphores parsèment les pages, toujours écrites avec un grand talent, ce qui, loin de perdre le lecteur, le pousse au contraire à plonger plus profondément dans l'ouvrage, et à s'y investir émotionnellement et intellectuellement. Ajoutons que le roman, loin de proposer un début et une fin précise, est au contraire un épisode de la vie du héros, s'inscrivant dans une unité de lieu putrescente : la lagune tropicale. En résulte paradoxalement un sentiment à la fois d'étouffement et de sécurité, similaire à la sensation pour Kerans de se trouver dans un fœtus intellectuel et naturel, dont il ne s'échappera qu'à la fin du livre. Enfin, certaines scènes sont extraordinairement réussies, le talent d'écriture de l'écrivain s'alliant à des situations fantasmagoriques et des personnages comme issus du ventre même de l'Apocalypse (citons la plongée dans un Londres englouti sous les yeux d'un pillard fanatique).vLe Monde Englouti est donc assurément l'un des meilleurs ouvrages de Ballard, mais également un grand roman, qui se lit sur deux tableaux : celui concret d'une planète redevenant primitive, et celui abstrait et philosophique d'un esprit retrouvant ses origines premières.
Lien : https://www.babelio.com/livr..
Lien : https://www.babelio.com/livr..
Un réchauffement climatique imputable à des explosions solaires ( et non aux activités humaines.) a provoqué une énorme montée des eaux .
De ce fait et sous nos latitudes nous allons de lagunes tropicales en villes au trois quarts submergées .
Avec des personnages qui survivent grâce aux système D et grâce à une bonne dose de marginalité .
Le milieux naturel triomphe de la civilisation et les changements s'imposent aux personnages .. les contraignent .. bousculent leur vie intérieure, les marquent et les influencent. Il y a une tonalité très british qui colore les rapports entre les gens ,leurs façons de communiquer en particulier et leur vision du monde en général.
L'auteur livre un récit assez poétique , tranquillement rythmé et très réussis. Le personnage principal ( un biologiste ) se décidera à s'enfoncer dans le sud alors que c'est le mouvement contraire qui prévaut chez les gens moins curieux ou tout simplement doués de bon sens.
Cependant la plus grande partie du roman explore les conséquences d'un état de droit dégradé , mais la société demeure cependant fonctionnelle.
La population est très clairsemées . Dans le meilleur des cas les rivages des océans ont sombrés dans les profondeurs ou dans le meilleur des cas ,ils ont fini en lagune.
Certaines choses du passé sont toujours fonctionnelles mais les communautés humaines cannibalisent largement ce qui reste du passé .
Cette tonalité d’outre-manche sous un soleil de plomb est très agréable à mon humble avis. Il y a plus une mélancolie qui plane que une angoisse prégnante sur le futur de cet univers.
Néanmoins La tonalité post-apocalyptique traditionnelle n’est pas éludée et il y à de des groupes en maraude plus ou moins nuisibles qui arpente ce monde et quelquefois ils sont nuisibles en toute légalité.
L’univers est réussi et il est un personnage à lui tout seul . De l’eau et de la végétation impénétrable à perte de vue.
Un très bon roman.
De ce fait et sous nos latitudes nous allons de lagunes tropicales en villes au trois quarts submergées .
Avec des personnages qui survivent grâce aux système D et grâce à une bonne dose de marginalité .
Le milieux naturel triomphe de la civilisation et les changements s'imposent aux personnages .. les contraignent .. bousculent leur vie intérieure, les marquent et les influencent. Il y a une tonalité très british qui colore les rapports entre les gens ,leurs façons de communiquer en particulier et leur vision du monde en général.
L'auteur livre un récit assez poétique , tranquillement rythmé et très réussis. Le personnage principal ( un biologiste ) se décidera à s'enfoncer dans le sud alors que c'est le mouvement contraire qui prévaut chez les gens moins curieux ou tout simplement doués de bon sens.
Cependant la plus grande partie du roman explore les conséquences d'un état de droit dégradé , mais la société demeure cependant fonctionnelle.
La population est très clairsemées . Dans le meilleur des cas les rivages des océans ont sombrés dans les profondeurs ou dans le meilleur des cas ,ils ont fini en lagune.
Certaines choses du passé sont toujours fonctionnelles mais les communautés humaines cannibalisent largement ce qui reste du passé .
Cette tonalité d’outre-manche sous un soleil de plomb est très agréable à mon humble avis. Il y a plus une mélancolie qui plane que une angoisse prégnante sur le futur de cet univers.
Néanmoins La tonalité post-apocalyptique traditionnelle n’est pas éludée et il y à de des groupes en maraude plus ou moins nuisibles qui arpente ce monde et quelquefois ils sont nuisibles en toute légalité.
L’univers est réussi et il est un personnage à lui tout seul . De l’eau et de la végétation impénétrable à perte de vue.
Un très bon roman.
" Kerans leva les yeux sur ces vieilles têtes impassibles et comprit la peur bizarre qu'elles suscitaient: elles évoquaient les scènes terrifiantes des jungles des premiers temps du paléogène, à l'époque où l’apparition des mammifères domina le règne des reptiles, et il ressentit cette haine implacable qu'éprouvent les représentants d'une espèce biologique envers ceux d'une autre qui leu a usurpé la place. "
Roman de SF post-apocalyptique écrit par J.G Ballard au début des années 60. L'auteur est connu pour la biographie de sa prime jeunesse portée à l'écran par S. Spielberg dans le film Empire of the Sun et pour avoir publié entre autres la série des Quatre catastrophes* ayant pour scène commune la planète terre dévastée par une catastrophe écologique. Ici, l'évolution du Soleil a pris une course telle que la température du globe est tellement montée que le terres émergées se sont transformées en marécages et jungles immenses.
++++++++++++++++++++++++++++++++
Tentative de résumé.
Quelque part dans le futur, sur Terre, la vie est devenue infernale. Avec un Soleil dilaté, l’augmentation de la température du globe a entrainé un cataclysme écologique, provoquant la fonte des glaciers, la débâcle violente des fleuves, l'accroissement des jungles, l'extension des marais et mangroves. Et alors que les villes s'enlisent dans les vases des marécages brûlants de soleil, les populations, toujours plus décimées par de nouvelles infections, émigrent toujours plus vers les pôles.
Pourtant, à la frontière ténue entre l'eau et la forêt, à l'ornière du monde des sauriens renaissants, quelques hommes stationnent dans les villes envasées dont seuls les plus robustes tours osent encore se dresser sur la surface des lagunes. Militaires et scientifiques tentent de comprendre, de retenir vainement l'inéluctable, alors qu'ils peuvent être tous partagés entre le désir de partir, rester ou s'enfoncer davantage dans la jungle. Car le soleil tape sur les têtes et les esprits.
Dans un huis clos aqueux, la solitude est préférable à la compagnie, car tout autre peut basculer dans la folie, car toute rencontre avec d'autres humains peut se transformer en danger. Ainsi, après le départ des militaires, lorsque les pirates arrivent, c'est une autre logique qui se met en place, c'est un cauchemar qui s'installe.
Lorsque le monde n'est plus assez accueillant pour les humains, le genre humain cesse d'être.
++++++++++++++++++++++++++++++++
Quelque part entre Apolypse Now et Huis Clos, on ressent un malaise continue à la lecture de ce roman définitivement apocalyptique. L'auteur met en scène des personnages bigarrés dans une cocotte minute, qui après avoir longtemps sifflée finit par exploser. Même dans un espace ouvert, on peut ressentir cette suffocation claustrophobique qui accompagne l'occupation d'un lieu par des personnalités et situations oppressantes.
Et lorsque le vide devient moins oppressant que la présence d'autrui, la fuite dans la jungle devient l'ultime refuge.
Lien : http://dedicated-monkeys.blo..
Au début, difficile de s'attacher à ce roman. On ne sait pas très bien où on est, ce qui se passe, à part que le personnage principal, Kerans, semble faire partie d'une unité d'exploration scientifique. Peu à peu, on comprend que nous sommes sur la planète qui se modifie lentement.
Pendant tout le roman ou presque, nous suivrons l'histoire dans des paysages de jungles aux allures d'enfer, où la nature reprend ses droits. Comment l'humanité va-t'elle survivre à ça ?
La suite sur mon blog !
Lien : http://parchmentsha.blogspot..
Pendant tout le roman ou presque, nous suivrons l'histoire dans des paysages de jungles aux allures d'enfer, où la nature reprend ses droits. Comment l'humanité va-t'elle survivre à ça ?
La suite sur mon blog !
Lien : http://parchmentsha.blogspot..
Grande fan de science-fiction et particulièrement des romans qui se déroulent dans un décor post-apocalyptique, je suis assez déçue.
Si j’ai apprécié l’atmosphère oppressante, suffocante et lourde créée par Ballard, le manque d’action et l’introspection excessive des personnages ralentissent le rythme du récit.
Le gros point négatif pour moi a été le côté raciste et sexiste de ce roman. J’ai du faire preuve de persévérance pour terminer ce livre, bien dommage car j’avais vraiment de grandes attentes.
Si j’ai apprécié l’atmosphère oppressante, suffocante et lourde créée par Ballard, le manque d’action et l’introspection excessive des personnages ralentissent le rythme du récit.
Le gros point négatif pour moi a été le côté raciste et sexiste de ce roman. J’ai du faire preuve de persévérance pour terminer ce livre, bien dommage car j’avais vraiment de grandes attentes.
Amoureux des décors post-apocalyptiques, bienvenue ! Ici, le monde a subit ses premières transformations 60 à 70 ans en arrière : une élévation progressive des températures a rendu les zones tropicales inhabitables, les zones tempérées tropicales, ainsi de suite, ne laissant bientôt plus que les pôles à peu près "vivables".
Des expéditions sont organisées pour rendre compte de l'état des villes : certains envisagent la réoccupation de certains sites sous une dizaine d'années. Kerans est un des membres civils accompagnant les militaires : il est le médecin officiel de l'unité et dirige la station d'essai. Voilà des mois qu'ils stagnent dans la partie émergée de ce qui fut jadis une capitale. Au moment de partir, une angoissse le tenaille : où est sa place ? Doit-il retourner vers le nord avec le reste de l'unité ? Certains se posent les mêmes questions, ressentent l'appel du sud. La folie, le sens de la vie, l'inné : tout se mélange dans la châleur tropicale, visions d'une humanité en plein déclin.
J'ai adoré accompagner l'auteur dans les dédales de cette cité engloutie. L'auteur nous plonge dans un tableau de Max Ernst, on en ressort à la dernière page.
Des expéditions sont organisées pour rendre compte de l'état des villes : certains envisagent la réoccupation de certains sites sous une dizaine d'années. Kerans est un des membres civils accompagnant les militaires : il est le médecin officiel de l'unité et dirige la station d'essai. Voilà des mois qu'ils stagnent dans la partie émergée de ce qui fut jadis une capitale. Au moment de partir, une angoissse le tenaille : où est sa place ? Doit-il retourner vers le nord avec le reste de l'unité ? Certains se posent les mêmes questions, ressentent l'appel du sud. La folie, le sens de la vie, l'inné : tout se mélange dans la châleur tropicale, visions d'une humanité en plein déclin.
J'ai adoré accompagner l'auteur dans les dédales de cette cité engloutie. L'auteur nous plonge dans un tableau de Max Ernst, on en ressort à la dernière page.
Je n’avais pas souvenir chez Ballard d’une écriture si froide. L’environnement qu’il décrit dans Le monde englouti est d’une grande précision scientifique mais l’analyse psychologique des caractères m’a semblée assez superficielle. Comme s’il avait prit de la hauteur par rapport aux héros de l’histoire. Peut-être parce que ces derniers n’en sont point.
L’humanité régresse et les peurs ancestrales s’emparent des esprits. Les rêves que font les humains ne sont peut être que le premier pas d’un processus récapitulant à l’envers chacune des étapes de l’évolution humaine.
Vers où cela pourrait-il mener ? un réelle extinction de l’espèce ou une nouvelle évolution de l’humanité ?
Lien : http://www.valunivers.fr/201..
L’humanité régresse et les peurs ancestrales s’emparent des esprits. Les rêves que font les humains ne sont peut être que le premier pas d’un processus récapitulant à l’envers chacune des étapes de l’évolution humaine.
Vers où cela pourrait-il mener ? un réelle extinction de l’espèce ou une nouvelle évolution de l’humanité ?
Lien : http://www.valunivers.fr/201..
Un roman d'anticipation plutôt original, on est tout de suite captivé par l'ambiance dans laquelle l'auteur place son histoire. Sur cette Terre pratiquement immergée par les océans, on retrouve les ruines de notre civilisation. Ce qui m'a le plus marqué, c'est l'écriture de Ballard, plus particulièrement ses descriptions : très riches et très imagées.
Kerans, biologiste, vit seul au dernier étage du Ritz, à Londres. La Terre, après avoir subi de violentes radiations solaires, a vu sa température monter de façon exponentielle et le niveau des eaux monter. Des lagunes étouffantes remplies de crocodiles et autres créatures marécageuses ou mutantes recouvrent la planète. Kerans va être aux prises avec un flibustier sanguinaire, la folie des derniers hommes et sa condition d’être humain.
C’est un roman un peu pénible à lire. L’univers décrit est déplaisant, les personnages apathiques et antipathiques, l’intrigue désespérante...
Lien : http://puchkinalit.tumblr.com/
C’est un roman un peu pénible à lire. L’univers décrit est déplaisant, les personnages apathiques et antipathiques, l’intrigue désespérante...
Lien : http://puchkinalit.tumblr.com/
-L'histoire-
Un futur proche, suite à un enchainement de catastrophes, de grands bouleversements climatiques ont changé radicalement le visage de la Terre. Augmentation de la température et montée des eaux ont transformé le monde. Dans un Londres abandonné et changé en lagune tropicale, quelques personnes, scientifiques et militaires restent encore pour rendre compte des changements. Mais alors qu’ils doivent abandonner la ville derrière eux, fuyant les orages violents et la nouvelle montée des températures qui s’annonce, certains décident de rester, poussé par un instinct enfoui au fond d’eux et venu des méandres du temps.
-Mon avis-
Que dire sur ce roman. Le principe de départ m’avait attiré, une apocalypse, de grands changements climatiques, des personnes qui cherchent à survivre dans un environnement hostile. Le 4e de couv était alléchante. Et le roman commence, l’atmosphère est lourde, oppressante, étouffante, pesante, suffocante, écrasante… De ce côté, rien à dire, l’atmosphère est bien rendu, servie par une écriture sans style et très distante on ressent cette atmosphère à chaque page. C’est peut-être là le problème, on ressent tellement cette atmosphère qu’elle finit par dégouliner des pages, ramper hors des mots et envahir le lecteur. Et chaque page devient un peu plus lourde, un peu plus oppressante.
Un roman d’ambiance alors ? Peut-être, mais uniquement, car le plus gros problème pour moi, c’est qu’il ne se passe rien, les personnages, creux au possible, se laissent porter par cette ambiance et subissent avec le lecteur l’ennui profond de ce monde englouti. Pas un instant je n’ai été intéressé par eux, et jamais je n’ai ressenti la moindre empathie à leur égard. Du coup, lorsqu’il se passe enfin quelque chose à 50 pages de la fin, lorsqu’enfin les personnages semblent sortirent de leur torpeur, je n’ai pas réussi à sortir de la mienne et je ne me suis pas du tout senti concerné par leur sort.
Rarement j’ai ressenti autant d’ennui à la lecture d’un livre, c’est vraiment la première fois depuis que je n’ai plus de lectures imposées par l’école/collège/lycée que je peine autant à finir un livre. J’ai plusieurs fois eu envie d’arrêter ma lecture et ne l’ai poursuivie que pour être sûr que je ne ratais rien.
Très grosse déception pour moi ce premier essai avec JG Ballard. Je pense attendre un moment avant de m’y remettre.
Lien : http://imaginelec.blogspot.f..
Un futur proche, suite à un enchainement de catastrophes, de grands bouleversements climatiques ont changé radicalement le visage de la Terre. Augmentation de la température et montée des eaux ont transformé le monde. Dans un Londres abandonné et changé en lagune tropicale, quelques personnes, scientifiques et militaires restent encore pour rendre compte des changements. Mais alors qu’ils doivent abandonner la ville derrière eux, fuyant les orages violents et la nouvelle montée des températures qui s’annonce, certains décident de rester, poussé par un instinct enfoui au fond d’eux et venu des méandres du temps.
-Mon avis-
Que dire sur ce roman. Le principe de départ m’avait attiré, une apocalypse, de grands changements climatiques, des personnes qui cherchent à survivre dans un environnement hostile. Le 4e de couv était alléchante. Et le roman commence, l’atmosphère est lourde, oppressante, étouffante, pesante, suffocante, écrasante… De ce côté, rien à dire, l’atmosphère est bien rendu, servie par une écriture sans style et très distante on ressent cette atmosphère à chaque page. C’est peut-être là le problème, on ressent tellement cette atmosphère qu’elle finit par dégouliner des pages, ramper hors des mots et envahir le lecteur. Et chaque page devient un peu plus lourde, un peu plus oppressante.
Un roman d’ambiance alors ? Peut-être, mais uniquement, car le plus gros problème pour moi, c’est qu’il ne se passe rien, les personnages, creux au possible, se laissent porter par cette ambiance et subissent avec le lecteur l’ennui profond de ce monde englouti. Pas un instant je n’ai été intéressé par eux, et jamais je n’ai ressenti la moindre empathie à leur égard. Du coup, lorsqu’il se passe enfin quelque chose à 50 pages de la fin, lorsqu’enfin les personnages semblent sortirent de leur torpeur, je n’ai pas réussi à sortir de la mienne et je ne me suis pas du tout senti concerné par leur sort.
Rarement j’ai ressenti autant d’ennui à la lecture d’un livre, c’est vraiment la première fois depuis que je n’ai plus de lectures imposées par l’école/collège/lycée que je peine autant à finir un livre. J’ai plusieurs fois eu envie d’arrêter ma lecture et ne l’ai poursuivie que pour être sûr que je ne ratais rien.
Très grosse déception pour moi ce premier essai avec JG Ballard. Je pense attendre un moment avant de m’y remettre.
Lien : http://imaginelec.blogspot.f..
Cette première rencontre avec J.G. Ballard s'est malheureusement révélée un rien décevante. Et pourtant, l'argument avait de quoi me séduire : une ancienne métropole peu à peu submergée par la montée des eaux et envahie par une végétation géante aussi bien qu'excentrique, aux apparences antédiluviennes, abritant une faune dangereuse. Et là, quelques humains, parmi lesquels Kerans, le héros, qui tentent plus ou moins d'étudier ces nouveaux phénomènes climatiques auxquels est soumis leur monde.
On pourrait penser, a priori, que le roman tient de la veine écologique de la science-fiction. Ce n'est pas vraiment le cas, mais peu importe, après tout. Le récit prend en revanche une tournure clairement onirique, à grands renforts de descriptions et de métaphores tout aussi poétiques que, disons-le tout net, psychanalytiques. La présence des ruines omniprésentes, de la végétation envahissante, de l'eau inquiétante, contribuent à créer une ambiance à la fois mystérieuse, chatoyante mais délétère, impressionnante mais étouffante, et, au final, extrêmement morbide. Les rêves et l'environnement prennent le dessus sur les humains, les renvoyant, d'abord dans leur sommeil (puis, plus tard, également à l'état de veille), à une nature terriblement attirante en même temps que repoussante et à une évolution à rebours, qui les ramèneraient aux premiers temps du monde. Mais si j'ai été sensible à cette atmosphère de fin du monde, malgré un style que j'ai parfois trouvé un rien emphatique, il m'a semblé que le roman ne développait pas suffisamment le thème principal - cette régression à la fois géologique et mentale -, bref, qu'il n'allait pas au terme de son parcours. Non pas que la fin ouverte m'ait dérangée, mais il m'a indéniablement manqué quelque chose ; peut-être une réflexion un peu plus poussée sur le sujet.
M'ont aussi un peu ennuyée les chapitres avec le personnage très peu fréquentable de Strangman, sorte de pirate avec des penchants sadiques, qui a évidemment toute sa place dans ce monde apocalyptique. Mais le texte finit alors par se perdre dans la description de ses allées et venues et celle, franchement longue, des sévices (bon, rien de complètement insupportable, que les âmes sensibles se rassurent) qu'il inflige à Kerans. Il m'a semblé également que la psychologie des personnages aurait gagnée à être davantage développé et que, peut-être, une narration à la première personne aurait enrichi le roman.
Du coup, j'ai tout de même envie de tenter La forêt de cristal mais je crains de me heurter aux mêmes écueils. Ce qui est certain, c'est que je ne m'arrêterai pas là dans ma fréquentation de J.G. Ballard. I.G.H. et Vermilion Sands restent à coup sûr dans ma ligne de mire.
On pourrait penser, a priori, que le roman tient de la veine écologique de la science-fiction. Ce n'est pas vraiment le cas, mais peu importe, après tout. Le récit prend en revanche une tournure clairement onirique, à grands renforts de descriptions et de métaphores tout aussi poétiques que, disons-le tout net, psychanalytiques. La présence des ruines omniprésentes, de la végétation envahissante, de l'eau inquiétante, contribuent à créer une ambiance à la fois mystérieuse, chatoyante mais délétère, impressionnante mais étouffante, et, au final, extrêmement morbide. Les rêves et l'environnement prennent le dessus sur les humains, les renvoyant, d'abord dans leur sommeil (puis, plus tard, également à l'état de veille), à une nature terriblement attirante en même temps que repoussante et à une évolution à rebours, qui les ramèneraient aux premiers temps du monde. Mais si j'ai été sensible à cette atmosphère de fin du monde, malgré un style que j'ai parfois trouvé un rien emphatique, il m'a semblé que le roman ne développait pas suffisamment le thème principal - cette régression à la fois géologique et mentale -, bref, qu'il n'allait pas au terme de son parcours. Non pas que la fin ouverte m'ait dérangée, mais il m'a indéniablement manqué quelque chose ; peut-être une réflexion un peu plus poussée sur le sujet.
M'ont aussi un peu ennuyée les chapitres avec le personnage très peu fréquentable de Strangman, sorte de pirate avec des penchants sadiques, qui a évidemment toute sa place dans ce monde apocalyptique. Mais le texte finit alors par se perdre dans la description de ses allées et venues et celle, franchement longue, des sévices (bon, rien de complètement insupportable, que les âmes sensibles se rassurent) qu'il inflige à Kerans. Il m'a semblé également que la psychologie des personnages aurait gagnée à être davantage développé et que, peut-être, une narration à la première personne aurait enrichi le roman.
Du coup, j'ai tout de même envie de tenter La forêt de cristal mais je crains de me heurter aux mêmes écueils. Ce qui est certain, c'est que je ne m'arrêterai pas là dans ma fréquentation de J.G. Ballard. I.G.H. et Vermilion Sands restent à coup sûr dans ma ligne de mire.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur
Auteurs proches de James Graham Ballard
Lecteurs de James Graham Ballard Voir plus
Quiz
Voir plus
La pluie comme on l'aime
Quel auteur attend "La pluie avant qu'elle tombe"?
Olivier Norek
Jonathan Coe
10 questions
204 lecteurs ont répondu
Créer un quiz sur cet auteur204 lecteurs ont répondu