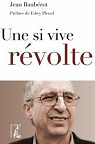Nationalité : France
Né(e) à : Châteauponsac, Haute-Vienne , le 26/07/1941
Ajouter des informations
Né(e) à : Châteauponsac, Haute-Vienne , le 26/07/1941
Biographie :
Jean Baubérot, né le 26 juillet 1941 à Châteauponsac (Haute-Vienne), est un historien et sociologue français spécialiste de la sociologie des religions et fondateur de la sociologie de la laïcité.
Après avoir occupé la chaire d'« Histoire et sociologie du protestantisme » (1978-1990), il est titulaire de la chaire d'« Histoire et sociologie de la laïcité » (depuis 1991) à l’École pratique des hautes études dont il est le président d'honneur. Il a écrit vingt ouvrages, dont un roman historique. Il est le coauteur d'une Déclaration internationale sur la laïcité signée par 250 universitaires de 30 pays. Il fut conseiller de Ségolène Royal, ministre déléguée à l'Enseignement scolaire.
Jean Baubérot, né le 26 juillet 1941 à Châteauponsac (Haute-Vienne), est un historien et sociologue français spécialiste de la sociologie des religions et fondateur de la sociologie de la laïcité.
Après avoir occupé la chaire d'« Histoire et sociologie du protestantisme » (1978-1990), il est titulaire de la chaire d'« Histoire et sociologie de la laïcité » (depuis 1991) à l’École pratique des hautes études dont il est le président d'honneur. Il a écrit vingt ouvrages, dont un roman historique. Il est le coauteur d'une Déclaration internationale sur la laïcité signée par 250 universitaires de 30 pays. Il fut conseiller de Ségolène Royal, ministre déléguée à l'Enseignement scolaire.
Ajouter des informations
étiquettes
Videos et interviews (8)
Voir plusAjouter une vidéo
Jean Baubérot et Laurent Bouvet : " La laïcité est-elle une et indivisible ?" .
"La laïcité est-elle une et indivisible ?"Débat avec Jean Baubérot et Laurent Bouvet https://www.franceculture.fr/emissions/du-grain-a-moudre/la-laicite-est-elle-une-et-indivisible
"La laïcité est-elle une et indivisible ?"Débat avec Jean Baubérot et Laurent Bouvet https://www.franceculture.fr/emissions/du-grain-a-moudre/la-laicite-est-elle-une-et-indivisible
Citations et extraits (22)
Voir plus
Ajouter une citation
Les officiers et divers administrateurs coloniaux se sont, en quelque sorte, progressivement inspirés du modèle concordataire en faisant passer « le culte musulman » en Algérie sous la dépendance financière des autorités coloniales et, de ce fait, ils ont instauré une forme de Concordat avec l’islam qui ne disait simplement pas son nom.
Certes, depuis 1998, le Centre d’action laïque (CAL) a formulé une distinction essentielle entre laïcité politique et laïcité philosophique.
La première se rapproche fortement de la laïcité à la française : elle implique « l’autonomie des pouvoirs publics » vis-à-vis des Églises et des groupements philosophiques, quels qu’ils soient, et « la garantie de l’autonomie de la sphère privée de tous les citoyens quant à leurs conceptions philosophiques et religieuses ».
La seconde implique quelque chose de plus : l’adhésion à une conception de la vie que recouvre le terme « humanisme » et qui se caractérise par « une éthique dont les fondements sont étrangers à tout principe divin ou surnaturel », tout en comportant certaines valeurs positives comme l’égalité, l’émancipation, la quête du bonheur, la solidarité… On s’aperçoit que la laïcité politique inclut les croyants (« c’est une conception non agressive à laquelle peuvent adhérer les croyants de n’importe quelle religion ainsi que les incroyants ») alors que la laïcité philosophique les exclut, car cette dernière entend promouvoir des hommes et des femmes se référant au « libre examen » et à l’« humanisme », et non « à un texte sacré, à un catéchisme ou à quelque autorité absolue » : or, dans le sens qu’utilise le CAL, « l’humaniste fait l’hypothèse ou a la conviction que l’homme est sa propre référence et non qu’il doit fonder ses valeurs sur une transcendance extérieure à l’humanité, qui le précède et le dépasse ».
La première se rapproche fortement de la laïcité à la française : elle implique « l’autonomie des pouvoirs publics » vis-à-vis des Églises et des groupements philosophiques, quels qu’ils soient, et « la garantie de l’autonomie de la sphère privée de tous les citoyens quant à leurs conceptions philosophiques et religieuses ».
La seconde implique quelque chose de plus : l’adhésion à une conception de la vie que recouvre le terme « humanisme » et qui se caractérise par « une éthique dont les fondements sont étrangers à tout principe divin ou surnaturel », tout en comportant certaines valeurs positives comme l’égalité, l’émancipation, la quête du bonheur, la solidarité… On s’aperçoit que la laïcité politique inclut les croyants (« c’est une conception non agressive à laquelle peuvent adhérer les croyants de n’importe quelle religion ainsi que les incroyants ») alors que la laïcité philosophique les exclut, car cette dernière entend promouvoir des hommes et des femmes se référant au « libre examen » et à l’« humanisme », et non « à un texte sacré, à un catéchisme ou à quelque autorité absolue » : or, dans le sens qu’utilise le CAL, « l’humaniste fait l’hypothèse ou a la conviction que l’homme est sa propre référence et non qu’il doit fonder ses valeurs sur une transcendance extérieure à l’humanité, qui le précède et le dépasse ».
Dans le meilleur des cas, dans les dénonciations faites, c'est la répartition dite du « pâté de cheval et d'alouette » ! Ce qui est alors d'abord en jeu, c'est l'écœurant conformisme de ceux qui passent leur temps à fustiger les minoritaires et les exclus, mais ne sont que bassesse et obséquiosité à l’égard des dominants
Au XVIIIe siècle, les pensées prélaïques se multiplient. Le juriste hollandais Grotius postule l’existence d’un contrat initial par lequel les humains ont renoncé à l’état de nature ; le droit naturel émane avant tout de la sociabilité humaine et vaudrait même si Dieu n’existait pas.
Les Traités de Westphalie se situent dans cette perspective. Selon Hobbes, observateur des troubles politico-religieux en Angleterre, pour échapper à l’état de guerre et de crainte mutuelle, les humains donnent un pouvoir artificiel, mais illimité au Prince. La fragmentation du christianisme, la diversité des opinions qui en résulte mettent fin à la distinction entre pouvoir temporel et pouvoir spirituel : le Léviathan est désormais le seul souverain.
Spinoza prône la « liberté de penser » et affirme que « l’exercice du culte religieux et les formes extérieures de la piété doivent se régler sur la paix et l’utilité de l’État », source du droit civil et du droit sacré (Traité théologico-politique, 1670). Face aux persécutions liées à la révocation de l’édit de Nantes, Bayle récuse toute contrainte en religion et, aspect novateur en Europe, estime que l’athéisme ne nuit pas au lien social.
Les Traités de Westphalie se situent dans cette perspective. Selon Hobbes, observateur des troubles politico-religieux en Angleterre, pour échapper à l’état de guerre et de crainte mutuelle, les humains donnent un pouvoir artificiel, mais illimité au Prince. La fragmentation du christianisme, la diversité des opinions qui en résulte mettent fin à la distinction entre pouvoir temporel et pouvoir spirituel : le Léviathan est désormais le seul souverain.
Spinoza prône la « liberté de penser » et affirme que « l’exercice du culte religieux et les formes extérieures de la piété doivent se régler sur la paix et l’utilité de l’État », source du droit civil et du droit sacré (Traité théologico-politique, 1670). Face aux persécutions liées à la révocation de l’édit de Nantes, Bayle récuse toute contrainte en religion et, aspect novateur en Europe, estime que l’athéisme ne nuit pas au lien social.
Mais que faut-il entendre par « laïcité » ? Pour son premier théoricien, Ferdinand Buisson, celle-ci résulte du « lent travail des siècles » où les « diverses fonctions de la vie publique » se sont « peu à peu distinguées, séparées les unes des autres, affranchies de la tutelle étroite de l’Église ». Ce processus relève d’une sorte de « préhistoire » de la laïcité. Jusqu’à 1789, en effet, le clergé conserve « un droit de surveillance, de contrôle et de veto » sur les différents pouvoirs et « l’ensemble de la vie publique et privée ». La Révolution française constitue donc le point de départ de l’histoire de la laïcité en France. Avec elle apparaît « l’idée de l’État laïque, neutre entre tous les cultes, indépendant de tous les clergés, dégagé de toute conception théologique ». Cela permet « l’égalité de tous les Français devant la loi, la liberté de tous les cultes, la constitution de l’état civil et du mariage civil et l’exercice de tous les droits civils, désormais assurés en dehors de toute conviction religieuse ».
Jaurès porte alors l’estocade : historiquement, « la France n’est pas schismatique, elle est révolutionnaire ». Au xvie siècle, quand « ce grand mouvement de la Réforme » grandit en Allemagne, en Angleterre, en Hollande, la France ne suit pas : était-elle « au-dessous de la Réforme » ?
Au contraire : « C’est parce que notre génie français avait cette merveilleuse audace d’espérance et d’affirmation de la pensée libre, qu’il s’est réservé devant la Réforme afin de se conserver tout entier pour la Révolution.
Au contraire : « C’est parce que notre génie français avait cette merveilleuse audace d’espérance et d’affirmation de la pensée libre, qu’il s’est réservé devant la Réforme afin de se conserver tout entier pour la Révolution.
Table des matières
Chapitre premier – Réforme et protestantisme
Les trois caractéristiques de la Réforme
Chapitre II – La formation du protestantisme
Le luthéranisme
En Suisse, d’autres protestantismes
La création des Églises réformées en France
L’Angleterre ou un protestantisme tempéré
« Nouvelle religion », nouvelle culture
Chapitre III – La modernité protestante
Les Provinces-Unies et la création d’une société pluraliste
Modernité et révolution en Angleterre
Le protestantisme en Amérique anglaise
Puritanisme et capitalisme
Chapitre IV – Difficultés et renouveau
La guerre de Trente ans et ses conséquences
Orthodoxie et piétisme
En France, de l’Édit de Nantes à sa révocation
Chapitre V – Des Lumières aux Réveils
Lumières et néopiétisme
Les Réveils du XVIIIe siècle
Évolution des Réveils au XIXe siècle
Chapitre VI – Le protestantisme contemporain
L’expansion par les missions et ses suites au XXe siècle
Pluralisme et laïcisation
Critique biblique, libéralisme, christianisme social
Recherches théologiques et essor du courant évangélique
Développement de l’œcuménisme
Nouveaux défis
Chapitre premier – Réforme et protestantisme
Les trois caractéristiques de la Réforme
Chapitre II – La formation du protestantisme
Le luthéranisme
En Suisse, d’autres protestantismes
La création des Églises réformées en France
L’Angleterre ou un protestantisme tempéré
« Nouvelle religion », nouvelle culture
Chapitre III – La modernité protestante
Les Provinces-Unies et la création d’une société pluraliste
Modernité et révolution en Angleterre
Le protestantisme en Amérique anglaise
Puritanisme et capitalisme
Chapitre IV – Difficultés et renouveau
La guerre de Trente ans et ses conséquences
Orthodoxie et piétisme
En France, de l’Édit de Nantes à sa révocation
Chapitre V – Des Lumières aux Réveils
Lumières et néopiétisme
Les Réveils du XVIIIe siècle
Évolution des Réveils au XIXe siècle
Chapitre VI – Le protestantisme contemporain
L’expansion par les missions et ses suites au XXe siècle
Pluralisme et laïcisation
Critique biblique, libéralisme, christianisme social
Recherches théologiques et essor du courant évangélique
Développement de l’œcuménisme
Nouveaux défis
"Gratuite, laïque et obligatoire", telle serait l’école depuis Jules Ferry. L’affirmation est fausse. L’instruction est obligatoire, l’école publique est gratuite et laïque. Précision capitale : jamais la liberté de l’enseignement n’a été abolie ni même le droit d’une instruction à domicile. Cependant un certain lien unit obligation et laïcité. Ferry s’est demandé comment respecter la liberté de conscience quand on rend l’instruction obligatoire. La solution fut la création de l’école publique laïque, une des réformes les plus fondamentales réalisées de façon démocratique en France.
Tenter de se faire historien de soi-même dans le souci non pas de l’exceptionnel, mais du commun : ce qui se partage, ce qui s’échange, ce qui rapproche
Hérétique face aux politiciens et aux adultes, englués dans la guerre d’Algérie ; hérétique face à la distribution des rôles entre garçons et filles ; hérétique, enfin, face au nouveau pasteur et au conseil presbytéral, ensemble de laïcs qui, en protestantisme, dirigent une paroisse
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur
Auteurs proches de Jean Baubérot
Lecteurs de Jean Baubérot (128)Voir plus
Quiz
Voir plus
Quand les enquêteurs parlent...
— Il s’en est fallu d’un cheveu ! Sans son regard rapide, sans ses yeux de lynx, XXX XXXX, en ce moment, ne serait peut-être plus de ce monde ! Quel désastre pour l’humanité ! Sans parler de vous, Hastings ! Qu’auriez-vous fait sans moi dans la vie, mon pauvre ami ? Je vous félicite de m’avoir encore à vos côtés ! Vous-même d’ailleurs, auriez pu être tué. Mais cela, au moins, ce ne serait pas un deuil national ! Héros de Agatha Christie
Arsène Lupin
Hercule Poirot
Rouletabille
Sherlock Holmes
13 questions
67 lecteurs ont répondu
Thèmes :
romans policiers et polars
, humour
, enquêteursCréer un quiz sur cet auteur67 lecteurs ont répondu