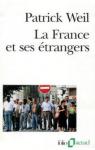Né(e) à : Neuilly-sur-Seine , le 14/10/1956
Patrick Weil est un historien et politologue français.
Ancien élève de l'ESSEC (1980), docteur en sciences politiques, directeur de recherche au CNRS, au Centre d’histoire sociale du XXe siècle de l'Université de Paris I, il a travaillé sur l'histoire de l'immigration en France. Il a notamment reçu en 1992 le prix de recherche de l'Assemblée nationale pour son ouvrage "La France et ses étrangers".
Il a exercé la fonction de chef de cabinet du secrétariat d'État aux immigrés en 1981 et 1982, fait partie de la commission Stasi, du Haut Conseil à l'intégration, ainsi que des instances de la Cité nationale de l'histoire de l'immigration dont il a démissionné le 18 mai 2007, avec sept autres universitaires, pour protester contre l'instauration par Nicolas Sarkozy du ministère de l'Immigration et de l'Identité nationale. Il avait auparavant, lors de l'élection présidentielle, signé un appel à soutenir la candidate du PS, Ségolène Royal.
Il appuie notamment l'interdiction du port du voile dans les écoles en France, tout en regrettant que cette interdiction ait été la seule proposition retenue du rapport Stasi.
Il défend par ailleurs la modification du système des grandes écoles par l'instauration d'un système de recrutement des étudiants utilisé au Texas : l'instauration d'une admission de droit dans ces grandes écoles pour les 10% des lycéens les mieux placés dans les résultats du baccalauréat.
Il est également a l'initiative de Bibliothèques Sans Frontières et en est le Président depuis sa création en décembre 2006. Cette ONG française, à but non lucratif, est également présente en Belgique, au Mexique, aux États-Unis et au Portugal. Elle vise à faciliter l'accès au savoir dans les pays en voie de développement par l’appui au développement des fonds des bibliothèques, des écoles et des universités, la formation de documentalistes, l’informatisation de centres documentaires et la structuration de réseaux de bibliothèques.
Avec Patrick Weill, directeur de recherche au CNRS. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages de référence, dont La France et ses étrangers (Folio), Qu'est-ce qu'un Français ? (Grasset) et le sens de la République (Grasset). La laïcité, qui permet aux croyants et non croyants, la liberté de conscience et l'égalité des droits, est au coeur de l'identité républicaine. Mais la majorité des Français ne sont pas à même de la définir. Ils ne sont pas capables d'expliquer à leurs enfants, à leurs amis, à leurs collègues, comment elle vit en droit et en pratique. Patrick Weil, dans son ouvrage, de la Laïcité, offre pour tous publics, une définition et une explication fondées sur le droit et sur l'histoire. Son appropriation par le plus grand nombre des citoyens est le premier instrument de sa défense efficace et légitime. Avec le soutien de la Région Centre Val de Loire et en partenariat avec la Maison de Bégon et la ville de Blois
Une seule certitude réunissait les adversaires : la France a une immigration, mais pas de politique pour la gérer. Des textes épars, des pratiques gouvernementales de circonstance, des administrations incompétentes. Rien qui puisse ressembler à une stratégie cohérente et continue.
Le premier contentieux devant le Conseil d’État portant sur cette définition, tardif, a concerné les dévots de « Krisna ». Le Conseil d’État a constaté l’absence de définition légale du culte. Le juge s’est référé, si l’on se fit aux conclusions du président Bacquet, commissaire du gouvernement sur l’arrêt du 14 mai 1982 « Association internationale pour la conscience de Krisna » (Rec., p. 179 et note C. Debouy et P. Boinot, D., 1982, J. 516), à la notion commune du culte : « L’hommage rendu selon certaines pratiques à une divinité ou à un saint personnage. »
Selon Guillaume Cuchet, la « bonne mort »catholique « suppose au minimum la réception des derniers sacrements, accompagnée si possible d’une indulgence plénière et des prières de l’Église. En amont, elle se prépare conformément à l’enseignement d’une longue tradition. Pour les meilleurs, elle se désire ».
La mort met à l’épreuve la solidité de la foi du mourant.Pour ceux chez qui elle est insuffisamment affermie, l’administration des rituels permet de s’en remettre à l’espérance chrétienne et d’expier le manque de foi.
25 mai 1944. Charles de Gaulle à William Bullitt : “Venez donc ! bon et cher ami américain. Nos rangs vous sont ouverts. Vous rentrerez avec nous dans Paris mutilé. Ensemble, nous y verrons vos drapeaux étoilés mêlés à nos tricolores. Veuillez croire, mon cher Ambassadeur, à mes sentiments dévoués.”
Ce ralliement venait à point nommé, alors que de Gaulle affrontait Roosevelt qui voulait l’écarter du pouvoir et des opérations militaires après le débarquement. Bullitt lui apportait brusquement la légitimité de l’un des Américains les plus connus en France.
Ce dont parfois nous souffrons, ce n'est donc pas d'insécurité culturelle, mais d'insécurité historique.
Cette insécurité d'ordre historique est d'abord liée à une difficulté à nous approprier toute notre histoire, à la regarder en face, pour que certains de nos compatriotes ne nous paraissent plus étrangers mais qu'avec eux nous fassions "histoire commune". » (p. 160)
Le passage du diable
Quel est le nom de famille du personnage principal ?
72 lecteurs ont répondu