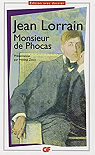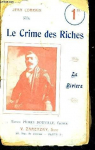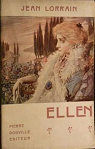Critiques de Jean Lorrain (59)
L'atmosphère est fantastique, délicieusement archaïsante. On pense à Moreau en peinture, à Huysmans en littérature. Il y a du Baudelaire, il y a du XIXe finissant, se perdant dans des rêves antiques ou médiévaux, dont l'atmosphère délétère exhale ses derniers relents. Voici les titres des nouvelles en questions et les thèmes récurrents :
La princesse aux Lys rouges : Belle damoiselle dans un couvent, elle tue en décapitant les fleurs.
La princesse des chemins : Une belle femme errante, épousée et enfermée par un roi, regrette sa liberté. Grimaldine aux crins d'or : la beauté fatale enfermée par son mari ressemble à la vagabonde.
La princesse du Sabbat et La princesse aux miroirs : Deux femmes, deux princesses qui veulent être toujours jeunes et jolies, pétries d'orgueil. Elle se rendent chez des sorcières mais perdent leur image au sabbat.
Les filles du vieux duc : des jeunes filles fuient le palais. Tout comme Hylas. Ils s'échappent des volontés toutes puissantes pour errer sur les chemins. Légende des trois princesses est sur le même mode : fuite des jeunes femmes à la poursuite d'un amour indigne et traitre à leur patrie.
Narkiss : Un beau pharaon à l'image d'Isis, méconnaît son reflet. Enlevé et élevé dans l'oisiveté par des prêtres, il est victime, comme son acolyte grec, de son propre visage.
La fin d'un jour : Découverte d'un carnage à Constantinople.
Conte du bohémien qui refuse de chanter pour roi et émerveille le peuple : une métaphore de l'amour.
La princesse Ottilia : pauvre sourde et muette jouet des ambitieux.
La Marquise de Spolète épouse un vieux duc et se noie dans les fêtes : tout dérape le soir où avec trois amants elle joue Salomé.
L'inutile vertu : un homme refuse les plaisirs de la vie tout à la recherche d'un criminel à éliminer. Il vieillit.
Mélusine enchantée : conte de la belle femme serpent, revu et corrigé.
Mandosiane captive : une beauté de tissus, image de bannière se délite à la fin du Moyen-Age.
Oriane vaincue : la sirène vaincue par le christ.
Le Prince dans la foret : deux contes au même titre qui traitent de l'enchantement des rêves dont on ne se sort que par la douleur et de la quête du bonheur comme indifférence à la souffrance.
Conte des faucheurs : amour et mort fauchent devant Raymondin.
La princesse sous le verre : Version corrigée de la Belle au bois dormant endormie que chacun cherche à réveiller... horrible carnage et canonisation de l'endormie.
Neighilde : une reprise de la Reine des neiges.
La princesse Neigefleur : L'histoire de Blanche Neige centrée sur mauvaise reine. On retrouve le thème du miroir omniprésent dans les premiers contes.
Un recueil délicieux, poétique mais souvent peu riant. Ne vous attendez pas à un happy end, car la pourriture, le poison, le temps viennent tout détruire. Il y a un peu de la mort du grand Pan, des civilisations disparues et des maléfices anciens dans ces œuvres. C'est beau, souvent d'une intense pureté, je me demande à quel point Silhol s'est inspirée de ces textes, de cette plume...
La princesse aux Lys rouges : Belle damoiselle dans un couvent, elle tue en décapitant les fleurs.
La princesse des chemins : Une belle femme errante, épousée et enfermée par un roi, regrette sa liberté. Grimaldine aux crins d'or : la beauté fatale enfermée par son mari ressemble à la vagabonde.
La princesse du Sabbat et La princesse aux miroirs : Deux femmes, deux princesses qui veulent être toujours jeunes et jolies, pétries d'orgueil. Elle se rendent chez des sorcières mais perdent leur image au sabbat.
Les filles du vieux duc : des jeunes filles fuient le palais. Tout comme Hylas. Ils s'échappent des volontés toutes puissantes pour errer sur les chemins. Légende des trois princesses est sur le même mode : fuite des jeunes femmes à la poursuite d'un amour indigne et traitre à leur patrie.
Narkiss : Un beau pharaon à l'image d'Isis, méconnaît son reflet. Enlevé et élevé dans l'oisiveté par des prêtres, il est victime, comme son acolyte grec, de son propre visage.
La fin d'un jour : Découverte d'un carnage à Constantinople.
Conte du bohémien qui refuse de chanter pour roi et émerveille le peuple : une métaphore de l'amour.
La princesse Ottilia : pauvre sourde et muette jouet des ambitieux.
La Marquise de Spolète épouse un vieux duc et se noie dans les fêtes : tout dérape le soir où avec trois amants elle joue Salomé.
L'inutile vertu : un homme refuse les plaisirs de la vie tout à la recherche d'un criminel à éliminer. Il vieillit.
Mélusine enchantée : conte de la belle femme serpent, revu et corrigé.
Mandosiane captive : une beauté de tissus, image de bannière se délite à la fin du Moyen-Age.
Oriane vaincue : la sirène vaincue par le christ.
Le Prince dans la foret : deux contes au même titre qui traitent de l'enchantement des rêves dont on ne se sort que par la douleur et de la quête du bonheur comme indifférence à la souffrance.
Conte des faucheurs : amour et mort fauchent devant Raymondin.
La princesse sous le verre : Version corrigée de la Belle au bois dormant endormie que chacun cherche à réveiller... horrible carnage et canonisation de l'endormie.
Neighilde : une reprise de la Reine des neiges.
La princesse Neigefleur : L'histoire de Blanche Neige centrée sur mauvaise reine. On retrouve le thème du miroir omniprésent dans les premiers contes.
Un recueil délicieux, poétique mais souvent peu riant. Ne vous attendez pas à un happy end, car la pourriture, le poison, le temps viennent tout détruire. Il y a un peu de la mort du grand Pan, des civilisations disparues et des maléfices anciens dans ces œuvres. C'est beau, souvent d'une intense pureté, je me demande à quel point Silhol s'est inspirée de ces textes, de cette plume...
En ouvrant ce roman du célèbre et dépravé Jean Lorrain, j'ai été stupéfait par les nombreux parallélismes qu'on pouvait dresser avec la Chute d'Albert Camus, qui ne pouvaient être fortuits : même lieu, même durée, même principe, la confession d'un homme fané. Après une brève recherche, j'ai constaté que je n'étais nullement le premier à faire cette "découverte", qui semble être le fait de Léon-François Hoffmann qui développe la question dans un article de la revue d'histoire littéraire de la France de février 1969. En tout cas, ce vieux dégénéré mythomane de Monsieur de Bougrelon m'aura fait passer un bon moment, l'auteur ayant une excellent plume, et le personnage rappelant par bien des côtés, les plus pervertis chez Proust, il y a du Swann, du Duc de Guermantes et surtout du Charlus dans Monsieur de Bougrelon / de Mortimer. Jean Lorrain nous gratifie de plusieurs traits d'esprit très fins, et le retournement final est surprenant tout en paraissant logique.
Ouvrage décadent assez classique, que je rapprocherais volontiers d'un Vice Suprême de Joséphin Péladan, du Crépuscule des dieux d'Elémir Bourges ou de A Rebours de Huysmans, il n'en reste pas moins "abominable et délicieux", comme l'a dit l'un des critiques de l'époque. Il explore le destin malheureux du dernier rejeton d'une race maudite, le prince Wladmir Noronsoff, surnommé par sa mère "Sacha". le roman est intéressant non seulement dans sa description de ce "jeune vieillard" qui s'ennuie et a comme unique passe-temps la corruption de ses moeurs, mais aussi dans l'érudition de son auteur, qui nous gratifie de nombreuses références littéraires ou picturales : les chansons de Bilitis, qui sont "pastichées", Gabriel Dante Rossetti pour la peinture, ou encore, cet Algernoon Filde qui fait penser à un certain Oscar... On constate aussi des références à l'Antiquité, dans le bal masqué, mais aussi une référence en sous-texte à la Rome décadente des IVème et Vème siècles et à l'Empire Byzantin. Des moments sont très drôles, d'autres assez poétiques, par exemple le "pastiche" du poème de Verlaine sur le Chevalier Malheur rend très bien. Belle plongée dans un auteur à scandales tombé dans un oubli relatif, la vengeance de femme qui ponctue l'ouvrage est suffisamment cruelle pour punir le vice du Noronsoff.
D'ailleurs, les vengeances de femmes devraient être considérées comme un style à part entière, j'ai le souvenir de plusieurs romans où le sujet est traité de façon intéressante : Colomba, de Mérimée, la Vengeance d'une femme de Barbey d'Aurevilly, les Liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos, Madame Putiphar de Pétrus Borel ou encore Vipère au poing d'Hervé Bazin. Les Noronsoff ne dépareilleraient pas parmi ceux-là.
D'ailleurs, les vengeances de femmes devraient être considérées comme un style à part entière, j'ai le souvenir de plusieurs romans où le sujet est traité de façon intéressante : Colomba, de Mérimée, la Vengeance d'une femme de Barbey d'Aurevilly, les Liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos, Madame Putiphar de Pétrus Borel ou encore Vipère au poing d'Hervé Bazin. Les Noronsoff ne dépareilleraient pas parmi ceux-là.
"Poussières de Paris" rassemble des articles de Jean Lorrain parus dans "L'Écho de Paris" de 1894 à 1895 et dans le "Journal" de 1899 à 1900. le style est celui d'un esthète "Fin de siècle". Jean Lorrain aime les mots rares, les longues phrases pleines de rythme, de musicalité. Jean Lorrain reste certes un mondain et un grand amateur d'art, dans ce Paris de la Belle Époque qu'il sait si bien observer et décrire; mais il aime aussi l'atmosphère des foules, le peuple des faubourgs, des champs de courses, les fêtes du 14 juillet... Il se rend parfois dans les Pyrénées, à Bordeaux, à Marseille... Les derniers articles sont consacrés à l'exposition universelle de 1900 et à l'Extrême-Orient. Jean Lorrain jouait son personnage, d'inverti mondain, d'éthéromane, d'auteur scandaleux, ne cachait rien de ses penchants, de ses opinions. On s'attend à ce qu'il soit caustique, véhément, ce pourquoi on le redoutait souvent, et l'on découvre un admirable poète.
Des pierreries variées, précieuses et empoisonnées ; des obsessions de regards glauques, qu’on croit discerner fugacement en des têtes quotidiennes, poursuivant l’attention jusqu’aux cauchemars et jusqu’à la folie ; des poupées d’enfants chlorotiques à taille humaine et des toiles byzantines aux femmes assassines, le tout élu pour leurs sulfures de cadavres ; des lieux louches que fréquentent à la fois les mondaines et les gaupes, qu’un argent abondant suscite ou permet, où l’on vient en témoin de dissection ; des multitudes que la vilenie déforme, parmi une époque d’animale bourgeoisie, où le divertissant sert de prétextes aux rumeurs pour jeter son ennui dans des maux constants et anodins ; des tares partout, vues ou décelées, et recherchées sous maints parfums capiteux et captieux, sous des masques bourgeois ou monstres, qu’on ne peut plus fuir, omniprésentes comme la contagion, signe des temps nécrosés ; des drogues banales, composées parfois en bouquets aux innocentes mines, auxquelles les habitués sont mithridatisés, dont on ne mange, pâles et lassés, non tant par goût exotique que par usances blasées ; une corruption générale des mœurs, des sexes, des genres, des âges, tout travesti et adultéré, où se confondent et contredisent des lubies qui doivent autant au caractère exaspéré qu’à l’extinction du goût sain de la vitalité directe ; une fascination pour l’Orient, reliquat d’une volonté plus fraîche de quitter les remugles des villes ostentatoires, que dénaturent pourtant les visions hallucinées de couleurs fauves, d’agitations de danses suggestives et de prostitution d’enfants, ainsi que de primitives et féroces allusions de domination occidentale – en somme, un répertoire assez complet fin-de-siècle – : voici ce que propose Lorrain dans ce roman d’un dandy qu’une influence pernicieuse énerve à la névrose, mais que l’ouvrage n’élève pas au Des Esseintes de Huysmans, parce qu’il s’y trouve un prétexte narratif et une facticité de progression, au lieu d’une stricte peinture de la stagnation obsessionnelle qui constitue l’argument de l’œuvre, qu’À rebours avait osé plus de quinze ans plus tôt, et dont le style relevait de plus de pittoresque encore.
« Rats d’opéra, lys du Rat Mort, mondaines frêles aux museaux de rongeurs, j’ai eu dans ma vie des ballerines impubères, des duchesses émaciées, douloureuses et toujours lasses, des mélomanes et des morphinées, des banquières juives aux yeux plus en caverne que ceux des rôdeurs de banlieue, et des figurantes de music-hall qui, à souper, versaient de la créosote dans leur Roederer ; et j’ai même eu des insexuées des tables d’hôte de Montmartre et jusqu’à de fâcheuses androgynes. Comme un snob et comme un mufle, j’ai aimé les petites filles angulaires, effarantes et macabres, le ragoût de phénol et de piment des chloroses fardées et des invraisemblables minceurs. » (page 65)
On suit dans Monsieur de Phocas une composition au sujet d’un homme riche, le duc de Fréneuse (autre nom de Phocas), que la présence interlope de Claudius Ethal, artiste perverti savamment, insinue et déforme morbidement. C’est l’exposition d’une emprise maléfique qui use et brise la santé, mise sous la forme d’un journal joliment invraisemblable, et que l’auteur ne déprend jamais tout à fait de la possibilité d’une guérison, ni même que, de façon paradoxale, Ethal fût un médecin de l’âme lui-même passé par les affres de l’incontrôlée révélation qui l’ont rendu excentrique. Le livre est trop roman, d’ailleurs d’intrigue pauvre, pour constituer l’audace littéraire, et les douleurs jaunes qu’il décrit par assemblages sont d’usage déjà trop répandu pour abonder l’impression du génie novateur. C’est assurément de style ciselé, avec certains défauts de journaliste Gotha – des recopiages relativement patents d’articles et un inachèvement assez systématique de la profondeur –, mais c’est déjà moins ostentatoire et plus composé que Fersen, même si je ne dirais pas que c’est une trouvaille ou une élaboration, dénouement compris. Je vois encore du confort dans ce récit de la démence qu’on n’atteint jamais, où l’adhésion reste relative, et Fréneuse demeure naïf et pudique, effaré sans cesse de ce qu’on présente à ses yeux de décadent pourtant réputé à Paris : Lorrain ne fait qu’accumuler baroquement, comme dans Monsieur de Bougrelon, des préjugés assez connus de vices contemporains et de détraquements des humeurs, mis en scène en l’exposition d’une variété de thèmes symboliques perturbants et presque classés. C’est sans conteste soigné, délicat et fin, mais ce n’est pas difficile à écrire, et la tournure même de l’intrigue, d’une maigre évolution et même assez stagnante, ne réalise le crime de Fréneuse contre Ethal que d’imprévisible et d’illogique manière, sans qu’un parangon de trouble ou qu’une gradation de ressentiment l’explique, plus dans une impulsion onirique insaisissable que dans un moment de véritable conscience – c’est en quoi la forme du roman est une contradiction, les perpétuelles descriptions ne se défigeant aux ultimes pages que parce qu’il faut à l’histoire une fin, et quelle fin plutôt banale, la mort d’un personnage et le départ de son meurtrier ! Toute l’intrigue pourrait se définir tant en style qu’en stagnation par ce passage :
« Quelque chose de funèbre et pourtant de chaud et d’attiédi, comme une odeur de pourriture de fleurs, mais de fleurs de cercueil, traînait dans l’atmosphère ; quelque chose aussi se préparait et qui ne commençait pas. » (page 158)
Je n’ai même jamais reconnu une profonde communication de la pathologie psychique du glauque qui n’est également qu’une superficie et qu’une parure, qui n’est que la forme d’un ennui sis dans un monde de paresse qui cependant est incapable de se défaire des apparences et se complaît dans l’Opinion, même dans celle qu’il abhorre. C’est la structure d’un esprit inapte à créer et entraîné non pas malgré lui mais bien volontairement dans un théâtre de dénigrements imaginatifs et mesquins, et qui ne sait ni ne veut s’occuper de lui, qui le déplore en fait autant qu’il s’en régale, qui se fait un jeu de mal vivre parce que sa pose de douloureuse langueur, il le devine, est de mode et qu’on la suppose caractériser une mentalité de la distance distinguée : c’est l’intellectuel nouveau qui, ainsi, exprime son nonchaloir peiné – à juste titre Hélène Zink, préfacière de cette édition, remarque-t-elle que « La sincérité de la douleur d’un des Esseintes s’est délitée dans la pose et le snobisme. Le “bréviaire de la décadence” s’est transformé en “guide des bons usages” de la mondanité fin-de-siècle. […] Le dandy décadent s’opposait à ses contemporains en prônant, pour lui seul, la transgression. Mais la banalité de ce phénomène lui a fait perdre tout caractère subversif. Politiquement, le dandy a été neutralisé par une société toujours prompte à phagocyter ce qui la met en danger. Le vice devient alors art de la pose, dénaturation et accaparement petit-bourgeois d’une nouvelle mode. La déviance s’exhibe, dans une logique marchande et normative. Elle se veut synonyme de raffinement culturel, d’aristocratie du vice policé. » (page 20) Avec si peu, Lorrain ne peut réellement transmettre l’inquiétude, mais il dispose certaines fatigues morales suivant différents contextes, à distance et sans confondante immersion, sans qu’on soit captivé plus que par l’ambiance de stupre latent, sans qu’on ressente avec insidieuse influence la douleur vivante et ahurie du personnage qu’une sorte d’anesthésie plaisante imprègne, sans qu’on croie à plus qu’une décoration d’ampoules pour un pantin malsain. Ce n’est néanmoins pas non plus superficiel, mais on ne saurait oublier tout en lisant qu’il s’agit de fiction, et l’on est forcé de se contenter d’un montage artificiel dont les impressions restent au registre de l’imaginaire sans investir le champ de la réalité du lecteur : rien n’est tellement « applicable » dans ce roman où même les situations ne sont pas, comme je l’ai écrit, d’une originalité surprenante ni d’un véritable trouble ; c’est une resucée élégante des poncifs de la littérature du spleen, où l’on retrouve, avec plus ou moins d’agrément selon son goût, des variations de compagnons bizarres et sophistiqués, et dans des décors chargés, et selon des excès assez prévisibles de déviante neurasthénie où l’amoral est davantage présent, moins audacieusement, que l’immoral – au fond, on perçoit toujours en sourdine la condamnation des individus déréglés, ce qui est très « sage ». L’éloquence y manque pour instruire le franc procès du siècle, car on sait avoir affaire à des exceptions qui ne résultent pas des processus explicités d’un monde en déclin, en dépit de rares beaux diagnostics, comme :
« Oh ! le ressassage des opinions toutes faites et des jugements appris, le vomissement automatique des articles lus, dans les feuilles et qu’on reconnaît au passage, leur désespérant désert d’idées, et là-dessus l’éternel plat du jour des clichés trop connus. […] Comme je comprends les bombes de l’Anarchie ! » (page 108-109),
… et malgré la suggestion brève de remèdes de pleine et vertueuse vitalité, comme :
« Partir vers le soleil et vers la mer, aller se guérir, non, se retrouver dans des pays neufs et très vieux, de foi encore vivace et non entamée par notre civilisation morne, se baigner dans la tradition, de la force et de la santé, la force et la santé des peuples restés jeunes, vivre dans l’Inde et dans l’Extrême-Orient, dans la clarté du ciel et de la mer, se disperser dans la nature, qui seule ne nous trompe pas, se libérer de toutes les conventions et de toutes les vaines attaches, relations, préjugés, qui sont autant de poids et d’affreux murs de geôle entre nous et la réalité de l’univers, vivre enfin la vie de son âme et de ses instincts loin des existences artificielles, surchauffées et nerveuses des Paris et des Londres, loin de l’Europe surtout !... » (page 176) – passage qui évoque Maupassant (Au soleil) comme beaucoup d’autres, mais sporadiques, où la couleur est alors si fidèle et reconnaissable, avec ses idiosyncrasies manifestes, que c’en est troublant comme une illusion de plagiat et même comme une réminiscence spontanée –
… mais qui retombe, avorton d’autres romans pas advenus, de romans pittoresque et supérieurs pourtant :
« Et je ne suis pas parti ! La pluie ruisselle, les arbres des avenues se dressent, lamentables, sur un ciel en colle de pâte ; dans des flaques d’eau noire, c’est l’horreur des stations de fiacre et la bousculade des parapluies, c’est le Paris de boue et le spleen de novembre. » (page 183)
On touche à des espèces de monstres sans limite et que sinon les auteurs, du moins des intrigues condamnent tout en faisant jouir de leurs portraits, et l’on se dit d’emblée que cette ménagerie turpide et improbable a mérité ce qui lui arrive : certes, mais ainsi on ne s’identifie point, et ce sont comme des romans où il n’y aurait que des figures de méchants sans étayage psychologique, sans responsabilité personelle et propre, sans mécanisme social, mystère d’êtres foncièrement maladifs, de figures dont les causes sont quasi génétiques. C’est presque un plaisir transitoire et distrait, mais tout à fait contradictoire, de tératologue pseudo moral, c’est-à-dire une façon d’accompagner la décadence en l’installant dans des attentions veules, plutôt que de la corriger, et c’est d’ailleurs le but des « récits à clés » comme celui-ci où les personnages sont identifiables à des personnes célèbres : on entretient la basse curiosité ragoteuse et malveillante des lecteurs, y compris en des livres qui feignent de la dénoncer mais qui en perpétuent plutôt la tradition en la présentant comme digne d’être littérarisée. Même, il est probable que ce roman dut en large part le bon accueil qu’il reçut, et apparemment unanime, à l’étalage mondain dont Lorrain avait l’usage quand il se plaisait à déchirer lapidairement des honneurs et des carrières, dans la presse, sur une seule épigramme défoulée et très suivie, distinguément et drolatiquement perfide, dont la foule raffole et ricane, et qui font la popularité parisienne : par précaution, on préféra sans doute, en cajolant la parution, s’épargner des représailles. C’est le paradoxe hideux, en quelque sorte, du mirliflore affectant de dénoncer une fois encore et pour la galerie l’époque insincère de dandysme éculé, écorchant avec force distance et pose des œuvres contre lesquelles il promeut profondeur et véracité, et condamnant avec ostentation des milieux surfaits, obscènes et immoraux afin que se régale indécemment un lectorat nombreux, complice et plein de vices auquel l’auteur aspire à plaire ! Ainsi le roman fin-de-siècle ou décadent succombe-t-il, à force de reprises et de blanchiments, à une exténuation de sa propre dénonciation : son intention de contestation passée, il devient lui aussi une pièce de mode, une ciselure cruelle et sardonique, un apanage de foule dérisoire ainsi qu’un divertissement venimeux, comme une caricature aux traits méticuleux, plaisante aux amateurs de caricatures puis aux caricaturés, dont l’objet initial eût été – la caricature même.
Lien : http://henrywar.canalblog.com
« Rats d’opéra, lys du Rat Mort, mondaines frêles aux museaux de rongeurs, j’ai eu dans ma vie des ballerines impubères, des duchesses émaciées, douloureuses et toujours lasses, des mélomanes et des morphinées, des banquières juives aux yeux plus en caverne que ceux des rôdeurs de banlieue, et des figurantes de music-hall qui, à souper, versaient de la créosote dans leur Roederer ; et j’ai même eu des insexuées des tables d’hôte de Montmartre et jusqu’à de fâcheuses androgynes. Comme un snob et comme un mufle, j’ai aimé les petites filles angulaires, effarantes et macabres, le ragoût de phénol et de piment des chloroses fardées et des invraisemblables minceurs. » (page 65)
On suit dans Monsieur de Phocas une composition au sujet d’un homme riche, le duc de Fréneuse (autre nom de Phocas), que la présence interlope de Claudius Ethal, artiste perverti savamment, insinue et déforme morbidement. C’est l’exposition d’une emprise maléfique qui use et brise la santé, mise sous la forme d’un journal joliment invraisemblable, et que l’auteur ne déprend jamais tout à fait de la possibilité d’une guérison, ni même que, de façon paradoxale, Ethal fût un médecin de l’âme lui-même passé par les affres de l’incontrôlée révélation qui l’ont rendu excentrique. Le livre est trop roman, d’ailleurs d’intrigue pauvre, pour constituer l’audace littéraire, et les douleurs jaunes qu’il décrit par assemblages sont d’usage déjà trop répandu pour abonder l’impression du génie novateur. C’est assurément de style ciselé, avec certains défauts de journaliste Gotha – des recopiages relativement patents d’articles et un inachèvement assez systématique de la profondeur –, mais c’est déjà moins ostentatoire et plus composé que Fersen, même si je ne dirais pas que c’est une trouvaille ou une élaboration, dénouement compris. Je vois encore du confort dans ce récit de la démence qu’on n’atteint jamais, où l’adhésion reste relative, et Fréneuse demeure naïf et pudique, effaré sans cesse de ce qu’on présente à ses yeux de décadent pourtant réputé à Paris : Lorrain ne fait qu’accumuler baroquement, comme dans Monsieur de Bougrelon, des préjugés assez connus de vices contemporains et de détraquements des humeurs, mis en scène en l’exposition d’une variété de thèmes symboliques perturbants et presque classés. C’est sans conteste soigné, délicat et fin, mais ce n’est pas difficile à écrire, et la tournure même de l’intrigue, d’une maigre évolution et même assez stagnante, ne réalise le crime de Fréneuse contre Ethal que d’imprévisible et d’illogique manière, sans qu’un parangon de trouble ou qu’une gradation de ressentiment l’explique, plus dans une impulsion onirique insaisissable que dans un moment de véritable conscience – c’est en quoi la forme du roman est une contradiction, les perpétuelles descriptions ne se défigeant aux ultimes pages que parce qu’il faut à l’histoire une fin, et quelle fin plutôt banale, la mort d’un personnage et le départ de son meurtrier ! Toute l’intrigue pourrait se définir tant en style qu’en stagnation par ce passage :
« Quelque chose de funèbre et pourtant de chaud et d’attiédi, comme une odeur de pourriture de fleurs, mais de fleurs de cercueil, traînait dans l’atmosphère ; quelque chose aussi se préparait et qui ne commençait pas. » (page 158)
Je n’ai même jamais reconnu une profonde communication de la pathologie psychique du glauque qui n’est également qu’une superficie et qu’une parure, qui n’est que la forme d’un ennui sis dans un monde de paresse qui cependant est incapable de se défaire des apparences et se complaît dans l’Opinion, même dans celle qu’il abhorre. C’est la structure d’un esprit inapte à créer et entraîné non pas malgré lui mais bien volontairement dans un théâtre de dénigrements imaginatifs et mesquins, et qui ne sait ni ne veut s’occuper de lui, qui le déplore en fait autant qu’il s’en régale, qui se fait un jeu de mal vivre parce que sa pose de douloureuse langueur, il le devine, est de mode et qu’on la suppose caractériser une mentalité de la distance distinguée : c’est l’intellectuel nouveau qui, ainsi, exprime son nonchaloir peiné – à juste titre Hélène Zink, préfacière de cette édition, remarque-t-elle que « La sincérité de la douleur d’un des Esseintes s’est délitée dans la pose et le snobisme. Le “bréviaire de la décadence” s’est transformé en “guide des bons usages” de la mondanité fin-de-siècle. […] Le dandy décadent s’opposait à ses contemporains en prônant, pour lui seul, la transgression. Mais la banalité de ce phénomène lui a fait perdre tout caractère subversif. Politiquement, le dandy a été neutralisé par une société toujours prompte à phagocyter ce qui la met en danger. Le vice devient alors art de la pose, dénaturation et accaparement petit-bourgeois d’une nouvelle mode. La déviance s’exhibe, dans une logique marchande et normative. Elle se veut synonyme de raffinement culturel, d’aristocratie du vice policé. » (page 20) Avec si peu, Lorrain ne peut réellement transmettre l’inquiétude, mais il dispose certaines fatigues morales suivant différents contextes, à distance et sans confondante immersion, sans qu’on soit captivé plus que par l’ambiance de stupre latent, sans qu’on ressente avec insidieuse influence la douleur vivante et ahurie du personnage qu’une sorte d’anesthésie plaisante imprègne, sans qu’on croie à plus qu’une décoration d’ampoules pour un pantin malsain. Ce n’est néanmoins pas non plus superficiel, mais on ne saurait oublier tout en lisant qu’il s’agit de fiction, et l’on est forcé de se contenter d’un montage artificiel dont les impressions restent au registre de l’imaginaire sans investir le champ de la réalité du lecteur : rien n’est tellement « applicable » dans ce roman où même les situations ne sont pas, comme je l’ai écrit, d’une originalité surprenante ni d’un véritable trouble ; c’est une resucée élégante des poncifs de la littérature du spleen, où l’on retrouve, avec plus ou moins d’agrément selon son goût, des variations de compagnons bizarres et sophistiqués, et dans des décors chargés, et selon des excès assez prévisibles de déviante neurasthénie où l’amoral est davantage présent, moins audacieusement, que l’immoral – au fond, on perçoit toujours en sourdine la condamnation des individus déréglés, ce qui est très « sage ». L’éloquence y manque pour instruire le franc procès du siècle, car on sait avoir affaire à des exceptions qui ne résultent pas des processus explicités d’un monde en déclin, en dépit de rares beaux diagnostics, comme :
« Oh ! le ressassage des opinions toutes faites et des jugements appris, le vomissement automatique des articles lus, dans les feuilles et qu’on reconnaît au passage, leur désespérant désert d’idées, et là-dessus l’éternel plat du jour des clichés trop connus. […] Comme je comprends les bombes de l’Anarchie ! » (page 108-109),
… et malgré la suggestion brève de remèdes de pleine et vertueuse vitalité, comme :
« Partir vers le soleil et vers la mer, aller se guérir, non, se retrouver dans des pays neufs et très vieux, de foi encore vivace et non entamée par notre civilisation morne, se baigner dans la tradition, de la force et de la santé, la force et la santé des peuples restés jeunes, vivre dans l’Inde et dans l’Extrême-Orient, dans la clarté du ciel et de la mer, se disperser dans la nature, qui seule ne nous trompe pas, se libérer de toutes les conventions et de toutes les vaines attaches, relations, préjugés, qui sont autant de poids et d’affreux murs de geôle entre nous et la réalité de l’univers, vivre enfin la vie de son âme et de ses instincts loin des existences artificielles, surchauffées et nerveuses des Paris et des Londres, loin de l’Europe surtout !... » (page 176) – passage qui évoque Maupassant (Au soleil) comme beaucoup d’autres, mais sporadiques, où la couleur est alors si fidèle et reconnaissable, avec ses idiosyncrasies manifestes, que c’en est troublant comme une illusion de plagiat et même comme une réminiscence spontanée –
… mais qui retombe, avorton d’autres romans pas advenus, de romans pittoresque et supérieurs pourtant :
« Et je ne suis pas parti ! La pluie ruisselle, les arbres des avenues se dressent, lamentables, sur un ciel en colle de pâte ; dans des flaques d’eau noire, c’est l’horreur des stations de fiacre et la bousculade des parapluies, c’est le Paris de boue et le spleen de novembre. » (page 183)
On touche à des espèces de monstres sans limite et que sinon les auteurs, du moins des intrigues condamnent tout en faisant jouir de leurs portraits, et l’on se dit d’emblée que cette ménagerie turpide et improbable a mérité ce qui lui arrive : certes, mais ainsi on ne s’identifie point, et ce sont comme des romans où il n’y aurait que des figures de méchants sans étayage psychologique, sans responsabilité personelle et propre, sans mécanisme social, mystère d’êtres foncièrement maladifs, de figures dont les causes sont quasi génétiques. C’est presque un plaisir transitoire et distrait, mais tout à fait contradictoire, de tératologue pseudo moral, c’est-à-dire une façon d’accompagner la décadence en l’installant dans des attentions veules, plutôt que de la corriger, et c’est d’ailleurs le but des « récits à clés » comme celui-ci où les personnages sont identifiables à des personnes célèbres : on entretient la basse curiosité ragoteuse et malveillante des lecteurs, y compris en des livres qui feignent de la dénoncer mais qui en perpétuent plutôt la tradition en la présentant comme digne d’être littérarisée. Même, il est probable que ce roman dut en large part le bon accueil qu’il reçut, et apparemment unanime, à l’étalage mondain dont Lorrain avait l’usage quand il se plaisait à déchirer lapidairement des honneurs et des carrières, dans la presse, sur une seule épigramme défoulée et très suivie, distinguément et drolatiquement perfide, dont la foule raffole et ricane, et qui font la popularité parisienne : par précaution, on préféra sans doute, en cajolant la parution, s’épargner des représailles. C’est le paradoxe hideux, en quelque sorte, du mirliflore affectant de dénoncer une fois encore et pour la galerie l’époque insincère de dandysme éculé, écorchant avec force distance et pose des œuvres contre lesquelles il promeut profondeur et véracité, et condamnant avec ostentation des milieux surfaits, obscènes et immoraux afin que se régale indécemment un lectorat nombreux, complice et plein de vices auquel l’auteur aspire à plaire ! Ainsi le roman fin-de-siècle ou décadent succombe-t-il, à force de reprises et de blanchiments, à une exténuation de sa propre dénonciation : son intention de contestation passée, il devient lui aussi une pièce de mode, une ciselure cruelle et sardonique, un apanage de foule dérisoire ainsi qu’un divertissement venimeux, comme une caricature aux traits méticuleux, plaisante aux amateurs de caricatures puis aux caricaturés, dont l’objet initial eût été – la caricature même.
Lien : http://henrywar.canalblog.com
Considérée comme une œuvre clef du mouvement décadent, "Monsieur de Phocas" est une longue confession, celle du mystérieux aristocrate, le duc de Fréneuse, en quête d'un regard, d'une lueur verte et glauque. Fâché avec son époque, il n'aura de cesse de dénoncer les "masques" horribles de la société, d'acheter les pierres les plus précieuses, de contempler les yeux des statues, de s'égarer, de s'isoler, jusqu'à croiser la route de Claudius Ethal, un peintre anglais aux penchants morbides ; une sorte de double maléfique, un monstre lubrique qui flatte les bas instincts, empoisonneur notoire. D'une cruauté sans nom, Ethal sera pour le duc un guide des enfers et de la perdition. Ils vont tous deux se repaître d'art, de perversions et de pauvretés. Ils trouvent la beauté dans le regard des agonisants, des tuberculeux, des fumeurs d'opium et de haschich, des danseuses et des prostituées affolées. Dans un style riche, macabre, symboliste, plein de références aux écrits et aux tableaux de la fin du siècle, Jean Lorrain arrive à trouver sa propre voix, distincte de celles de Huysmans, Baudelaire, Bourges, Mirbeau.
Un homme qui emploie des mots comme « dahablée » et qui se voit comme un « blond éphèbe » (il n’est ni blond ni éphèbe) ne peut pas être entièrement mauvais, me semble-t-il.
Lien : https://www.nouvelobs.com/la..
Lien : https://www.nouvelobs.com/la..
Il y avait quelque temps que je n'avais lu de littérature « décadente ». Avec jean Lorrain, c'est le plaisir assuré. Monsieur de Phocas est un aristocrate déchu, névrosé, et qui va s'enfoncer de plus en plus dans le délire. On pense bien évidemment à Des Esseintes de Huysmans. C'est le même propos. Si ce n'est que Lorrain à assigné à son héros un autre décadent, un peintre anglais qui va complètement le manipuler. Nous évoluons dans un Paris « fin-de siècle » avec ses garçonnières, ses prostituées, mais aussi ses aristocrates dégénéré(e)s. Une des scènes que je retiens est celle où le peintre invite toutes ses connaissances à une soirée qui se terminera en orgie et fumerie à opium. Lorrain n'a pas son pareil pour décrire ce genre de scène. C'est une écriture très choisie – souvent j'ai eu recours au dictionnaire – précise. Les notes en bas de page proposées par l'édition Flammarion sont les bienvenues ainsi que le dossier final. Il faut bien replacer cette littérature dans son contexte fin-de-siècle, où, comme il est dit dans le dossier, un monde finissant laisse la place à un monde nouveau. C'est à ce monde déclinant que nous convie Jean Lorrain.
Les amateurs du genre ne seront pas déçus.
Les amateurs du genre ne seront pas déçus.
Jean Lorrain est probablement le dernier de ceux que l'on a baptisés les "Décadents". Son ouvrage se caractérise par un style finement ciselé, que je comparerais, en peinture, aux tableaux de Gustave Moreau, avec une haute dose de symbolisme et de sens cachés.
J'ai eu la chance de récupérer dans une boîte à dons, ce présent livre, qui est une anthologie sur les fées.
Il est édité chez l'Oxymore et les nouvelles qui le constituent sont réunis par Léa Silhol, qui est une spécialiste de la littérature féerique. Il est parsemé de superbes illustrations d'Amandine Labarre.
Ne connaissant pas du tout le monde féerique, je me suis lancée dans la lecture de ce livre en pure curiosité. Il est composé de 13 nouvelles qui nous montre tout un panel de ce que peut-être la littérature féerique. Pour ma part je trouve qu'il y en a certaines qui sont un peu trop cucul la praline. Mais ça c'est mon avis personnel. Sinon certaines sont vraiment génial, comme « Les Sombres » de Karim Berrouka, qui est ma préférée car beaucoup plus sombre.
Pour moi, mais je peux me tromper, le monde des fées est fait d'amour de soi, de l'autre, de la nature, de l'acceptation de l'autre, de la nature exetera.
Il y a beaucoup de comparaison au monde végétal, animal, minérale et même sur la nourriture sans oublier la musique. Ce monde est très enjoliver et douceâtre, tout y est beau. La musique y est enchanteresse.
Ce peut-être un monde à part entière ou être présent à nos côtés et atteignable par une porte ou un portail, même carrément être que onirique. Nous pouvons vivre au côté de ces êtres sans jamais les voir, certaines personnes peuvent interagir avec eux, ces êtres peuvent même nous donner un don pour nous aider dans la vie.
C'est souvent fleur bleue, beaucoup de happy end où tout comme (ce monde de merde ce trouve embellie ou amélioré par la présence des fées et autres êtres magiques).
Il y a souvent une morale sous-jacente à l'histoire qui nous est comté.
Par contre, il y en a certaines qui ont tendance à la noirceur. Tout ne finis pas forcément du bon côté.
Je conseil ce livre aux personnes qui sont comme moi et qui ne connaissent pas ce monde, car cela permet de se donner une idée de quel genre nous convient et même carrément de s'initier à ce monde totalement à part.
J'ai aimé parcourir ses nouvelles, sans oublier les deux annexes à la fin. La première nous est présenté par Marie-Laure Nouhaud, qui nous narre en gros la Genèse des fées Celtes, Irlandaises et Écossaises qui est très intéressante et même instructif avec quelques anecdotes. Ensuite la deuxième se trouve composé de plusieurs extraits de la « Mythologie feerique de Thomas Keightley», nous présentant des témoignages d'un autre temps sur l'interaction du monde féerique avec les humains. Cela peut paraître surprenant et même incongru.
Sans oublier les deux bibliographies, la première présenter par Léa Silhol, sur les traités, essais, livre d'art exetera, pour les aficionados. La deuxième présenté par Lionel Davoust et Léa Silhol, sur la littérature féerique, pour découvrir quel auteur et potentiellement en accord avec notre envie.
Voilà , j'espère ne pas choquer les connaisseurs en la matière.
Il est édité chez l'Oxymore et les nouvelles qui le constituent sont réunis par Léa Silhol, qui est une spécialiste de la littérature féerique. Il est parsemé de superbes illustrations d'Amandine Labarre.
Ne connaissant pas du tout le monde féerique, je me suis lancée dans la lecture de ce livre en pure curiosité. Il est composé de 13 nouvelles qui nous montre tout un panel de ce que peut-être la littérature féerique. Pour ma part je trouve qu'il y en a certaines qui sont un peu trop cucul la praline. Mais ça c'est mon avis personnel. Sinon certaines sont vraiment génial, comme « Les Sombres » de Karim Berrouka, qui est ma préférée car beaucoup plus sombre.
Pour moi, mais je peux me tromper, le monde des fées est fait d'amour de soi, de l'autre, de la nature, de l'acceptation de l'autre, de la nature exetera.
Il y a beaucoup de comparaison au monde végétal, animal, minérale et même sur la nourriture sans oublier la musique. Ce monde est très enjoliver et douceâtre, tout y est beau. La musique y est enchanteresse.
Ce peut-être un monde à part entière ou être présent à nos côtés et atteignable par une porte ou un portail, même carrément être que onirique. Nous pouvons vivre au côté de ces êtres sans jamais les voir, certaines personnes peuvent interagir avec eux, ces êtres peuvent même nous donner un don pour nous aider dans la vie.
C'est souvent fleur bleue, beaucoup de happy end où tout comme (ce monde de merde ce trouve embellie ou amélioré par la présence des fées et autres êtres magiques).
Il y a souvent une morale sous-jacente à l'histoire qui nous est comté.
Par contre, il y en a certaines qui ont tendance à la noirceur. Tout ne finis pas forcément du bon côté.
Je conseil ce livre aux personnes qui sont comme moi et qui ne connaissent pas ce monde, car cela permet de se donner une idée de quel genre nous convient et même carrément de s'initier à ce monde totalement à part.
J'ai aimé parcourir ses nouvelles, sans oublier les deux annexes à la fin. La première nous est présenté par Marie-Laure Nouhaud, qui nous narre en gros la Genèse des fées Celtes, Irlandaises et Écossaises qui est très intéressante et même instructif avec quelques anecdotes. Ensuite la deuxième se trouve composé de plusieurs extraits de la « Mythologie feerique de Thomas Keightley», nous présentant des témoignages d'un autre temps sur l'interaction du monde féerique avec les humains. Cela peut paraître surprenant et même incongru.
Sans oublier les deux bibliographies, la première présenter par Léa Silhol, sur les traités, essais, livre d'art exetera, pour les aficionados. La deuxième présenté par Lionel Davoust et Léa Silhol, sur la littérature féerique, pour découvrir quel auteur et potentiellement en accord avec notre envie.
Voilà , j'espère ne pas choquer les connaisseurs en la matière.
Albert est l’itinéraire d’une imparable décadence, une anti-évolution fatale et résolue, une cacobiographie dénaturée, à laquelle condamne la conscience hyperesthésique de la réalité blanche sans ambages, sans illusions et sans symboles.
Premièrement on naît et vagit : c’est hasard entropique, qui est-on pour naître ? Où voit-on qu’il y réside un mérite ou une destinée ? Toute généalogie est sérendipité.
On éprouve et on témoigne : faible évangile au regard du siècle insignifiant et bête où l’on existe. C’est assez laid et morne, tout cela ; ça obéit à des règles plutôt stupides, tout compte fait ; il faut tout rehausser de beaucoup. C’est objectivement une affaire, rien de plus, et pourtant une entièreté, une finitude, un vide profond dans de certaines formes superficielles – couleurs et mouvements. Esquisse sale et mal faite. Un défaut, une approximation, un malentendu, avec de rares velléités exagérément vantées, idéalisées, aisément abattables. Des préjugés de beauté – surestimes par aveuglement ou par consolation.
On simulacre et on carriérise : compromissions avec le temps, insinuer douceâtrement sa place, usurpant et copiant d’officielles vertus. S’oblitérer suffisamment le souhait et s’altérer la conscience pour se trouver de l’estime, omettre et évacuer le dégoût. Gratter le pur, les parois, comme dans un trou tiédi. Se blottir, se confire, s’accommoder de la contagion du corps faufilé. Confiteor et confitures : prier avec du sucre.
On naufrage et on agonise : dans ce pot, parmi des millions d’étagères, bof et zut. Et le local chuta : bruit net de verre et de l’organe séché qui s’écrase, un impact d’une provisoireté patente et incontestable, fracas mou sans écho. La mémoire ? Peuh ! qui s’intéresse longtemps à une conserve ? C’est tombé, voilà, on a plutôt après ça son récipient à maintenir près du mur, le plus loin possible du précipice. Se figurer boîte infrangible, et, pour cela, déconsidérer avec l’oubli les relativités chues.
Tout événement constitue l’arbitraire prétexte pour entretenir la rétention d’un soupir d’à-quoi-bon. On n’apprend guère : tout est déjà su, au fond, on ne fait que se renseigner sur des ordres et des hiérarchies différents, étrangers, arbitraires. Si on s’exalte par saccades : élans factices, comme l’autruche battant des ailes, on n’ira point plus haut. Lire Shakespeare, se croire Roméo : mais Roméo est une baudruche exhaussée par un vent, de l’enflure soufflée par une certaine convention qu’on aime à reconnaître pour se rassurer à défaut d’autre modèle, à défaut surtout d’imagination réelle, à défaut d’un véritable ailleurs de l’âme. On n’a toujours que les valeurs où l’on a traîné et que l’on a trop traînées avec soi, comme des parfums fanés et puants.
Albert doit choisir, comme tout le monde, parce qu’il faut. Pas dépressif, lucide, désir d’idéal par envie de sens, et puis juste pion, poète, hédonique, pessimiste, catatonique et enfin mort. Une succession, pas un parcours, moins un itinéraire. Tout raté, pas moyen d’accomplir quelque chose : le monde est trop bas et le sens trop haut. Décalage de l’être à la société comme de l’être à l’au-delà. Pas même pathétique, l’émotion se mérite, ici rien de transfigurable, rien d’une jésucrucifixion. Une drôle d’impasse, sans plus, sans sublimité, fatalité sans fatalisme : la vie comme état inchangeable, comme définition inflexible, avec, à cause de la vitalité, de très vaines tentatives de dépassement. Des curiosités successives, échouées et pas même tellement décevantes. Il fallait tenter et voir : impulsion, réflexe, instinct, sans plus. Le médiocre fatidique n’est jamais tragique, comme tout ce qui se regarde de loin et avec ennui. Une mécanique. Ça bouge et ça cesse de bouger.
Et ce style assorti : Dumur goûte la dénaturation du langage, l’anti-spontanéité du verbe, souvent plaisamment excentrique ou profondément poétique, léger ou bien lourd – comme le fond. Pas naturel : mainte expérience, ni fluide pour l’esprit, pas d’habituation – littéraire. Des artifices élaborés, sapience de savantasse, mot déplacé, déparé, résistant à l’entrain, examiné – dissection. Spirituel et monstrueux. Évidemment, c’est un roman sur rien autant que sur le rien, sur l’anéantissement de l’essor, invariable annonce d’échecs désémus, intrigue sur la négligence délibérée d’une histoire, où tout ramène au sentiment d’une étrangeté, d’un dérangé, de l’idéal même d’une fiction, récit systématiquement inutile – de l’art, démonstration de style, insuffisant car œuvre uniquement sur l’insuffisance foncière d’exister, ontologique essence de vanité avec sa forme exactement congruente, contenant ensemble sa beauté intrinsèque et son défaut ad hoc.
Lien : http://henrywar.canalblog.com
Premièrement on naît et vagit : c’est hasard entropique, qui est-on pour naître ? Où voit-on qu’il y réside un mérite ou une destinée ? Toute généalogie est sérendipité.
On éprouve et on témoigne : faible évangile au regard du siècle insignifiant et bête où l’on existe. C’est assez laid et morne, tout cela ; ça obéit à des règles plutôt stupides, tout compte fait ; il faut tout rehausser de beaucoup. C’est objectivement une affaire, rien de plus, et pourtant une entièreté, une finitude, un vide profond dans de certaines formes superficielles – couleurs et mouvements. Esquisse sale et mal faite. Un défaut, une approximation, un malentendu, avec de rares velléités exagérément vantées, idéalisées, aisément abattables. Des préjugés de beauté – surestimes par aveuglement ou par consolation.
On simulacre et on carriérise : compromissions avec le temps, insinuer douceâtrement sa place, usurpant et copiant d’officielles vertus. S’oblitérer suffisamment le souhait et s’altérer la conscience pour se trouver de l’estime, omettre et évacuer le dégoût. Gratter le pur, les parois, comme dans un trou tiédi. Se blottir, se confire, s’accommoder de la contagion du corps faufilé. Confiteor et confitures : prier avec du sucre.
On naufrage et on agonise : dans ce pot, parmi des millions d’étagères, bof et zut. Et le local chuta : bruit net de verre et de l’organe séché qui s’écrase, un impact d’une provisoireté patente et incontestable, fracas mou sans écho. La mémoire ? Peuh ! qui s’intéresse longtemps à une conserve ? C’est tombé, voilà, on a plutôt après ça son récipient à maintenir près du mur, le plus loin possible du précipice. Se figurer boîte infrangible, et, pour cela, déconsidérer avec l’oubli les relativités chues.
Tout événement constitue l’arbitraire prétexte pour entretenir la rétention d’un soupir d’à-quoi-bon. On n’apprend guère : tout est déjà su, au fond, on ne fait que se renseigner sur des ordres et des hiérarchies différents, étrangers, arbitraires. Si on s’exalte par saccades : élans factices, comme l’autruche battant des ailes, on n’ira point plus haut. Lire Shakespeare, se croire Roméo : mais Roméo est une baudruche exhaussée par un vent, de l’enflure soufflée par une certaine convention qu’on aime à reconnaître pour se rassurer à défaut d’autre modèle, à défaut surtout d’imagination réelle, à défaut d’un véritable ailleurs de l’âme. On n’a toujours que les valeurs où l’on a traîné et que l’on a trop traînées avec soi, comme des parfums fanés et puants.
Albert doit choisir, comme tout le monde, parce qu’il faut. Pas dépressif, lucide, désir d’idéal par envie de sens, et puis juste pion, poète, hédonique, pessimiste, catatonique et enfin mort. Une succession, pas un parcours, moins un itinéraire. Tout raté, pas moyen d’accomplir quelque chose : le monde est trop bas et le sens trop haut. Décalage de l’être à la société comme de l’être à l’au-delà. Pas même pathétique, l’émotion se mérite, ici rien de transfigurable, rien d’une jésucrucifixion. Une drôle d’impasse, sans plus, sans sublimité, fatalité sans fatalisme : la vie comme état inchangeable, comme définition inflexible, avec, à cause de la vitalité, de très vaines tentatives de dépassement. Des curiosités successives, échouées et pas même tellement décevantes. Il fallait tenter et voir : impulsion, réflexe, instinct, sans plus. Le médiocre fatidique n’est jamais tragique, comme tout ce qui se regarde de loin et avec ennui. Une mécanique. Ça bouge et ça cesse de bouger.
Et ce style assorti : Dumur goûte la dénaturation du langage, l’anti-spontanéité du verbe, souvent plaisamment excentrique ou profondément poétique, léger ou bien lourd – comme le fond. Pas naturel : mainte expérience, ni fluide pour l’esprit, pas d’habituation – littéraire. Des artifices élaborés, sapience de savantasse, mot déplacé, déparé, résistant à l’entrain, examiné – dissection. Spirituel et monstrueux. Évidemment, c’est un roman sur rien autant que sur le rien, sur l’anéantissement de l’essor, invariable annonce d’échecs désémus, intrigue sur la négligence délibérée d’une histoire, où tout ramène au sentiment d’une étrangeté, d’un dérangé, de l’idéal même d’une fiction, récit systématiquement inutile – de l’art, démonstration de style, insuffisant car œuvre uniquement sur l’insuffisance foncière d’exister, ontologique essence de vanité avec sa forme exactement congruente, contenant ensemble sa beauté intrinsèque et son défaut ad hoc.
Lien : http://henrywar.canalblog.com
Monsieur de Bougrelon est un roman sur rien ou presque sur rien, quasi sans intrigue, une couleur avant d’être une somme d’actions, le récit de deux Français en visite à Amsterdam qui s’ennuient dans ces rues froides et mal peuplées et qui rencontrent une truculence de haute lignée, Bougrelon lui-même, qui se propose cicérone vers de sensuelles distractions tout en leur racontant, d’un ton passionnément désuet, les événements pittoresques de son passé français d’aristocrate. Ce cyrano défraîchi, acculé à une fière misère, constitue la voix de presque toute la narration, quoique le narrateur soit l’un des touristes, mais il est si volubile et tant fascinant d’ampoule et d’incongruité qu’il occupe à lui seul la place et même le volume de ce court roman, avec ses parures ostentatoires de dandy intempestif qui le font universellement étranger et disparate, avec ses discours enflés de style et bardés de jeux lexicaux où l’originalité tapageuse rend l’impression d’une figure démesurée à la culture pléthorique, avec ses récits de femmes convoitées, d’exil d’outre-siècle et de divertissements surannés autant que bizarres, avec toute sa dignité empressée de pathétique chimère. Il racontera entre autres, en convoitant des portraits sulfureux et en pelotant des musées de pelisses, comme une certaine femme qui lui résista fut assassinée par son serviteur noir qu’elle exaspérait de son corps tentateur, comme les yeux de la morte lui furent ensuite évoqués par un caniche fille qu’il poursuivit jusque dans les ruelles les plus sombres, puis comme cette chienne après avoir été trucidée par un grand ami noble se rappela à lui sous la forme d’un ananas en bocal qu’il conserva comme un évocatoire infiniment précieux de toute la vie effervescente et profonde des tropiques quintessenciés. Ce récit très fin-de-siècle exacerbe les sens jusqu’à la dégénérescence, dégoûte incommensurablement de la vie moderne, imprègne d’une moite lassitude le désœuvré à la recherche perpétuelle de nouveautés, accompagne tout pérégrination inutile d’un spectre diffus de mélancolie mollement distraite, menace de pamoisons des sangs trop purs qui vaquent comme ils peuvent et profitent presque avec vampirisme de l’occasion d’une balade jusqu’à l’ivresse, comme précédant la trop calme et logique résolution du revolver.
C’est évidemment un travail de haut style que cet écrin de velours qui ne renferme que des fantômes d’être avec ses senteurs passées, une gageure que de savoir à ce point parler d’une absence avec les formes de l’envoûtement, une identité et une littérature que d’assumer une relation uniquement sur des ambiances de chair épuisée, un caractère superbe de ne pas vouloir s’abaisser à l’intérêt des foules engouées que pour des vivacités édifiantes et des déterminations fortes. En demi-teinte, en clair-obscur, en quasi-gothiques abus, des galeries doucereuses d’une pesante malséance, la sensation d’une race en extinction ou dont la décadence se perçoit à la prédominance de manière sur le fait, l’impression d’un souffle brisé avec force alanguissements cardiaques, cadavériques et dévalés – ou bien j’y vois trop, moi seul, dans ces vents violents et ces rideaux d’humidité plombée, le décor propre à exalter ma pensée fascinable et artiste d’une abondance de significations souffreteuses. C’est néanmoins une excellente pièce sur un vide, une pièce sur une façon de combler un vide, une pièce sur le comblement impossible d’un vide au moyen de la posture et de la verve. Évidemment, comme histoire et comme édification, c’est maigre, mais comme type et comme art, quel dédain et quel succès !
Lien : http://henrywar.canalblog.com
C’est évidemment un travail de haut style que cet écrin de velours qui ne renferme que des fantômes d’être avec ses senteurs passées, une gageure que de savoir à ce point parler d’une absence avec les formes de l’envoûtement, une identité et une littérature que d’assumer une relation uniquement sur des ambiances de chair épuisée, un caractère superbe de ne pas vouloir s’abaisser à l’intérêt des foules engouées que pour des vivacités édifiantes et des déterminations fortes. En demi-teinte, en clair-obscur, en quasi-gothiques abus, des galeries doucereuses d’une pesante malséance, la sensation d’une race en extinction ou dont la décadence se perçoit à la prédominance de manière sur le fait, l’impression d’un souffle brisé avec force alanguissements cardiaques, cadavériques et dévalés – ou bien j’y vois trop, moi seul, dans ces vents violents et ces rideaux d’humidité plombée, le décor propre à exalter ma pensée fascinable et artiste d’une abondance de significations souffreteuses. C’est néanmoins une excellente pièce sur un vide, une pièce sur une façon de combler un vide, une pièce sur le comblement impossible d’un vide au moyen de la posture et de la verve. Évidemment, comme histoire et comme édification, c’est maigre, mais comme type et comme art, quel dédain et quel succès !
Lien : http://henrywar.canalblog.com
Je retrouve avec plaisir la plume enlevée et acerbe de Jean Lorrain, dans cette histoire courte mais éloquente sur l'hypocrisie qui peut régner dans certains milieux fermés.
Il parle décidément très joliment de la nature humaine et des rapports biaisés par les buts différents entretenus sur un même sujet, qu'il soit artistique, sentimentale ou sociétal.
La mésaventure de Mme Farnier peut si facilement être retranscrite dans un autre lieu et une autre époque, qu'elle aurait très bien pu se passer par exemple de nos jours : rien n'a vraiment changé si ce n'est l'enrobage.
Il parle décidément très joliment de la nature humaine et des rapports biaisés par les buts différents entretenus sur un même sujet, qu'il soit artistique, sentimentale ou sociétal.
La mésaventure de Mme Farnier peut si facilement être retranscrite dans un autre lieu et une autre époque, qu'elle aurait très bien pu se passer par exemple de nos jours : rien n'a vraiment changé si ce n'est l'enrobage.
Dans Monsieur de Phocas (1901) de Jean Lorrain, le monsieur de Phocas en question, bizarrement, disparait après les premières pages. C'est un pseudonyme du duc de Fréneuse, le protagoniste, pseudonyme qui est rapidement laissé de côté. Tout comme dans A rebours de Huysmans, on est en plein dans le roman décadentiste : Fréneuse est extrêmement riche par héritage, il a épuisé tous les plaisirs de l'existence et il désespère de trouver quoi que ce soit de satisfaisant. Ici, ses tourments ont un petit air de possession par une entité orientale : il a des visions, il se réfugie dans l'art, il cherche une lueur particulière et insaisissable dans les yeux humains...
Ce qui fonctionne bien dans ce type de roman, c'est le partage des vices entre le protagoniste et la société, voire l'existence humaine en général. Ce n'est pas juste un personnage corrompu par l'extérieur, ni un extérieur corrompu par la perspective malade du personnage : la faute est partagée. C'est par ce filet dont on ne peut s'échapper que vient la sympathie pour un millionnaire décadent comme Fréneuse. Il a les moyens de se débattre, aussi vain que ce soit.
Si ce charme est bien présent, j'ai trouvé la trame assez faible. Le début, qui explore la vie intérieure de Fréneuse, est agréable, mais par la suite notre duc se retrouve embourbé dans une relation toxique avec Ethal, un peintre qui perçoit ses tourments et décide de jouer avec. Ainsi Fréneuse perd beaucoup de sa personnalité et se retrouve comme mené par le bout du doigt, ce qui m'a semblé ne pas se marier très bien avec l'esprit de ce type de roman, où justement toute l'horreur vient d'être livré à soi-même dans un monde où rien n'est attirant. Tout comme dans A rebours, il y a régulièrement des passages plus aiguisés qui viennent motiver à continuer sa lecture, notamment ce moment où, passant la nuit dans un hôtel sordide, notre duc de Fréneuse, qui a tout connu du sexe mais rien de l'amour, se retrouve à espionner le couple de la chambre voisine. Pas de prostitution pour ces deux-là, non, juste un jeune couple sincère, deux personnes naïves qui s'aiment, partagent par des mots et des gestes primaires quelque chose que Fréneuse n'a jamais effleuré.
Lien : http://lespagesdenomic.blogs..
Ce qui fonctionne bien dans ce type de roman, c'est le partage des vices entre le protagoniste et la société, voire l'existence humaine en général. Ce n'est pas juste un personnage corrompu par l'extérieur, ni un extérieur corrompu par la perspective malade du personnage : la faute est partagée. C'est par ce filet dont on ne peut s'échapper que vient la sympathie pour un millionnaire décadent comme Fréneuse. Il a les moyens de se débattre, aussi vain que ce soit.
Si ce charme est bien présent, j'ai trouvé la trame assez faible. Le début, qui explore la vie intérieure de Fréneuse, est agréable, mais par la suite notre duc se retrouve embourbé dans une relation toxique avec Ethal, un peintre qui perçoit ses tourments et décide de jouer avec. Ainsi Fréneuse perd beaucoup de sa personnalité et se retrouve comme mené par le bout du doigt, ce qui m'a semblé ne pas se marier très bien avec l'esprit de ce type de roman, où justement toute l'horreur vient d'être livré à soi-même dans un monde où rien n'est attirant. Tout comme dans A rebours, il y a régulièrement des passages plus aiguisés qui viennent motiver à continuer sa lecture, notamment ce moment où, passant la nuit dans un hôtel sordide, notre duc de Fréneuse, qui a tout connu du sexe mais rien de l'amour, se retrouve à espionner le couple de la chambre voisine. Pas de prostitution pour ces deux-là, non, juste un jeune couple sincère, deux personnes naïves qui s'aiment, partagent par des mots et des gestes primaires quelque chose que Fréneuse n'a jamais effleuré.
Lien : http://lespagesdenomic.blogs..
Le crime des riches est un recueil de nouvelles de notre ami Jean Lorrain, prince des décadents fin-de-siècle, "enfilanthrope" de première, journaliste et écrivain à la langue de vipère et aux mots assassins.
Les formidables éditions du Chat Rouge rééditent avec brio ce livre publié il y a 115 ans et qui flamboie toujours de mille feux acides.
On y croise des vieilles peaux fardées sur leur terre de prédilection, la Riviera, "quelques gargouilles en rupture de cathédrale", dont divers narrateurs se font un plaisir de raconter les perfidies, les mensonges et les immondices qu'elles cachent derrière le vernis luxueux de leurs villas étincelantes.
Carnavals, fêtes foraines et lieux interlopes sont aussi le terrain de chasse de Lorrain, qui s'y plaisait autant que dans les lieux les plus nobles. Plus la fange sentait mauvais plus son acuité semblait s'épanouir à observer et caricaturer (à peine cela dit) les grands noms de ce monde, ducs et duchesses, marquis et marquises, princes pervers et princesses aux secrets plus fournis que leurs tiroirs à bijoux.
C'est succulent, incisif, drôle et amer tout à la fois et l'on rêverait que Lorrain soit encore là pour nous faire rire et frémir du monde de faux semblants dans lequel nous vivons, toujours.
Les formidables éditions du Chat Rouge rééditent avec brio ce livre publié il y a 115 ans et qui flamboie toujours de mille feux acides.
On y croise des vieilles peaux fardées sur leur terre de prédilection, la Riviera, "quelques gargouilles en rupture de cathédrale", dont divers narrateurs se font un plaisir de raconter les perfidies, les mensonges et les immondices qu'elles cachent derrière le vernis luxueux de leurs villas étincelantes.
Carnavals, fêtes foraines et lieux interlopes sont aussi le terrain de chasse de Lorrain, qui s'y plaisait autant que dans les lieux les plus nobles. Plus la fange sentait mauvais plus son acuité semblait s'épanouir à observer et caricaturer (à peine cela dit) les grands noms de ce monde, ducs et duchesses, marquis et marquises, princes pervers et princesses aux secrets plus fournis que leurs tiroirs à bijoux.
C'est succulent, incisif, drôle et amer tout à la fois et l'on rêverait que Lorrain soit encore là pour nous faire rire et frémir du monde de faux semblants dans lequel nous vivons, toujours.
Voilà un traité d'esthétique du déchet dispendieux.
Belle Époque mais pas Années Folles, c'est un peu le pendant européen à Gatsby le magnifique de Francis Scott Fitzgerald (si, si, j'ose). Mais le glamour agaçant des Américains n'a pas droit de cité ici. Je m'en trouve très bien personnellement.
Les Noronsoff constituent un tourbillon narratif délicieusement fin-de-siècle, avec le cortège d'images foutraques et maladives qui vont avec, option luxe oriental grand teint, lubies d'aristocrates désœuvrés, fin de race et mépris de classe; voire à l'occasion une touche de Fragonard pour le parfum d'alcôve et l'hommage nostalgique à la licence XVIIIème. Pour ce goût de moisi je suis bon public (j'ai raté hélas l'examen de gendre idéal). Pour faire bon poids, Lorrain ajoute le vocabulaire idoine tout aussi délicieusement suranné (oaristys ou oarystis, c'est une question orthographique qui agite les foules) et les références appuyées à Suétone, aux turpitudes de Néron, à l'extravagance d'Héliogabale, aux nymphes, à Adonis. Pour cet hommage érudit à l'Antiquité j'applaudis (j'ai réussi haut la main l'examen de cuistre).
Ceci dit, dans le genre (le mauvais genre) on peut tout de même trouver plus vénéneux. Cette lecture est fort plaisante, scandaleusement charmante, avec quelques rebondissements - le pus et la malédiction bohémienne sont servis à discrétion - mais je m'attendais à un feu d'artifice légèrement plus coloré après la grosse dose d'humour du début. Movere, docere, placere: je me suis demandé si c'est consciemment ou non que Lorrain aurait gardé sur ce Néron moderne (et sa mère dédoublée) un fond de point de vue moral de Suétone et de Racine . Mais rassurez-vous, l'auteur n'écrit pas pour l'édification des rosières. On reste là dans une joyeuse série B et un sympathique concerto de l'agonie.
Alors, on ne va pas bouder son plaisir. Vous reprendrez bien un peu de décadence ?
Belle Époque mais pas Années Folles, c'est un peu le pendant européen à Gatsby le magnifique de Francis Scott Fitzgerald (si, si, j'ose). Mais le glamour agaçant des Américains n'a pas droit de cité ici. Je m'en trouve très bien personnellement.
Les Noronsoff constituent un tourbillon narratif délicieusement fin-de-siècle, avec le cortège d'images foutraques et maladives qui vont avec, option luxe oriental grand teint, lubies d'aristocrates désœuvrés, fin de race et mépris de classe; voire à l'occasion une touche de Fragonard pour le parfum d'alcôve et l'hommage nostalgique à la licence XVIIIème. Pour ce goût de moisi je suis bon public (j'ai raté hélas l'examen de gendre idéal). Pour faire bon poids, Lorrain ajoute le vocabulaire idoine tout aussi délicieusement suranné (oaristys ou oarystis, c'est une question orthographique qui agite les foules) et les références appuyées à Suétone, aux turpitudes de Néron, à l'extravagance d'Héliogabale, aux nymphes, à Adonis. Pour cet hommage érudit à l'Antiquité j'applaudis (j'ai réussi haut la main l'examen de cuistre).
Ceci dit, dans le genre (le mauvais genre) on peut tout de même trouver plus vénéneux. Cette lecture est fort plaisante, scandaleusement charmante, avec quelques rebondissements - le pus et la malédiction bohémienne sont servis à discrétion - mais je m'attendais à un feu d'artifice légèrement plus coloré après la grosse dose d'humour du début. Movere, docere, placere: je me suis demandé si c'est consciemment ou non que Lorrain aurait gardé sur ce Néron moderne (et sa mère dédoublée) un fond de point de vue moral de Suétone et de Racine . Mais rassurez-vous, l'auteur n'écrit pas pour l'édification des rosières. On reste là dans une joyeuse série B et un sympathique concerto de l'agonie.
Alors, on ne va pas bouder son plaisir. Vous reprendrez bien un peu de décadence ?
Le récit narre les trois derniers mois de la vie d’Ellen Horneby, une très jeune fille issue de l’aristocratie anglaise, frappée depuis quelques années par un mal mystérieux qui la rend fébrile et décharnée, et flétrit précocement sa jeunesse. Tout comme Jean Lorrain, Ellen est envoyée au doux soleil de la Riviera pour y retrouver la santé. Accompagnée par sa mère, Lady Horneby, Ellen est installée à Hyères, où elle se meurt d’ennui, entre cette génitrice étouffante et apeurée, qui ne cesse de vouloir contraindre sa fille à rester enfermée, et un médecin peu passionné par cette patiente, qu’il juge tout bonnement phtisique
On l'aura deviné, « Ellen » est un roman désespéré, quoique curieusement centré sur le désespoir de l’adolescence. Car par-delà la symbolique de cette mystérieuse maladie, c’est le spleen fin de siècle qui tue la trop sensible Ellen, cernée par une famille inflexible et pragmatique où nul ne parvient à la comprendre. Étrange initiative chez un quinquagénaire souffreteux de signer cette version féminine de l’histoire de Chatterton. Peu de romans de la Belle-Époque abordent la difficulté du passage à l’âge adulte, celui-ci mérite donc d’être cité, même si Jean Lorrain est ici dans une démarche purement romantique, qui pourtant ne lui ressemble guère. Rien de luxurieux, ni même de sensuel dans ces pages : Ellen est une jeune fille pure et chaste, dont les élans libidineux ne dépassent pas l’envie d’un baiser sur la bouche par son fiancé. Jean Lorrain qui a si souvent décrit des prostituées, des catins, des mères maquerelles, surprend son lecteur avec cette touchante beauté virginale et maladive, décrite avec une justesse, une cohérence, un réalisme vraiment attendrissants. Est-ce une vraie malade, croisée à la station thermale où il reposait, qui lui a inspiré ce si beau portrait ? On ne le saura sans doute jamais…
« Ellen » n’est pas passé loin d’être un vrai chef d’œuvre de la littérature française. Quelques défauts de fabrication le minent néanmoins assez notablement. Emporté par le raffinement extrême de sa rhétorique, Jean Lorrain perd parfois le fil de son récit, ou oublie un personnage en cours de route. Le précaire état de santé de l’écrivain n’y a sans doute pas été étranger. Ensuite, même en 1906, la forme littéraire de ce récit était tout de même un peu surannée, particulièrement si on le comparait aux autres romans de Jean Lorrain, pas souvent aussi réussis mais souvent plus modernes. Ajoutons à cela que publié l’année même de la mort de Lorrain, avec deux autres romans retrouvés dans ses archives, ce livre a été sans doute un peu commercialisé comme un fond de tiroir. Pourtant, « Ellen » est une œuvre majeure de Jean Lorrain, malgré ses défauts et son style inhabituel. Rarement Lorrain se sera montré sous ce jour académique et néanmoins brillant, inspiré, évoluant dans un romantisme tourmenté, presque noir, qui se veut aussi, via la nationalité de son héroïne, un hommage appuyé à ces femmes de lettres britanniques à la santé fragile qu’il a sans doute beaucoup lues : Charlotte Brontë, Emily Brontë, Mary Webb, George Eliot, etc…
Au-delà de l’intrigue dramatique, « Ellen » est aussi paradoxalement une merveilleuse évocation de la Provence fleurie et ensoleillée. Jean Lorrain en donne une retranscription vivante et intemporelle, qui complète, sans s’y opposer, la lente chute dépressive d’Ellen. En ce sens, le roman ne sombre jamais dans une ambiance morbide ou délétère. S’il est question d’enfermement, d’isolement, qui oppresse Ellen Horneby, c’est par les murs de mensonge, de conventions absurdes, que dressent devant elle des gens qui sont persuadés de l’aimer. De ce fait, il n’est pas contradictoire de dire que ce roman, « Ellen » est aussi un tragique hymne à la jeunesse et à la vie, et rappelle, dans ce décor féerique et avec cette jeune fille à l’agonie sublime, que nous autres, êtres humains, sommes bien souvent nos propres bourreaux.
Lien : https://mortefontaine.wordpr..
On l'aura deviné, « Ellen » est un roman désespéré, quoique curieusement centré sur le désespoir de l’adolescence. Car par-delà la symbolique de cette mystérieuse maladie, c’est le spleen fin de siècle qui tue la trop sensible Ellen, cernée par une famille inflexible et pragmatique où nul ne parvient à la comprendre. Étrange initiative chez un quinquagénaire souffreteux de signer cette version féminine de l’histoire de Chatterton. Peu de romans de la Belle-Époque abordent la difficulté du passage à l’âge adulte, celui-ci mérite donc d’être cité, même si Jean Lorrain est ici dans une démarche purement romantique, qui pourtant ne lui ressemble guère. Rien de luxurieux, ni même de sensuel dans ces pages : Ellen est une jeune fille pure et chaste, dont les élans libidineux ne dépassent pas l’envie d’un baiser sur la bouche par son fiancé. Jean Lorrain qui a si souvent décrit des prostituées, des catins, des mères maquerelles, surprend son lecteur avec cette touchante beauté virginale et maladive, décrite avec une justesse, une cohérence, un réalisme vraiment attendrissants. Est-ce une vraie malade, croisée à la station thermale où il reposait, qui lui a inspiré ce si beau portrait ? On ne le saura sans doute jamais…
« Ellen » n’est pas passé loin d’être un vrai chef d’œuvre de la littérature française. Quelques défauts de fabrication le minent néanmoins assez notablement. Emporté par le raffinement extrême de sa rhétorique, Jean Lorrain perd parfois le fil de son récit, ou oublie un personnage en cours de route. Le précaire état de santé de l’écrivain n’y a sans doute pas été étranger. Ensuite, même en 1906, la forme littéraire de ce récit était tout de même un peu surannée, particulièrement si on le comparait aux autres romans de Jean Lorrain, pas souvent aussi réussis mais souvent plus modernes. Ajoutons à cela que publié l’année même de la mort de Lorrain, avec deux autres romans retrouvés dans ses archives, ce livre a été sans doute un peu commercialisé comme un fond de tiroir. Pourtant, « Ellen » est une œuvre majeure de Jean Lorrain, malgré ses défauts et son style inhabituel. Rarement Lorrain se sera montré sous ce jour académique et néanmoins brillant, inspiré, évoluant dans un romantisme tourmenté, presque noir, qui se veut aussi, via la nationalité de son héroïne, un hommage appuyé à ces femmes de lettres britanniques à la santé fragile qu’il a sans doute beaucoup lues : Charlotte Brontë, Emily Brontë, Mary Webb, George Eliot, etc…
Au-delà de l’intrigue dramatique, « Ellen » est aussi paradoxalement une merveilleuse évocation de la Provence fleurie et ensoleillée. Jean Lorrain en donne une retranscription vivante et intemporelle, qui complète, sans s’y opposer, la lente chute dépressive d’Ellen. En ce sens, le roman ne sombre jamais dans une ambiance morbide ou délétère. S’il est question d’enfermement, d’isolement, qui oppresse Ellen Horneby, c’est par les murs de mensonge, de conventions absurdes, que dressent devant elle des gens qui sont persuadés de l’aimer. De ce fait, il n’est pas contradictoire de dire que ce roman, « Ellen » est aussi un tragique hymne à la jeunesse et à la vie, et rappelle, dans ce décor féerique et avec cette jeune fille à l’agonie sublime, que nous autres, êtres humains, sommes bien souvent nos propres bourreaux.
Lien : https://mortefontaine.wordpr..
Formidable recueil pour découvrir l'oeuvre de Jean Lorrain... En neuf nouvelles vous aurez un aperçu de ses talents narratifs, de sa capacité à plonger ses lecteurs dans les cauchemars de ses obsessions. Masques terrifiants, créatures fantastiques, hallucinations et tortures du spleen, le tout dans une atmosphère d'éther, cette drogue que Lorrain affectionnait tant. Comme l'évoque avec justesse Gérald Duchemin en préface, il n'y avait à l'époque aucune difficulté légale à s'en procurer et à s'en régaler, au point que Lorrain en avait créé un cocktail : "Râpures de noix de coco, fraises et cerises fraîches dans un bain de champagne frappé, et là-dessus cinq cuillérées à café d'éther". Sautez donc, à votre retour dans le monde, sur la superbe édition des Editions du Chat Rouge !
Écrivain prolifique de la décadence, Jean Lorrain (1855-1906) a, comme ses collègues, publié un grand nombre de textes dans des journaux et revues. Beaucoup ont été rassemblés en recueils par divers éditeurs. Aujourd’hui, les Âmes d’Atala font paraître le leur, sous le joli titre un tantinet désuet de Miscellanées – nom parfaitement adapté dans la mesure où, comme le confesse d’ailleurs l’éditeur scientifique des textes, ce recueil propose un mélange hétéroclite. Les écrits choisis sont regroupés en cinq sections : des contes, des impressions de voyage, deux récits inspirés par l’amitié tournée au vinaigre entre Lorrain et Jeanne Jacquemin, des textes autour de Salomé et enfin deux histoires de crimes. Tous les textes ne se valent pas, me semble-t-il ; certains sont assez anecdotiques. D’autres, en revanche, sont de petits bijoux qui reflètent à merveille l’art de Lorrain, son style ciselé et son imaginaire violent et bigarré.
Dans les contes, les nains fantastiques de l’araignée du Néthou précèdent les oies féeriques de Normandie, objets d’un récit légèrement patoisant. Un pastiche de conte de princesse est entrecoupé de scènes mettant en scène deux Anglaises contemporaines assez vulgaires, tandis que des rêveries ouvrent la porte à des visions cruelles et esthétiques.
Du côté des impressions de voyage, la vision très stéréotypée d’une Espagne pétrie de dévotion morbide et d’excès précède une promenade pittoresque au fil de la Seine, laquelle est suivie d’une plongée dans les quartiers de la prostitution à Marseille, où les femmes perdues sont tout à la fois viande et masques.
Les textes mettant en scène la « peintresse des yeux » Jeanne Jacquemin parlent d’art, d’esprit et de sensualité. Ils sont intéressants notamment en ce qu’ils montrent la technique du remploi littéraire : d’un texte à l’autre, nombre d’expressions, de phrases sont reprises. Une économie d’effort fréquemment observée chez les auteurs qui publiaient beaucoup dans les journaux. Ils illustrent aussi la fameuse dent dure de Lorrain envers ses contemporains.
Les textes associés à Salomé, figure chérie de la fin du siècle, évoquent ici la tentatrice fatale, là les avatars artistiques de la Danseuse. Dans l’un, les masques font leur retour sur un mode burlesque, tandis qu’un autre est l’occasion d’un portrait d’Oscar Wilde, auteur d’une Salomé théâtrale qui fit date.
Les deux derniers venus dans le livre sont très dissemblables. Le premier, fort réussi, est une fiction qui fait d’une couleur l’origine d’un meurtre (il fallait y penser !), alors que le second se présente comme le récit d’une visite à la morgue et sur les lieux supposés d’un crime. Tous deux exaltent un macabre emprunt de fascination propre à l’esprit décadent.
Somme toute, ce recueil varié se lit avec plaisir et permet d’envisager diverses facettes de l’art de Jean Lorrain, dont le visage aux yeux lourds orne la couverture du volume. Pour ne rien gâcher, le livre est charmant avec son costume violet au toucher délicieusement doux. Le violet dont Lorrain écrit, dans la nouvelle Le Vieux Rose : « Le violet est cruel, humble, rampant, sinistre ; les crimes des évêques, trahisons et supplices, flamboient dans ses reflets », et qui revêtait déjà, dans une nuance un peu différente, les couvertures de la célèbre Bibliothèque décadente des éditions Séguier… Bref, une couleur parfaite pour accompagner ces mots fin de siècle.
Lien : https://litteraemeae.wordpre..
Dans les contes, les nains fantastiques de l’araignée du Néthou précèdent les oies féeriques de Normandie, objets d’un récit légèrement patoisant. Un pastiche de conte de princesse est entrecoupé de scènes mettant en scène deux Anglaises contemporaines assez vulgaires, tandis que des rêveries ouvrent la porte à des visions cruelles et esthétiques.
Du côté des impressions de voyage, la vision très stéréotypée d’une Espagne pétrie de dévotion morbide et d’excès précède une promenade pittoresque au fil de la Seine, laquelle est suivie d’une plongée dans les quartiers de la prostitution à Marseille, où les femmes perdues sont tout à la fois viande et masques.
Les textes mettant en scène la « peintresse des yeux » Jeanne Jacquemin parlent d’art, d’esprit et de sensualité. Ils sont intéressants notamment en ce qu’ils montrent la technique du remploi littéraire : d’un texte à l’autre, nombre d’expressions, de phrases sont reprises. Une économie d’effort fréquemment observée chez les auteurs qui publiaient beaucoup dans les journaux. Ils illustrent aussi la fameuse dent dure de Lorrain envers ses contemporains.
Les textes associés à Salomé, figure chérie de la fin du siècle, évoquent ici la tentatrice fatale, là les avatars artistiques de la Danseuse. Dans l’un, les masques font leur retour sur un mode burlesque, tandis qu’un autre est l’occasion d’un portrait d’Oscar Wilde, auteur d’une Salomé théâtrale qui fit date.
Les deux derniers venus dans le livre sont très dissemblables. Le premier, fort réussi, est une fiction qui fait d’une couleur l’origine d’un meurtre (il fallait y penser !), alors que le second se présente comme le récit d’une visite à la morgue et sur les lieux supposés d’un crime. Tous deux exaltent un macabre emprunt de fascination propre à l’esprit décadent.
Somme toute, ce recueil varié se lit avec plaisir et permet d’envisager diverses facettes de l’art de Jean Lorrain, dont le visage aux yeux lourds orne la couverture du volume. Pour ne rien gâcher, le livre est charmant avec son costume violet au toucher délicieusement doux. Le violet dont Lorrain écrit, dans la nouvelle Le Vieux Rose : « Le violet est cruel, humble, rampant, sinistre ; les crimes des évêques, trahisons et supplices, flamboient dans ses reflets », et qui revêtait déjà, dans une nuance un peu différente, les couvertures de la célèbre Bibliothèque décadente des éditions Séguier… Bref, une couleur parfaite pour accompagner ces mots fin de siècle.
Lien : https://litteraemeae.wordpre..
Indispensable pour toutes les amoureuses de littérature fin-de-siècle. Belles présentations de Guy Ducrey. Et puis, les bouquins sont gros ! J'aime !
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur
Auteurs proches de Jean Lorrain
Lecteurs de Jean Lorrain (312)Voir plus
Quiz
Voir plus
Hervé Bazin ou François Mauriac
La Mort du petit cheval ?
Hervé Bazin
François Mauriac
10 questions
30 lecteurs ont répondu
Créer un quiz sur cet auteur30 lecteurs ont répondu