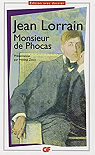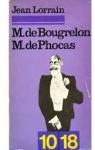Nationalité : France
Né(e) à : Fécamp , le 09/08/1855
Mort(e) à : Paris , le 30/06/1906
Né(e) à : Fécamp , le 09/08/1855
Mort(e) à : Paris , le 30/06/1906
Biographie :
Paul Alexandre Martin Duval, dit Jean Lorrain, est un écrivain français. Poète parnassien, il est l'un des écrivains scandaleux de la Belle Époque.
Né dans une famille d'armateurs, destiné à devenir lui-même armateur, Jean Lorrain naquit, comme le souligne Thibaut d'Anthonay, en 1882 lorsqu'il décida de devenir écrivain.
Installé définitivement à Paris, en 1884, il soumet ses premiers écrits à des revues disparates : la Vie moderne, la Revue indépendante, Lutèce, la Revue normande, l'Art et la Mode, le Chat noir, etc. - Il publie aussi des poèmes : le Sang des dieux, la Forêt bleue ; à compte d'auteur. Et il fréquente la bohème qui gravite autour de Rodolphe Salis.
La même année, il publie dans le Courrier français une série de portraits élogieux et irrévérencieux dont un sur Rachilde, qui venait de publier quatre ans auparavant Monsieur Vénus, avec qui il se lie d'amitié ; de complicité serait plus juste. À partir de ce moment-là, il se crée un personnage qui circule de cabarets en bals costumés, de Montmartre au quartier Latin, vêtu de costumes outranciers ; allant même se présenter à l'un des bals des Quat'z-Arts en maillot rose avec le caleçon en peau de panthère de son ami, le Lutteur Marseillais.
Il est tout de suite remarqué d'autant plus qu'il affiche de façon ostentatoire son homosexualité. L'allusion grivoise, les gauloiseries, les bons vieux ragots de fesse font partie de ce personnage qu'il est devenu mais il se targue aussi d'être un esthète, se lançant dans la critique de spectacles, de peintures, de sculptures où il devient vite encore plus redoutable. Sa critique de "Les plaisirs et les jours" d'un jeune écrivain mondain lui vaut un duel. - Et des duels, il en aura, des gifles aussi et même des attaques physiques.
En 1891, son recueil de nouvelles Sonyeuse lui vaut son premier succès de librairie. En 1897, la critique salue son roman Monsieur de Bougrelon comme un chef d'œuvre.
Et il sera de tous les vices et de tous les plaisirs défendus. Il deviendra éthéromane, par exemple, car l'éther deviendra à la mode. - Et ses nombreuses aventures qu'on n'ose pas qualifier d'amoureuses le rendent encore plus amères. - Sa santé en souffre. Opéré puis ré-opéré, il se perfore les intestins en tentant de s'administrer un lavement. Pozzi refuse de l'opérer à nouveau et il meurt entouré de la seule personne qui lui est restée fidèle toute sa vie : sa mère.
Jean Lorrain, mais aussi Mérimée, Maupassant, Alexandre Dumas ou bien enco
+ Voir plusPaul Alexandre Martin Duval, dit Jean Lorrain, est un écrivain français. Poète parnassien, il est l'un des écrivains scandaleux de la Belle Époque.
Né dans une famille d'armateurs, destiné à devenir lui-même armateur, Jean Lorrain naquit, comme le souligne Thibaut d'Anthonay, en 1882 lorsqu'il décida de devenir écrivain.
Installé définitivement à Paris, en 1884, il soumet ses premiers écrits à des revues disparates : la Vie moderne, la Revue indépendante, Lutèce, la Revue normande, l'Art et la Mode, le Chat noir, etc. - Il publie aussi des poèmes : le Sang des dieux, la Forêt bleue ; à compte d'auteur. Et il fréquente la bohème qui gravite autour de Rodolphe Salis.
La même année, il publie dans le Courrier français une série de portraits élogieux et irrévérencieux dont un sur Rachilde, qui venait de publier quatre ans auparavant Monsieur Vénus, avec qui il se lie d'amitié ; de complicité serait plus juste. À partir de ce moment-là, il se crée un personnage qui circule de cabarets en bals costumés, de Montmartre au quartier Latin, vêtu de costumes outranciers ; allant même se présenter à l'un des bals des Quat'z-Arts en maillot rose avec le caleçon en peau de panthère de son ami, le Lutteur Marseillais.
Il est tout de suite remarqué d'autant plus qu'il affiche de façon ostentatoire son homosexualité. L'allusion grivoise, les gauloiseries, les bons vieux ragots de fesse font partie de ce personnage qu'il est devenu mais il se targue aussi d'être un esthète, se lançant dans la critique de spectacles, de peintures, de sculptures où il devient vite encore plus redoutable. Sa critique de "Les plaisirs et les jours" d'un jeune écrivain mondain lui vaut un duel. - Et des duels, il en aura, des gifles aussi et même des attaques physiques.
En 1891, son recueil de nouvelles Sonyeuse lui vaut son premier succès de librairie. En 1897, la critique salue son roman Monsieur de Bougrelon comme un chef d'œuvre.
Et il sera de tous les vices et de tous les plaisirs défendus. Il deviendra éthéromane, par exemple, car l'éther deviendra à la mode. - Et ses nombreuses aventures qu'on n'ose pas qualifier d'amoureuses le rendent encore plus amères. - Sa santé en souffre. Opéré puis ré-opéré, il se perfore les intestins en tentant de s'administrer un lavement. Pozzi refuse de l'opérer à nouveau et il meurt entouré de la seule personne qui lui est restée fidèle toute sa vie : sa mère.
Jean Lorrain, mais aussi Mérimée, Maupassant, Alexandre Dumas ou bien enco
Source : www.udenap.org
Ajouter des informations
étiquettes
Podcasts (1)
Citations et extraits (135)
Voir plus
Ajouter une citation
MÉLUSINE
Les bras nus cerclés d'or et froissant le brocart
De sa robe argentée aux taillis d'aubépines,
Mélusine apparaît entre les herbes fines,
Les cheveux révoltés, saignante et l'oeil hagard.
La splendeur de sa gorge éblouit le regard
Et l'émail de ses dents a des clartés divines ;
Mais Mélusine est folle et fait dans les ravines
Paître au pied des sapins la biche et le brocart.
Depuis cent ans qu'elle erre au pied des arbres fées,
Elle est fée elle-même ; un charme étrange et doux
La fait suivre à minuit des renards et des loups.
Ses yeux au ciel nocturne enchantent les hiboux,
Et près d'elle, érigeant ses fleurs en clairs trophées,
Jaillit un glaïeul rose à feuillage de houx.
Les bras nus cerclés d'or et froissant le brocart
De sa robe argentée aux taillis d'aubépines,
Mélusine apparaît entre les herbes fines,
Les cheveux révoltés, saignante et l'oeil hagard.
La splendeur de sa gorge éblouit le regard
Et l'émail de ses dents a des clartés divines ;
Mais Mélusine est folle et fait dans les ravines
Paître au pied des sapins la biche et le brocart.
Depuis cent ans qu'elle erre au pied des arbres fées,
Elle est fée elle-même ; un charme étrange et doux
La fait suivre à minuit des renards et des loups.
Ses yeux au ciel nocturne enchantent les hiboux,
Et près d'elle, érigeant ses fleurs en clairs trophées,
Jaillit un glaïeul rose à feuillage de houx.
MORGANE
Un pâle clair de lune allonge sur la grève
L'ombre de hauts clochers et de grands toits, où rêve
Tout un choeur de géants et d'archanges ailés.
Pourtant la ville est loin, à plus de deux cents lieues ;
La dune est solitaire et les toits dentelés,
Les clochers, les pignons et les murs crénelés,
Sur le sable et les flots montent en ombres bleues.
Au fond des profondeurs du ciel gris remuées
Toute une ville étrange apparaît : des palais,
Des campaniles d'or, hantés de clairs reflets,
Et des grands escaliers croulant dans les nuées.
Leur ombre grandissante envahit les galets
Et Morgane, accoudée au milieu des nuages,
Berce au-dessus des mers la ville des mirages.
Un pâle clair de lune allonge sur la grève
L'ombre de hauts clochers et de grands toits, où rêve
Tout un choeur de géants et d'archanges ailés.
Pourtant la ville est loin, à plus de deux cents lieues ;
La dune est solitaire et les toits dentelés,
Les clochers, les pignons et les murs crénelés,
Sur le sable et les flots montent en ombres bleues.
Au fond des profondeurs du ciel gris remuées
Toute une ville étrange apparaît : des palais,
Des campaniles d'or, hantés de clairs reflets,
Et des grands escaliers croulant dans les nuées.
Leur ombre grandissante envahit les galets
Et Morgane, accoudée au milieu des nuages,
Berce au-dessus des mers la ville des mirages.
"Ne trouvez-vous pas, monsieur le duc, que la marquise de Sarlèze ressemble étrangement à une cigogne ce soir ?"
C'était fou et c'était vrai.
Avec son long cou granulé, sa face étroite, ses yeux ronds aux paupières membraneuses, avec son grand nez effilé surtout, effilé comme un bec et l'artifice évident des faux cheveux adhérant mal au crâne, la marquise de Sarlèze était, ce soir-là, une effarante cigogne de cauchemar. La ressemblance m'apparut tout à fait criante, et je sentais ma raison sombrer dans l'inconnu ; car dans la buée lumineuse des lustres, le long des hautes fenêtres drapées de satin vert pâle et dans l'embrasure des portes, les salons de l'hôtel de Sarlèze venaient de se peupler de masques.
La femme au piano, qui chantait, à moitié nue, comme entraînée en avant par le poids de sa gorge, avait le profil d'une brebis bêlante ; le blond de ses cheveux avait jusqu'à l'aspect terne et laineux d'une toison. De Tramsel dégageait un museau de renard, Mireau, le romancier, une gueule de hyène ; dans le groupe des femmes assises, toutes les fleurs du faubourg en corbeille pourtant, c'étaient des édifices de plumes, de gazes et de soie peintes écrasant des cous frêles et des poitrines plates : d'étroites épaules engoncées de manches énormes, la maigreur étoffée des phtisies à la mode, ou bien, pis encore, l'éléphantiasis cuirassée de jais des grosses dames, et cela sous les jets crus du gaz. De lourdes faces bovines, des prunelles aqueuses de vaches ruminantes à côté de fronts fuyants de carnassiers et d'yeux ronds d'oiseaux de proie.
Debout près du Pleyel, la dame à la face moutonnière, la comtesse de Barville, continuait à bêler du Chaminade ; un pianiste, un professionnel aux yeux saillants de batracien dans une pauvre petite figure écrasée et stupide, l'accompagnait en saccade avec des gestes hâtifs.
L'enfilade des salons de l'hôtel de Sarlèze, leurs longs parallélogrammes d'anciennes boiseries à peine rehaussées d'or, peuplés littéralement de spectres et, comme dans un envoûtement, l'atmosphère toute grouillante de larves, telle une goute d'eau vue au microscope, laissait transparaître avec les âmes les épouvantables faces des instincts et des pensées ignobles. Autour de nous, grimaçaient, tournoyaient des bouches d'ombre.
C'était fou et c'était vrai.
Avec son long cou granulé, sa face étroite, ses yeux ronds aux paupières membraneuses, avec son grand nez effilé surtout, effilé comme un bec et l'artifice évident des faux cheveux adhérant mal au crâne, la marquise de Sarlèze était, ce soir-là, une effarante cigogne de cauchemar. La ressemblance m'apparut tout à fait criante, et je sentais ma raison sombrer dans l'inconnu ; car dans la buée lumineuse des lustres, le long des hautes fenêtres drapées de satin vert pâle et dans l'embrasure des portes, les salons de l'hôtel de Sarlèze venaient de se peupler de masques.
La femme au piano, qui chantait, à moitié nue, comme entraînée en avant par le poids de sa gorge, avait le profil d'une brebis bêlante ; le blond de ses cheveux avait jusqu'à l'aspect terne et laineux d'une toison. De Tramsel dégageait un museau de renard, Mireau, le romancier, une gueule de hyène ; dans le groupe des femmes assises, toutes les fleurs du faubourg en corbeille pourtant, c'étaient des édifices de plumes, de gazes et de soie peintes écrasant des cous frêles et des poitrines plates : d'étroites épaules engoncées de manches énormes, la maigreur étoffée des phtisies à la mode, ou bien, pis encore, l'éléphantiasis cuirassée de jais des grosses dames, et cela sous les jets crus du gaz. De lourdes faces bovines, des prunelles aqueuses de vaches ruminantes à côté de fronts fuyants de carnassiers et d'yeux ronds d'oiseaux de proie.
Debout près du Pleyel, la dame à la face moutonnière, la comtesse de Barville, continuait à bêler du Chaminade ; un pianiste, un professionnel aux yeux saillants de batracien dans une pauvre petite figure écrasée et stupide, l'accompagnait en saccade avec des gestes hâtifs.
L'enfilade des salons de l'hôtel de Sarlèze, leurs longs parallélogrammes d'anciennes boiseries à peine rehaussées d'or, peuplés littéralement de spectres et, comme dans un envoûtement, l'atmosphère toute grouillante de larves, telle une goute d'eau vue au microscope, laissait transparaître avec les âmes les épouvantables faces des instincts et des pensées ignobles. Autour de nous, grimaçaient, tournoyaient des bouches d'ombre.
Amsterdam, c'est toujours de l'eau et des maisons peintes en blanc et noir, tout en vitres, avec pignons sculptés et rideaux de guipure ; du noir, du blanc se dédoublant dans l'eau. Donc, c'est toujours de l'eau, de l'eau morte, de l'eau moirée et de l'eau grise, des allées d'eau qui ne finissent plus, des canaux gardés par des logis pareils à des jeux de dominos énormes ; ça pourrait être funèbre et pourtant ça n'est pas triste, mais c'est un peu monotone à la longue, surtout quand il gèle et que l'étain figé des canaux ne mire plus les belles petites maisons de poupée, perron en l'air et tête en bas.
Oui, il était mon amant ! Il est hideux, je le sais...La vie coûte à Paris !
Mais il s'agit bien de cela !
Ce corps ne peut pas rester ici, ma fille dort à côté, presque porte à porte, et mon fils à la pension !
Ce serait affreux, songez, la police ici, le concierge, le scandale dans la maison et les les journaux et moi-même traitée en fille publique !....
Ah !....et puis, vous savez, Mr Bariller est marié ; il y a une femme, des enfants, une famille, je ne peux pas leur renvoyer ça !.....
Mais il s'agit bien de cela !
Ce corps ne peut pas rester ici, ma fille dort à côté, presque porte à porte, et mon fils à la pension !
Ce serait affreux, songez, la police ici, le concierge, le scandale dans la maison et les les journaux et moi-même traitée en fille publique !....
Ah !....et puis, vous savez, Mr Bariller est marié ; il y a une femme, des enfants, une famille, je ne peux pas leur renvoyer ça !.....
Mme Adèle était une brune quadragénaire à l'arrière train énorme, une engorgée et massive commère dont les yeux capotes et le profil absent nageaient dans la graisse.
Le rouge outrageant de ses joues n'en animait pas la pâleur. Ses sourcils peints, ses cheveux gras de pommade et les bajoues de sa face blafarde en faisaient un type accompli de matrone.
Ses bras trop courts émergeant en ailerons d'un peignoir de surah mauve, elle avait installé sa croulante personne parmi les coussins Liberty d'un divan et nous faisait maintenant les honneurs du boudoir.
Le rouge outrageant de ses joues n'en animait pas la pâleur. Ses sourcils peints, ses cheveux gras de pommade et les bajoues de sa face blafarde en faisaient un type accompli de matrone.
Ses bras trop courts émergeant en ailerons d'un peignoir de surah mauve, elle avait installé sa croulante personne parmi les coussins Liberty d'un divan et nous faisait maintenant les honneurs du boudoir.
Est-ce pour m'être trop complu dans l'eau froide des joyaux que mes prunelles ont pris cette clairvoyance atroce ? La vérité est que je souffre et meurs de ce que ne voient pas les autres et de ce que, moi, je vois!
- Mais une qui ne m'a pas emballé, oh ! ça non ! c'est leur grande vedette, et ils en font pourtant un foin pour elle. Vous connaissez, vous, Mlle Yls ? Mais, c'est pas une femme, c'est une canne à pêche, ça n'a ni tétons, ni fesses.
En v'là une qui n'ferait pas un sou chez nous, et ça couche dans le lit des princes !
Ah ! on peut bien dire que les gens d'la haute ont l'estomac fatigué !
Y faut guère avoir d'appétit pour aimer une femme ainsi torchée, y a pas la place pour aimer ; mais si j'avais ça chez moi, j'la mettrais sur une étagère et encore j'aurais peur de l'épousseter.
Ah ! non, que je n'la gobe pas, vot' demoiselle Plumeau.
En v'là une qui n'ferait pas un sou chez nous, et ça couche dans le lit des princes !
Ah ! on peut bien dire que les gens d'la haute ont l'estomac fatigué !
Y faut guère avoir d'appétit pour aimer une femme ainsi torchée, y a pas la place pour aimer ; mais si j'avais ça chez moi, j'la mettrais sur une étagère et encore j'aurais peur de l'épousseter.
Ah ! non, que je n'la gobe pas, vot' demoiselle Plumeau.
"Et avec ça, la clientèle qui chipote, grognasse et se fait de plus en plus regardante...des fournitures qui deviennent de jour en jour inférieures..., et la concurrence, et la plus déloyale, tolérée dans la rue.
Ainsi à Aubry-les-Epinettes il y a bien deux régiments, et, les jours de marché, toute la campagne qui rapplique ; et les cultivateurs, ça, c'est un rendement sûr ; mais il y a aussi les fabriques, deux tissages et un cardage de coton...et les ouvrières ! Ah ! monsieur Jacques, les ouvrières de fabrique ! Et la police ferme les yeux, elle ne dit rien, la police ; mais elle ne se gêne pas pour me dresser des contraventions.
A la moindre infraction, il faut voir si ça tombe ! Comme la grêle sur le blé d'avril ! Ces filles de fabrique, ça se donne pour vingt sous, quelque fois moins, au bord d'un champ, derrière une haie, où ça se trouve, tandis que chez moi c'est deux francs, pas moins, et, si l'on reste la nuit, la thune...
Mais il n'y a pas à dire, établissement régulier, ça n'a jamais l'excitant de l'aventure.
Ainsi à Aubry-les-Epinettes il y a bien deux régiments, et, les jours de marché, toute la campagne qui rapplique ; et les cultivateurs, ça, c'est un rendement sûr ; mais il y a aussi les fabriques, deux tissages et un cardage de coton...et les ouvrières ! Ah ! monsieur Jacques, les ouvrières de fabrique ! Et la police ferme les yeux, elle ne dit rien, la police ; mais elle ne se gêne pas pour me dresser des contraventions.
A la moindre infraction, il faut voir si ça tombe ! Comme la grêle sur le blé d'avril ! Ces filles de fabrique, ça se donne pour vingt sous, quelque fois moins, au bord d'un champ, derrière une haie, où ça se trouve, tandis que chez moi c'est deux francs, pas moins, et, si l'on reste la nuit, la thune...
Mais il n'y a pas à dire, établissement régulier, ça n'a jamais l'excitant de l'aventure.
C'est en sortie qu'il faut connaître ces dames.
A la maison elles se ressemblent toutes ; il y a que la couleur des cheveux qui diffère ; c'est toutes les mêmes vaches en peignoir.
Mais, une fois dehors, ça fringue et ça se requinque, ça ne vit vraiment que les jours de ballade. C'est alors que vous les poissez sur le tas, rigolant comme matelots en bordée et satisfaisant, chacune, sa petite passion et son vice.
Il y a les marchandes d'ail qui vont rejoindre leurs gousses, ça se carre à Montmartre ; les sentimentales ont un petit homme et vont à la campagne filer le parfait amour ; il y a les chahuteuses que vous trouverez au bal des Vaches ou à Nogent, chez Convert ; les veuves, celles qui cherchent à se marier par besoin de tendresse ; la Groseille à maquereau, la mistonne à béguins. Celle-là sait où trouver les hommes, les gros et les beaux, et ce n'est pas loin d'ici ; mais il y a les jours. Il faut les savoir.
A la maison elles se ressemblent toutes ; il y a que la couleur des cheveux qui diffère ; c'est toutes les mêmes vaches en peignoir.
Mais, une fois dehors, ça fringue et ça se requinque, ça ne vit vraiment que les jours de ballade. C'est alors que vous les poissez sur le tas, rigolant comme matelots en bordée et satisfaisant, chacune, sa petite passion et son vice.
Il y a les marchandes d'ail qui vont rejoindre leurs gousses, ça se carre à Montmartre ; les sentimentales ont un petit homme et vont à la campagne filer le parfait amour ; il y a les chahuteuses que vous trouverez au bal des Vaches ou à Nogent, chez Convert ; les veuves, celles qui cherchent à se marier par besoin de tendresse ; la Groseille à maquereau, la mistonne à béguins. Celle-là sait où trouver les hommes, les gros et les beaux, et ce n'est pas loin d'ici ; mais il y a les jours. Il faut les savoir.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur
Auteurs proches de Jean Lorrain
Lecteurs de Jean Lorrain (314)Voir plus
Quiz
Voir plus
Concours : Vita et Virginia
Quel livre Virginia Woolf a-t-elle écrit en s’inspirant de son amante Vita Sackwille-West ?
Les Vagues
Orlando
Une chambre à soi
Mrs Dalloway
5 questions
155 lecteurs ont répondu
Thème :
Virginia WoolfCréer un quiz sur cet auteur155 lecteurs ont répondu