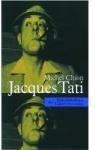Nationalité : France
Né(e) à : Creil (Oise) , le 16/01/1947
Né(e) à : Creil (Oise) , le 16/01/1947
Biographie :
Michel Chion est un compositeur de musique concrète, réalisateur, enseignant de cinéma et critique.
Après des études littéraires et musicales, il entre en 1970 au Service de la recherche de l'ORTF, où il est successivement assistant de Pierre Schaeffer au Conservatoire national de musique de Paris, réalisateur-producteur des émissions du GRM, et responsable des publications de l'Ina-GRM, dont il fait partie de 1971 à 1976.
Parallèlement, il compose dans les studios du GRM des « musiques concrètes », dont le Requiem (Grand prix du disque 1978) et plusieurs mélodrames concrets, forme dramatique qu'il inaugure en 1972 avec Le prisonnier du son.
Il ouvre comme théoricien un domaine neuf: l'étude systématique des rapports audio-visuels, qu'il enseigne dans plusieurs centres (notamment à l'Université de Paris III, où il est Professeur associé) et écoles de cinéma (La Fémis, l'ESEC, DAVI), et développe dans un ensemble de cinq ouvrages.
Parmi une vingtaine de titres traduits dans une dizaine de langues, il a écrit aussi sur Pierre Henry, François Bayle, Charlie Chaplin, Jacques Tati, David Lynch, Andreï Tarkovski divers sujets de musique et de cinéma, publié dans des revues françaises et internationales et contribué à de nombreux dictionnaires et encyclopédies.
+ Voir plusMichel Chion est un compositeur de musique concrète, réalisateur, enseignant de cinéma et critique.
Après des études littéraires et musicales, il entre en 1970 au Service de la recherche de l'ORTF, où il est successivement assistant de Pierre Schaeffer au Conservatoire national de musique de Paris, réalisateur-producteur des émissions du GRM, et responsable des publications de l'Ina-GRM, dont il fait partie de 1971 à 1976.
Parallèlement, il compose dans les studios du GRM des « musiques concrètes », dont le Requiem (Grand prix du disque 1978) et plusieurs mélodrames concrets, forme dramatique qu'il inaugure en 1972 avec Le prisonnier du son.
Il ouvre comme théoricien un domaine neuf: l'étude systématique des rapports audio-visuels, qu'il enseigne dans plusieurs centres (notamment à l'Université de Paris III, où il est Professeur associé) et écoles de cinéma (La Fémis, l'ESEC, DAVI), et développe dans un ensemble de cinq ouvrages.
Parmi une vingtaine de titres traduits dans une dizaine de langues, il a écrit aussi sur Pierre Henry, François Bayle, Charlie Chaplin, Jacques Tati, David Lynch, Andreï Tarkovski divers sujets de musique et de cinéma, publié dans des revues françaises et internationales et contribué à de nombreux dictionnaires et encyclopédies.
Source : Wikipédia
Ajouter des informations
étiquettes
Citations et extraits (15)
Voir plus
Ajouter une citation
Tati a peint son époque comme un changement d'époque; ce faisant, il était toujours décalé.
A propos du film " Mon Oncle ", Truffaut disait :
Mon oncle, un film qui concerne notre époque mais sans nous la montrer puisque les deux mondes en opposition sont celui d'il y a vingt ans et celui dans lequel on vivra dans vingt ans.
A propos du film " Mon Oncle ", Truffaut disait :
Mon oncle, un film qui concerne notre époque mais sans nous la montrer puisque les deux mondes en opposition sont celui d'il y a vingt ans et celui dans lequel on vivra dans vingt ans.
Si l'on veut conserver le " regard à la Tati" qu'il nous arrive d'avoir sur le monde, pendant quelques minutes, au sortir de ces films, il nous faut adopter une attitude très spéciale de retrait corporel.
Quant chez Tati l'on voit de près, ce n'est plus de la vision, c'est de l'odorat, du flair.
Le monde, que nous admirons, n'a pas besoin pour être beau d'être regardé. Le monde ne cesse pas de vivre sous prétexte que les hommes se font la guerre : le vent continue de souffler, les herbes de se balancer, le soleil d'apparaître et de disparaître derrière les nuages, et de raviver les couleurs du monde, l'aurore se lève toujours. C'est ce que montre le film.
Ce que je pourrais dire sur ce que j’ai voulu raconter dans mes films n’aurait aucune importance. C’est comme si vous déterriez un type mort et que vous lui demandiez de vous parler de son livre.
David Lynch
David Lynch
Chaque œuvre joue […] sa partie propre, qui ne coïncide pas forcément avec l’intérêt des œuvres suivantes, non plus qu’avec celui de son auteur. Elle peut atteindre au sublime et à l’universel en échappant à son créateur…
Lorsqu’on a une idée pour la première fois, elle recèle une puissance intrinsèque. Il faut essayer de ne pas oublier le sentiment que l’on éprouvait au moment où l’on a eu cette idée, et y rester fidèle.
David Lynch
David Lynch
Le cinéma, pour moi, c’est un désir très fort de marier l’image au son. Lorsque j’y parviens, j’en éprouve un véritable frisson. En vérité, je ne suis pas sûr de rechercher autre chose que ce frisson.
David Lynch
David Lynch
Affirmer le contraste, en somme, comme le fait Lynch sur tous les plans, c’est fonctionner en séparateur du monde. C’est mettre de la séparation dans le continuum naturel. C’est créer.
La science -fiction met à jour les fantasmes et les questions nés avec l'histoire du monde, les progrès de la médecine et l'évolution des lois, des connaissances et des mœurs. Elle permet des métaphores hardies sur le destin de l'espèce.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur
Auteurs proches de Michel Chion
Quiz
Voir plus
Blanc, Noir... ou bien Gris ?
Jack London a écrit :
Croc-Blanc
Croc-Noir
Croc-Gris
20 questions
2618 lecteurs ont répondu
Thèmes :
noir et blanc
, couleur
, humour
, littérature
, contrairesCréer un quiz sur cet auteur2618 lecteurs ont répondu