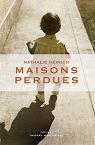Critiques de Nathalie Heinich (81)
La sociologue Nathalie Heinich livre une réflexion sur le capital de visibilité, ressource sociale caractérisée par la dissymétrie entre le nombre de personnes qui reconnaissent un individu et ceux qu’elle reconnaît.
Lien : http://www.laviedesidees.fr/..
Lien : http://www.laviedesidees.fr/..
Cet essai est d'une lecture lumineuse pour se forger un jugement non polémique sur l'art contemporain qui est bien différent de l'art moderne. L'analyse de la sociologue Nathalie Heinich se veut sans parti pris , uniquement basée sur des faits irréfutables. Pour certains c'est un art fondamentalement en crise parce que la transgression ne peut pas se renouveler éternellement, on ne peut pas inventer tout le temps de nouvelles formes de transgression, tandis que pour d'autres il ne cesse de se renouveler. Au lecteur de se faire une idée, mais dés lors de le transgressif est institutionnalisé et que les artistes court-circuitent le système marchand traditionnel on est en droit de s'interroger sur les conflits d'intérêts qui minent ce "genre artistique".
On ne sait pas très bien expliquer à quoi sert l'art, on se demande même très souvent ce qui est de l'art et ce qui n'en est pas. Ce livre pose la question d'aborder l'art par la société.
Si la sociologie a un mérite, c'est d'avoir fait tomber l'art de son piédestal. De montrer que l'art ne se réduit pas à l'étude de la beauté, d'une part, et qu'il n'est pas non plus un idéal, une valeur absolue indiscutable. Sans être totalement le "produit" d'une société, il semble clairement que la production artistique ne peut être totalement hors de l'influence, des conditions de vie de la société qui l'héberge. Un seul exemple donné est éclairant: Norbert Elias expliquant que le style gothique pouvait trouver sa source non dans un symbole d'élévation spirituelle, mais tout simplement comme le résultat de la concurrence entre cités et États pour construire plus haut que les autres.
L'auteur aborde le sujet en nous brossant le tableau des différentes approches de l'art par des sociologues. On en retient qu'il y eut plusieurs périodes: tout d'abord centrée sur les œuvres, on est passé à l'étude critique des institutions - par exemple les musées, les académies, et le mécénat, dont on sait le rôle majeur qu'il joue aujourd'hui; puis enfin, par des enquêtes, à l'étude de la réception des œuvres d'art par le public.
On me pardonnera cette simplification outrageuse, qu'il est sans doute utile d'éclairer par un exemple. À cet effet, Nathalie Heinich analyse la question de l'authenticité des œuvres, notion incontournable dans notre rapport à l'art. Dans la première approche, nous dit-elle, il s'agit d'établir en quoi un produit est authentique. Dans une approche critique, on mettra en lumière que cette notion d'authenticité est une construction sociale, l'expression d'une violence symbolique imposant une légitimité sur le public et les acteurs du monde de l'art, qui nous amène à y croire (on est presque dans le fétichisme religieux). Enfin, dans la troisième approche, pragmatique, on étudie les processus concrets d'authentification, les compétences requises pour être un expert, d'une part, et d'autre part, on essaiera d'analyser les émotions, les effets sur les personnes, d'une œuvre d'art présentée comme authentique.
Parfois un peu savant, le livre reste accessible à tout public. Comme d'habitude dans cette collection, il fait appel à une synthèse des théories des nombreux penseurs de la question, de Benjamin à Bourdieu. Synthèse qui se double d'une analyse critique de ces mêmes théories, dont on retient qu'aucune n'est parfaite.
Parmi les éléments intéressants, on trouvera notamment quelques réflexions sur la position des artistes. On apprend ainsi que les artistes viennent de milieux sociaux très divers, mais qu'ils épousent souvent une femme (car la majorité sont des hommes) d'un niveau supérieur. Qu'ils se déclarent fréquemment autodidactes, alors qu'ils ont fait des études supérieures. La question de l'inspiration est également évoquée, certains artistes eux-mêmes insistant pour la déconstruire, affirmant que la création est un travail comme un autre.
Si ce petit bouquin est également fort utile, c'est aussi parce qu'il se demande à quoi peut servir la sociologie. On peut essayer d'y répondre par une boutade. L'art ne sert à rien, mais la vie sans art serait bien moins passionnante. Je crois qu'on peut en dire autant de la sociologie?
Si la sociologie a un mérite, c'est d'avoir fait tomber l'art de son piédestal. De montrer que l'art ne se réduit pas à l'étude de la beauté, d'une part, et qu'il n'est pas non plus un idéal, une valeur absolue indiscutable. Sans être totalement le "produit" d'une société, il semble clairement que la production artistique ne peut être totalement hors de l'influence, des conditions de vie de la société qui l'héberge. Un seul exemple donné est éclairant: Norbert Elias expliquant que le style gothique pouvait trouver sa source non dans un symbole d'élévation spirituelle, mais tout simplement comme le résultat de la concurrence entre cités et États pour construire plus haut que les autres.
L'auteur aborde le sujet en nous brossant le tableau des différentes approches de l'art par des sociologues. On en retient qu'il y eut plusieurs périodes: tout d'abord centrée sur les œuvres, on est passé à l'étude critique des institutions - par exemple les musées, les académies, et le mécénat, dont on sait le rôle majeur qu'il joue aujourd'hui; puis enfin, par des enquêtes, à l'étude de la réception des œuvres d'art par le public.
On me pardonnera cette simplification outrageuse, qu'il est sans doute utile d'éclairer par un exemple. À cet effet, Nathalie Heinich analyse la question de l'authenticité des œuvres, notion incontournable dans notre rapport à l'art. Dans la première approche, nous dit-elle, il s'agit d'établir en quoi un produit est authentique. Dans une approche critique, on mettra en lumière que cette notion d'authenticité est une construction sociale, l'expression d'une violence symbolique imposant une légitimité sur le public et les acteurs du monde de l'art, qui nous amène à y croire (on est presque dans le fétichisme religieux). Enfin, dans la troisième approche, pragmatique, on étudie les processus concrets d'authentification, les compétences requises pour être un expert, d'une part, et d'autre part, on essaiera d'analyser les émotions, les effets sur les personnes, d'une œuvre d'art présentée comme authentique.
Parfois un peu savant, le livre reste accessible à tout public. Comme d'habitude dans cette collection, il fait appel à une synthèse des théories des nombreux penseurs de la question, de Benjamin à Bourdieu. Synthèse qui se double d'une analyse critique de ces mêmes théories, dont on retient qu'aucune n'est parfaite.
Parmi les éléments intéressants, on trouvera notamment quelques réflexions sur la position des artistes. On apprend ainsi que les artistes viennent de milieux sociaux très divers, mais qu'ils épousent souvent une femme (car la majorité sont des hommes) d'un niveau supérieur. Qu'ils se déclarent fréquemment autodidactes, alors qu'ils ont fait des études supérieures. La question de l'inspiration est également évoquée, certains artistes eux-mêmes insistant pour la déconstruire, affirmant que la création est un travail comme un autre.
Si ce petit bouquin est également fort utile, c'est aussi parce qu'il se demande à quoi peut servir la sociologie. On peut essayer d'y répondre par une boutade. L'art ne sert à rien, mais la vie sans art serait bien moins passionnante. Je crois qu'on peut en dire autant de la sociologie?
En décrivant le parcours et les problématiques de trois artistes, cette bande dessinée pleine de pédagogie nous permet de comprendre les rouages du monde de l'art contemporain.
Nathalie Heinich, sociologue de l'art mondialement reconnue, s'applique en effet ici à expliquer, sans militantisme aucun et avec beaucoup de clarté, comment fonctionne cet univers souvent mal compris.
Qu'on aime ou qu'on n'aime pas l'art contemporain, peu importe ! Ce petit livre d'environ 70 pages, agréablement illustré par Benoît Feroumont, parvient à nous éclairer. Où l'on réalise notamment que l'art contemporain partage de très nombreuses caractéristiques avec les précédentes périodes de l'histoire de l'art : salons et expos, critiques d'art, réseaux, collectionneurs, atelier avec assistants pour les plus grands, etc.
L'ouvrage tord également le cou à quelques clichés. Par exemple, si cette galaxie est effectivement très restreinte sur le plan sociologique, on oublie souvent que la proportion d'artistes contemporains qui gagnent beaucoup d'argent grâce à leurs oeuvres est en réalité infime.
Nathalie Heinich, sociologue de l'art mondialement reconnue, s'applique en effet ici à expliquer, sans militantisme aucun et avec beaucoup de clarté, comment fonctionne cet univers souvent mal compris.
Qu'on aime ou qu'on n'aime pas l'art contemporain, peu importe ! Ce petit livre d'environ 70 pages, agréablement illustré par Benoît Feroumont, parvient à nous éclairer. Où l'on réalise notamment que l'art contemporain partage de très nombreuses caractéristiques avec les précédentes périodes de l'histoire de l'art : salons et expos, critiques d'art, réseaux, collectionneurs, atelier avec assistants pour les plus grands, etc.
L'ouvrage tord également le cou à quelques clichés. Par exemple, si cette galaxie est effectivement très restreinte sur le plan sociologique, on oublie souvent que la proportion d'artistes contemporains qui gagnent beaucoup d'argent grâce à leurs oeuvres est en réalité infime.
En résumé : Contemporain. Un recueil de textes autour de la maison, ce lieux de vie que l’on habite autant qu’il nous habite.
En détail :
“La maison qui soigne” livre à travers une série de textes courts, l’histoire qu’entretient l’autrice, Nathalie Heinich, avec sa maison de vacances. Le lecteur suit, de manière décousue et réorganisée en thématiques, l’achat de cette demeure, les déboires des travaux et l’entretien parfois compliqué d’un lieu restant souvent inhabité. Là se trouve l’entièreté de l’intrigue de ce roman, il s’agit d’une lecture calme et contemplative. Ces textes sont tour à tour des récits, des réflexions jetées sur le papier, des correspondances avec une amie, des extraits de carnets personnels. Tous autour du lien qui se crée entre nous et notre lieu d’habitation, ce lieu qui nous ressemble ou que nous désirons voir nous ressembler, qui doit être notre refuge mais aussi celui où nous invitons des personnes extérieures. C’est ce lien qu’explore la narratrice : comment une maison qu’elle trouvait même au départ un peu moche, finit par devenir son coin de paradis.
Le texte retranscrit le plaisir de l’autrice à aménager et emplir ce lieu qu’elle s’approprie. Les bibliothèques à remplir, les lampes à chiner, les plantes à installer dans le jardin. Le récit tourne parfois à l’inventaire, mais sans lourdeur : les textes restent courts et les descriptions de l’aménagement sont entrecoupées d'anecdotes et de réflexions. Cette maison sera la dernière et l’on sent la détermination de la narratrice à en faire son lieu de vie idéal, somme de tous ses désirs de décoration et de confort.
Nathalie Heinich est une sociologue qui a publié de nombreux ouvrages en lien avec son domaine de compétences (la sociologie de l’art et l’identité féminine notamment).“La maison qui soigne”, qui fait suite à “Maisons perdues”, est un texte plus personnel.
De la même autrice : Maisons perdues
Dans le même genre : Au coeur des maisons, de Donatella Caprioglio
En détail :
“La maison qui soigne” livre à travers une série de textes courts, l’histoire qu’entretient l’autrice, Nathalie Heinich, avec sa maison de vacances. Le lecteur suit, de manière décousue et réorganisée en thématiques, l’achat de cette demeure, les déboires des travaux et l’entretien parfois compliqué d’un lieu restant souvent inhabité. Là se trouve l’entièreté de l’intrigue de ce roman, il s’agit d’une lecture calme et contemplative. Ces textes sont tour à tour des récits, des réflexions jetées sur le papier, des correspondances avec une amie, des extraits de carnets personnels. Tous autour du lien qui se crée entre nous et notre lieu d’habitation, ce lieu qui nous ressemble ou que nous désirons voir nous ressembler, qui doit être notre refuge mais aussi celui où nous invitons des personnes extérieures. C’est ce lien qu’explore la narratrice : comment une maison qu’elle trouvait même au départ un peu moche, finit par devenir son coin de paradis.
Le texte retranscrit le plaisir de l’autrice à aménager et emplir ce lieu qu’elle s’approprie. Les bibliothèques à remplir, les lampes à chiner, les plantes à installer dans le jardin. Le récit tourne parfois à l’inventaire, mais sans lourdeur : les textes restent courts et les descriptions de l’aménagement sont entrecoupées d'anecdotes et de réflexions. Cette maison sera la dernière et l’on sent la détermination de la narratrice à en faire son lieu de vie idéal, somme de tous ses désirs de décoration et de confort.
Nathalie Heinich est une sociologue qui a publié de nombreux ouvrages en lien avec son domaine de compétences (la sociologie de l’art et l’identité féminine notamment).“La maison qui soigne”, qui fait suite à “Maisons perdues”, est un texte plus personnel.
De la même autrice : Maisons perdues
Dans le même genre : Au coeur des maisons, de Donatella Caprioglio
Un percutant recueil de textes consacrés aux ravages de l'écriture inclusive
Lien : https://www.marianne.net/cul..
Lien : https://www.marianne.net/cul..
"Tracts" est une intéressante petite collection pour une première approche d'un sujet.
Ce que je retiens de ce numéro 29 est que la recherche fait fausse route et que le militantisme pervertit son but premier : la connaissance.
Nathalie Heinrich aborde la notion de la neutralité axiologique de la recherche et le fait que le sociologue n'a pas à prendre position sur son objet et doit suspendre son opinion personnelle dans le cadre de ses recherches.
L'auteur redoute que les "chercheurs", notamment dans le domaine des sciences humaines et tout particulièrement en sociologie, ne partent d'un a priori et que leurs travaux n'aient pour finalité que de confirmer cet a priori, au risque de mettre de côté ce qui la contredirait.
D'autant qu'ils subissent peu de contrôles et d'évaluations sur la qualité de leurs travaux de la part d'universitaires pourtant habilités à le faire.
Au risque que l'idéologie ne remplace la connaissance.
Au risque aussi que les étudiants militants deviennent les futurs enseignants dans un cercle désastreux et pernicieux.
Ce que je retiens de ce numéro 29 est que la recherche fait fausse route et que le militantisme pervertit son but premier : la connaissance.
Nathalie Heinrich aborde la notion de la neutralité axiologique de la recherche et le fait que le sociologue n'a pas à prendre position sur son objet et doit suspendre son opinion personnelle dans le cadre de ses recherches.
L'auteur redoute que les "chercheurs", notamment dans le domaine des sciences humaines et tout particulièrement en sociologie, ne partent d'un a priori et que leurs travaux n'aient pour finalité que de confirmer cet a priori, au risque de mettre de côté ce qui la contredirait.
D'autant qu'ils subissent peu de contrôles et d'évaluations sur la qualité de leurs travaux de la part d'universitaires pourtant habilités à le faire.
Au risque que l'idéologie ne remplace la connaissance.
Au risque aussi que les étudiants militants deviennent les futurs enseignants dans un cercle désastreux et pernicieux.
Je pense que c’est un ouvrage tout à fait intéressant et accessible pour qui voudrait découvrir le féminisme vu par le prisme de la littérature occidentale. En effet, l’écriture n’est pas compliquée pour rien, au contraire, l’essai se lit plutôt bien, agréablement. Elle donne de nombreuses pistes de réflexions qui ne demandent qu’à être continuées. Cela peut être donc une porte d’entrée pour s’intéresser au féminisme par le biais de l’art littéraire ou une manière de se lancer dans le féminisme littéraire.
Après avoir lu ce livre, on traque plus facilement les situations « attendues » des personnages féminins. Et croyez moi, ce n’est pas facile de s’en dépêtre !
Heinich explique les carcans qui poursuivent littéralement et littérairement les femmes. En effet, la fiction, comme elle le montre, permet une forme d’étude anthropologique de la société dans laquelle elle puise ses racines. Elle dénoncent les attentes, les statuts entre lesquels les femmes ont le choix : épouse, mère, vierge… Ils ne sont pas foulent et démontrent tous le mépris de la société envers les femmes, et les personnages dans lesquels elles pourraient oser se projeter.
Si beaucoup de choses nous paraissent alors désuètes à la lecture, on se rend compte que la pression qui est aujourd’hui exercée sur les femmes est la même. Le média n’est peut-être plus le roman (qui est tristement déserté snif snif) mais les réseaux sociaux : où les femmes s’exhibent en mère parfaite, en cuisinière talentueuses ou en décoratrice d’intérieur.
Dans la littérature, dont Heinich se sert en tant que fenêtre donnant sur notre société, on remarque bien que l’homme ne craint rien à prendre une maîtresse, la seule chose qu’il pourrait craindre serait de déshonorer… sa femme. Lui ne risque rien, lui qui possède le statut et le nom, et elle, jamais rien.
Cette question de femme trompée, d’être la maîtresse ou d’être la seconde hante la littérature occidentale et c’est une grosse partie de l’étude que renferme ce livre.
Enfin, je conseillerais ce livre à un autre type de personne : celui du public qui a la flemme de lire ses classiques. En effet, l’autrice, pour étayer son propos, nous livre l’étude qu’elle fait d’un livre. Ses chapitres sont hantés d’autant de références littéraires qu’elle exploite à la lumière de sa thèse.
Après avoir lu ce livre, on traque plus facilement les situations « attendues » des personnages féminins. Et croyez moi, ce n’est pas facile de s’en dépêtre !
Heinich explique les carcans qui poursuivent littéralement et littérairement les femmes. En effet, la fiction, comme elle le montre, permet une forme d’étude anthropologique de la société dans laquelle elle puise ses racines. Elle dénoncent les attentes, les statuts entre lesquels les femmes ont le choix : épouse, mère, vierge… Ils ne sont pas foulent et démontrent tous le mépris de la société envers les femmes, et les personnages dans lesquels elles pourraient oser se projeter.
Si beaucoup de choses nous paraissent alors désuètes à la lecture, on se rend compte que la pression qui est aujourd’hui exercée sur les femmes est la même. Le média n’est peut-être plus le roman (qui est tristement déserté snif snif) mais les réseaux sociaux : où les femmes s’exhibent en mère parfaite, en cuisinière talentueuses ou en décoratrice d’intérieur.
Dans la littérature, dont Heinich se sert en tant que fenêtre donnant sur notre société, on remarque bien que l’homme ne craint rien à prendre une maîtresse, la seule chose qu’il pourrait craindre serait de déshonorer… sa femme. Lui ne risque rien, lui qui possède le statut et le nom, et elle, jamais rien.
Cette question de femme trompée, d’être la maîtresse ou d’être la seconde hante la littérature occidentale et c’est une grosse partie de l’étude que renferme ce livre.
Enfin, je conseillerais ce livre à un autre type de personne : celui du public qui a la flemme de lire ses classiques. En effet, l’autrice, pour étayer son propos, nous livre l’étude qu’elle fait d’un livre. Ses chapitres sont hantés d’autant de références littéraires qu’elle exploite à la lumière de sa thèse.
Depuis des années la réflexion sociologique de Nathalie Heinich irrigue les sciences humaines d’analyses renouvelées sur l’art contemporain, le statut de l’artiste, la reconnaissance littéraire où encore l’identité féminine. Son oeuvre, à travers une alternance d’ouvrages de recherche et essais, Nathalie Heinich nous propose une pensée féconde et éclairante où la question des valeurs est première. Prolongeant le travail de Pierre Bourdieu tout en prenant certaines distances avec son maître - dont elle a su, soi dit en passant, interroger avec beaucoup d’intelligence sociologique dans “Pourquoi Bourdieu” le statut d’ousider que ce dernier faisait de lui-même - Heinich revient avec “Des valeurs” sur le point nodal de son travail et de son oeuvre.
Le projet d’Heinich est inédit tant par rapport à la tradition philosophique qu’à la tradition sociologique car elle fait appel à deux niveaux d’énonciation : normatif et constatif mais aussi analytico-descriptif . Si la “valeur” est bien l’objet d’étude, c’est dans la discipline de la sociologie que s’inscrit ce projet. Comme le formule la chercheuse : “Quels que soient les matériaux utilisés (corpus littéraires ou archives historiques, articles de presse, entretiens, observations, questionnaires statistiques), l’important est que l’on exerce pas une activité intellectuelle uniquement spéculative , comme dans le cas de la philosophie, mais que l’on raisonne à partir de l’expérience effective.” Travailler sur “le rapport aux valeurs” exigera aussi de se détacher de la philosophie morale qui prétendrait énoncer ce que seraient les vraies valeurs.
En disciple de Max Weber Nathalie Heinich nous propose une approche plutôt désenchanteuse mais le rôle du sociologue n’est-il pas de nous arracher à une métaphysique qui ne dit pas son nom au profit d’un accord raisonné entre les humains. Le lecteur est invité à se plonger dans l’étude de l’activité normative ou axiologique autour de la question de la production du jugement de valeur, il pourra ainsi comprendre à quelles règles sociales dans ce domaine obéissent les humains. Dans une première partie Nathalie Heinich définit ce qu’est exactement un jugement de valeur à travers les diverses modalités de l’opinion, dans la partie 2 est consacrée aux trois sens du mot valeur - la grandeur, le bien, le principe - enfin la troisième partie traite des valeurs en tant que principe de jugement et permet de dégager une “grammaire axiologique” commune. Un ouvrage indispensable dans son domaine.
Archibald PLOOM (CULTURE-CHRONIQUE)
Lien : http://www.culture-chronique..
Le projet d’Heinich est inédit tant par rapport à la tradition philosophique qu’à la tradition sociologique car elle fait appel à deux niveaux d’énonciation : normatif et constatif mais aussi analytico-descriptif . Si la “valeur” est bien l’objet d’étude, c’est dans la discipline de la sociologie que s’inscrit ce projet. Comme le formule la chercheuse : “Quels que soient les matériaux utilisés (corpus littéraires ou archives historiques, articles de presse, entretiens, observations, questionnaires statistiques), l’important est que l’on exerce pas une activité intellectuelle uniquement spéculative , comme dans le cas de la philosophie, mais que l’on raisonne à partir de l’expérience effective.” Travailler sur “le rapport aux valeurs” exigera aussi de se détacher de la philosophie morale qui prétendrait énoncer ce que seraient les vraies valeurs.
En disciple de Max Weber Nathalie Heinich nous propose une approche plutôt désenchanteuse mais le rôle du sociologue n’est-il pas de nous arracher à une métaphysique qui ne dit pas son nom au profit d’un accord raisonné entre les humains. Le lecteur est invité à se plonger dans l’étude de l’activité normative ou axiologique autour de la question de la production du jugement de valeur, il pourra ainsi comprendre à quelles règles sociales dans ce domaine obéissent les humains. Dans une première partie Nathalie Heinich définit ce qu’est exactement un jugement de valeur à travers les diverses modalités de l’opinion, dans la partie 2 est consacrée aux trois sens du mot valeur - la grandeur, le bien, le principe - enfin la troisième partie traite des valeurs en tant que principe de jugement et permet de dégager une “grammaire axiologique” commune. Un ouvrage indispensable dans son domaine.
Archibald PLOOM (CULTURE-CHRONIQUE)
Lien : http://www.culture-chronique..
La corrida est-elle un art ou une torture ? Dans l'arène de ce débat emblématique, la sociologue construit une réflexion passionnante sur le sens de ces valeurs qui nous relient ou nous séparent.
Lien : http://www.telerama.fr/criti..
Lien : http://www.telerama.fr/criti..
Une très bonne entrée en matière pour mieux appréhender ce qu'est aujourd'hui un Artiste Contemporain.
Lien : http://www.sceneario.com/bd_..
Lien : http://www.sceneario.com/bd_..
L'humour est fréquemment au rendez-vous et contribue à rendre cette découverte de l'Art contemporain et de ceux qui le créent aussi plaisante qu'intéressante.
Lien : http://www.auracan.com/album..
Lien : http://www.auracan.com/album..
Une explication sommaire et bien faite de l’industrie de l’art contemporain. La formule de La Petite Bédéthèque des Savoirs ne convainc cependant toujours pas parfaitement.
Lien : http://www.bdgest.com/chroni..
Lien : http://www.bdgest.com/chroni..
La sociologue Nathalie Heinich dresse un portrait global du monde de l’art contemporain. Choisissant des exemples saillants, la sociologue démontre que l’art contemporain correspond à une véritable révolution artistique.
Lien : http://www.laviedesidees.fr/..
Lien : http://www.laviedesidees.fr/..
Nathalie Heinich détaille de manière passionnante "le nouveau paradigme de l’art".
Lien : http://www.lalibre.be/cultur..
Lien : http://www.lalibre.be/cultur..
Les maisons que nous avons connues, où nous avons vêcu depuis notre enfance sont dans notre mémoire, et nous évoquent plus qu'un lieu : une époque, les personnes qui y vivaient avec nous, une atmosphère, des senteurs, des sensations... elles sont en nous. Je partage les sentiments de N. Heinich, et son livre m'a beaucoup touchée
Voilà un livre qui arrive à point nommé ! Paru il y a un an, – une vétille en regard de l'excellence d'un propos foisonnant, de l'étendue du champ d'investigation, de l'immuable actualité du sujet, de sa nécessaire et salutaire opportunité, et de la propension résolument didactique d'une étude très fouillée, à l'heure où tout est patrimoine – l'ouvrage de Nathalie Heinich, chercheure au CNRS et sociologue, nous invite à faire le point et tenter de voir plus clair face à la confusion, aux doutes et aux dérives générés par l'usage abusif voire intempestif de cette notion. Elle se propose de revisiter, de réexaminer la question fondamentale du patrimoine, le sens et les réalités qu'elle recouvre, son histoire, ses protocoles, ses méthodes et ses valeurs, ses fondations intellectuelles, la pérennité des valeurs constitutives de son identité et leur validité : " le bien commun", "l'héritage", le "conserver pour transmettre", et enfin de cerner les spéculations qu'alimente notre imaginaire moderne et vagabond. Serait-il, une fois encore, question de s'assurer de la légimité d'un des plus indispensables fondements de la mémoire et de l'histoire de nos sociétés ? Méthodique, Nathalie Heinich dresse un inventaire historique et technique complet, et finement commenté des façons dont s'élabore le patrimoine. La métaphore, l'image emblématique de la borne Michelin qui figure sur la couverture donne la mesure de la problématique et du postulat du livre qui nous intéresse.
La notion de patrimoine n'est pas le bloc monolithique, froid, figé, opaque et élitiste que le profane se plaît volontiers à imaginer. L'image austère et quelque peu rustique s'efface dès qu'on plonge dans ses arcanes et qu'on découvre qu'elle s'inscrit dans un processus en perpétuel mouvement, sujet aux doutes, aux questionnements et aux remises en question – un work in progress qui se pense en permanence et qui porte encore en lui les stigmates d'une histoire lourde de certitudes, de préjugés, d'antagonismes, de subjectivismes, d'avancées et de reculs, de tâtonnements erratiques, et de versatilités dogmatiques. La notion de patrimoine est tiraillée, contaminée par des considérations exogènes incertaines et douteuses : le "bon goût", les occurences historiques, l'environnement social, les considérations esthétiques, les enjeux politiques, les glissements sémantiques qui freinent, façonnent ou précipitent son évolution vers une spirale exponentielle, une ''inflation patrimoniale" effrénée, selon la remarquable formule de l'auteure. L'ordonnance calibrée des chapitres égraine dans le détail les travers des administrations de tutelle : l'inadéquation des expertises, la relativité des évaluations, le déroulé poussif des procédures, la réglementation intrusive et la déréglementation de convenance, le manque de diligence de l'action administrative, les conflits de compétences, le rôle prospectif et déstabilisant de l'Inventaire [général du patrimoine culturel], le sentiment déchirant d'infinitude et la rude expérience de l'inachevé éprouvés par les "patrimoniaux".
La quête de Nathalie Heinich s'appuye sur une enquête, une méthodologie pragmatique, qui s'inscrit dans la sociologie des valeurs que l'auteure construit en puisant dans la réalité concrète, à grand renfort de témoignages simples, voire crues Ses interlocuteurs sont les acteurs du quotidien et de terrain : agents du patrimoine, chercheurs de l'inventaire, propriétaires, élus, rumeurs. Elle réduit le périmètre de sa méthodologie à une formule lapidaire : "il s'agit non d'expliquer, mais de comprendre". Son approche est constamment émaillée de réfléxions et confidences en discordance avec la vulgate officielle, livrées sans retenue et gorgées d'informations plus que significatives.
Loin d'être un réquisitoire, l'ouvrage fourmille cependant d'observations critiques et évoque sans détour les limites de certains processus dans un effort continu pour contextualiser, illustrer, exemplariser. "Un fois de plus, contrairement à une idée reçue qui a profondément imprégné la politique culturelle, modernisation et démocratisation sont loin d'aller de pair".Pensée caustique où affleure l'indépendance d'esprit et la sagacité d'une sociologue aguerrie.
Alors faut-il repenser la fabrique du patrimoine ?
Nathalie Heinich laisse la question en suspens sans négliger pour autant son lecteur; elle ne nous abreuve pas de termes techniques et d'aphorismes verbeux. Plus le propos est savant, plus la lisibilité s'accroît. La langue est pure, déliée, châtiée. Enfin une écriture "audible"! La limpidité d'un argumentaire largement maîtrisé, l'intérêt de la méthode d' investigation, l'énoncé des idées et la progression de la pensée expriment la logique d'un raisonnement sans heurt, un cheminement intellectuel clair et parfait. Tout cela concourt à faire de ce livre une synthèse critique incontournable, un ouvrage de référence.
[Les directrices ont] composé l’ouvrage en rassemblant une palette aussi nombreuse que variée de cas de possibles de passages à l’art.
Lien : http://www.nonfiction.fr/art..
Lien : http://www.nonfiction.fr/art..
La notion recouvre l'envie de voir des gens connus autant que le désir de devenir soi-même connu. Dans un essai imposant, Nathalie Heinich en analyse aussi bien les conditions matérielles […], la fonction sociale […] ou les enjeux moraux […].
Lien : http://rss.nouvelobs.com/c/3..
Lien : http://rss.nouvelobs.com/c/3..
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur
Auteurs proches de Nathalie Heinich
Lecteurs de Nathalie Heinich (488)Voir plus
Quiz
Voir plus
Pseudonymes d' écrivains : bas les masques !
Arouet est le véritable patronyme de :
Voltaire
Rousseau
Marivaux
13 questions
81 lecteurs ont répondu
Thèmes :
littérature
, pseudonyme
, écrivain
, Mandragores
, classique français
, culture littéraireCréer un quiz sur cet auteur81 lecteurs ont répondu