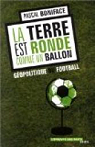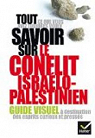Critiques de Pascal Boniface (144)
Les élites françaises n’ont qu’indifférence ou mépris pour le sport. « Opium du peuple », le sport serait un loisir d’ilotes uniquement soucieux de « cirque » et de « pain » pour paraphraser la formule de Juvenal. Pascal Boniface le sait mieux que quiconque, lui qui, depuis une quinzaine d’années a tenté d’ériger le sport en général, le football en particulier, au rang de sujet géopolitique à part entière. Il ne se passe plus désormais de Coupe du Monde qui ne soit l’occasion pour cet auteur prolixe de publier un ouvrage sur le sujet : « Géopolitique du football » en 1999 (suite à un colloque tenu à, l’Assemblée nationale en mars 1998), « La terre et ronde comme un ballon » en mai 2002, « Football et mondialisation » en avril 2006, « La coupe du monde dans tous ses états » en avril 2010. Il ne déroge pas à la règle en publiant, quelques semaines avant le début du Mundial 2014 une « géopolitique du sport » qui étend aux autres disciplines sportives et actualise les idées développées dans ces précédents ouvrages consacrés au football.
Première idée : le sport est un fait social mondial. 14 pays participaient aux jeux olympiques d’Athènes en 1896 ; pas moins de 205 – soit plus que les 193 États membres de l’ONU – ont participé à ceux de Londres en 2012. A l’heure du « village global », les grands événements sportifs rassemblent la planète toute entière : on estime à plus de 2 milliards le nombre de téléspectateurs de la finale de la Coupe du monde le 13 juillet dernier entre l’Allemagne et l’Argentine. 90 Chefs d’Etat et de gouvernement assistaient à la cérémonie d’ouverture des JO de pékin en 2008 Les stars du ballon rond sont universellement reconnues. Leur popularité éclipse celle des chefs d’Etat et des artistes.
Deuxième idée : le sport est multipolaire. La géopolitique du sport est le reflet des rapports de force stratégique. Si, pendant la Guerre froide, Washington et Moscou se disputaient la première place au palmarès olympique, la Chine a effectué une percée impressionnante, devançant les États-Unis aux JO de Pékin (mais devancés par eux aux JO de Londres 4 ans plus tard). L’Occident ne domine plus la scène sportive et n’a plus le monopole de l’organisation des grandes manifestations sportives. En l’espace de dix ans, les BRICs auront accueilli trois JO (Pékin 2008, Sotchi 2014 et Rio 2016) et deux Coupes du monde (Brésil 2014 et Russie 2018). L’organisation de la Coupe du monde de football 2022 au Qatar est un signal fort d’intégration du monde arabe dans la mondialisation.
Troisième idée : le sport suscite la fierté nationale. C’est un paradoxe à l’heure de la mondialisation qui brouille les frontières et dissout les identités. On nous dit que le monde est devenu post-westphalien, que les États sont désormais concurrencés sur la scène internationale par de nouveaux acteurs (entreprises, ONG, médias, mafias, religions ….) ; mais chaque JO, chaque Coupe du monde sont l’occasion d’un engouement chauviniste pour son pays. La popularité des Diables rouges, dans une Belgique qu’on disait à l’agonie, lors du dernier Mundial brésilien en est un exemple. Les États le savent qui n’hésitent pas à en faire un instrument de prestige et de propagande : ce fut le cas à Berlin en 1936 ou, deux ans plus tôt, à Rome lors de la Coupe du monde organisée et remportée par l’Italie.
Quatrième idée : le sport peut réconcilier les peuples et susciter des guerres. Cette idée est réductrice. Comme l’écrit très justement pascal Boniface « la seule rencontre sportive ne viendra pas mettre fin à des décennies de haine entre certains peuples ; mais [le sport] n’est pas non plus déclencheur de guerre. Le ping-pong n’a pas suffi à rapprocher les États-Unis et la Chine maoïste en 1971. Le football n’a pas entraîné à lui seul la guerre qui opposa en 1969 le Honduras au Salvador.
Il ne faut pas donner au sport plus d’importance qu’il n’en a. Le monde contemporain reste dominé par des rapports de puissance et le sport, aussi populaire soit-il, reste un loisir. Pour autant, la mondialisation a donné au sport une visibilité globale et, dans une logique dialectique, se nourrit elle-même de sa capacité d’intégration. Paraphrasant Malraux, Boniface n’a pas tort d’affirmer : « le XXIème siècle sera sportif ou ne sera pas ! ».
Première idée : le sport est un fait social mondial. 14 pays participaient aux jeux olympiques d’Athènes en 1896 ; pas moins de 205 – soit plus que les 193 États membres de l’ONU – ont participé à ceux de Londres en 2012. A l’heure du « village global », les grands événements sportifs rassemblent la planète toute entière : on estime à plus de 2 milliards le nombre de téléspectateurs de la finale de la Coupe du monde le 13 juillet dernier entre l’Allemagne et l’Argentine. 90 Chefs d’Etat et de gouvernement assistaient à la cérémonie d’ouverture des JO de pékin en 2008 Les stars du ballon rond sont universellement reconnues. Leur popularité éclipse celle des chefs d’Etat et des artistes.
Deuxième idée : le sport est multipolaire. La géopolitique du sport est le reflet des rapports de force stratégique. Si, pendant la Guerre froide, Washington et Moscou se disputaient la première place au palmarès olympique, la Chine a effectué une percée impressionnante, devançant les États-Unis aux JO de Pékin (mais devancés par eux aux JO de Londres 4 ans plus tard). L’Occident ne domine plus la scène sportive et n’a plus le monopole de l’organisation des grandes manifestations sportives. En l’espace de dix ans, les BRICs auront accueilli trois JO (Pékin 2008, Sotchi 2014 et Rio 2016) et deux Coupes du monde (Brésil 2014 et Russie 2018). L’organisation de la Coupe du monde de football 2022 au Qatar est un signal fort d’intégration du monde arabe dans la mondialisation.
Troisième idée : le sport suscite la fierté nationale. C’est un paradoxe à l’heure de la mondialisation qui brouille les frontières et dissout les identités. On nous dit que le monde est devenu post-westphalien, que les États sont désormais concurrencés sur la scène internationale par de nouveaux acteurs (entreprises, ONG, médias, mafias, religions ….) ; mais chaque JO, chaque Coupe du monde sont l’occasion d’un engouement chauviniste pour son pays. La popularité des Diables rouges, dans une Belgique qu’on disait à l’agonie, lors du dernier Mundial brésilien en est un exemple. Les États le savent qui n’hésitent pas à en faire un instrument de prestige et de propagande : ce fut le cas à Berlin en 1936 ou, deux ans plus tôt, à Rome lors de la Coupe du monde organisée et remportée par l’Italie.
Quatrième idée : le sport peut réconcilier les peuples et susciter des guerres. Cette idée est réductrice. Comme l’écrit très justement pascal Boniface « la seule rencontre sportive ne viendra pas mettre fin à des décennies de haine entre certains peuples ; mais [le sport] n’est pas non plus déclencheur de guerre. Le ping-pong n’a pas suffi à rapprocher les États-Unis et la Chine maoïste en 1971. Le football n’a pas entraîné à lui seul la guerre qui opposa en 1969 le Honduras au Salvador.
Il ne faut pas donner au sport plus d’importance qu’il n’en a. Le monde contemporain reste dominé par des rapports de puissance et le sport, aussi populaire soit-il, reste un loisir. Pour autant, la mondialisation a donné au sport une visibilité globale et, dans une logique dialectique, se nourrit elle-même de sa capacité d’intégration. Paraphrasant Malraux, Boniface n’a pas tort d’affirmer : « le XXIème siècle sera sportif ou ne sera pas ! ».
Ce livre est très intéressant, principalement dans la première partie où il démonte la tendance des Occidentaux - mais pas seulement des philosophes - à attaquer les religions et plus particulièrement l'islam et les musulmans. J'ai appris beaucoup de choses.
La deuxième partie est plus lourde pour la Belge que je suis. Il y a pas mal de personnes renseignées dans cette section que je ne connais pas.
La deuxième partie est plus lourde pour la Belge que je suis. Il y a pas mal de personnes renseignées dans cette section que je ne connais pas.
J'attendais beaucoup de ce livre d'entretiens. D'abord parce qu'il s'agit d'un livre d'entretien, d'un dialogue bien plus vivant où la pensée de l'intellectuel prend le temps de se mettre en place. Ensuite parce que certains des invités de Pascal Boniface font partie de mes lectures pour mieux appréhender notre cher monde complexe (je pense entre autre à Emmanuel Todd). Eh bien, comment dire? Cela reste grandement en surface. La pensée des auteurs, bah, comment dire? Là aussi le retour sur leur parcours ne nous apprend pas grand chose et on en est souvent dans le discours entendu, bien superficiel. La quintessence étant le premier des entretiens, celui de Stéphane Hessel, pétri d'intentions louables mais qui ne dépassent pas le constat que la guerre c'est mal et les cheveux ça pousse.
Bien dommage...
Bien dommage...
Ecrit en réponse à son propre premier essai sur les Intellectuels faussaires, les intellectuels intègres le prend en contrepied et propose une série de portraits et d'interviews de philosophes, démographes, géographes, sociologues ...qui mobilisent une oeuvre ou une recherche à l'appui de leurs prises de positions publiques. Contrepied donc, puisque la recherche et l'oeuvre sont ici bien réelles, puisqu'ici la qualification d'intellectuelle ne ressort pas (ou pas exclusivement) de leur visibilité médiatique. Si la légitimité universitaire des personnages semble fondée, de Tzvetan Todorov à Edgar Morin en passant par Emmanuel Todd ou Régis Debray, on soulignera néanmoins un fort biais de sélection peu assumé et qui aurait permis peu s'en faut de retitrer l'ouvrage Les intellectuels de gauche intègres qui partagent la position de Boniface sur le conflit israëlo-palestinien. Même si ce dernier apparaît comme nodal, il serait injuste d'oublier que chacun des intellectuels à qui Boniface donne la parole a ses propres marottes et ses coups de gueule. On picore à droite à gauche les idées pour penser la laïcité, l'avenir de l'hyperpuissance nord-américaine, le totalitarisme, la diplomation internationale etc. On picore simplement car chaque interview est trop brève pour donner une analyse autre que superficielle. En revanche la réflexion transversale sur le rôle de l'intellectuel, sur ses mutations historiques et sur les motifs d'existence de faussaires surnuméraires est intéressante.
Sous la forme d’un pamphlet très facile d’accès, Pascal Boniface, directeur de l’Institut de relations internationales et stratégiques (I.R.I.S.), dénonce une poignée d’éditorialistes dévoués à la pensée unique et omniprésents dans les médias. Par la même occasion, il entend démontrer la stigmatisation généralisée de l’Islam dans les grands médias et la défense systématique de la politique d’Israël. Un point de vue intéressant à mettre en perspective.
Le titre de ce livre coché sur la liste de Babelio m’a fait penser à Astérix…
« Nous sommes en 2013 après Jésus-Christ. Les médias nous décrivent un monde de « tous pourris »… Tous ?... Non ! Un îlot peuplé d’irréductibles penseurs résiste encore et toujours au prêt-à-penser et à la morosité ambiante ».
Pascale Boniface propose de nous en présenter 15. Bonne idée !
Je dois dire qu’à part Stéphane Hessel qui a bénéficié d’une belle couverture médiatique ces deux dernières années, j’étais incapable de mettre un visage ou des actions sur les 14 autres noms. Autant de belles découvertes donc !
Chacun est présenté par une biographie sommaire, avant une interview sur le rôle de l’intellectuel et sur ses principaux travaux. Un des critères de sélection étant que leur champ de réflexion couvre les relations internationales. Un livre dense, donc, mais accessible.
Ce livre s’adresse à notre intelligence… Ca devient assez rare ! Et ça fait du bien…
Une fois les 400 pages lues, une question me vient : comment être à la hauteur de tous ces grands penseurs ? Pensée un peu décourageante à première vue, mais ce livre est suffisamment accessible pour encourager chacun à exercer sa liberté de pensée et à essayer d’agir à son niveau. Ne pas avoir peur d’aller à l’encontre de courants dominants, garder l’esprit ouvert à plusieurs grilles d’analyse, savoir que seul on ne peut pas grand-chose : presque tous ont un engagement politique, associatif, entrepreneurial…
Difficile de résumer autant de pensées, surtout que tous insistent sur le fait que la réalité est complexe et nécessite souvent une argumentation étayée… Pour les personnes qui n’auront pas le temps de se plonger dans ce livre, je préfère laisser la parole à ces intellectuels, au gré de phrases qui m’ont interpellée. En vous encourageant bien sûr à creuser…
Jean BAUBEROT (spécialiste de la laïcité)
« j’aime bien circuler entre des mondes différents, culturellement et socialement ». Il utilise une belle métaphore de « la tentation de la montagne » pour décrire le sommet où arrive le chercheur après avoir amassé et analysé de multiples données ; il a ainsi une belle « vision d’ensemble qu’il est impossible d’avoir quand on reste au sol ». Le chercheur est alors souvent tenté de rester au sommet. Or, il faut essayer de redescendre et « je me mêle à la vie sociale, je tente d’indiquer aux autres ce que j’ai vu ». « L’intégrité demande un positionnement clair dans un écheveau complexe ».
Il parle du « paradoxe démocratique » : « En démocratie, l’électeur est souverain et doit donc avoir une opinion sur tout. Cela risque de le livrer à des stéréotypes plutôt qu’à une véritable démarche de connaissance », « Bien sûr nul ne peut tout connaître mais on devrait mieux connaître les limites de son savoir ». Or, en démocratie il est difficile de dire « je ne prends pas position sur ce point car je ne dispose d’aucun avoir sur la question. Je suis donc dépendant d’un discours social qui acquiert de la validité surtout par sa répétition ».Il cite Alain : « Une vérité qui cesse d’être questionnée finit par devenir fausse ».
Esther BENBASSA (études de lettres et d’histoire, directrice de recherche au CNRS, française, turque et israélienne)
« Esther mobilise ses souvenirs personnels d’harmonie interculturelle et sa volonté de dépasser les affrontements et le communautarisme...".« J’ai croisé énormément de gens et je n’aurais rien été sans ceux, parmi eux, qui m’ont encouragée à devenir ce que je suis. Le peu que j’ai pu faire, c’est grâce à eux. Il n’y a pas un jour où je ne pense à l’un d’eux à l’occasion d’une lecture, d’une réflexion, et parfois sans raison précise. Ils et elles sont en moi et font partie de mon être.»
« Comme nous le savons tous, au moins dans notre for intérieur, l’institution tue l’innovation ou la créativité parce qu’il y a des normes, des cadres, et je suis sûre que si Freud avait été professeur à l’université, il n’aurait pas été Freud ».« Les juifs avaient cette faculté d’appartenir et de ne pas appartenir, c’est un peu ma conception de l’intellectuel. Cette non-appartenance a été l’une des conditions de l’inventivité et de la créativité et surtout de l’anticonformisme, y compris chez des femmes, comme Rosa Luxembourg, Emma Goldman et d’autres. (...) cette dualité leur a permis de se dépasser, d’aller plus loin et de prendre des risques »
« Je pense que les minorités gagnent à être connues, leur culture peut apporter un plus à la culture générale du monde ou du pays dans lequel on vit. Ces contributions des différentes cultures font les civilisations ; il n’y a que les salafistes, les ultra-orthodoxes juifs ou les chrétiens intégristes pour croire que l’ « authenticité » est la marque de la vraie culture. ». "un savoir qui ne sert pas reste un savoir en soi, sans ambition ». « si chaque jour je change, ne serait-ce qu’un peu, la condition d’une seule personne, je trouve que j’aurai fait ma révolution. Je suis pour les petites révolutions au quotidien, les petits actes qui sont, au fond, révolutionnaires. »
Rony BRAUMAN (MSF)
« La lecture de Eichmann à Jérusalem de Hannah Arendt, (...) sa réflexion sur les rapports entre pitié et terreur, m’ont fortement influencé à l’époque. C’est à partir de ce moment que la rhétorique humanitaire, les discours « victimaires » et leurs rapports avec le pouvoir et la violence sont devenus un sujet de réflexion. »
Régis DEBRAY (Philosophe, homme politique de gauche)
Dans « L’Etat séducteur en 1993 (il) regrette l’effacement des frontières entre vie publique et vie privée et substitue l’examen de moralité au débat d’idées. Sont évoqués la tentation des apparences et du showbiz, la priorité accordée au temps bref sur le temps long et l’abandon du complexe au profit du simple. »
« regretter qu’aujourd’hui tout soit devenu affaire de communauté et que la grande perdante est la communauté nationale « devenue introuvable » ».
« la une de L’Aurore avec le J’accuse de Zola. C’est un article très ennuyeux, très long. Il n’y avait pas une illustration à la une de l’Aurore, pas plus que dans les pages intérieures à l’époque. Aujourd’hui, une intervention dans la presse, c’est combien ? Trois mille signes. Zola je crois que c’est quarante mille. Ouvrir un dossier, décrire une situation, proposer une stratégie demandent du temps et de l’espace. »
Alfred GROSSER (D’origine juive et agrégé d’allemand, professeur à Sciences Po, journaliste)
« ma méthode pour conduire séminaires et groupes de travail étaient toujours les mêmes : « Premièrement, les choses sont plus compliquées que vous n’aviez cru. Deuxièmement, ceci est vrai, mais le contraire n’est pas tout à fait faux. » Il est vrai que j’ai toujours voulu susciter la compréhension sur le point de vue opposé. » « Mon thème central (…) est que la vertu la plus importante est la prise en considération de la souffrance de l’ « autre » . Après 1945, nous ne pouvions pas demander à un jeune allemand de comprendre pleinement l’horreur des crimes hitlériens si nous ne lui montrions pas une vraie compréhension pour les souffrances des siens, dans les villes bombardées ou pendant les expulsions subies. ». « A côté de lui se trouvait un jeune prisonnier allemand, soigné lui aussi. J’ai (...) découvert qu’il n’avait rien su, qu’il ne savait vraiment rien des horreurs accomplies au nom de son pays. D’où la conviction qu’il fallait ouvrir ces jeunes-là à la vérité, les insérer dans la société internationale si on ne voulait pas les exposer à de nouvelles propagandes nationalistes et haineuses. »
Olivier MONGIN (Philosophe, directeur de la rédaction de la revue Esprit)
« parler de l’intellectuel au sens politique « à la française » c’est associer de la réflexion, de la conviction et un engagement public, ce qui désigne une espèce en voie de disparition. ». « l’intellectuel que je défends est un généraliste(…), un architecte qui doit faire un tout avec des morceaux, un homme de réflexion qui n’est pas enfermé dans une spécialisation ».
« On vit dans un univers moins curieux (mais plus chargé d’informations qui tournent en rond), plus rapide mais moins mobile, moins susceptible de prendre du temps et de donner du plaisir. » « l’extrême rapidité de la circulation des informations a pour conséquence que nous sommes toujours en retard ».
« Par ailleurs, l’époque souffre sur le plan intellectuel d’une absence de langage commun minimal. On ne s’accorde plus sur les mots, et on se réfugie souvent dans des débats techniques ou juridiques auxquels personne ne comprend rien en dehors des professionnels et des fameux experts qui sont avant tout des traducteurs de sigles.». Aujourd’hui « La guerre est de plus en plus interne, et elle va l’être de plus en plus parce que nous sommes dans des sociétés confrontées aux problèmes des inégalités, de la crise des Etats providences qui étaient des facteurs de pacification. »
Edgar MORIN (Sciences Humaines, résistant, chercheur au CNRS)
Un intellectuel s’adresse aux êtres humains « Comme disait Heidegger, questionner fait voler en éclat les boîtes dans lesquelles sont enfermées les disciplines spécialisées. Si vous posez une interrogation fondamentale, vous êtes obligés de faire appel à des connaissances dispersées.». « Une chose très importante est de comprendre, c’est-à-dire entrer dans les raisons d’autrui ». « la mauvaise foi part souvent de la foi ». « Le fait d’identification à Israël, avec tout ce que cela signifie, relève d’une psychologie que j’ai connue chez les communistes : l’identification à l’union soviétique qui était leur patrie,(...)car ils y avaient mis l’essentiel de leur rêve, de leur espoir, de leur personnalité. »
Emmanuel TODD (Historien, démographe, INED)
« Ma vocation est de faire de l’histoire et de la prospective ». « Il identifie (…) une relation entre la structure familiale paysanne et l’idéologie qui émerge durant la phase de désintégration de la société traditionnelle : la famille communautaire est suivie en Russie ou en Chine par le communautarisme, la famille souche en Allemagne ou au Japon par le nationalisme ethnocentrique, la famille nucléaire en Angleterre ou en France par l’émergence du libéralisme moderne, pur ou égalitaire. ». « il y a un rapport entre l’évolution de la fécondité et celle de la politique. Regardez la Révolution française : la fécondité commence à baisser dans les petites villes du bassin parisien juste avant la Révolution et puis…chute. Je n’ai jamais fait autre chose sur l’Union soviétique que d’appliquer ces techniques». « Dans son livre Après l’Empire, Emmanuel Todd annonce la fin de l’hégémonie américaine. Les Etats-Unis consomment plus qu’ils ne produisent, ils sont donc, à terme, condamnés. ». « C’est typique des empires en déclin économique et culturel de se réfugier dans l’hypertrophie militaire. »
Tzvetan TODOROV (Lettres modernes, centre de recherche sur les arts et le langage, CNRS)
« La peur des barbares est une réponse aux théories sur le choc des civilisations mais également à ceux qui essayent, y compris à gauche, de montrer que l’islam n’est pas intégrable à nos sociétés. (…) les musulmans sont réduits à l’islam, lui-même réduit à l’islamisme politique, lui-même réduit au terrorisme. »
La naturalisation change l’esprit d’un homme : « mon être s’est petit à petit transformé parce que je vivais en France ; et ma conscience a suivi ! (…) J’ai été naturalisé Français dix ans après mon arrivée (…) je suis devenu un membre de plein droit de la société française, j’ai donc commencé petit à petit à réagir comme un Français et non plus comme un Bulgare. Je n’ai pas oublié mon expérience précédente, je ne l’oublierai jamais, mais je l’ai poussée un peu de côté. »
« La peine de mort est une ignominie à cause de ce refus d’admettre qu’un individu puisse changer, et toute peine de mort déguisée, du type perpétuité réelle, va dans le même sens. Elle contredit l’un des postulats fondamentaux du régime démocratique, à savoir que l’être humain n’est pas formé une fois pour toutes. Il est transformable. »
Jean-Christophe VICTOR (Langues orientales, Affaires Etrangères, création du LEPAC (Laboratoire d’études prospectives et d’analyses cartographiques, créateur de l’émission « Le dessous des cartes » sur ARTE)
« Demeurer libre, notamment vis-à-vis des pouvoirs qu’ils soient politiques ou financiers, ouvrir de nouveaux chemins et inventer, respecter l’autre en s’intéressant à tout ce qui peut être différent ». « Lorsqu’il intervient, il s’efforce de présenter les faits, les logiques adverses, les thèses en présence, les différentes interprétations que l’on peut en faire. Il se méfie de la « fabrication des ennemis », qu’il s’agisse de la Chine, de l’islam, des migrants, ne croit pas que le monde occidental continuera à dominer le monde et estime que ce dernier a trop souvent une attitude arrogante « qui est non seulement stupide, mais désormais tout à fait obsolète. » ». « cela fait 500 ans que l’Europe et ses enfants, Etats-Unis, Nouvelle Zélande et Australie, (...)sont au centre du monde et le centre du monde. Ainsi s’est installé un sentiment de supériorité vis-à-vis du reste du globe, notamment depuis le début de l’exportation du christianisme » (…) « Je pense que la globalisation est une occidentalisation du monde. Mais cet occidentalo-centrisme vit ses dernières décennies avec l’affirmation de l’ASIE et autres BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) et Next Eleven (« onze prochains » : Bangladesh, Corée du Sud, Egypte, Indonésie, Iran, Mexique, Nigéria, Pakistan, Philippines, Turquie et Vietnam). Nous vivons une double accélération : le XXIème siècle sera le siècle de l’Asie du fait des différentiels de croissance, de la démographie et des nouvelles classes moyennes. La deuxième accélération, c’est la contradiction propre à notre modèle économique, à la fois producteur –le monde est plus riche qu’il y a 20 ans – et terriblement destructeur. Nous sommes en train de léguer aux futures générations une crise environnementale majeure. »
« Je pense que l’on va vers un monde pluripolaire, ce qui explique pourquoi je ne parlerais pas de « déclin de l’Occident ». Il faut intégrer ce que peuvent continuer à apporter la France et l’Europe sur le plan des systèmes juridiques, de la protection de l’individu par le droit, des négociations climatiques et celui des dépôts de brevets...»
Le dessous des cartes ? « Premièrement repérer les tendances longues, faire comprendre et non pas faire savoir en partant du principe que l’on sait beaucoup de choses mais sans savoir les ranger. Deuxièmement, réhabiliter la dimension historique au sein des médias audiovisuels qui est à la fois absente et essentielle, j’avais le sentiment qu’on était toujours dans un temps sans mémoire, sans matelas historique. Troisièmement, investir la dimension géographique, spatialiser les données puisque nous passons notre vie à naviguer entre ces deux contraintes et avantages que sont l’espace et le temps. »
« Oui le monde est complexe, il n’est pas binaire et vous êtes suffisamment intelligents pour aborder cette complexité ». « L’interdépendance est un phénomène complexe à décrypter ».
« Il faut à chaque fois tenter d’entrer dans la logique de l’autre, le faire avec beaucoup de rigueur, de modestie, de respect, et restituer le tout dans les dix minutes dont je dispose pour l’émission ».
Michel WIEVIORKA (Sciences économiques, sociologie…)
« Le problème n’est pas seulement d’être intègre, il est aussi d’être ouvert et capable de circuler ente la production de connaissances précises parce qu’on ne peut pas tout connaître, et la participation à la vie intellectuelle générale qui ne soit pas coupée de connaissances précises". Blaise Pascal l’a dit bien avant moi, l’idéal de l’honnête homme est de savoir quelque chose de tout, plus encore que de savoir le tout d’une chose. »
En parlant des débats : « l’intégrité dans ce cas, c’est la capacité à écouter les autres tout en défendant un point de vue que l’on a soi-même construit. C’est paradoxal : comment écouter les autres et être capable de changer de point de vue tout en argumentant pour défendre et promouvoir sa position initiale ? »
« Chaque fois que je fais une recherche j’en sors tranformé. (…)L’intégrité c’est accepter d’être transformé soit par la pratique sociale soit par les analyses des autres, ce qui n’est pas toujours facile ni toujours agréable car il faut rester soi-même – j’allais dire dans son intégrité intellectuelle ».« Le chercheur doit pouvoir, sans jargonner ni se trahir, dire les choses. »
Catherine WIHTOL DE WENDEN (Sciences po, CNRS, travail sur les migrations)
« Le droit de migrer va être une cause de militance qui prendra peut-être des proportions aussi fortes que ce qu’a été le combat pour la suppression de l’esclavage aux XVIII et XIXè Siècles. Je pense que la question du droit à la mobilité va être un débat récurrent pendant tout le XXIè siècle. » « les américains considèrent que les bateaux qui arrivaient à New-York sont leur histoire à eux … "
Dominique WOLTON (sociologue, EHESS, sciences de la communication CNRS)
« Penser, créer, rêver, suppose de la discontinuité, du hasard, de l’inutilité, du temps ! » « (Le monde de la connaissance et de la culture) se trouve en position défensive dans une culture qui ne parle que de vitesse, d’ouverture, de globalité, d’efficacité, alors que la culture et la connaissance, valeurs inhérentes au monde académique, sont par définition plus parcellaires, plus lentes, moins brillantes. »
« paradoxe qui est celui du niveau culturel et de formation des journalistes, nettement supérieur à ce qu’il était il y a trente ans. Or, la concurrence entre eux est telle, tout comme entre les différents supports, qu’elle engendre des inégalités et étouffe toute la capacité critique légitime que les journalistes peuvent avoir. (…)Les journalistes ne sortent plus enquêter dans la société, leur ordinateur est devenu leur horizon. »
Jean ZIEGLER (Suisse, Sciences po, droit international, vice-président du comité consultatif du Conseil des droits de l’homme des Nations unies)
Venant d’un milieu aisé, il raconte la genèse de sa rébellion. Il a aussi rencontré Ernesto Guevara qui lui a dit qu’il serait plus utile pour combattre le système en étant dans le système. Dès 1976 il dénonce les pratiques des principales banques suisses, et plus récemment la spéculation sur les matières premières alimentaires qui constitue pour lui un crime contre l’humanité. « .. la mise en œuvre de la raison analytique est une activité par essence subversive. L’intellectuel a cette fonction là, de dire ce qui est. »
Sur l’analyse de la faim dans le monde « l’obscurantisme néolibéral brouille cette réalité du monde. Au libre choix des hommes, il oppose l’idée que les lois de l’économie et du marché sont des lois naturelles, que le marché est responsable, qu’il n’est pas encore assez libéralisé, pas assez privatisé (…). Or c’est bien une stratégie de domination qui est à l’œuvre. ». « Les oligarchies du capital financier transcontinental ont le pouvoir et échappent totalement à tout contrôle social, notamment étatique. Elles ont un pouvoir tel qu’aucun empereur, aucun roi, aucun pape n’a jamais eu sur la planète. ». La Suisse est le 2ème pays le plus riche or elle a très peu de ressources « Comment l’oligarchie bancaire, qui domine complètement ce pays, s’y prend-elle? Elle pille le monde entier.» 3 sources : « le capital en fuite des pays du Tiers-Monde, l’argent des mafias internationales lavé en Suisse grâce au secret bancaire et, bien sûr, l’argent de la fraude fiscale des pays alentours..."« Pendant ce court instant que nous passons sur terre, je pense que nous avons une mission : mener ce combat sans même nous demander pourquoi. Tu sais, comme le disent les Wolofs du Sénégal : « on ne connaît pas le fruit des arbres qu’on plante ». ( …). On doit mener la lutte. »
« Nous sommes en 2013 après Jésus-Christ. Les médias nous décrivent un monde de « tous pourris »… Tous ?... Non ! Un îlot peuplé d’irréductibles penseurs résiste encore et toujours au prêt-à-penser et à la morosité ambiante ».
Pascale Boniface propose de nous en présenter 15. Bonne idée !
Je dois dire qu’à part Stéphane Hessel qui a bénéficié d’une belle couverture médiatique ces deux dernières années, j’étais incapable de mettre un visage ou des actions sur les 14 autres noms. Autant de belles découvertes donc !
Chacun est présenté par une biographie sommaire, avant une interview sur le rôle de l’intellectuel et sur ses principaux travaux. Un des critères de sélection étant que leur champ de réflexion couvre les relations internationales. Un livre dense, donc, mais accessible.
Ce livre s’adresse à notre intelligence… Ca devient assez rare ! Et ça fait du bien…
Une fois les 400 pages lues, une question me vient : comment être à la hauteur de tous ces grands penseurs ? Pensée un peu décourageante à première vue, mais ce livre est suffisamment accessible pour encourager chacun à exercer sa liberté de pensée et à essayer d’agir à son niveau. Ne pas avoir peur d’aller à l’encontre de courants dominants, garder l’esprit ouvert à plusieurs grilles d’analyse, savoir que seul on ne peut pas grand-chose : presque tous ont un engagement politique, associatif, entrepreneurial…
Difficile de résumer autant de pensées, surtout que tous insistent sur le fait que la réalité est complexe et nécessite souvent une argumentation étayée… Pour les personnes qui n’auront pas le temps de se plonger dans ce livre, je préfère laisser la parole à ces intellectuels, au gré de phrases qui m’ont interpellée. En vous encourageant bien sûr à creuser…
Jean BAUBEROT (spécialiste de la laïcité)
« j’aime bien circuler entre des mondes différents, culturellement et socialement ». Il utilise une belle métaphore de « la tentation de la montagne » pour décrire le sommet où arrive le chercheur après avoir amassé et analysé de multiples données ; il a ainsi une belle « vision d’ensemble qu’il est impossible d’avoir quand on reste au sol ». Le chercheur est alors souvent tenté de rester au sommet. Or, il faut essayer de redescendre et « je me mêle à la vie sociale, je tente d’indiquer aux autres ce que j’ai vu ». « L’intégrité demande un positionnement clair dans un écheveau complexe ».
Il parle du « paradoxe démocratique » : « En démocratie, l’électeur est souverain et doit donc avoir une opinion sur tout. Cela risque de le livrer à des stéréotypes plutôt qu’à une véritable démarche de connaissance », « Bien sûr nul ne peut tout connaître mais on devrait mieux connaître les limites de son savoir ». Or, en démocratie il est difficile de dire « je ne prends pas position sur ce point car je ne dispose d’aucun avoir sur la question. Je suis donc dépendant d’un discours social qui acquiert de la validité surtout par sa répétition ».Il cite Alain : « Une vérité qui cesse d’être questionnée finit par devenir fausse ».
Esther BENBASSA (études de lettres et d’histoire, directrice de recherche au CNRS, française, turque et israélienne)
« Esther mobilise ses souvenirs personnels d’harmonie interculturelle et sa volonté de dépasser les affrontements et le communautarisme...".« J’ai croisé énormément de gens et je n’aurais rien été sans ceux, parmi eux, qui m’ont encouragée à devenir ce que je suis. Le peu que j’ai pu faire, c’est grâce à eux. Il n’y a pas un jour où je ne pense à l’un d’eux à l’occasion d’une lecture, d’une réflexion, et parfois sans raison précise. Ils et elles sont en moi et font partie de mon être.»
« Comme nous le savons tous, au moins dans notre for intérieur, l’institution tue l’innovation ou la créativité parce qu’il y a des normes, des cadres, et je suis sûre que si Freud avait été professeur à l’université, il n’aurait pas été Freud ».« Les juifs avaient cette faculté d’appartenir et de ne pas appartenir, c’est un peu ma conception de l’intellectuel. Cette non-appartenance a été l’une des conditions de l’inventivité et de la créativité et surtout de l’anticonformisme, y compris chez des femmes, comme Rosa Luxembourg, Emma Goldman et d’autres. (...) cette dualité leur a permis de se dépasser, d’aller plus loin et de prendre des risques »
« Je pense que les minorités gagnent à être connues, leur culture peut apporter un plus à la culture générale du monde ou du pays dans lequel on vit. Ces contributions des différentes cultures font les civilisations ; il n’y a que les salafistes, les ultra-orthodoxes juifs ou les chrétiens intégristes pour croire que l’ « authenticité » est la marque de la vraie culture. ». "un savoir qui ne sert pas reste un savoir en soi, sans ambition ». « si chaque jour je change, ne serait-ce qu’un peu, la condition d’une seule personne, je trouve que j’aurai fait ma révolution. Je suis pour les petites révolutions au quotidien, les petits actes qui sont, au fond, révolutionnaires. »
Rony BRAUMAN (MSF)
« La lecture de Eichmann à Jérusalem de Hannah Arendt, (...) sa réflexion sur les rapports entre pitié et terreur, m’ont fortement influencé à l’époque. C’est à partir de ce moment que la rhétorique humanitaire, les discours « victimaires » et leurs rapports avec le pouvoir et la violence sont devenus un sujet de réflexion. »
Régis DEBRAY (Philosophe, homme politique de gauche)
Dans « L’Etat séducteur en 1993 (il) regrette l’effacement des frontières entre vie publique et vie privée et substitue l’examen de moralité au débat d’idées. Sont évoqués la tentation des apparences et du showbiz, la priorité accordée au temps bref sur le temps long et l’abandon du complexe au profit du simple. »
« regretter qu’aujourd’hui tout soit devenu affaire de communauté et que la grande perdante est la communauté nationale « devenue introuvable » ».
« la une de L’Aurore avec le J’accuse de Zola. C’est un article très ennuyeux, très long. Il n’y avait pas une illustration à la une de l’Aurore, pas plus que dans les pages intérieures à l’époque. Aujourd’hui, une intervention dans la presse, c’est combien ? Trois mille signes. Zola je crois que c’est quarante mille. Ouvrir un dossier, décrire une situation, proposer une stratégie demandent du temps et de l’espace. »
Alfred GROSSER (D’origine juive et agrégé d’allemand, professeur à Sciences Po, journaliste)
« ma méthode pour conduire séminaires et groupes de travail étaient toujours les mêmes : « Premièrement, les choses sont plus compliquées que vous n’aviez cru. Deuxièmement, ceci est vrai, mais le contraire n’est pas tout à fait faux. » Il est vrai que j’ai toujours voulu susciter la compréhension sur le point de vue opposé. » « Mon thème central (…) est que la vertu la plus importante est la prise en considération de la souffrance de l’ « autre » . Après 1945, nous ne pouvions pas demander à un jeune allemand de comprendre pleinement l’horreur des crimes hitlériens si nous ne lui montrions pas une vraie compréhension pour les souffrances des siens, dans les villes bombardées ou pendant les expulsions subies. ». « A côté de lui se trouvait un jeune prisonnier allemand, soigné lui aussi. J’ai (...) découvert qu’il n’avait rien su, qu’il ne savait vraiment rien des horreurs accomplies au nom de son pays. D’où la conviction qu’il fallait ouvrir ces jeunes-là à la vérité, les insérer dans la société internationale si on ne voulait pas les exposer à de nouvelles propagandes nationalistes et haineuses. »
Olivier MONGIN (Philosophe, directeur de la rédaction de la revue Esprit)
« parler de l’intellectuel au sens politique « à la française » c’est associer de la réflexion, de la conviction et un engagement public, ce qui désigne une espèce en voie de disparition. ». « l’intellectuel que je défends est un généraliste(…), un architecte qui doit faire un tout avec des morceaux, un homme de réflexion qui n’est pas enfermé dans une spécialisation ».
« On vit dans un univers moins curieux (mais plus chargé d’informations qui tournent en rond), plus rapide mais moins mobile, moins susceptible de prendre du temps et de donner du plaisir. » « l’extrême rapidité de la circulation des informations a pour conséquence que nous sommes toujours en retard ».
« Par ailleurs, l’époque souffre sur le plan intellectuel d’une absence de langage commun minimal. On ne s’accorde plus sur les mots, et on se réfugie souvent dans des débats techniques ou juridiques auxquels personne ne comprend rien en dehors des professionnels et des fameux experts qui sont avant tout des traducteurs de sigles.». Aujourd’hui « La guerre est de plus en plus interne, et elle va l’être de plus en plus parce que nous sommes dans des sociétés confrontées aux problèmes des inégalités, de la crise des Etats providences qui étaient des facteurs de pacification. »
Edgar MORIN (Sciences Humaines, résistant, chercheur au CNRS)
Un intellectuel s’adresse aux êtres humains « Comme disait Heidegger, questionner fait voler en éclat les boîtes dans lesquelles sont enfermées les disciplines spécialisées. Si vous posez une interrogation fondamentale, vous êtes obligés de faire appel à des connaissances dispersées.». « Une chose très importante est de comprendre, c’est-à-dire entrer dans les raisons d’autrui ». « la mauvaise foi part souvent de la foi ». « Le fait d’identification à Israël, avec tout ce que cela signifie, relève d’une psychologie que j’ai connue chez les communistes : l’identification à l’union soviétique qui était leur patrie,(...)car ils y avaient mis l’essentiel de leur rêve, de leur espoir, de leur personnalité. »
Emmanuel TODD (Historien, démographe, INED)
« Ma vocation est de faire de l’histoire et de la prospective ». « Il identifie (…) une relation entre la structure familiale paysanne et l’idéologie qui émerge durant la phase de désintégration de la société traditionnelle : la famille communautaire est suivie en Russie ou en Chine par le communautarisme, la famille souche en Allemagne ou au Japon par le nationalisme ethnocentrique, la famille nucléaire en Angleterre ou en France par l’émergence du libéralisme moderne, pur ou égalitaire. ». « il y a un rapport entre l’évolution de la fécondité et celle de la politique. Regardez la Révolution française : la fécondité commence à baisser dans les petites villes du bassin parisien juste avant la Révolution et puis…chute. Je n’ai jamais fait autre chose sur l’Union soviétique que d’appliquer ces techniques». « Dans son livre Après l’Empire, Emmanuel Todd annonce la fin de l’hégémonie américaine. Les Etats-Unis consomment plus qu’ils ne produisent, ils sont donc, à terme, condamnés. ». « C’est typique des empires en déclin économique et culturel de se réfugier dans l’hypertrophie militaire. »
Tzvetan TODOROV (Lettres modernes, centre de recherche sur les arts et le langage, CNRS)
« La peur des barbares est une réponse aux théories sur le choc des civilisations mais également à ceux qui essayent, y compris à gauche, de montrer que l’islam n’est pas intégrable à nos sociétés. (…) les musulmans sont réduits à l’islam, lui-même réduit à l’islamisme politique, lui-même réduit au terrorisme. »
La naturalisation change l’esprit d’un homme : « mon être s’est petit à petit transformé parce que je vivais en France ; et ma conscience a suivi ! (…) J’ai été naturalisé Français dix ans après mon arrivée (…) je suis devenu un membre de plein droit de la société française, j’ai donc commencé petit à petit à réagir comme un Français et non plus comme un Bulgare. Je n’ai pas oublié mon expérience précédente, je ne l’oublierai jamais, mais je l’ai poussée un peu de côté. »
« La peine de mort est une ignominie à cause de ce refus d’admettre qu’un individu puisse changer, et toute peine de mort déguisée, du type perpétuité réelle, va dans le même sens. Elle contredit l’un des postulats fondamentaux du régime démocratique, à savoir que l’être humain n’est pas formé une fois pour toutes. Il est transformable. »
Jean-Christophe VICTOR (Langues orientales, Affaires Etrangères, création du LEPAC (Laboratoire d’études prospectives et d’analyses cartographiques, créateur de l’émission « Le dessous des cartes » sur ARTE)
« Demeurer libre, notamment vis-à-vis des pouvoirs qu’ils soient politiques ou financiers, ouvrir de nouveaux chemins et inventer, respecter l’autre en s’intéressant à tout ce qui peut être différent ». « Lorsqu’il intervient, il s’efforce de présenter les faits, les logiques adverses, les thèses en présence, les différentes interprétations que l’on peut en faire. Il se méfie de la « fabrication des ennemis », qu’il s’agisse de la Chine, de l’islam, des migrants, ne croit pas que le monde occidental continuera à dominer le monde et estime que ce dernier a trop souvent une attitude arrogante « qui est non seulement stupide, mais désormais tout à fait obsolète. » ». « cela fait 500 ans que l’Europe et ses enfants, Etats-Unis, Nouvelle Zélande et Australie, (...)sont au centre du monde et le centre du monde. Ainsi s’est installé un sentiment de supériorité vis-à-vis du reste du globe, notamment depuis le début de l’exportation du christianisme » (…) « Je pense que la globalisation est une occidentalisation du monde. Mais cet occidentalo-centrisme vit ses dernières décennies avec l’affirmation de l’ASIE et autres BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) et Next Eleven (« onze prochains » : Bangladesh, Corée du Sud, Egypte, Indonésie, Iran, Mexique, Nigéria, Pakistan, Philippines, Turquie et Vietnam). Nous vivons une double accélération : le XXIème siècle sera le siècle de l’Asie du fait des différentiels de croissance, de la démographie et des nouvelles classes moyennes. La deuxième accélération, c’est la contradiction propre à notre modèle économique, à la fois producteur –le monde est plus riche qu’il y a 20 ans – et terriblement destructeur. Nous sommes en train de léguer aux futures générations une crise environnementale majeure. »
« Je pense que l’on va vers un monde pluripolaire, ce qui explique pourquoi je ne parlerais pas de « déclin de l’Occident ». Il faut intégrer ce que peuvent continuer à apporter la France et l’Europe sur le plan des systèmes juridiques, de la protection de l’individu par le droit, des négociations climatiques et celui des dépôts de brevets...»
Le dessous des cartes ? « Premièrement repérer les tendances longues, faire comprendre et non pas faire savoir en partant du principe que l’on sait beaucoup de choses mais sans savoir les ranger. Deuxièmement, réhabiliter la dimension historique au sein des médias audiovisuels qui est à la fois absente et essentielle, j’avais le sentiment qu’on était toujours dans un temps sans mémoire, sans matelas historique. Troisièmement, investir la dimension géographique, spatialiser les données puisque nous passons notre vie à naviguer entre ces deux contraintes et avantages que sont l’espace et le temps. »
« Oui le monde est complexe, il n’est pas binaire et vous êtes suffisamment intelligents pour aborder cette complexité ». « L’interdépendance est un phénomène complexe à décrypter ».
« Il faut à chaque fois tenter d’entrer dans la logique de l’autre, le faire avec beaucoup de rigueur, de modestie, de respect, et restituer le tout dans les dix minutes dont je dispose pour l’émission ».
Michel WIEVIORKA (Sciences économiques, sociologie…)
« Le problème n’est pas seulement d’être intègre, il est aussi d’être ouvert et capable de circuler ente la production de connaissances précises parce qu’on ne peut pas tout connaître, et la participation à la vie intellectuelle générale qui ne soit pas coupée de connaissances précises". Blaise Pascal l’a dit bien avant moi, l’idéal de l’honnête homme est de savoir quelque chose de tout, plus encore que de savoir le tout d’une chose. »
En parlant des débats : « l’intégrité dans ce cas, c’est la capacité à écouter les autres tout en défendant un point de vue que l’on a soi-même construit. C’est paradoxal : comment écouter les autres et être capable de changer de point de vue tout en argumentant pour défendre et promouvoir sa position initiale ? »
« Chaque fois que je fais une recherche j’en sors tranformé. (…)L’intégrité c’est accepter d’être transformé soit par la pratique sociale soit par les analyses des autres, ce qui n’est pas toujours facile ni toujours agréable car il faut rester soi-même – j’allais dire dans son intégrité intellectuelle ».« Le chercheur doit pouvoir, sans jargonner ni se trahir, dire les choses. »
Catherine WIHTOL DE WENDEN (Sciences po, CNRS, travail sur les migrations)
« Le droit de migrer va être une cause de militance qui prendra peut-être des proportions aussi fortes que ce qu’a été le combat pour la suppression de l’esclavage aux XVIII et XIXè Siècles. Je pense que la question du droit à la mobilité va être un débat récurrent pendant tout le XXIè siècle. » « les américains considèrent que les bateaux qui arrivaient à New-York sont leur histoire à eux … "
Dominique WOLTON (sociologue, EHESS, sciences de la communication CNRS)
« Penser, créer, rêver, suppose de la discontinuité, du hasard, de l’inutilité, du temps ! » « (Le monde de la connaissance et de la culture) se trouve en position défensive dans une culture qui ne parle que de vitesse, d’ouverture, de globalité, d’efficacité, alors que la culture et la connaissance, valeurs inhérentes au monde académique, sont par définition plus parcellaires, plus lentes, moins brillantes. »
« paradoxe qui est celui du niveau culturel et de formation des journalistes, nettement supérieur à ce qu’il était il y a trente ans. Or, la concurrence entre eux est telle, tout comme entre les différents supports, qu’elle engendre des inégalités et étouffe toute la capacité critique légitime que les journalistes peuvent avoir. (…)Les journalistes ne sortent plus enquêter dans la société, leur ordinateur est devenu leur horizon. »
Jean ZIEGLER (Suisse, Sciences po, droit international, vice-président du comité consultatif du Conseil des droits de l’homme des Nations unies)
Venant d’un milieu aisé, il raconte la genèse de sa rébellion. Il a aussi rencontré Ernesto Guevara qui lui a dit qu’il serait plus utile pour combattre le système en étant dans le système. Dès 1976 il dénonce les pratiques des principales banques suisses, et plus récemment la spéculation sur les matières premières alimentaires qui constitue pour lui un crime contre l’humanité. « .. la mise en œuvre de la raison analytique est une activité par essence subversive. L’intellectuel a cette fonction là, de dire ce qui est. »
Sur l’analyse de la faim dans le monde « l’obscurantisme néolibéral brouille cette réalité du monde. Au libre choix des hommes, il oppose l’idée que les lois de l’économie et du marché sont des lois naturelles, que le marché est responsable, qu’il n’est pas encore assez libéralisé, pas assez privatisé (…). Or c’est bien une stratégie de domination qui est à l’œuvre. ». « Les oligarchies du capital financier transcontinental ont le pouvoir et échappent totalement à tout contrôle social, notamment étatique. Elles ont un pouvoir tel qu’aucun empereur, aucun roi, aucun pape n’a jamais eu sur la planète. ». La Suisse est le 2ème pays le plus riche or elle a très peu de ressources « Comment l’oligarchie bancaire, qui domine complètement ce pays, s’y prend-elle? Elle pille le monde entier.» 3 sources : « le capital en fuite des pays du Tiers-Monde, l’argent des mafias internationales lavé en Suisse grâce au secret bancaire et, bien sûr, l’argent de la fraude fiscale des pays alentours..."« Pendant ce court instant que nous passons sur terre, je pense que nous avons une mission : mener ce combat sans même nous demander pourquoi. Tu sais, comme le disent les Wolofs du Sénégal : « on ne connaît pas le fruit des arbres qu’on plante ». ( …). On doit mener la lutte. »
Véritable coup de cœur pour ce roman destine à un jeune public qui peut également être lus par tous.
Ce livre résume les vrais valeurs du football.
L'histoire commence en 2026 lors de la finale de la coupe du monde la France affronte le Sénégal.
Et on va faire la connaissance avec Mamadou Diouf, jeune espoir du football qui à décidé de jouer avec l'équipe du Sénégal et pas de la France. Pourquoi ce choix ?
Pascal Boniface, dans ce premier roman, nous fait vivre de grand moment dans ce roman notamment lors d'une séance de tir au but.
Le titre, l'expulsion, nous fait attendre un drame et effectivement le père de Mamadou est sans-papiers et il va être expulsé. Malgré la mobilisation des enfants et des parents, cette expulsion aura lieu.
Les thèmes du roman sont d'actualité et je pense qu'il est intéressant de le faire lire au plus grand nombre.
Ce livre résume les vrais valeurs du football.
L'histoire commence en 2026 lors de la finale de la coupe du monde la France affronte le Sénégal.
Et on va faire la connaissance avec Mamadou Diouf, jeune espoir du football qui à décidé de jouer avec l'équipe du Sénégal et pas de la France. Pourquoi ce choix ?
Pascal Boniface, dans ce premier roman, nous fait vivre de grand moment dans ce roman notamment lors d'une séance de tir au but.
Le titre, l'expulsion, nous fait attendre un drame et effectivement le père de Mamadou est sans-papiers et il va être expulsé. Malgré la mobilisation des enfants et des parents, cette expulsion aura lieu.
Les thèmes du roman sont d'actualité et je pense qu'il est intéressant de le faire lire au plus grand nombre.
Fruit d’une rencontre improbable entre le géopoliticien bien connu et le rappeur sur le vivre ensemble en ces temps de crise, avec notamment la question épineuse de l’intégration des musulmans. Dialogue vivifiant qui se lit comme un roman.
Virginie
Virginie
Sur le marché très concurrentiel du manuel de relations internationales, le cours du très prolifique directeur de l’IRIS est un modèle du genre. Rédigé dans une langue très claire, débarrassé du jargon théorique qui parfois encombre certains manuels universitaires, il se lit avec un grand plaisir. Pascal Boniface a le don pour rendre la matière vivante, en éclairant sans cesse des idées abstraites par des exemples concrets et en multipliant les citations savoureuses. Connaissant l’auteur et ses sujets de prédilection – la prolifération étatique, le conflit israélo-palestinien, le football … – on admirera que, à la différence de beaucoup d’enseignants prompts à évoquer sans retenue leurs marottes, il n’ait pas cédé à cette facilité.
Pascal Boniface parvient en moins de 300 pages à traiter tous les thèmes du programme de R.I. avec une concision qui force l’admiration, même si elle provoque parfois un brin de frustration (on regrettera que les chapitres sur le réchauffement climatique, les déséquilibres économiques internationaux ou la démographie, soient expédiés en moins de dix pages). Participe de ce même désir de concision l’absence quasi-complète de références bibliographiques au sujet de laquelle on émettra néanmoins quelques réserves. On s’interrogera enfin sur le parti-pris éditorial du refus d’une présentation trop scolaire – sous forme de plans détaillés par exemple – qui risque de conduire les étudiants à préférer à cet ouvrage des manuels plus pédagogiques.
Si l’on compare le cours de Pascal Boniface avec des ouvrages similaires écrits il y a une quinzaine d’années (on pense aux synthèses de Philippe Moreau-Defarges, de Marisol Touraine, de Ghassan Salamé ou de Maxime Lefebvre ), on est frappé par la continuité qui s’en dégage. Aujourd’hui comme hier, un cours de relations internationales s’organise autour de trois ou quatre grandes parties : une présentation du « cadre de la vie internationale », un tour du monde géopolitique des « puissances », un éclairage sur les grands « défis globaux » - auxquelles Boniface rajoute une quatrième partie, d’ailleurs très brève, sur les « valeurs ». Aujourd’hui comme hier, on recourt aux mêmes références : au sujet du Brésil, on cite Clémenceau (« le Brésil est un pays d’avenir qui le restera longtemps »), de la démographie Briand (« je fais la politique étrangère de notre natalité »), du réchauffement climatique Saint-Exupéry (« la Terre n’est pas un héritage de nos ancêtre mais un emprunt à nos descendants »).
Il ne faut pas lire dans ce qui précède un reproche à l’auteur de ne pas avoir mis à jour son cours. Bien au contraire, on saluera les références très contemporaines aux événements les plus récents (l’élection de Barack Obama, le conflit russo-géorgien, la crise financière internationale …) dont on sait qu’il est souvent difficile de les insérer harmonieusement à un plan que l’on renâcle parfois à actualiser d’une année sur l’autre.
Le constat vise au contraire à souligner que le monde ne change pas autant qu’on se plaît à le dire. Pascal Boniface a raison, dans son introduction, de relativiser le choc du 11-septembre qui, selon lui, constitua certainement un événement choquant mais pas une rupture historique – à la différence du 9 novembre 1989. Avant comme après le 11-septembre, les grandes questions qui se posent à notre monde demeurent les mêmes : quel ordre international ? quelles réponses aux grands défis globaux ? quelles valeurs universelles ?
Pascal Boniface parvient en moins de 300 pages à traiter tous les thèmes du programme de R.I. avec une concision qui force l’admiration, même si elle provoque parfois un brin de frustration (on regrettera que les chapitres sur le réchauffement climatique, les déséquilibres économiques internationaux ou la démographie, soient expédiés en moins de dix pages). Participe de ce même désir de concision l’absence quasi-complète de références bibliographiques au sujet de laquelle on émettra néanmoins quelques réserves. On s’interrogera enfin sur le parti-pris éditorial du refus d’une présentation trop scolaire – sous forme de plans détaillés par exemple – qui risque de conduire les étudiants à préférer à cet ouvrage des manuels plus pédagogiques.
Si l’on compare le cours de Pascal Boniface avec des ouvrages similaires écrits il y a une quinzaine d’années (on pense aux synthèses de Philippe Moreau-Defarges, de Marisol Touraine, de Ghassan Salamé ou de Maxime Lefebvre ), on est frappé par la continuité qui s’en dégage. Aujourd’hui comme hier, un cours de relations internationales s’organise autour de trois ou quatre grandes parties : une présentation du « cadre de la vie internationale », un tour du monde géopolitique des « puissances », un éclairage sur les grands « défis globaux » - auxquelles Boniface rajoute une quatrième partie, d’ailleurs très brève, sur les « valeurs ». Aujourd’hui comme hier, on recourt aux mêmes références : au sujet du Brésil, on cite Clémenceau (« le Brésil est un pays d’avenir qui le restera longtemps »), de la démographie Briand (« je fais la politique étrangère de notre natalité »), du réchauffement climatique Saint-Exupéry (« la Terre n’est pas un héritage de nos ancêtre mais un emprunt à nos descendants »).
Il ne faut pas lire dans ce qui précède un reproche à l’auteur de ne pas avoir mis à jour son cours. Bien au contraire, on saluera les références très contemporaines aux événements les plus récents (l’élection de Barack Obama, le conflit russo-géorgien, la crise financière internationale …) dont on sait qu’il est souvent difficile de les insérer harmonieusement à un plan que l’on renâcle parfois à actualiser d’une année sur l’autre.
Le constat vise au contraire à souligner que le monde ne change pas autant qu’on se plaît à le dire. Pascal Boniface a raison, dans son introduction, de relativiser le choc du 11-septembre qui, selon lui, constitua certainement un événement choquant mais pas une rupture historique – à la différence du 9 novembre 1989. Avant comme après le 11-septembre, les grandes questions qui se posent à notre monde demeurent les mêmes : quel ordre international ? quelles réponses aux grands défis globaux ? quelles valeurs universelles ?
Une mise en perspective historique des Jeux olympiques, sous l'angle politique et diplomatique.
Lien : http://www.nonfiction.fr/art..
Lien : http://www.nonfiction.fr/art..
Pascal BONIFACE avait publié cet essai de « géopolitique du football » à la veille de l’ouverture du Mondial 2002. Cet auteur prolixe, dans son souci de décloisonner les savoirs, élève non sans démagogie le football au rang de sujet géopolitique à part entière.
Il montre comment le ballon rond peut réconcilier les peuples. Ainsi la normalisation des relations hispano-soviétiques (l’Espagne refusait de reconnaître l’URSS) fut-elle précédée par une rencontre organisée lors de la Coupe des Nations de 1964. Américains et Iraniens ont également entamé leur rapprochement sur la pelouse d’un stage de football à Lyon lors du Mondial 98.
Mais le football est également « la continuation de la politique par d’autres moyens » voire la seule forme de guerre inter-étatique acceptable dans un monde où la guerre entre États a quasiment disparu. Parfois, une rivalité sportive peut dégénérer en conflit armé : c’est la « guerre du football » entre le Honduras et le Salvador en 1969. D’autres fois, c’est le match de football qui permet de prendre une revanche après une défaite militaire : ainsi de la victoire de l’Argentine sur l’Angleterre en demi-finale de la Coupe du Monde 86.
Pour autant, Pascal BONIFACE a raison de ne pas donner au football plus d’importance qu’il n’en a. Un match de football ne va pas déclencher un conflit entre deux pays qui entretiennent de bonnes relations, ni apporter la paix à des États qui veulent en découdre. Le football n’est qu’un instrument, parmi d’autres, dont disposent les acteurs de la vie internationale pour s’affronter ou se rapprocher. Il est en fin de compte toujours instrumentalisé par les États. Il est ainsi un instrument de prestige et de propagande, utilisé par exemple sans vergogne par Mussolini à l’occasion de la Coupe du monde de 1934 organisée - et remportée - par l’Italie. Il est aussi un moyen pour l’Etat de conquérir ou d’affirmer son identité nationale : les États nouvellement indépendants demandent, séance tenante, leur admission à la FIFA, qui compte plus de membres que l’ONU.
La vérité oblige toutefois à dire que Pascal BONIFACE n’apporte pas grand chose à l’ouvrage qu’il avait dirigé en 1998 (Géopolitique du football, Complexe). Il ne dit quasiment rien de l’évolution récente du football, se bornant à signaler une intéressante rencontre Tibet-Groënland en juillet 2001. Les fiches présentant les participants au Mondial 2002 sont certes utiles mais font trop figure de « pièce rapportée », dont la compilation sur 83 pages aura été sous-traitée à quelque stagiaire de l’IRIS,
Quelques thèmes intéressants sont évoqués mais pas assez fouillés : l’absence de domination américaine (voir plutôt « Pourquoi n’y a-t-il pas de football aux Etats-Unis ? » de Andrei MARKOVITS dans Vingtième siècle revue d’histoire, avril-juin 90), les déséquilibres Nord-Sud (« Le sport dans les relations internationales » de Patrick GAUTRAT, Revue française d’administration publique, janv-mars 2001) ou bien sûr les enjeux du Mondial 2002 (« World Cup Korea Japan 2002 : que la fête recommence » de BUI Xuan Quang, Revue juridique et économique du sport, mai-juin 2002).
Il montre comment le ballon rond peut réconcilier les peuples. Ainsi la normalisation des relations hispano-soviétiques (l’Espagne refusait de reconnaître l’URSS) fut-elle précédée par une rencontre organisée lors de la Coupe des Nations de 1964. Américains et Iraniens ont également entamé leur rapprochement sur la pelouse d’un stage de football à Lyon lors du Mondial 98.
Mais le football est également « la continuation de la politique par d’autres moyens » voire la seule forme de guerre inter-étatique acceptable dans un monde où la guerre entre États a quasiment disparu. Parfois, une rivalité sportive peut dégénérer en conflit armé : c’est la « guerre du football » entre le Honduras et le Salvador en 1969. D’autres fois, c’est le match de football qui permet de prendre une revanche après une défaite militaire : ainsi de la victoire de l’Argentine sur l’Angleterre en demi-finale de la Coupe du Monde 86.
Pour autant, Pascal BONIFACE a raison de ne pas donner au football plus d’importance qu’il n’en a. Un match de football ne va pas déclencher un conflit entre deux pays qui entretiennent de bonnes relations, ni apporter la paix à des États qui veulent en découdre. Le football n’est qu’un instrument, parmi d’autres, dont disposent les acteurs de la vie internationale pour s’affronter ou se rapprocher. Il est en fin de compte toujours instrumentalisé par les États. Il est ainsi un instrument de prestige et de propagande, utilisé par exemple sans vergogne par Mussolini à l’occasion de la Coupe du monde de 1934 organisée - et remportée - par l’Italie. Il est aussi un moyen pour l’Etat de conquérir ou d’affirmer son identité nationale : les États nouvellement indépendants demandent, séance tenante, leur admission à la FIFA, qui compte plus de membres que l’ONU.
La vérité oblige toutefois à dire que Pascal BONIFACE n’apporte pas grand chose à l’ouvrage qu’il avait dirigé en 1998 (Géopolitique du football, Complexe). Il ne dit quasiment rien de l’évolution récente du football, se bornant à signaler une intéressante rencontre Tibet-Groënland en juillet 2001. Les fiches présentant les participants au Mondial 2002 sont certes utiles mais font trop figure de « pièce rapportée », dont la compilation sur 83 pages aura été sous-traitée à quelque stagiaire de l’IRIS,
Quelques thèmes intéressants sont évoqués mais pas assez fouillés : l’absence de domination américaine (voir plutôt « Pourquoi n’y a-t-il pas de football aux Etats-Unis ? » de Andrei MARKOVITS dans Vingtième siècle revue d’histoire, avril-juin 90), les déséquilibres Nord-Sud (« Le sport dans les relations internationales » de Patrick GAUTRAT, Revue française d’administration publique, janv-mars 2001) ou bien sûr les enjeux du Mondial 2002 (« World Cup Korea Japan 2002 : que la fête recommence » de BUI Xuan Quang, Revue juridique et économique du sport, mai-juin 2002).
Le dernier opus de Pascal Boniface […] a paru aux éditions Jean-Claude Gawsevitch, dans la collection "Coup de gueule". Mais il n'en est pas vraiment un. Ce n’est certes pas non plus un hommage au quinquennat de l’actuel président. En matière de politique étrangère, il est néanmoins une réflexion équilibrée sur son bilan.
Lien : http://www.nonfiction.fr/art..
Lien : http://www.nonfiction.fr/art..
Le concept de cette nouvelle collection est d'en apprendre le plus possible, et le plus vite possible sur un sujet à priori complexe. Ici, le conflit israëlo-palestinien. Pour cela, Hatier applique une recette simple, alterner une page écrite, et un visuel judicieusement choisi. Ainsi on remonte l'histoire du conflit des origines du sionismes jusqu'aux incidents les plus récents.
La lecture est agréable et cela tient autant à la qualité du texte qu'à la mise en page et au dynamise coloré de cette collection.
N'attendez pas pour autant une lecture haletante, et une plongée ébouriffante au sein de l'histoire comme le permettent certain chefs d'oeuvre de romans historique.
Ce livre est un livre informatif, court et succin, et en cela il remplit son objectif.
La lecture est agréable et cela tient autant à la qualité du texte qu'à la mise en page et au dynamise coloré de cette collection.
N'attendez pas pour autant une lecture haletante, et une plongée ébouriffante au sein de l'histoire comme le permettent certain chefs d'oeuvre de romans historique.
Ce livre est un livre informatif, court et succin, et en cela il remplit son objectif.
J'ai reçu "Tout savoir sur le conflit Israélo-palestinien." dans le cadre de l'opération « Masse critique » de Babelio. Je remercie tout d'abord Babelio et l'éditeur Hatier pour ce chouette cadeau.
Cet ouvrage est un "Guide visuel à destination des esprits curieux et pressés." comme il se définit lui-même, alors pari réussi ?
« Guide visuel »: tout à fait réussi, en effet à chaque double-page une photographie présentant des cartes ainsi que les personnages principaux de ce conflit. Cela rend ce guide agréable à parcourir et donne de la substance au sujet.
« A destination des esprits curieux » : réussi, il couvre bien la thématique pour un non spécialiste, j’imagine que quelqu’un ayant suivi les phases du conflit régulièrement restera sur sa faim mais il trouvera un bon condensé dans ce livre.
« …et pressés » : réussi aussi, le livre se lit en une bonne heure, la forme est agréable et on a l’impression de lire un diaporama géant avec un texte pertinent dont les mots clés principaux sont mis en évidence ce qui permet de l’utiliser aussi comme référence et de retrouver rapidement les éléments principaux.
Est ce que je sais « tout sur le conflit Israélo-palestinien » maintenant ? Assurément pas mais j’ai une bonne vue d’ensemble sur les étapes principales de ce conflit qui dure. J’aurai apprécié une introduction plus fouillée sur les raisons qui font que cette partie du monde est tant convoitée par les représentants des 3 religions monothéistes (islam, juif et chrétiens).
La forme est agréable mais les écrits noirs sur fond rouge (notamment les légendes des photos) sont peu lisibles…
Cet ouvrage est un "Guide visuel à destination des esprits curieux et pressés." comme il se définit lui-même, alors pari réussi ?
« Guide visuel »: tout à fait réussi, en effet à chaque double-page une photographie présentant des cartes ainsi que les personnages principaux de ce conflit. Cela rend ce guide agréable à parcourir et donne de la substance au sujet.
« A destination des esprits curieux » : réussi, il couvre bien la thématique pour un non spécialiste, j’imagine que quelqu’un ayant suivi les phases du conflit régulièrement restera sur sa faim mais il trouvera un bon condensé dans ce livre.
« …et pressés » : réussi aussi, le livre se lit en une bonne heure, la forme est agréable et on a l’impression de lire un diaporama géant avec un texte pertinent dont les mots clés principaux sont mis en évidence ce qui permet de l’utiliser aussi comme référence et de retrouver rapidement les éléments principaux.
Est ce que je sais « tout sur le conflit Israélo-palestinien » maintenant ? Assurément pas mais j’ai une bonne vue d’ensemble sur les étapes principales de ce conflit qui dure. J’aurai apprécié une introduction plus fouillée sur les raisons qui font que cette partie du monde est tant convoitée par les représentants des 3 religions monothéistes (islam, juif et chrétiens).
La forme est agréable mais les écrits noirs sur fond rouge (notamment les légendes des photos) sont peu lisibles…
Je viens de recevoir dans le cadre de l’opération « Masse critique » de Babelio un petit livre : »Tout savoir sur le conflit Israélo-palestinien. » paru en décembre 2011 chez Hatier.
Ce petit livre fait partie d’une collection nouvelle qui se décrit comme étant des « Guide visuel à destination des esprits curieux et pressés. » Le livre est précédé d’une préface de Pascal Boniface, spécialiste bien connu de ces problèmes et qui dit tout, à la fois la passion qui entoure cette question et, cependant, la nécessité du débat.
Ce problème israélo-palestinien est, selon moi, une des questions la plus importante de notre époque et qui est la source, notamment, du conflit opposant le monde arabo-musulman à l’occident et donc, en grande partie du terrorisme islamique qui s’alimente de cette crise qui dure depuis plus de cinquante ans.
Des espoirs ont été mis récemment sur le rôle que pouvait jouer les Etats-Unis de Barack Obama dont le discours du Caire a donné beaucoup d’espoir. Force est de constater qu’il a échoué et, je le crains, renoncé à user de l’influence de son pays pour faire évoluer la question.
Ce contexte que je viens d’évoquer, même s’il rend assez pessimiste ne doit pas faire renoncer à lutter pour une paix juste, mais pour mener une telle lutte encore faut-il être informé. Ce petit livre a le grand mérite de donner aux lecteurs des faits historiques et rien que des faits bruts et ainsi de lui permettre de se faire sa propre opinion. Oeuvre, oh combien utile sur cette question si controversée et sur laquelle, hélas, la passion domine !
Tous ceux qui s’intéressent à la chose publique et notamment à cette question fondamentale pour la paix du monde, devraient avoir ce petit guide sous la main s’ils veulent aller à l’essentiel.
Ce petit livre fait partie d’une collection nouvelle qui se décrit comme étant des « Guide visuel à destination des esprits curieux et pressés. » Le livre est précédé d’une préface de Pascal Boniface, spécialiste bien connu de ces problèmes et qui dit tout, à la fois la passion qui entoure cette question et, cependant, la nécessité du débat.
Ce problème israélo-palestinien est, selon moi, une des questions la plus importante de notre époque et qui est la source, notamment, du conflit opposant le monde arabo-musulman à l’occident et donc, en grande partie du terrorisme islamique qui s’alimente de cette crise qui dure depuis plus de cinquante ans.
Des espoirs ont été mis récemment sur le rôle que pouvait jouer les Etats-Unis de Barack Obama dont le discours du Caire a donné beaucoup d’espoir. Force est de constater qu’il a échoué et, je le crains, renoncé à user de l’influence de son pays pour faire évoluer la question.
Ce contexte que je viens d’évoquer, même s’il rend assez pessimiste ne doit pas faire renoncer à lutter pour une paix juste, mais pour mener une telle lutte encore faut-il être informé. Ce petit livre a le grand mérite de donner aux lecteurs des faits historiques et rien que des faits bruts et ainsi de lui permettre de se faire sa propre opinion. Oeuvre, oh combien utile sur cette question si controversée et sur laquelle, hélas, la passion domine !
Tous ceux qui s’intéressent à la chose publique et notamment à cette question fondamentale pour la paix du monde, devraient avoir ce petit guide sous la main s’ils veulent aller à l’essentiel.
« Les intellectuels faussaires ». Quatorze refus d’éditeurs avant de le voir publié ! nous annonce son auteur Pascal Boniface. Admettons que le sujet est bien loin de faire consensus : « les intellectuels faussaires » ; autrement dit les intellectuels – ou considérés comme tels –dont l’engagement dans un sens ou dans l’autre, sur un sujet ou sur un autre – et notamment le conflit israélo-palestinien – est plus motivé par l’air du temps et/ou le gain éventuel en matière de carrière et/ou d’accès aux médias de grande diffusion… Jusqu’à utiliser des raisonnements fallacieux, voire malhonnêtes.
Quatorze refus tout de même !
Il faut dire que Pascal Boniface n’y va pas avec le dos de la cuillère. Fort d’une première partie « théorique » intitulée « De la malhonnêteté intellectuelle en général » où il expose un état des lieux des relations (parfois complices) entre réseaux d’intellectuels et médias, l’auteur nous brosse, en deuxième partie, une galerie de portraits plus ou moins bien sentie où l’on retrouve pêle-mêle : « tonton » Adler, « la serial menteuse » Caroline Fourest, Mohamed Sifaoui, Thérèse Delpech, Frédéric Encel, Philippe Val, et le bouquet final : l’ineffable BHL qui a droit, en tant que parangon de la malhonnêteté intellectuelle, à une étude de cas in extenso.
Au final, que restera-t-il de ce brûlot ? Une première partie – faible – qui ne convaincra que les convaincus ; et une deuxième partie, celle de la galerie de portraits, où, même convaincu, on ne ressent qu’une vaste opération revancharde. Pas très constructif, tout ça ; et je n’ai pu au long de cette lecture me départir de la pensée suivante : « Tout ce qui excessif est dérisoire… »
Que restera-t-il à la fin ? Rien. Dommage car je partage certaines analyses de l’auteur… Sur BHL, notamment.
Quatorze refus tout de même !
Il faut dire que Pascal Boniface n’y va pas avec le dos de la cuillère. Fort d’une première partie « théorique » intitulée « De la malhonnêteté intellectuelle en général » où il expose un état des lieux des relations (parfois complices) entre réseaux d’intellectuels et médias, l’auteur nous brosse, en deuxième partie, une galerie de portraits plus ou moins bien sentie où l’on retrouve pêle-mêle : « tonton » Adler, « la serial menteuse » Caroline Fourest, Mohamed Sifaoui, Thérèse Delpech, Frédéric Encel, Philippe Val, et le bouquet final : l’ineffable BHL qui a droit, en tant que parangon de la malhonnêteté intellectuelle, à une étude de cas in extenso.
Au final, que restera-t-il de ce brûlot ? Une première partie – faible – qui ne convaincra que les convaincus ; et une deuxième partie, celle de la galerie de portraits, où, même convaincu, on ne ressent qu’une vaste opération revancharde. Pas très constructif, tout ça ; et je n’ai pu au long de cette lecture me départir de la pensée suivante : « Tout ce qui excessif est dérisoire… »
Que restera-t-il à la fin ? Rien. Dommage car je partage certaines analyses de l’auteur… Sur BHL, notamment.
Sorti fin mai, «les Intellectuels faussaires» s'est vendu à 50.000 exemplaires en trois mois. Pour un essai, c'est considérable. Hélas, le contenu l'est nettement moins - considérable.
Lien : http://rss.nouvelobs.com/c/3..
Lien : http://rss.nouvelobs.com/c/3..
Ce livre, nécessaire, souligne les mensonges de certains de nos intellectuels les plus prisés des médias, mais par son manque de rigueur et son obsession, vire tristement au règlement de compte.
Lien : http://www.nonfiction.fr/art..
Lien : http://www.nonfiction.fr/art..
Je me suis donnée comme règle de conduite de ne jamais écrire une critique d’un livre que j’aurais abandonné en cours de lecture. Et dans le cas présent, j’ai dû me faire violence pour aller jusqu’au bout de cet ouvrage, à vrai dire relativement court (247 pages), qu’un de nos amis nous a prêté.
Je connaissais de loin l’auteur, Pascal Boniface, invité régulier d’émissions de débat comme « C dans l’air », spécialiste de la géostratégie, et défenseur du Monde Arabe en général et de la cause palestinienne en particulier. Au même titre que toute opinion, sa voix est éminemment respectable et il est bon que toutes les sensibilités puissent s’exprimer librement. Mais pourquoi donc cet intellectuel s’est-il donc mis en tête de « balancer » comme ça certains de ses confrères, dans un livre plein de rancœur et de haine et se parant, lui seul, de la détention de la vérité ?
Il n’est pas le premier de sa caste – celle des intellectuels justement – à « cracher dans la soupe médiatique ». Mais on en vient à se poser des questions : pourquoi cible-t-il tout particulièrement certains de ses contemporains comme Alexandre Adler, Caroline Fourest, Mohamed Sifaoui, Thérèse Delpech, Frédéric Encel, François Heisbourg, Philippe Val et surtout Bernard-Henry Levy , qualifié de seigneur et maître des faussaires ?
Je ne suis pas la seule à formuler cette question. Et je cite volontiers Wikipédia : certains passages du livre polémique "Les intellectuels faussaires" sont inspirés d'articles publiés auparavant sur le site d'Acrimed et dans Le Monde Diplomatique. De la même façon, Le Canard Enchaîné s'interroge dans une brève publiée le 3 août 2011 : «Pourquoi donc Pascal Boniface s'est-il transformé en "copiste solitaire"... comme le surnomment ceux qui se considèrent quelque peu pompés ?»
En fait, j’appliquerai bien au livre de Pascal Boniface la critique (citée par lui à propos d’un livre de Philippe Val) publiée dans Le Figaro du 8 février 2007 : « Cousu de truismes et d’évidences qui ne font guère trembler la vaisselle, son livre est pontifiant et soporifique. »
De toutes façons, les cibles de Pascal Boniface sont des intellectuels qui vivent très bien de leur talent, et je doute qu’en dehors le cercle restreint du microcosme parisien, ces dénonciations y portent un quelconque préjudice. N’est pas un bretteur comme Denis Jeambar (Portraits crachés) qui veut !
Et puis enfin il est des citations qui – même si elles sont parfaitement exactes - font frémir comme celle-ci, qui résument sans doute la profonde pensée de l’auteur : « Il est des juifs qui, soit parce qu’ils sont très à gauche (tradition du Bund) soit parce qu’ils sont très religieux (tradition de la Torah), pensent que les juifs ne doivent pas avoir d’Etat. »
Comme tout serait plus simple, n’est-ce pas ?
Je connaissais de loin l’auteur, Pascal Boniface, invité régulier d’émissions de débat comme « C dans l’air », spécialiste de la géostratégie, et défenseur du Monde Arabe en général et de la cause palestinienne en particulier. Au même titre que toute opinion, sa voix est éminemment respectable et il est bon que toutes les sensibilités puissent s’exprimer librement. Mais pourquoi donc cet intellectuel s’est-il donc mis en tête de « balancer » comme ça certains de ses confrères, dans un livre plein de rancœur et de haine et se parant, lui seul, de la détention de la vérité ?
Il n’est pas le premier de sa caste – celle des intellectuels justement – à « cracher dans la soupe médiatique ». Mais on en vient à se poser des questions : pourquoi cible-t-il tout particulièrement certains de ses contemporains comme Alexandre Adler, Caroline Fourest, Mohamed Sifaoui, Thérèse Delpech, Frédéric Encel, François Heisbourg, Philippe Val et surtout Bernard-Henry Levy , qualifié de seigneur et maître des faussaires ?
Je ne suis pas la seule à formuler cette question. Et je cite volontiers Wikipédia : certains passages du livre polémique "Les intellectuels faussaires" sont inspirés d'articles publiés auparavant sur le site d'Acrimed et dans Le Monde Diplomatique. De la même façon, Le Canard Enchaîné s'interroge dans une brève publiée le 3 août 2011 : «Pourquoi donc Pascal Boniface s'est-il transformé en "copiste solitaire"... comme le surnomment ceux qui se considèrent quelque peu pompés ?»
En fait, j’appliquerai bien au livre de Pascal Boniface la critique (citée par lui à propos d’un livre de Philippe Val) publiée dans Le Figaro du 8 février 2007 : « Cousu de truismes et d’évidences qui ne font guère trembler la vaisselle, son livre est pontifiant et soporifique. »
De toutes façons, les cibles de Pascal Boniface sont des intellectuels qui vivent très bien de leur talent, et je doute qu’en dehors le cercle restreint du microcosme parisien, ces dénonciations y portent un quelconque préjudice. N’est pas un bretteur comme Denis Jeambar (Portraits crachés) qui veut !
Et puis enfin il est des citations qui – même si elles sont parfaitement exactes - font frémir comme celle-ci, qui résument sans doute la profonde pensée de l’auteur : « Il est des juifs qui, soit parce qu’ils sont très à gauche (tradition du Bund) soit parce qu’ils sont très religieux (tradition de la Torah), pensent que les juifs ne doivent pas avoir d’Etat. »
Comme tout serait plus simple, n’est-ce pas ?
Excédé par « les mensonges de donneurs de leçons très médiatiques », Pascal Boniface se défoule dans un livre jouissif. Son ouvrage est un succès, y compris parmi les journalistes français « qui supportent mal ces phénomènes ».
Lien : http://www.lesoir.be/culture..
Lien : http://www.lesoir.be/culture..
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur
Auteurs proches de Pascal Boniface
Lecteurs de Pascal Boniface (810)Voir plus
Quiz
Voir plus
Qui a écrit cette oeuvre?
Qui a écrit 1984 ?
H.G Wells
O Wells
S Beckett
G Orwell
11 questions
10690 lecteurs ont répondu
Créer un quiz sur cet auteur10690 lecteurs ont répondu