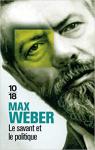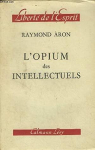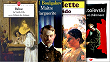Né(e) à : Paris , le 14/05/1905
Mort(e) à : Paris , le 17/10/1983
Raymond Claude Ferdinand Aron est un philosophe, sociologue, politologue, historien et journaliste français.
Issu d'une famille juive et d'un milieu aisé, il est élève en khâgne au lycée Condorcet (Paris) d'octobre 1922 à 1924, date à laquelle il est reçu à l'École normale supérieure, rue d'Ulm. Ses camarades sont alors Paul Nizan, Georges Canguilhem et Jean-Paul Sartre. En 1928, il est reçu 1er à l'agrégation de philosophie. Aron se rend à partir de 1930 en Allemagne où il étudie un an à l'université de Cologne, puis de 1931 à 1933 à Berlin, où il est pensionnaire de l'Institut français créé en 1930 et fréquente l'université de Berlin.
Il revient en France en 1933 et publie "La sociologie allemande contemporaine" où il introduit l'idée-nouvelle-de la relativité et d'indéterminisme en sociologie, en 1935. En 1938, il obtient son doctorat ès-Lettres avec une thèse intitulée "Introduction à la philosophie de l'histoire". En 1940, il rejoint Londres où il reste jusqu'en 1945. Engagé dans les Forces françaises libres, il devient rédacteur de La France Libre.
Une fois la guerre achevée, il s'installe à Paris et devient professeur à l'École nationale d'administration de Paris entre 1945 et 1947. Puis, de 1948 à 1954, il est professeur à l'Institut d'études politiques de Paris. Il est chargé d'enseignement dès 1955 puis, à partir de 1958, professeur à la faculté des lettres et sciences humaines de l'université de Paris ; directeur d'études à l'École pratique des hautes études de 1960 à 1983 ; professeur au Collège de France titulaire de la chaire "Sociologie de la civilisation moderne" de 1970 à 1978.
Il devient, lors de la montée des totalitarismes, un ardent promoteur du libéralisme, à contre-courant d'un milieu intellectuel pacifiste et de gauche alors dominant. Il dénonce ainsi, dans son ouvrage "L'Opium des intellectuels" (1955), l'aveuglement et la bienveillance des intellectuels à l'égard des régimes communistes.
Pendant trente ans, il est éditorialiste au quotidien Le Figaro. Durant ses dernières années, il travaille à L'Express. Grâce à des compétences et des centres d'intérêt multiples-en économie, sociologie, philosophie, géopolitique-il se distingue et acquiert une grande réputation auprès des intellectuels.
Ses convictions libérales et atlantistes lui attirent de nombreuses critiques. Longtemps méprisé par les intellectuels de la gauche marxiste, qui l’accusait de trahison, Raymond Aron garda avec obstination le cap de l’antitotalitari
Ajouter des informations
L'oeuvre du sociologue Raymond Aron est toujours vivante et pertinente. Ses idées tranchaient à son époque. le philosophe a pensé la guerre et les relations internationales à un moment où ce n'était pas en vogue. Son oeuvre permet encore de penser et analyser les relations internationales et le conflit israélo-palestinien. Comment Raymond Aron percevait-il les prémices d'un conflit qui fait toujours l'actualité ? Pour en parler, Guillaume Erner reçoit : - Perrine Simon-Nahum, docteure en histoire, directrice de recherches au CNRS et professeure attachée au département de philosophie de l'Ecole normale supérieure - Jean-Vincent Holeindre, professeur de science politique à l'Université Paris 2 Panthéon-Assas et directeur scientifique de l'IRSEM (Institut de recherche stratégique de l'Ecole militaire) #guerre #hamas ##israel _______________ Découvrez tous les invités des Matins dans "France Culture va plus loin" https://www.youtube.com/playlist?list=PLKpTasoeXDroMCMte_GTmH-UaRvUg6aXj ou sur le site https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/l-invite-e-des-matins Suivez France Culture sur : Facebook : https://fr-fr.facebook.com/franceculture Twitter : https://twitter.com/franceculture Instagram : https://www.instagram.com/franceculture TikTok : https://www.tiktok.com/@franceculture Twitch : https://www.twitch.tv/franceculture
La première partie de l'ouvrage reprend une définition de concepts-clés, à commencer par les différents sens de la politique, ainsi que la mise en perspective du lien entre la superstructure que constituent les régimes institutionnels et l'infrastructure économique et sociale, cela dans une perspective historique.
Elle se conclut par un dégagement des principes essentiels, au sens de Montesquieu, du régime démocratique et du régime totalitaire. Le premier se caractériserait par le respect de la légalité et l'esprit de compromis, perdant son essence s'il ne parvient pas à se maintenir entre ces deux principes, basculant soit dans la corruption, soit dans la démagogie, soit dans les deux. Le second repose sur la foi dans le partie, sur la domination idéologique par un parti se disant révolutionnaire. L'ordre social y est alors fondé sur le sentiment d'impuissance des masses, la croyance en un grand dessein, et la peur imposée aux opposants. Aron nuance toutefois le propos en affichant les biais, variantes, espaces d'interprétation possibles entre les régimes réels et ces "modèles".
Les deux chapitres suivant reprennent de manière dialectique oppositions et spécificités de chaque régime, à partir de l'observation sociologique des régimes existants au début des années 60. Quel dommage que R. Aron ne soit plus là pour analyser avec autant de finesse les spécificités et déviances de la Russie de Poutine, de la Chine de XI Jiping, de l'Amérique de Trump ou de la France de Macron, ou des phénonèmes comme l'Etat Islamique.
Il en résulte que l'analyse de R. Aron dans cet ouvrage mériterait une actualisation. De nombreux commentaires et nombre d'explications sont toujours utiles au lecteur pour interpréter l'actualité, mais le système aronien tel que posé est un peu daté. En outre, cet ouvrage présuppose d'avoir intégré -ce qui n'était pas on cas quand je l'ai lu- les fondements de sa pensée. Aussi, il me semble utile au lecteur de lire d'abord son ouvrage sur les Etapes de la Pensée Sociologique, avant celui-ci.
note 55 : Dans son message d'adieu à la nation, le 16 janvier 1961, le président Eisenhower met en garde ses concitoyens contre l'influence croissante du complexe militaro-industriel engendré par la guerre froide : " Notre organisation militaire actuelle a peu à voir avec ce que mes prédécesseurs ont connu. Nous avons été amenés à mettre en place une industrie permanente d'armements d'une vaste ampleur. Cette conjonction d'une immense institution militaire avec une grande industrie d'armements est un fait nouveau dans l'histoire américaine. Son influence en tous domaines, économique, politique, même moral, s'est abattue sur chaque municipalité, sur chaque État, sur chaque département de l'administration fédérale. Dans l'exercice du pouvoir, nous devons empêcher que s'impose cette influence sans garde-fou, qu'elle soit consciente ou non, de la part du complexe militaro-industriel. La possibilité d'ascension funeste d'un pouvoir envahissant existe et demeurera."
Aron ! Aron ! Petit Patapon !
Raymond Aron moque les compagnons de route du Parti communiste, notamment Sartre et le groupe des Temps modernes, en signifiant que comme le peuple dont l'opium est la religion selon Saint Marx, qu'eux aussi ont leur opium, ...?...
19 lecteurs ont répondu