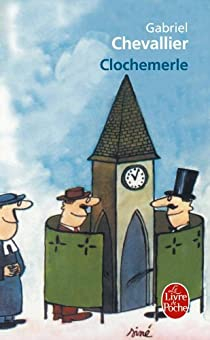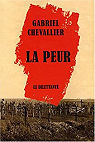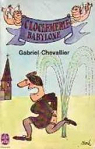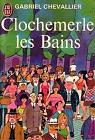le roman le plus drôle que j'aie lu récemment! Nous sommes en 1923 dans un petit village du beaujolais dont le nom n'existe pas. Les habitants sont plutôt débonnaires, aimant le bon vin et d'autres plaisirs et visitant l'église seulement le dimanche. L'installation d'un urinoir devant l'église va déclencher une querelle qui dépassera largement le cadre du village. Justine Putet, vieille fille aigrie habitant au-dessus de l'église, va en effet s'élever contre ce défilé d'hommes sous ses fenêtres. Les habitants sont des caricatures: il y a le cocu content de l'être, la femme qui fait fantasmer tout le village, sa rivale patronne du café se laissant volontiers tripoter les fesses, le curé qui , pour le bien de l'Eglise, assouvit ses pulsions avec sa bonne, l'instituteur qui se prend pour un intellectuel, la baronne arrogante, le fils de famille se rêvant poète... la satire est mordante et, quand elle touche à la hiérarchie politique ou militaire, elle n'a pas pris une ride!
A cause de la construction d'une pissotière jugée par certains trop proche de l'église, c'est tout un petit village qui implose sous l'oeil impitoyable et la prose délicieusement vitriolée de l'auteur.
Armée, religion, croyants, hommes politiques, administration, bourgeoisie, aristocratie : personne n'est épargné et Gabriel Chevallier porte à son plus haut niveau la satire sociale.
On se régale de ces petites et grandes mesquineries humaines, de cette bienpensance hypocrite décortiquées avec un mordant jubilatoire : commérages de villageois et voisins bouffés par l'envie et la jalousie, manoeuvres politiciennes puantes d'opportunisme, alliances intéressées, étalage de petitesses humaines, comportements peu glorieux de ses semblables, l'auteur n'oublie rien de ce qui fait les petits travers humains les plus détestables.
La chronique est féroce, le sarcasme est élevé au rang d'art, Gabriel Chevallier fait payer à la caste des décideurs politiques sa jeunesse bousillée dans les tranchées de la Première Guerre Mondiale.
Sa plume est aussi tranchante qu'un couperet, son humour caustique est salutaire et le rire est maintenu sur les 300 pages qui composent ce roman.
On tient là une charge satirique comme j'en ai rarement eu entre mes mains de lecteur !
Armée, religion, croyants, hommes politiques, administration, bourgeoisie, aristocratie : personne n'est épargné et Gabriel Chevallier porte à son plus haut niveau la satire sociale.
On se régale de ces petites et grandes mesquineries humaines, de cette bienpensance hypocrite décortiquées avec un mordant jubilatoire : commérages de villageois et voisins bouffés par l'envie et la jalousie, manoeuvres politiciennes puantes d'opportunisme, alliances intéressées, étalage de petitesses humaines, comportements peu glorieux de ses semblables, l'auteur n'oublie rien de ce qui fait les petits travers humains les plus détestables.
La chronique est féroce, le sarcasme est élevé au rang d'art, Gabriel Chevallier fait payer à la caste des décideurs politiques sa jeunesse bousillée dans les tranchées de la Première Guerre Mondiale.
Sa plume est aussi tranchante qu'un couperet, son humour caustique est salutaire et le rire est maintenu sur les 300 pages qui composent ce roman.
On tient là une charge satirique comme j'en ai rarement eu entre mes mains de lecteur !
J'ai beaucoup apprécié la Peur de Gabriel Chevallier. La lecture de Clochemerle, longtemps différée, me partage un peu. La vacherie est partout présente: tout le monde y passe: l'instituteur, le paysan amateur de beaujolais et près de ses sous, la vieille fille rancie, la jeune fille niaise, la femme mûre volage, l'élu calculateur, la baronne condescendante, le notaire confit, bref chacun en prend pour son grade tout au long du livre. Bien sûr il y a un souffle et un style agréable sinon épique. Mais le monde rural recèle peut être d'autres aspects hier comme aujourd'hui, non?
ça faisait longtemps que je ne m'étais pas un peu forcée pour finir un livre, alors ça trainaillait, mais quand même, je voulais connaitre la fin. Non qu'elle soit transcendante, mais l'immersion est dépaysante et le vocabulaire aussi. L'histoire se passe en 1923, le roman est sorti en 1934, et autant dire que ça se sent. Si vous êtes féministes ET que vous avez du mal à prendre du recul et de la hauteur, fuyez, loin ! Sinon, vous risquez de vous amuser, vous aurez même peut-être envie de vous en servir comme d'un matériau très intéressant sur la place et la vision des femmes dans le milieu rural de ces années-là :)
Plus de huit décennies après sa parution, ce livres reste d'une actualité brûlante. Un style delicieux. Des réflexions mémorables. Un pur plaisir.
En 1922, à Clochemerle-en-Beaujolais, le maire Piéchut décide d'installer dans sa commune une vespasienne, pour le confort urinaire de ses administrés, et pour faire la nique à la réaction locale ; la baronne, le curé et le notaire.
Paru en 1934, le roman de Chevallier connut un succès qui ne se dément pas.
Adapté au cinéma en 1948, (film interdit au moins de 16 ans à sa sortie !) Clochemerle est passé dans le langage courant; on évoque parfois encore ce nom pour parler d'une querelle locale un peu ridicule, exemple au hasard: Un "néo-rural" qui se plaint du bruit des cloches ou du chant du coq…
Au-delà de la farce et de la critique sociale sous-jacente, il faut signaler la qualité de l'écriture de Gabriel Chevallier ; riche, drôle, imagée, elle est infiniment plaisante.
Il est bien dommage que cet auteur soit tombé dans l'oubli, car il semble que Clochemerle soit son seul roman encore réédité et disponible en librairie de nos jours -en l'occurrence au Livre de Poche- citons aussi son roman sur son expérience de la première guerre mondiale "La peur", occasionnellement réédité.
Chevallier, n'est donc pas l'auteur d'un seul roman emblématique, je vous invite cordialement à le découvrir !
Paru en 1934, le roman de Chevallier connut un succès qui ne se dément pas.
Adapté au cinéma en 1948, (film interdit au moins de 16 ans à sa sortie !) Clochemerle est passé dans le langage courant; on évoque parfois encore ce nom pour parler d'une querelle locale un peu ridicule, exemple au hasard: Un "néo-rural" qui se plaint du bruit des cloches ou du chant du coq…
Au-delà de la farce et de la critique sociale sous-jacente, il faut signaler la qualité de l'écriture de Gabriel Chevallier ; riche, drôle, imagée, elle est infiniment plaisante.
Il est bien dommage que cet auteur soit tombé dans l'oubli, car il semble que Clochemerle soit son seul roman encore réédité et disponible en librairie de nos jours -en l'occurrence au Livre de Poche- citons aussi son roman sur son expérience de la première guerre mondiale "La peur", occasionnellement réédité.
Chevallier, n'est donc pas l'auteur d'un seul roman emblématique, je vous invite cordialement à le découvrir !
S'il est certain que Gabriel Chevallier fut un auteur populaire, et que son roman a fait la joie de plusieurs générations, on ne peut pas dire qu'il se soit montré indulgent pour certains de ses contemporains.
L'univers clochemerlesque fait penser irrésistiblement aux dessins de Dubout, dans lesquels se côtoient des personnages grotesques ou vaniteux, couples dépareillés, foules en délire ou en furie, populace débraillée et forte en gueule. Fortes matrones ou vieilles filles desséchées, godelureaux naïfs ou vieux grigous bilieux, on est certes dans la caricature appuyée, pas loin du stéréotype. Grâce au style du portraitiste, qui ne se prive pas de nous fournir tous les détails, au physique et au moral, de ses personnages, le théâtre Guignol devient digne de Molière.
Mais au-delà de la caricature, transperce la tendresse pour le genre humain, ses faiblesses et sa fragilité. Ses travers et sa drôlerie souvent involontaires, ses bouffées d'orgueil et son incurable optimisme. le récit passe de la bouffonnerie au drame, mais c'est toujours le rire qui l'emporte. Chevallier n'a pas oublié les leçons de Maitre Rabelais, et Clochemerle est le lieu de guerres Picrocholines, de banquets et de beuveries mémorables, ou le curé et le sacristain sont de la partie. le jus de la treille réjouit les gosiers et les coeurs, il s'ensuit une belle ardeur qui annonce d'autres réjouissances de la chair.
Passées les agapes et les batifolages villageois, au détour d'un chapitre, Chevallier ne se prive pas de glisser des discours violemment anti-militaristes et anti-cléricaux. La tradition lyonnaise des canuts ne se trouve pas que dans la consommation des pots de beaujolais. Il y a ici de la critique sociale qui attaque aussi bien les bourgeois étriqués et les aristos décatis que les politiciens sans scrupule.
Clochemerle est ainsi une lecture résolument subversive, qui prône la liberté de vivre et de penser, plus libertaire et contestataire qu'on ne le croirait, plus proche de Brassens que de Chasse, pêche, nature et traditions.
L'univers clochemerlesque fait penser irrésistiblement aux dessins de Dubout, dans lesquels se côtoient des personnages grotesques ou vaniteux, couples dépareillés, foules en délire ou en furie, populace débraillée et forte en gueule. Fortes matrones ou vieilles filles desséchées, godelureaux naïfs ou vieux grigous bilieux, on est certes dans la caricature appuyée, pas loin du stéréotype. Grâce au style du portraitiste, qui ne se prive pas de nous fournir tous les détails, au physique et au moral, de ses personnages, le théâtre Guignol devient digne de Molière.
Mais au-delà de la caricature, transperce la tendresse pour le genre humain, ses faiblesses et sa fragilité. Ses travers et sa drôlerie souvent involontaires, ses bouffées d'orgueil et son incurable optimisme. le récit passe de la bouffonnerie au drame, mais c'est toujours le rire qui l'emporte. Chevallier n'a pas oublié les leçons de Maitre Rabelais, et Clochemerle est le lieu de guerres Picrocholines, de banquets et de beuveries mémorables, ou le curé et le sacristain sont de la partie. le jus de la treille réjouit les gosiers et les coeurs, il s'ensuit une belle ardeur qui annonce d'autres réjouissances de la chair.
Passées les agapes et les batifolages villageois, au détour d'un chapitre, Chevallier ne se prive pas de glisser des discours violemment anti-militaristes et anti-cléricaux. La tradition lyonnaise des canuts ne se trouve pas que dans la consommation des pots de beaujolais. Il y a ici de la critique sociale qui attaque aussi bien les bourgeois étriqués et les aristos décatis que les politiciens sans scrupule.
Clochemerle est ainsi une lecture résolument subversive, qui prône la liberté de vivre et de penser, plus libertaire et contestataire qu'on ne le croirait, plus proche de Brassens que de Chasse, pêche, nature et traditions.
Le récit est un vrai bijou de trouvaille dans la façon dont il est agencé et dans le contenu !
Tout commence dès le premier chapitre avec le maire, M. Piéchut (admiré le nom) qui décide de moderniser son village de Clochemerle et pour cela de faire installer un urinoir, une pissotière.. bref... une bombe à retardement aux conséquences hallucinantes !!!
Les habitants du bourg sont invraisemblables ... perso, je ne voudrais pas habiter dans ce village. Je vous présente quelques habitants :
- le curé succombant aux péchés de la chair avec sa servante et partant se confesser toutes les semaines.
- la femme de l'épicier... la Bimbo du coin.... une nymphomane dont le seul homme à ne pas être au courant est son mari.
- le docteur... Dr Frankenstein ! Pour lui, les anesthésies c'est INUTILE et la douceur également. Je vous laisse imaginer le personnage
- le pharmacien et son penchant pour le morbide (
- le notaire et sa vision anti-humaniste et pro-pécuniaire dans ses jugements
- l'instit ... monsieur je vous asphyxie de mon haleine !!
- la vieille fille ... la scène finale est d'une drôlerie !
Bref, suite à l'installation de l'urinoir, deux clans voient le jour : les urinophobes et les urinophiles :D (désolé pour les néologismes)
Très vite, la guéguerre prend de telle proportion que cela en arrive aux oreilles du gouvernement, voire même internationale (le passage lors de la conférence pour le désarmement est génial !
Côté structure... un récit frais, drôle avec un côté rustique pour ne pas dire régionale avec des expressions de patois. L'auteur n'hésite pas à faire parler certains habitants pour relater les faits et cela apporte un véritable aspect vivant au récit.
Une superbe satire de notre société et du monde politique. Quand on le lit, on pourrait aisément le transposer à notre époque où les politiques sont imbus d'eux-mêmes et non là pour servir une cause ou un pays.
Pour résumer : à lire sans la moindre hésitation parce que vous allez avoir droit à de vrais moments de rires
Tout commence dès le premier chapitre avec le maire, M. Piéchut (admiré le nom) qui décide de moderniser son village de Clochemerle et pour cela de faire installer un urinoir, une pissotière.. bref... une bombe à retardement aux conséquences hallucinantes !!!
Les habitants du bourg sont invraisemblables ... perso, je ne voudrais pas habiter dans ce village. Je vous présente quelques habitants :
- le curé succombant aux péchés de la chair avec sa servante et partant se confesser toutes les semaines.
- la femme de l'épicier... la Bimbo du coin.... une nymphomane dont le seul homme à ne pas être au courant est son mari.
- le docteur... Dr Frankenstein ! Pour lui, les anesthésies c'est INUTILE et la douceur également. Je vous laisse imaginer le personnage
- le pharmacien et son penchant pour le morbide (
- le notaire et sa vision anti-humaniste et pro-pécuniaire dans ses jugements
- l'instit ... monsieur je vous asphyxie de mon haleine !!
- la vieille fille ... la scène finale est d'une drôlerie !
Bref, suite à l'installation de l'urinoir, deux clans voient le jour : les urinophobes et les urinophiles :D (désolé pour les néologismes)
Très vite, la guéguerre prend de telle proportion que cela en arrive aux oreilles du gouvernement, voire même internationale (le passage lors de la conférence pour le désarmement est génial !
Côté structure... un récit frais, drôle avec un côté rustique pour ne pas dire régionale avec des expressions de patois. L'auteur n'hésite pas à faire parler certains habitants pour relater les faits et cela apporte un véritable aspect vivant au récit.
Une superbe satire de notre société et du monde politique. Quand on le lit, on pourrait aisément le transposer à notre époque où les politiques sont imbus d'eux-mêmes et non là pour servir une cause ou un pays.
Pour résumer : à lire sans la moindre hésitation parce que vous allez avoir droit à de vrais moments de rires
ISBN : inconnu
Françaises, Français ...
... Ah ! ah ! avouez que je vous ai fait peur ! Mais si, je vous ai vu sursauter, là, vous, dans le coin, qui tentez de vous cacher derrière votre camarade ! Vous vous êtes dit sans doute : "Pour son anniversaire, elle a complètement pété les plombs !" mais rassurez-vous, il n'en est rien : je commençais ainsi parce qu'il est dommage que le rédacteur de "La Peur" (roman terrible sur la non moins terrible Grande guerre) ou encore de "Sainte-Colline" (récit d'une scolarité malheureuse) ne soit resté dans la mémoire de la majorité d'entre nous (et sur la majorité de nos étagères de bibliothèque) que pour un seul roman, il est vrai digne de Rabelais mais en moins pédagogique : "Clochemerle." Quand je suis née - il y a de cela cinquante-six ans - on interdisait sévèrement aux enfants d'y porter ne fût-ce que le regard le plus indifférent : c'est vous dire combien les vilains garnements (dont je ne fus jamais ) cherchaient à en savoir plus. D'autant que, dans l'édition qu'il y avait chez ma grand-mère (et que j'ai rachetée chez un bouquiniste par la suite), les illustrations avaient un charme baroque, un peu à la Peynet. L'un des personnages, qui soulève son chapeau melon devant "Les Galeries Beaujolaises" et la flamboyante Judith Toutmignon, ressemble d'ailleurs presque comme un frère à l'Amoureux de Peynet. Mais comme, à l'époque, on ne signalait pas le nom des illustrateurs à moins que leur nom ne fût déjà bien connu (manie détestable et injuste réapparue depuis quelques années d'ailleurs dans notre monde des quatrièmes de couvertures), il m'est impossible de vous garantir que c'est effectivement Peynet qui conçut la première jaquette de "Clochemerle" pour "Le Livre de Poche."
Roman inusable, indémodable, "Clochemerle" fait partie de ces succès de librairie qu'on réédite régulièrement et qui fit, d'ailleurs, la fortune de son auteur, le Lyonnais Gabriel Chevallier né l'année même où les frères Lumières inauguraient ... le cinéma. Pourquoi un tel succès pour un livre qui insiste - parfois lourdement - sur l'aspect grivois de l'intrigue et qui se rebelle plus ou moins ouvertement contre le système - encore et toujours lui - même si le déclenchement du Grand Soir n'en est pas le thème principal ?
Eh ! bien, peut-être parce que "Clochemerle" symbolise toute une part de notre littérature, la part rabelaisienne et humaniste, le tout en un style beaucoup plus fin que ne se l'imaginerait quelqu'un qui ne l'a jamais lu, le tout fondé sur des personnages truculents et qui, bien que solidement typés pour la plupart, n'en font pas moins terriblement authentiques. A Clochermerle, paysans ou notables, on ne triche pas. En tous cas, pas avec le lecteur. On dit ce qu'on pense, dans la langue de Molière, en trébuchant parfois sur les syllabes parce qu'il faut bien rappeler que ce livre est aussi un roman de terroir et l'on n'y a aucune honte de ce coq emblématique associé à notre pays, qui célèbre avec ardeur le retour du soleil et laisse traîner ses ergots dans le fumier avec la plus totale indifférence : "Rien ne se perd ..."
"Clochemerle", c'est la France rurale qui sort de la Grande guerre - nous sommes en 1922 - et qui, sous un soleil éclatant, voit se ranimer en ses murs la vieille querelle entre cléricaux et anti-cléricaux. le maire, Barthélémy Piéchut, enfant du pays, a en effet pour projet de faire bâtir un nouvel édicule auprès de l'église, fief du paisible abbé Ponosse. Mais attention ! Pas n'importe quel édicule ! Non, messieurs-dames, Piéchut, avec sa roublardise joviale et gardant toujours en vue un avenir de sénateur (et pourquoi pas ? On a vu bien pire, non ? ... ) entend "moderniser" sa municipalité en y faisant élever ... un urinoir où ne seront évidemment autorisées à s'exprimer que les vessies de sexe mâle. Or, outre sa frappante proximité avec l'église, le lieu choisi par Piéchut donne d'un côté sur l'Impasse des Moines et, de l'autre, sur une autre impasse au nom tout aussi réjouissant. Mais c'est dans l'Impasse des Moines que réside, si mes souvenirs ne m'ont pas encore lâchée, la redoutable et redoutée Justine Putet, "vieille fille" attitrée du bourg, à la langue implacable et aux obsessions innombrables, surtout dans le domaine sexuel. Justine Putet possède de surcroît, on ne peut le lui contester, un sens de la repartie absolument fracassant qui lui fera jeter à sa rivale en piété, la non moins redoutable Clémentine Chavaigne - que le pharmacien du coin, perdant la tête, avait anesthésiée dans son arrière boutique dans des buts ... euh ... mystérieux mais à coup sûr répréhensibles - qu'elle "s'était fait poilpharder." Expression désormais passée dans le langage courant clochemerlin et issue du nom du malheureux apothicaire à la dérive de ses fantasmes : Poilphard.
Alors, comptons ensemble, si vous le voulez bien : l'église, le curé Ponosse, sa fidèle servante-maîtresse (chuttt ! ) Honorine et Justine Putet d'un côté et, de l'autre, le maire et son premier adjoint, l'instituteur Ernest Tafardel, célibataire intouchable portant lorgnon et petit bouc, grand amateur et rédacteur de discours anti-calotins, jacobin de première main et d'une honnêteté scrupuleuse que certains événements actuels scandalisent certainement, dans ce Paradis des Livres qui illumine mon humble logis. Soutenant Piéchut et Tafardel, tous les radicaux "de gauche" (oui, de gauche, vous voulez que j'épelle ?) de la commune, ceux qui ne vont pas à la messe très régulièrement mais qui, en général, font toujours baptiser leur progéniture.
Entre les deux, l'urinoir et ce à quoi il est destiné.
Et, partout, partout, avec une bonne humeur rabelaisienne (je sais, j'insiste, tant pis ! ), les femmes et filles de Clochemerle qui ragotent et cancanent sur le mode suraigu. Comme leurs hommes d'ailleurs, ces dames connaissent tous les scandales, ceux qui ont éclaté, ceux qui éclatent au moment où je tape sur ce clavier, et surtout ceux qui vont éclater dans pas longtemps. Ainsi, tenez, le cas de la Rose Bivaque, honteusement chassée de la confrérie des Enfants de Marie en raison d'un petit ventre qui se fait un peu trop proéminent depuis que le Claudius Brodequin - un beau gars, et pas fier, et travailleur, et dont les parents ont du bien - est parti au régiment. La Rose Bivaque, le Bon Dieu, le curé Ponosse - qui est un bon gros naïf, de l'avis de toutes les dames-patronesses du coin, lesquelles le considèrent à la fois avec le respect dû à sa fonction et le mépris absolu du sexe faible pour un curé qui croit tout ce qu'on lui raconte - continuerait à le lui donner pratiquement sans confession, tous les dimanche, si seulement il n'y avait pas ce ventre ...
Mais sans l'urinoir, mesdames, messieurs, sans l'urinoir diabolique des non moins sataniques Piéchut et Tafardel, ce ventre n'aurait jamais grossi comme ça, tout seul, dans la nature, alors qu'il se promenait en toute innocence avec le Claudius Brodequin - un pervers, celui-là, démoniaque lui aussi et à qui on devrait infliger le sort jadis imaginé par le bon et miséricordieux chanoine Fulbert envers ce satyre d'Abélard !
Oui, Mesdames, oui, Messieurs : il FAUT détruire l'urinoir ! le lapider, le raser, le piétiner, lui cracher dessus, répandre du sel sur ce qui fut ses fondations puantes, le ...
Et encore, je ne vous donne ici qu'un bien modeste aperçu du climat de tensions et de haines, laïcardes comme religieuses, qui a entrepris de détruire Clochemerle et les Clochemerlins !
Cet urinoir, ce ventre, ces dame-patronesses, celles qui n'en sont pas comme Judith Toumignon la Sans-Vergogne, qui fait cocu son François d'époux, un parfait abruti , à tous les coins de rue (et peut-être même dans l'urinoir, qui sait ? ) ou encore sa rivale, Adèle Torbayon, la bistrotière du coin, qui trompe aussi allègrement son mari (celui-là, c'est Arthur ) mais dont le rêve, d'ailleurs atteint, est de le tromper avec l'amant en titre de Judith, le bel Hippolyte Foncimagne, et surtout ces vieilles filles estampillées "Pureté et Chasteté" comme la Putet et la Chavaigne, sans oublier les ivrognes du coin (ils sont assez nombreux et, côté cancans, bien qu'appartenant au sexe prétendu "fort", ils en remontrent parfois à Justine Putet en personne, c'est vous dire ! ) et tous ces imbéciles, jeunes et vieux, qui, émergeant de l'urinoir, ont omis - volontairement ou non, nous ne nous prononcerons pas - de rajuster leur braguette un peu débraillée tout en adressant de grands signes amicaux de la main à la malheureuse Justine Putet - oui, toujours elle - qu'on soupçonne de satisfaire ces plaisirs qu'on dit charnels en espionnant à sa fenêtre les allées et venues autour de l'urinoir piéchutesque ...
... tout ça crée une gigantesque cocotte-minute avant l'heure qui va exploser avec la remontée triomphale de la grand-rue clochemerline par une Justine Putet qui n'a plus toute sa tête et qui s'est décidée à se rendre à la grand-messe dans le plus simple appareil, à l'exception d'un chapelet probablement destiné, dans son esprit détraqué, à protéger en dernier recours ce qu'elle possède de plus précieux.
Sous ces dehors rabelaisiens, Gabriel Chevallier inscrit en filigrane la critique féroce d'une société qui, lentement, se délite, obsédée qu'elle est par l'argent, le statut social et le sexe. Oh ! les mots ne sont pas prononcés mais, dans l'"héneaurme" silence typiquement gaulois de "Clochemerle", ce sont eux que le lecteur attentif entend bien au-delà les vociférations et fanfaronnades d'une tel ou d'une telle.
En ce sens, on peut dire sans exagération - je ne pense pas que notre amie Lydia me contredise - que "Clochemerle", sorti initialement en 1934, assure le lien avec les fabliaux de notre Moyen-Âge, l'oeuvre de Rabelais, les flopées de libelles licencieux qui se prélassent tout au long de l'histoire de notre littérature, les "gauloiseries" d'un Paul de Kock dont, paraît-il, se régalait le Chancelier de Fer, pourtant si peu francophile et ce type d'ouvrages qui, de tous temps, certains avec talent, d'autres avec une vulgarité rare, ont contribué à la survie d'une certaine partie (oh ! peut-être pas la plus glorieuse, je l'admets ! ) de la littérature française. J'oserai même aller plus loin en précisant que les fantasmes sexuels du pharmacien Poilphard ont bel et bien quelque chose de sadien ...
Pour en terminer, n'allez pas croire que Chevallier se contente de se moquer des malheureuses comme Justine Putet. Bien au contraire. Sous le grotesque de leurs excès, il pose la question, là aussi en filigrane : "Qui les a rendues ainsi ? Ne sommes-nous pas un peu responsables, dans le fond, nous qui avons eu plus de chance qu'elles ?"
Gabriel Chevallier, féministe avant la lettre ? Peut-être. En tous cas un homme intelligent, qui se posait pas mal de questions et qu'il est bon de découvrir (ou plutôt de redécouvrir) non seulement avec sa trilogie de "Clochemerle" (bien que le premier volume soit le meilleur, vous vous en doutez) mais aussi avec bien d'autres livres dont "La Peur", lequel vaut largement, voire même dépasse "Le Feu" de Henri Barbusse. ;o)
Françaises, Français ...
... Ah ! ah ! avouez que je vous ai fait peur ! Mais si, je vous ai vu sursauter, là, vous, dans le coin, qui tentez de vous cacher derrière votre camarade ! Vous vous êtes dit sans doute : "Pour son anniversaire, elle a complètement pété les plombs !" mais rassurez-vous, il n'en est rien : je commençais ainsi parce qu'il est dommage que le rédacteur de "La Peur" (roman terrible sur la non moins terrible Grande guerre) ou encore de "Sainte-Colline" (récit d'une scolarité malheureuse) ne soit resté dans la mémoire de la majorité d'entre nous (et sur la majorité de nos étagères de bibliothèque) que pour un seul roman, il est vrai digne de Rabelais mais en moins pédagogique : "Clochemerle." Quand je suis née - il y a de cela cinquante-six ans - on interdisait sévèrement aux enfants d'y porter ne fût-ce que le regard le plus indifférent : c'est vous dire combien les vilains garnements (dont je ne fus jamais ) cherchaient à en savoir plus. D'autant que, dans l'édition qu'il y avait chez ma grand-mère (et que j'ai rachetée chez un bouquiniste par la suite), les illustrations avaient un charme baroque, un peu à la Peynet. L'un des personnages, qui soulève son chapeau melon devant "Les Galeries Beaujolaises" et la flamboyante Judith Toutmignon, ressemble d'ailleurs presque comme un frère à l'Amoureux de Peynet. Mais comme, à l'époque, on ne signalait pas le nom des illustrateurs à moins que leur nom ne fût déjà bien connu (manie détestable et injuste réapparue depuis quelques années d'ailleurs dans notre monde des quatrièmes de couvertures), il m'est impossible de vous garantir que c'est effectivement Peynet qui conçut la première jaquette de "Clochemerle" pour "Le Livre de Poche."
Roman inusable, indémodable, "Clochemerle" fait partie de ces succès de librairie qu'on réédite régulièrement et qui fit, d'ailleurs, la fortune de son auteur, le Lyonnais Gabriel Chevallier né l'année même où les frères Lumières inauguraient ... le cinéma. Pourquoi un tel succès pour un livre qui insiste - parfois lourdement - sur l'aspect grivois de l'intrigue et qui se rebelle plus ou moins ouvertement contre le système - encore et toujours lui - même si le déclenchement du Grand Soir n'en est pas le thème principal ?
Eh ! bien, peut-être parce que "Clochemerle" symbolise toute une part de notre littérature, la part rabelaisienne et humaniste, le tout en un style beaucoup plus fin que ne se l'imaginerait quelqu'un qui ne l'a jamais lu, le tout fondé sur des personnages truculents et qui, bien que solidement typés pour la plupart, n'en font pas moins terriblement authentiques. A Clochermerle, paysans ou notables, on ne triche pas. En tous cas, pas avec le lecteur. On dit ce qu'on pense, dans la langue de Molière, en trébuchant parfois sur les syllabes parce qu'il faut bien rappeler que ce livre est aussi un roman de terroir et l'on n'y a aucune honte de ce coq emblématique associé à notre pays, qui célèbre avec ardeur le retour du soleil et laisse traîner ses ergots dans le fumier avec la plus totale indifférence : "Rien ne se perd ..."
"Clochemerle", c'est la France rurale qui sort de la Grande guerre - nous sommes en 1922 - et qui, sous un soleil éclatant, voit se ranimer en ses murs la vieille querelle entre cléricaux et anti-cléricaux. le maire, Barthélémy Piéchut, enfant du pays, a en effet pour projet de faire bâtir un nouvel édicule auprès de l'église, fief du paisible abbé Ponosse. Mais attention ! Pas n'importe quel édicule ! Non, messieurs-dames, Piéchut, avec sa roublardise joviale et gardant toujours en vue un avenir de sénateur (et pourquoi pas ? On a vu bien pire, non ? ... ) entend "moderniser" sa municipalité en y faisant élever ... un urinoir où ne seront évidemment autorisées à s'exprimer que les vessies de sexe mâle. Or, outre sa frappante proximité avec l'église, le lieu choisi par Piéchut donne d'un côté sur l'Impasse des Moines et, de l'autre, sur une autre impasse au nom tout aussi réjouissant. Mais c'est dans l'Impasse des Moines que réside, si mes souvenirs ne m'ont pas encore lâchée, la redoutable et redoutée Justine Putet, "vieille fille" attitrée du bourg, à la langue implacable et aux obsessions innombrables, surtout dans le domaine sexuel. Justine Putet possède de surcroît, on ne peut le lui contester, un sens de la repartie absolument fracassant qui lui fera jeter à sa rivale en piété, la non moins redoutable Clémentine Chavaigne - que le pharmacien du coin, perdant la tête, avait anesthésiée dans son arrière boutique dans des buts ... euh ... mystérieux mais à coup sûr répréhensibles - qu'elle "s'était fait poilpharder." Expression désormais passée dans le langage courant clochemerlin et issue du nom du malheureux apothicaire à la dérive de ses fantasmes : Poilphard.
Alors, comptons ensemble, si vous le voulez bien : l'église, le curé Ponosse, sa fidèle servante-maîtresse (chuttt ! ) Honorine et Justine Putet d'un côté et, de l'autre, le maire et son premier adjoint, l'instituteur Ernest Tafardel, célibataire intouchable portant lorgnon et petit bouc, grand amateur et rédacteur de discours anti-calotins, jacobin de première main et d'une honnêteté scrupuleuse que certains événements actuels scandalisent certainement, dans ce Paradis des Livres qui illumine mon humble logis. Soutenant Piéchut et Tafardel, tous les radicaux "de gauche" (oui, de gauche, vous voulez que j'épelle ?) de la commune, ceux qui ne vont pas à la messe très régulièrement mais qui, en général, font toujours baptiser leur progéniture.
Entre les deux, l'urinoir et ce à quoi il est destiné.
Et, partout, partout, avec une bonne humeur rabelaisienne (je sais, j'insiste, tant pis ! ), les femmes et filles de Clochemerle qui ragotent et cancanent sur le mode suraigu. Comme leurs hommes d'ailleurs, ces dames connaissent tous les scandales, ceux qui ont éclaté, ceux qui éclatent au moment où je tape sur ce clavier, et surtout ceux qui vont éclater dans pas longtemps. Ainsi, tenez, le cas de la Rose Bivaque, honteusement chassée de la confrérie des Enfants de Marie en raison d'un petit ventre qui se fait un peu trop proéminent depuis que le Claudius Brodequin - un beau gars, et pas fier, et travailleur, et dont les parents ont du bien - est parti au régiment. La Rose Bivaque, le Bon Dieu, le curé Ponosse - qui est un bon gros naïf, de l'avis de toutes les dames-patronesses du coin, lesquelles le considèrent à la fois avec le respect dû à sa fonction et le mépris absolu du sexe faible pour un curé qui croit tout ce qu'on lui raconte - continuerait à le lui donner pratiquement sans confession, tous les dimanche, si seulement il n'y avait pas ce ventre ...
Mais sans l'urinoir, mesdames, messieurs, sans l'urinoir diabolique des non moins sataniques Piéchut et Tafardel, ce ventre n'aurait jamais grossi comme ça, tout seul, dans la nature, alors qu'il se promenait en toute innocence avec le Claudius Brodequin - un pervers, celui-là, démoniaque lui aussi et à qui on devrait infliger le sort jadis imaginé par le bon et miséricordieux chanoine Fulbert envers ce satyre d'Abélard !
Oui, Mesdames, oui, Messieurs : il FAUT détruire l'urinoir ! le lapider, le raser, le piétiner, lui cracher dessus, répandre du sel sur ce qui fut ses fondations puantes, le ...
Et encore, je ne vous donne ici qu'un bien modeste aperçu du climat de tensions et de haines, laïcardes comme religieuses, qui a entrepris de détruire Clochemerle et les Clochemerlins !
Cet urinoir, ce ventre, ces dame-patronesses, celles qui n'en sont pas comme Judith Toumignon la Sans-Vergogne, qui fait cocu son François d'époux, un parfait abruti , à tous les coins de rue (et peut-être même dans l'urinoir, qui sait ? ) ou encore sa rivale, Adèle Torbayon, la bistrotière du coin, qui trompe aussi allègrement son mari (celui-là, c'est Arthur ) mais dont le rêve, d'ailleurs atteint, est de le tromper avec l'amant en titre de Judith, le bel Hippolyte Foncimagne, et surtout ces vieilles filles estampillées "Pureté et Chasteté" comme la Putet et la Chavaigne, sans oublier les ivrognes du coin (ils sont assez nombreux et, côté cancans, bien qu'appartenant au sexe prétendu "fort", ils en remontrent parfois à Justine Putet en personne, c'est vous dire ! ) et tous ces imbéciles, jeunes et vieux, qui, émergeant de l'urinoir, ont omis - volontairement ou non, nous ne nous prononcerons pas - de rajuster leur braguette un peu débraillée tout en adressant de grands signes amicaux de la main à la malheureuse Justine Putet - oui, toujours elle - qu'on soupçonne de satisfaire ces plaisirs qu'on dit charnels en espionnant à sa fenêtre les allées et venues autour de l'urinoir piéchutesque ...
... tout ça crée une gigantesque cocotte-minute avant l'heure qui va exploser avec la remontée triomphale de la grand-rue clochemerline par une Justine Putet qui n'a plus toute sa tête et qui s'est décidée à se rendre à la grand-messe dans le plus simple appareil, à l'exception d'un chapelet probablement destiné, dans son esprit détraqué, à protéger en dernier recours ce qu'elle possède de plus précieux.
Sous ces dehors rabelaisiens, Gabriel Chevallier inscrit en filigrane la critique féroce d'une société qui, lentement, se délite, obsédée qu'elle est par l'argent, le statut social et le sexe. Oh ! les mots ne sont pas prononcés mais, dans l'"héneaurme" silence typiquement gaulois de "Clochemerle", ce sont eux que le lecteur attentif entend bien au-delà les vociférations et fanfaronnades d'une tel ou d'une telle.
En ce sens, on peut dire sans exagération - je ne pense pas que notre amie Lydia me contredise - que "Clochemerle", sorti initialement en 1934, assure le lien avec les fabliaux de notre Moyen-Âge, l'oeuvre de Rabelais, les flopées de libelles licencieux qui se prélassent tout au long de l'histoire de notre littérature, les "gauloiseries" d'un Paul de Kock dont, paraît-il, se régalait le Chancelier de Fer, pourtant si peu francophile et ce type d'ouvrages qui, de tous temps, certains avec talent, d'autres avec une vulgarité rare, ont contribué à la survie d'une certaine partie (oh ! peut-être pas la plus glorieuse, je l'admets ! ) de la littérature française. J'oserai même aller plus loin en précisant que les fantasmes sexuels du pharmacien Poilphard ont bel et bien quelque chose de sadien ...
Pour en terminer, n'allez pas croire que Chevallier se contente de se moquer des malheureuses comme Justine Putet. Bien au contraire. Sous le grotesque de leurs excès, il pose la question, là aussi en filigrane : "Qui les a rendues ainsi ? Ne sommes-nous pas un peu responsables, dans le fond, nous qui avons eu plus de chance qu'elles ?"
Gabriel Chevallier, féministe avant la lettre ? Peut-être. En tous cas un homme intelligent, qui se posait pas mal de questions et qu'il est bon de découvrir (ou plutôt de redécouvrir) non seulement avec sa trilogie de "Clochemerle" (bien que le premier volume soit le meilleur, vous vous en doutez) mais aussi avec bien d'autres livres dont "La Peur", lequel vaut largement, voire même dépasse "Le Feu" de Henri Barbusse. ;o)
Clochemerle, village du Beaujolais, où Barthélémy Piéchut, viticulteur, maire et carriériste veut faire construire un urinoir près de l'église en-dessous de chez Justine, vieille fille. Pissotière qui mettra en guerre le village et fera intervenir la curé, la baronne, le notaire, les politiques, les ministres, les riches, les pauvres, les militaires.
Roman de chroniques sociales paru en 1934 et traduit en 26 langues.
Satire qui nous montre, déjà, l'intolérance des humains. Les dialogues sont un régal. Toutefois, un peu long sur la deuxième partie. (434 pages).
Roman de chroniques sociales paru en 1934 et traduit en 26 langues.
Satire qui nous montre, déjà, l'intolérance des humains. Les dialogues sont un régal. Toutefois, un peu long sur la deuxième partie. (434 pages).
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Gabriel Chevallier (16)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Compléter les titres
Orgueil et ..., de Jane Austen ?
Modestie
Vantardise
Innocence
Préjugé
10 questions
20396 lecteurs ont répondu
Thèmes :
humourCréer un quiz sur ce livre20396 lecteurs ont répondu