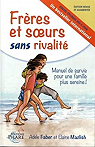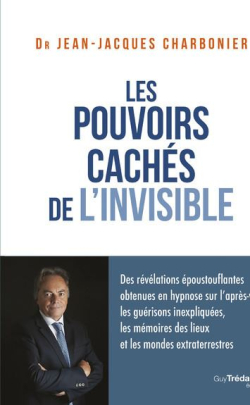Nathalie Francols/5
1 notes
Au fil des pages, les titres des chapitres de cet ouvrage correspondent à des paroles d’enfants, d’adolescents, d’adultes. « C’est trop dur ! », « Il m’a traité ! », « Mon fils ne fera pas votre punition ! », « On n’a pas le temps »… Ces paroles, l’auteure les a entendues en tant qu’enseignante, formatrice ou psychopraticienne, non une fois mais plusieurs centaines de fois. C’est leur caractèr... >Voir plus
Résumé :
Au fil des pages, les titres des chapitres de cet ouvrage correspondent à des paroles d’enfants, d’adolescents, d’adultes. « C’est trop dur ! », « Il m’a traité ! », « Mon fils ne fera pas votre punition ! », « On n’a pas le temps »… Ces paroles, l’auteure les a entendues en tant qu’enseignante, formatrice ou psychopraticienne, non une fois mais plusieurs centaines de fois. C’est leur caractèr... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après Profs et élèves, apprendre ensembleVoir plus
Citations et extraits (5)
Ajouter une citation
La difficulté (en particulier pour les élèves allophones dont al situation bien spécifique produit finalement un effet de loupe sur celle que vivent tous les élèves) est de comprendre à qui s ’adresse l’enseignant pour orienter son attention. À travers ces quelques exemples, on conçoit l’habileté que doivent développer les élèves pour prendre des repères dans un déluge de parole. On comprend aussi la fatigue des enseignants pour maintenir l’attention de tous vers le bon objet, attention qui change tout au long ed la journée à un rythme soutenu. On ne dialogue donc pas vraiment avec une entité classe, mais à un instant t avec certains élèves de la classe. Pendant quel ’un intervient, les autres ont le choix d’observer la mise en scène du tête à tête, d’y participer, ou de se retirer de l’échange avec plus ou moins de discrétion. Si tout le monde a bien conscience que l’attention des élèves est limitée et que la variation des dispositifs didactiques maintient un certain niveau de motivation, on ne dit pas assez que le cours dialogué reste le format didactique le plus difficile à tenir, à moins d’endormir sa classe d’ennui, ou de la qlacer par la terreur. Pourtant le temps dialogué/magistral parfois s’étire. Ponctué d’exercices individuels, il s’allonge jusqu’à l’engourdissement ou l’agitation auxquels il faudra mettre un terme, en ajoutant encore des paroles à un discours déjà trop long. Les migraines professionnelles sont indiscutablement liées au bruit d’un groupe d’enfants et d’adolescents partageant un espace clos et restreint. Une partie non négligeable de ces migraines est due à son propre flot de paroles, à tous ces monts mis bout à bout, toutes ces demandes insatisfaites. Il y a beaucoup de pistes à inventer pour limites ces bénéfices négatifs. Toutes ont la même racine : il faudra nécessairement abandonner l’illusion de l’exhaustivité et du contrôle des comportements. Ce qui conduit à trop parler tient à une croyance selon laquelle ce que l’on dit est entendu et retenu ! Toutes les recherches sur les processus de compréhension et de mémorisation montrent qu’il n’en est rien. Même silencieux, l’élève n’est pas nécessairement attentif, encore moins en train d’apprendre. Pour cela il faut autre chose, incontrôlable de l’extérieur, on ne peut que la susciter : une intention ! (p. 21-22)
À partir de cet exemple et de ses recherches, Damasio est l’un des premiers neuroscientifiques à montrer comment dans la vie, aucune décision n’est prise exclusivement rationnellement. De nombreux chercheurs le démontrent aujourd’hui avec précision. Combien de fois avez-vous rempli des lignes de pour et de contre pour aboutir au statut quo face à une décision à prendre ? Dans tout processus décisionnel, le choix se réalise par comparaison entre les scénarios qu’on imagine : si je fais ceci, j’obtiendrai cela. Toute décision change la situation qu’il faut à nouveau analyser pour à nouveau choisir. Il y a les petits choix de la vie quotidienne qui se déroulent le plus souvent en pilotage automatique, et les choix plus importants pour eux qui tournent en boucle dans la tête et qui empêchent de dormir). il y a enfin toutes les situations ou l’on ne choisit pas vraiment (en tout cas pas consciemment) parce qu’on est en mode réactionnel. Dans ces situations, on n’agit pas pour obtenir quelque chose, mais parce que quelque chose. Nous reviendrons sur ce point car c’est l’un des meilleurs moyens de ne pas résoudre un problème. Si l’un des scenarii a plus de poids qu’un autre, c’est en fonction de l’émotion que l’on ressent à sa mise en image dans notre esprit. C’est ce penchant affectif, parfois très faible ou très intense, qui conduit à choisir. L’affectif est un support au rationnel, l’un et l’autre ne s’opposent pas. Pour acheter un yaourt nature ou aux fruits, pour mettre un point de plus à une copie, pour interroger un élève ou un autre, pour changer d’établissement ou se séparer d’un conjoint, le processus est le même : nous imaginons le scénario conséquent à telle décision et nous choisissons celui qui nous plaît le plus ou nous déplaît le moins. Comme le sel, l’affecte est un exhausteur de goût, il donne une saveur agréable ou désagréable à un scénario particulier. Et nous choisissons l’action qui mettra en acte le scénario que nous trouvons à notre goût.
Au lieu d’opposer raison et émotion, il faut pouvoir associer les deux en se permettant de penser sur ses sentiments et de ressentir ses idées. (p. 55)
Au lieu d’opposer raison et émotion, il faut pouvoir associer les deux en se permettant de penser sur ses sentiments et de ressentir ses idées. (p. 55)
Quand Madame Machin pose une heure de retenue sur un acte que Monsieur Truc passe sous silence, ou quand Monsieur Bidule fait ce qu’il veut comme il veut en bafouant le règlement intérieur, il y a un problème de cohérence à traiter d’abord entre adultes. La première étape me semble être une réflexion qui distingue le « grave » du « pas grave » dans les accrocs à une bonne vie ensemble. Le premier niveau de cohérence entre les adultes concerne la loi dans l’établissement. Il n’y a en réalité que deux règles à faire respecter dans un établissement scolaire : la sécurité des personnes et le respect de la propriété des objets. Cette synthèse autour de ces deux règles ne rend pas leur application simple pour autant parce qu’elles ne disent pas de manière automatique ce qu’est une transgression. Il y a les transgressions nettes : le coup porté, le vol. Il y a le plus souvent les transgressions sur le bord de la limite : le coup porté en réponse à une autre violence, l’insulte maugréée, l’emprunt forcé, la dégradation regrettée. Il me semble irréaliste de construire un dispositif dans lequel une sanction serait prévue pour chaque transgression. Une transgression est toujours prise dans un contexte, dans des circonstances aggravantes ou atténuantes qu’il faut au minimum nommer pour être juste. Dans ce domaine, les enfants auront toujours plus d’imagination que les adultes et aussi pénibles soient-elles, les transgressions sont nécessaires. Sans prise en compte des circonstances, on supprime l’espace de parole autour de la Loi, or la Loi s’érige dans la parole. La question n’est donc pas de répéter le même discours comme un automate à chaque transgression d’élève mais que chacun s’accorde à faire quelque chose de ces transgressions : une parole, une sanction, une réparation. (p. 38)
Lorsqu’on observe des transcriptions de classe pendant les temps collectifs, quel que soit le niveau de classe, on constate que 75 % du temps environ est occupé par la parole de l’enseignant. La plupart des productions orales des élèves sont prises en sandwich entre une question (« Qui… ? », « Pourquoi ? ») et une évaluation (« Pas tout à fait… », « Le Nil est le plus long oui très bien… »). Les interventions de l’enseignant sont des consignes, des directives comportementales, des informations complémentaires, et s’adressent tantôt à l’ensemble de la classe, tantôt à un élève ou plusieurs élèves désignés. Si 75 % du temps est occupé par la parole de l’enseignant, cela conduit mathématiquement à un partage des 25 % de l’espace de production orale restant entre élèves. S’ils sont 25, et tous gentils et polis, ils auront 1 % chacun…
L’expression « cours dialogué » est une erreur. Un dialogue se déroule à deux, si on parle de cours dialogué, alors on considère l’ensemble des élèves comme un seul homme. Or les élèves forment un groupe classe à géométrie variable : de petits groupes de travail, des groupes d’affinités, des groupes de niveau, des individualités juxtaposées. Le flot de paroles et la situation d’interlocution à plus de 25 obligent les élèves à s’adapter au fil continu de la définition des rôles interlocutifs dans la classe. En effet, c’est quasi à chaque tour de parole que l’enseignant définit ceux qui seront simples témoins d’un échange, et ceux qui seront directement concernés par une requête. (p. 20)
L’expression « cours dialogué » est une erreur. Un dialogue se déroule à deux, si on parle de cours dialogué, alors on considère l’ensemble des élèves comme un seul homme. Or les élèves forment un groupe classe à géométrie variable : de petits groupes de travail, des groupes d’affinités, des groupes de niveau, des individualités juxtaposées. Le flot de paroles et la situation d’interlocution à plus de 25 obligent les élèves à s’adapter au fil continu de la définition des rôles interlocutifs dans la classe. En effet, c’est quasi à chaque tour de parole que l’enseignant définit ceux qui seront simples témoins d’un échange, et ceux qui seront directement concernés par une requête. (p. 20)
Enfin mon territoire est constitué des choses que j’aime. Il y a comme un fil invisible mais solide, entre les choses ou les gens que j’aime et moi. Quand nous lisons un livre bouleversant que nous souhaitons partager avec un ami qui le critique violemment, quelque chose grince en nous. Ce quelque chose est le signe que nous nous sentons rejeté par le rejet d’un livre que nous aimons. Le livre est devenu en quelque sorte une extension de nous. Cela reste supportable dans cette situation mais c’est ce qui rend difficile à entendre les critiques sur un vêtement, un métier, un conjoint, choisis avec soin. C’est aussi ce qui se produit quand un élève affiche de manière ostentatoire son dégoût pour la discipline qu’on enseigne. L’amour n’est pas transitif ! Là encore, il est possible qu’avant d’être « traité de », le conflit soit né de frictions sur les territoires des choses ou des gens aimés. (p. 69)
Les plus populaires : autre
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Quiz
Voir plus
Freud et les autres...
Combien y a-t-il de leçons sur la psychanalyse selon Freud ?
3
4
5
6
10 questions
438 lecteurs ont répondu
Thèmes :
psychologie
, psychanalyse
, sciences humainesCréer un quiz sur ce livre438 lecteurs ont répondu