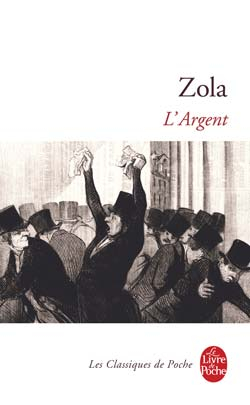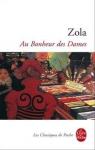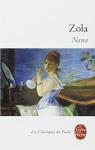une seule faute technique, toujours d'actualité
Saccard, frère d'Eugène Rougon, monte un projet boursier, se liant avec l'ingénieur Hamelin et sa soeur Caroline, qui devient aussi sa maîtresse. Les voisines, les Beauvilliers, nobles et ruinées, mettent tout leur argent à sa disposition. Il lance, ni plus ni moins, la Banque Universelle, catholique, contre l'argent juif. C'est tout d'abord un succès. Saccard entretient une liaison avec la baronne Sandorff, croise des grands personnages dans les salons. Busch, rude créancier, veut exploiter contre lui une vieille dette liée à un enfant naturel. Caroline s'interpose. Puis meurt Sigismond, frère de Busch, socialiste utopiste qui déteste l'argent. L'ultime projet de Saccard est de s'attaquer à la plus grande puissance de la bourse, le Juif Gundermann. En plein succès, il manque son objectif : Daigremont se retire, Gundermann gagne la bataille. C'est la débandade. Mazaud, l'agent de change, se suicide, les associés quittent le navire avec Daigremont, Victor, l'enfant naturel, violent la fille des Beauvilliers. Mais Saccard veut monter une nouvelle affaire et il a en lui une force qui lui permet d'espérer.
Thème éponyme du roman, l'argent à une force ambivalente. D'une part il génère constamment l'espoir, comme Saccard, d'autre part la plus grande malhonnêteté et le malheur sont ses fruits (comme Saccard ?)
Thème éponyme du roman, l'argent à une force ambivalente. D'une part il génère constamment l'espoir, comme Saccard, d'autre part la plus grande malhonnêteté et le malheur sont ses fruits (comme Saccard ?)
lisez ce livre, et vous comprendrez que l histoire se repete et que les problemes d hier si bien connus si bien documentes, comme la crise du canal de Panama ou les emprunts russes n ont toujours pas servis d exemple
l histoire ne fait que de se repeter,
la preuve ?
la crise des subprimes aujourd hui.
La cupidite et la magouille ne cesseront jamais d exister.
l histoire ne fait que de se repeter,
la preuve ?
la crise des subprimes aujourd hui.
La cupidite et la magouille ne cesseront jamais d exister.
Malgré les abondantes études qu'Emile Zola consacra à la question sociale et au marxisme en amont de l'écriture de ce volume, le roman de L'Argent ne permet pas de saisir d'un coup d'oeil la nature du système économique de la fin du 19e siècle. 400 pages de réflexion dans ses brouillons seront réduites à un feuillet dans le roman ; pour le reste, Emile Zola connaissait mal la Bourse. Sa vie durant, il n'eut jamais à gérer ses finances. Son éditeur Fasquelle lui tenait lieu de banquier et Zola lui demandait à mesure les sommes dont il avait besoin, sans qu'il ne lui soit nécessaire de se préoccuper plus attentivement des mécanismes de la banque.
C'est tant pis mais c'est aussi tant mieux : nous n'apprendrons peut-être pas grand-chose de surprenant concernant les processus déjà avides qui fondent le système bancaire à la fin de ce siècle (les processus de notre époque, bien plus abstraits et enchevêtrés, seraient une source mille fois plus prodigue en étonnement et consternation) mais nous suivrons avec émotion la démonstration dressée par Emile Zola pour traduire ce que suscita peut-être son étude préalable : le grand scandale selon lequel la misère n'est pas provoquée par l'argent mais par l'accaparement de l'argent dans une société qui se fonde sur l'exploitation des multitudes par quelques privilégiés.
L'intrigue s'inspire de l'affaire Bontoux qui suscita le Krach de l'Union générale en janvier 1882. Cette déconfiture fut ensuite utilisée pour accuser, entre autres, les juifs et les francs-maçons. Ce roman traduit d'ailleurs très bien l'antisémitisme naissant et relié aux envies, aux jalousies et aux ambitions folles dont la source est la concurrence économique. le discours d'Emile Zola est intelligent et mesuré. Il aurait été facile de blâmer uniquement l'argent et d'en faire l'image d'un dieu avilissant qui soumet une population d'êtres humains purs par nature, mais Emile Zola préfère souligner la culpabilité de l'homme dans l'établissement d'un système dominé par l'argent. A cause de l'homme, l'argent est devenu sale : il a tout souillé, même, et surtout, le désir. Et dans cette décrépitude du lien, de l'estime et de la dignité, que devient l'amour ?
A travers L'Argent, Emile Zola s'est posé beaucoup de questions qui ont le mérite de l'intemporalité. Saurons-nous jamais créer quelque chose de noble avec et malgré l'argent, ou notre nature même nous en empêchera-t-elle toujours ?
Lien : http://colimasson.blogspot.f..
C'est tant pis mais c'est aussi tant mieux : nous n'apprendrons peut-être pas grand-chose de surprenant concernant les processus déjà avides qui fondent le système bancaire à la fin de ce siècle (les processus de notre époque, bien plus abstraits et enchevêtrés, seraient une source mille fois plus prodigue en étonnement et consternation) mais nous suivrons avec émotion la démonstration dressée par Emile Zola pour traduire ce que suscita peut-être son étude préalable : le grand scandale selon lequel la misère n'est pas provoquée par l'argent mais par l'accaparement de l'argent dans une société qui se fonde sur l'exploitation des multitudes par quelques privilégiés.
L'intrigue s'inspire de l'affaire Bontoux qui suscita le Krach de l'Union générale en janvier 1882. Cette déconfiture fut ensuite utilisée pour accuser, entre autres, les juifs et les francs-maçons. Ce roman traduit d'ailleurs très bien l'antisémitisme naissant et relié aux envies, aux jalousies et aux ambitions folles dont la source est la concurrence économique. le discours d'Emile Zola est intelligent et mesuré. Il aurait été facile de blâmer uniquement l'argent et d'en faire l'image d'un dieu avilissant qui soumet une population d'êtres humains purs par nature, mais Emile Zola préfère souligner la culpabilité de l'homme dans l'établissement d'un système dominé par l'argent. A cause de l'homme, l'argent est devenu sale : il a tout souillé, même, et surtout, le désir. Et dans cette décrépitude du lien, de l'estime et de la dignité, que devient l'amour ?
A travers L'Argent, Emile Zola s'est posé beaucoup de questions qui ont le mérite de l'intemporalité. Saurons-nous jamais créer quelque chose de noble avec et malgré l'argent, ou notre nature même nous en empêchera-t-elle toujours ?
Lien : http://colimasson.blogspot.f..
Cette fois c'est l'argent le héro étudié, caricaturé, grossi, tourmenté, sali...
On l'avait déjà abordé avec Saccard dans le tome 2 mais c'était la motivation sourde et Zola traitait plutôt de la course à la construction parisienne et de l'inceste.
Là on retrouve notre cher Saccard ruiné mais fou qui profite des gens et est persuadé de son bon droit, continue à les embobiner, avec altruisme pourtant, et folie.
Comme toujours on coule doucement et inévitablement vers le drame, c'est ça, l'art de Zola.
On l'avait déjà abordé avec Saccard dans le tome 2 mais c'était la motivation sourde et Zola traitait plutôt de la course à la construction parisienne et de l'inceste.
Là on retrouve notre cher Saccard ruiné mais fou qui profite des gens et est persuadé de son bon droit, continue à les embobiner, avec altruisme pourtant, et folie.
Comme toujours on coule doucement et inévitablement vers le drame, c'est ça, l'art de Zola.
Où l'on retrouve Saccard, héros de deux volumes, comme Jean. Deux volumes séparés par seize autres titres alors qu'ils ne sont distants que de quelques mois. L'histoire s'étend de 1864 à 1869.
Une nouvelle fois Saccard veut trouver un moyen de s'enrichir. Il décide de s'attaquer aux banques juives en créant une banque catholique. Mais Saccard étant ce qu'il est, cela ne se fait pas sans irrégularités. Il s'entoure de personnes dont le nom inspire confiance mais qui ne sont pas irréprochables, utilise un prête nom pour acheter fictivement des actions, ne recule pas devant ce qu'on appellerait aujourd'hui un délit d'initié… Mais personnalité complexe, il s'occupe parallèlement très honnêtement de la comptabilité d'une maison destinée à recevoir des enfants afin de leur permettre d'apprendre un métier et la moralité.
Autant le dire tout de suite, ce n'est pas du tout mon préféré. Sans doute parce qu'il concerne « ce mystère des opérations financières où peu de cervelles françaises pénètrent », en tout cas pas la mienne.
En revanche j'ai apprécié les portraits des divers personnages : l'ingénieur Hamelin et sa soeur Mme Caroline, qui de retour d'orient avec des projets de développement, cherchent des fonds pour leur donner vie. Sigismond le socialiste rêveur qui imagine des mondes parfaits sur le papier mais ignore tout du monde réel et ne s'aperçoit pas que son frère recouvreur de dettes peu scrupuleux fait partie de ceux qu'il veut abattre. Les dames de Beauvilliers mère et fille, ruinées mais qui ne veulent pas déroger à leur rang…
Zola oppose le personnage de Saccard mené par ses passions à celui du banquier juif Gunderman de tempérament très froid. Il y a d'ailleurs de nombreuses attaques contre les juifs dont je ne suis pas certaine qu'elles ont toujours été lues comme des condamnations de l'opinion antisémite de l'époque. Car je suppose que cela ne reflète pas celle de Zola. Zola qui une fois encore a voulu faire un panorama le plus complet possible de la société du Second Empire et a taché d'y mettre beaucoup de choses, la banque et la bourse bien sûr mais aussi succinctement les journaux, le socialisme qui se développe de plus en plus, les nobles qui jusqu'alors avaient été peu présents..
le livre est inspiré du krach de la banque l'Union Générale de Bontoux et écrit au moment du scandale de Panama, dans lequel des petits épargnants auquel Ferdinand de Lesseps a fait appel ont été ruinés.
Il se termine toutefois sur la note positive de l'argent qui corrompt, qui ruine (petits épargnants), mais argent qui crée de la vie (projets de Hamelin).
Une nouvelle fois Saccard veut trouver un moyen de s'enrichir. Il décide de s'attaquer aux banques juives en créant une banque catholique. Mais Saccard étant ce qu'il est, cela ne se fait pas sans irrégularités. Il s'entoure de personnes dont le nom inspire confiance mais qui ne sont pas irréprochables, utilise un prête nom pour acheter fictivement des actions, ne recule pas devant ce qu'on appellerait aujourd'hui un délit d'initié… Mais personnalité complexe, il s'occupe parallèlement très honnêtement de la comptabilité d'une maison destinée à recevoir des enfants afin de leur permettre d'apprendre un métier et la moralité.
Autant le dire tout de suite, ce n'est pas du tout mon préféré. Sans doute parce qu'il concerne « ce mystère des opérations financières où peu de cervelles françaises pénètrent », en tout cas pas la mienne.
En revanche j'ai apprécié les portraits des divers personnages : l'ingénieur Hamelin et sa soeur Mme Caroline, qui de retour d'orient avec des projets de développement, cherchent des fonds pour leur donner vie. Sigismond le socialiste rêveur qui imagine des mondes parfaits sur le papier mais ignore tout du monde réel et ne s'aperçoit pas que son frère recouvreur de dettes peu scrupuleux fait partie de ceux qu'il veut abattre. Les dames de Beauvilliers mère et fille, ruinées mais qui ne veulent pas déroger à leur rang…
Zola oppose le personnage de Saccard mené par ses passions à celui du banquier juif Gunderman de tempérament très froid. Il y a d'ailleurs de nombreuses attaques contre les juifs dont je ne suis pas certaine qu'elles ont toujours été lues comme des condamnations de l'opinion antisémite de l'époque. Car je suppose que cela ne reflète pas celle de Zola. Zola qui une fois encore a voulu faire un panorama le plus complet possible de la société du Second Empire et a taché d'y mettre beaucoup de choses, la banque et la bourse bien sûr mais aussi succinctement les journaux, le socialisme qui se développe de plus en plus, les nobles qui jusqu'alors avaient été peu présents..
le livre est inspiré du krach de la banque l'Union Générale de Bontoux et écrit au moment du scandale de Panama, dans lequel des petits épargnants auquel Ferdinand de Lesseps a fait appel ont été ruinés.
Il se termine toutefois sur la note positive de l'argent qui corrompt, qui ruine (petits épargnants), mais argent qui crée de la vie (projets de Hamelin).
Après une petite panne de lecture de quelques mois, il me fallait du solide pour reprendre les habitudes, "L'Argent" de Zola en a été l'objet idéal.
Antépénultième (c'est à dire avant-avant-dernier en français courant !) opus de la série des Rougon-Macquart, on retrouve Zola en pleine possession de ses capacités romanesques. Il a écarté les litanies de synonymes qui rythmaient "Le Ventre de Paris" ou "Au bonheur des dames", creuse un peu mieux (ai-je trouvé) la psychologie de ses personnages, qu'il emporte dans un tourbillon de péripéties. Sans suprise à la lecture du titre, il brosse cette fois le monde de la bourse du Second empire triomphant, en dégageant surtout les penchants pour le jeu et la spéculation, le besoin viscéral d'écraser l'adversaire et au final : de défier le sort, au coeur des désirs éternels de la condition humaine. Ici encore, quelques magnifiques pages sur la psychologie humaine et sa façon de faire face et répondre aux circonstances de la vie. D'autant que Zola équilibre ici l'importance de ses deux personnages principaux : Saccard et Mme Caroline, un homme et une femme, un entrepreneur-spéculateur et la figure tutélaire de la raison bienveillante, voire maternelle.
A l'instar de "Germinal", le roman s'achève doucement par l'habile mélange d'une catastrophe finale mais également avec la force irrepressible de l'espérance dans les lendemains. Une grande et belle lecture.
Antépénultième (c'est à dire avant-avant-dernier en français courant !) opus de la série des Rougon-Macquart, on retrouve Zola en pleine possession de ses capacités romanesques. Il a écarté les litanies de synonymes qui rythmaient "Le Ventre de Paris" ou "Au bonheur des dames", creuse un peu mieux (ai-je trouvé) la psychologie de ses personnages, qu'il emporte dans un tourbillon de péripéties. Sans suprise à la lecture du titre, il brosse cette fois le monde de la bourse du Second empire triomphant, en dégageant surtout les penchants pour le jeu et la spéculation, le besoin viscéral d'écraser l'adversaire et au final : de défier le sort, au coeur des désirs éternels de la condition humaine. Ici encore, quelques magnifiques pages sur la psychologie humaine et sa façon de faire face et répondre aux circonstances de la vie. D'autant que Zola équilibre ici l'importance de ses deux personnages principaux : Saccard et Mme Caroline, un homme et une femme, un entrepreneur-spéculateur et la figure tutélaire de la raison bienveillante, voire maternelle.
A l'instar de "Germinal", le roman s'achève doucement par l'habile mélange d'une catastrophe finale mais également avec la force irrepressible de l'espérance dans les lendemains. Une grande et belle lecture.
J'ai toujours plaisir a découvrir d'autres tomes de la grande histoire des Rougon Macquart. L'histoire est très prenante et on plonge dans les méandres de la bourse et de la spéculation. Seul petit bémol le vocabulaire très technique propre au milieu bancaire qui impose une concentration importante pour bien tout comprendre.
L'argent... tiens, tiens, ça me dit quelque chose en ce moment... Un peu comme si une frénésie d'argent s'emparait de tout et de tout le monde avec des airs de jouer au ballon... Mais non, j'ai dû me tromper de sujet, il n'y a aucun rapport entre le sport et l'argent... Les joueurs ne sont pas une marchandise cotée en bourse... euh...
L'Argent, oui, nous y sommes en plein, L'Argent, un des plus magnifiques livres des Rougon-Macquart, selon moi, où l'on suivra cette fois Aristide Rougon, le frère du ministre, nommé Saccard, qu'on avait déjà vu à l'oeuvre dans La Curée, livre auquel je vous renvoie pour comprendre les raisons de ce changement de nom.
Ici seront moins détaillés les vices et les dérives du luxe comme dans La Curée (ou Nana) et l'angle de vue sera davantage focalisé sur les mécanismes financiers, un peu à la manière d'Au Bonheur Des Dames qui détaillait quant à lui la mécanique marchande.
Nous retrouvons Aristide, quelques années après ses déboires de la fin de la Curée, en pleine forme, as de la finance, mais emporté comme toujours par son euphorie du jeu et de l'argent facile sur un coup de dé. Il est sujet, dans sa frénésie du gain, à la perte totale de contrôle, quitte à faire tomber tout le monde dans son sillage. Cela ne vous rappelle pas certaines affaires récentes ou moins récentes et un certain Jérôme Kerviel (et tellement, tellement d'autres) ?
Dans ses tractations, le délit d'initié est roi. Cela ne vous rappelle pas l'affaire EADS (entre autres) ou plus anciennement Pechiney et son lien avec le pouvoir de l'époque (Mitterand). Ici, c'est Huret, l'homme de main du ministre et frère de Saccard (voir le n°6 Son Excellence Eugène Rougon).
Mais aujourd'hui il n'y a plus rien à craindre de ce genre puisqu'il n'y a plus aucun lien entre les hommes de pouvoirs et de finance (aucune élection qui soit pilotée, aux USA ou ailleurs, par des gros financiers, même pas un petit Sarkozy qu'on essaierait de caser, même pas le frère de l'ancien président à un poste important au MEDEF, rien, tout ça c'est du passé, maintenant tout est propre, à gauche comme à droite, l'intégrité fait loi !).
Bref, on est surpris de voir à quel point rien n'a changé, à quel point la finance était, est et restera une gigantesque magouille légale, qui fait ce qu'elle veut, et qui dicte aux politiques leur marche à suivre.
Saccard me fait penser à Jean-Marie Messier, génial tant qu'il gagnait, bon à jeter aux cochons quand l'empire s'écroula. Tous les rats de la bourse quittent évidemment le navire au premier tangage et seuls restent sur le carreau les petits actionnaires qui ont toujours une guerre de retard car ils ne jouent pas dans la même cour. Je le dis à tout hasard mais ça ne vous rappelle pas un scénario de 2008 ?
Le texte de Zola est extrêmement documentaire et décrit quasi intégralement le scandale de la banque Union Générale en 1882, désignée dans le roman sous le nom L'Universelle. Gundermann est le financier juif concurrent du fervent catholique et monarchiste Saccard. On reconnaît sans peine le portrait de James de Rothschild sous Gundermann et de Paul Eugène Bontoux sous Saccard même si historiquement, les deux hommes ne se sont jamais affrontés car James de Rothschild est mort avant même la création de la banque de Bontoux.
Autre personnage étrange du roman, Sigismond, le frère chétif du plus abject charognard du roman, communiste convaincu auquel Zola fait dire des tirades pleines d'utopie et qui annoncent déjà en quoi le communisme était voué à l'échec avant même d'avoir vu le jour.
C'est donc un chef-d'oeuvre visionnaire que vous avez là sous les yeux, un quasi essai, un texte, à beaucoup d'égards, plus journalistique et documentaire que romanesque. À lire absolument si l'on souhaite ouvrir un peu son regard sur la manière dont fonctionne le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Un monde qui, je crois, répond plus que jamais à cette description — cruellement réaliste —, mais ce n'est là que mon avis, à ne pas prendre pour argent comptant, c'est-à-dire, pas grand-chose.
L'Argent, oui, nous y sommes en plein, L'Argent, un des plus magnifiques livres des Rougon-Macquart, selon moi, où l'on suivra cette fois Aristide Rougon, le frère du ministre, nommé Saccard, qu'on avait déjà vu à l'oeuvre dans La Curée, livre auquel je vous renvoie pour comprendre les raisons de ce changement de nom.
Ici seront moins détaillés les vices et les dérives du luxe comme dans La Curée (ou Nana) et l'angle de vue sera davantage focalisé sur les mécanismes financiers, un peu à la manière d'Au Bonheur Des Dames qui détaillait quant à lui la mécanique marchande.
Nous retrouvons Aristide, quelques années après ses déboires de la fin de la Curée, en pleine forme, as de la finance, mais emporté comme toujours par son euphorie du jeu et de l'argent facile sur un coup de dé. Il est sujet, dans sa frénésie du gain, à la perte totale de contrôle, quitte à faire tomber tout le monde dans son sillage. Cela ne vous rappelle pas certaines affaires récentes ou moins récentes et un certain Jérôme Kerviel (et tellement, tellement d'autres) ?
Dans ses tractations, le délit d'initié est roi. Cela ne vous rappelle pas l'affaire EADS (entre autres) ou plus anciennement Pechiney et son lien avec le pouvoir de l'époque (Mitterand). Ici, c'est Huret, l'homme de main du ministre et frère de Saccard (voir le n°6 Son Excellence Eugène Rougon).
Mais aujourd'hui il n'y a plus rien à craindre de ce genre puisqu'il n'y a plus aucun lien entre les hommes de pouvoirs et de finance (aucune élection qui soit pilotée, aux USA ou ailleurs, par des gros financiers, même pas un petit Sarkozy qu'on essaierait de caser, même pas le frère de l'ancien président à un poste important au MEDEF, rien, tout ça c'est du passé, maintenant tout est propre, à gauche comme à droite, l'intégrité fait loi !).
Bref, on est surpris de voir à quel point rien n'a changé, à quel point la finance était, est et restera une gigantesque magouille légale, qui fait ce qu'elle veut, et qui dicte aux politiques leur marche à suivre.
Saccard me fait penser à Jean-Marie Messier, génial tant qu'il gagnait, bon à jeter aux cochons quand l'empire s'écroula. Tous les rats de la bourse quittent évidemment le navire au premier tangage et seuls restent sur le carreau les petits actionnaires qui ont toujours une guerre de retard car ils ne jouent pas dans la même cour. Je le dis à tout hasard mais ça ne vous rappelle pas un scénario de 2008 ?
Le texte de Zola est extrêmement documentaire et décrit quasi intégralement le scandale de la banque Union Générale en 1882, désignée dans le roman sous le nom L'Universelle. Gundermann est le financier juif concurrent du fervent catholique et monarchiste Saccard. On reconnaît sans peine le portrait de James de Rothschild sous Gundermann et de Paul Eugène Bontoux sous Saccard même si historiquement, les deux hommes ne se sont jamais affrontés car James de Rothschild est mort avant même la création de la banque de Bontoux.
Autre personnage étrange du roman, Sigismond, le frère chétif du plus abject charognard du roman, communiste convaincu auquel Zola fait dire des tirades pleines d'utopie et qui annoncent déjà en quoi le communisme était voué à l'échec avant même d'avoir vu le jour.
C'est donc un chef-d'oeuvre visionnaire que vous avez là sous les yeux, un quasi essai, un texte, à beaucoup d'égards, plus journalistique et documentaire que romanesque. À lire absolument si l'on souhaite ouvrir un peu son regard sur la manière dont fonctionne le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Un monde qui, je crois, répond plus que jamais à cette description — cruellement réaliste —, mais ce n'est là que mon avis, à ne pas prendre pour argent comptant, c'est-à-dire, pas grand-chose.
Ce tome est axé sur Aristide Saccard et sa descendance.
Aristide Saccard n'est pas un nouveau personnage dans la saga des Rougon Macquart. Je dirai même que c'est un habitué dont l'amour de l'argent guidera toute sa vie. Emile Zola le reprendra ici dans une de ses tentatives d'assouvir la soif de l'or et c'est en effet le personnage idéal pour traiter d'un tel sujet.
Nous retrouvons donc Aristide Saccard à un moment clé de sa vie. Il retrouve son fils, Maxime, avec qui les relations sont extrêmement particulières mais aussi avec son petit bâtard, Victor, fruit issu d'une relation hors mariage avec une servante. Nous avons donc là dans le tableau familial un enfant né en mariage, qui fut toujours manipulé par son père et un autre de la violence, issu quasiment d'un viol qui démètra l'épaule de la pauvre mère et la débauchera ensuite.
Saccard n'apprécie pas trop son fils aîné, Maxime. Tout d'abord parce qu'ils ont un passif assez lourd entre eux (pour le découvrir, je vous donne rendez vous dans la chronique de la Curée qui arrivera très bientôt). Mais ensuite parce que Maxime ressemble en partie à sa mère (qui adorait Saccard) et donc est le plus à même de l'accepter comme il est : un homme manipulateur avide de sexe et d'argent. C'est comme cela qu'est Victor, il est un miroir de son père. Et quelques parts, c'est aussi pour cela que son père ne va jamais le voir, car il est comme un miroir.
Le rapport à l'argent décrit sous toutes ses formes par Emile Zola.
C'est avec ce personnage merveilleusement complexe qu'Emile Zoola veut nous parler de l'argent. Et croyez moi, lorsque l'auteur décrit l'argent avec les yeux de Saccard, vous aurez là une description d'un érotisme extrêmement poussé. Avec Aristide Saccard, vous aurez l'argent de la spéculation, celui qui provoque de la fièvre, celui qui rend fou car vous ferez n'importe quoi pour en posséder plus, pour jouer avec mais vous ne serez jamais satisfait.
Vous aurez aussi le manque d'argent. Celui qui pousse une famille noble à se priver de tout pour sauvegarder une petite apparence. Cet argent là vous rendra malade, vous rongera de l'intérieur. Il vous fera perdre votre famille, vous enlèvera vos meubles et vos rêves.
C'est aussi celui qui brûle car il n'est pas gagné honnêtement. Celui là provoque mauvaise conscience et ne vous laissera pas une vie tranquille, vous isolant du monde, vous rendant malade et vous poussera à des actes frisant la folie.
L'argent, l'argent qui sépare les hommes. L'argent qui les détruit. L'argent qui pousse à la lutte des classes. On pourrait croire qu'Emile Zola à l'argent en horreur s'il n'y avait pas là dedans, dans ce récit, madame Caroline. Cette femme, en effet, a un rapport sain avec l'argent, ce qui fait qu'elle n'en gagne, ni n'en perd. Elle ne fait que poursuivre sa vie, dans ses rêves. le message est là, simple et clair : l'argent n'apport que ce qu'il est, un moyen de subvenir à ses besoins. Gare à ceux qui le considèrent comme un besoin tout court
Lien : http://labibliodekoko.blogsp..
Aristide Saccard n'est pas un nouveau personnage dans la saga des Rougon Macquart. Je dirai même que c'est un habitué dont l'amour de l'argent guidera toute sa vie. Emile Zola le reprendra ici dans une de ses tentatives d'assouvir la soif de l'or et c'est en effet le personnage idéal pour traiter d'un tel sujet.
Nous retrouvons donc Aristide Saccard à un moment clé de sa vie. Il retrouve son fils, Maxime, avec qui les relations sont extrêmement particulières mais aussi avec son petit bâtard, Victor, fruit issu d'une relation hors mariage avec une servante. Nous avons donc là dans le tableau familial un enfant né en mariage, qui fut toujours manipulé par son père et un autre de la violence, issu quasiment d'un viol qui démètra l'épaule de la pauvre mère et la débauchera ensuite.
Saccard n'apprécie pas trop son fils aîné, Maxime. Tout d'abord parce qu'ils ont un passif assez lourd entre eux (pour le découvrir, je vous donne rendez vous dans la chronique de la Curée qui arrivera très bientôt). Mais ensuite parce que Maxime ressemble en partie à sa mère (qui adorait Saccard) et donc est le plus à même de l'accepter comme il est : un homme manipulateur avide de sexe et d'argent. C'est comme cela qu'est Victor, il est un miroir de son père. Et quelques parts, c'est aussi pour cela que son père ne va jamais le voir, car il est comme un miroir.
Le rapport à l'argent décrit sous toutes ses formes par Emile Zola.
C'est avec ce personnage merveilleusement complexe qu'Emile Zoola veut nous parler de l'argent. Et croyez moi, lorsque l'auteur décrit l'argent avec les yeux de Saccard, vous aurez là une description d'un érotisme extrêmement poussé. Avec Aristide Saccard, vous aurez l'argent de la spéculation, celui qui provoque de la fièvre, celui qui rend fou car vous ferez n'importe quoi pour en posséder plus, pour jouer avec mais vous ne serez jamais satisfait.
Vous aurez aussi le manque d'argent. Celui qui pousse une famille noble à se priver de tout pour sauvegarder une petite apparence. Cet argent là vous rendra malade, vous rongera de l'intérieur. Il vous fera perdre votre famille, vous enlèvera vos meubles et vos rêves.
C'est aussi celui qui brûle car il n'est pas gagné honnêtement. Celui là provoque mauvaise conscience et ne vous laissera pas une vie tranquille, vous isolant du monde, vous rendant malade et vous poussera à des actes frisant la folie.
L'argent, l'argent qui sépare les hommes. L'argent qui les détruit. L'argent qui pousse à la lutte des classes. On pourrait croire qu'Emile Zola à l'argent en horreur s'il n'y avait pas là dedans, dans ce récit, madame Caroline. Cette femme, en effet, a un rapport sain avec l'argent, ce qui fait qu'elle n'en gagne, ni n'en perd. Elle ne fait que poursuivre sa vie, dans ses rêves. le message est là, simple et clair : l'argent n'apport que ce qu'il est, un moyen de subvenir à ses besoins. Gare à ceux qui le considèrent comme un besoin tout court
Lien : http://labibliodekoko.blogsp..
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Émile Zola (295)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Les personnages des Rougon Macquart
Dans l'assommoir, quelle est l'infirmité qui touche Gervaise dès la naissance
Elle est alcoolique
Elle boîte
Elle est myope
Elle est dépensière
7 questions
594 lecteurs ont répondu
Thème :
Émile ZolaCréer un quiz sur ce livre594 lecteurs ont répondu