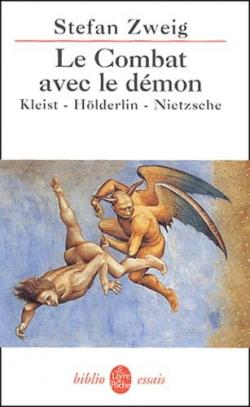Citations sur Le Combat avec le démon. Kleist, Hölderlin, Nietzsche (43)
La terre, lourde et dure, ce quatrième élément de l’univers, comme je l’ai déjà dit, n’a point part à la structure aérienne de la poésie hölderlinienne, elle est pour lui toujours chose basse et vulgaire — l’ennemie aux liens de laquelle il fait effort pour échapper, la pesanteur, qui lui rappelle éternellement sa matérialité terrestre. Mais la terre contient également une sainte puissance d’art pour celui qui sait la façonner ; elle apporte solidité, netteté des contours, chaleur et ampleur, une divine surabondance à celui qui possède l’art de s’en servir. Baudelaire, qui élabore avec une passion intellectuelle égale à celle d’Hôlderlin une matière concrète et terrestre, est peut-être l’antipode lyrique d’Hölderlin le plus parfait qui existe. Ses poésies, entièrement faites de compression (tandis que celles d’Hôlderlin sont faites d’une sorte d’expansion immatérielle), ont autant de solidité devant l’infini, comme plastique de l’esprit, que la musique d’Hôlderlin ; leur éclat cristallin et leur puissance ne sont pas moins purs que la blanche diaphanéité et l’harmonie flottante d’Hôlderlin. Ces deux genres de poésies se font face en s’opposant, comme la terre et le ciel, le marbre et la nuée. Mais dans chacun d’eux la transposition et la transformation de la vie en « forme d’art », soit plastique, soit musicale, atteignent à la perfection : ce qu’il y a entre elles comme variantes infinies du flot poétique — fait de matérialisation ou d’idéalisation — constitue une possibilité de transitions magnifiques. Mais ces deux formes d’art sont les deux extrêmes, le point suprême de la concentration et le point suprême de l’expansion vaporeuse.
Des quatre éléments de la philosophie grecque, le feu, l’eau, l’air et la terre, la poésie hölderlinienne n’en a que trois : la terre en est absente, la terre trouble et pesante, elle qui est lien et assujettissement, symbole de plastique et de dureté. Cette poésie est fille du feu, qui flamboie et se dresse dans l’air, symbole d’élan, de l’éternelle ascension ; elle est légère comme l’air, éternel équilibre, vol de nuées et vent retentissant ; elle est pure comme l’eau, diaphane. Toutes les couleurs y luisent au travers ; toujours elle est en mouvement ; c’est une perpétuelle élévation et une perpétuelle descente, la perpétuelle haleine de l’esprit créateur. Ses vers n’ont aucune racine plongée dans le sol, aucune prise dans la réalité quotidienne ; ils se dressent toujours hostilement, à contre-sens de la terre lourde et perfide : il y a en eux quelque chose d’errant, quelque chose d’inquiet, quelque chose des nuages qui chevauchent vers le ciel, qui tantôt sont illuminés par la rougeur aurorale de l’enthousiasme et tantôt sont obscurcis par les ombres de la mélancolie ; et souvent du sein de leur masse orageuse jaillissent l’éclair enflammé et le tonnerre de la prophétie. Mais toujours ils marchent dans les hauteurs, dans la sphère aérienne et éthérée, toujours loin de la terre, inaccessibles au contact des sens et sensibles seulement au sentiment. « Leur esprit souffle dans le chant », a dit Hôlderlin des poètes, et dans ce souffle et ce flottement les faits se dissolvent en musique aussi complètement que le feu en fumée. Tout est dirigé vers les hauteurs : « Par la chaleur l’esprit s’élève » ; par la combustion, l’évaporation, l’idéalisation de la matière, le sentiment se sublime. Au sens hölderlinien, la poésie est donc toujours dissolution — dissolution en esprit — de la matière solide et terrestre, sublimation du monde dans l’esprit universel — mais jamais concrétisation, condensation objective et matérialisation. La poésie de Goethe, même la plus spiritualisée, garde toujours une substance ; on la sent savoureuse comme un fruit, on peut en faire le tour et la saisir avec tous ses sens, tandis que la poésie d’Hôlderlin, elle, s’évanouit dans l’air. La poésie de Goethe, aussi sublimée qu’elle soit, garde toujours un reste de chaleur corporelle, un arôme de temps et d’âge, un goût salé de terre et de destin : toujours il y a en elle quelque chose de l’individualité de Johann Wolfgang Goethe et quelque chose de son univers. Au contraire la poésie d’Hôlderlin dépouille consciemment toute individualité : « L’individuel résiste à l’esprit pur qui en a la conception », dit-il obscurément et pourtant d’une façon assez compréhensible. Par suite de ce manque de matière, sa poésie a une statique particulière ; elle ne repose pas circulairement sur elle-même, mais elle est comme un avion qui ne se maintient que grâce à son élan : toujours on a l’impression de quelque chose d’angélique, quelque chose de pur, de blanc, d’insexué, de flottant, quelque chose qui passe sur la terre comme un rêve, quelque chose qui est impondérable et qui s’épanouit dans sa propre et bienheureuse mélodie. Goethe compose ses poésies sur la terre et Hölderlin, lui, les compose au-dessus de la terre : la poésie est pour lui (comme pour Novalis, comme pour Keats, comme pour tous les génies qui sont morts prématurément) élimination de la pesanteur, dissolution de l’expression dans la musique, retour à la fluidité élémentaire.
Son esprit[Hölderlin], non pas concentré mais agissant fortement par réactions explosives, pouvait être enflammé par chaque étincelle isolée qui tombait dans le baril de poudre de son enthousiasme : ainsi la philosophie lui a été sans doute utile, mais simplement en ce qu’il pouvait en tirer un parti poétique, en ce qu’elle était de nature à l’inspirer. Les idées n’ont de valeur pour lui que comme véhicule de son enthousiasme, comme balistique de son élan intérieur ; jamais Hölderlin, dont la puissance intellectuelle était uniquement la « pieuse contemplation » des choses, n’a dû beaucoup aux spéculations théoriques et aux raffinements des philosophes de l’école. Et, quand, par hasard, il leur emprunte quelques motifs d’inspiration, il les transpose, en les dissolvant dans l’extase et dans les flots du rythme : il utilise un mot de ses amis Hegel ou Schelling comme, par exemple, Wagner utilise la philosophie de Schopenhauer dans l’ouverture de Tristan ou le Prélude du troisième acte des Maîtres chanteurs, c’est-à-dire qu’il en fait de la musique, du sentiment et de l’exaltation. Sa pensée n’est que la diffusion de sa propre sensibilité, qui se confond avec le sentiment universel, comme le souffle d’une poitrine humaine a besoin d’une flûte, d’un roseau, pour se déverser musicalement dans l’univers.
Sais-tu ce qui fait ton deuil ? Ce n’est pas une chose qui soit disparue depuis telle année ; on ne peut pas exactement dire quand elle était là, quand elle est partie, mais elle était là, elle est là encore, elle est en toi. C’est une époque meilleure que tu cherches, un monde plus beau.
Diotima à Hypérion.
Diotima à Hypérion.
"La vague du cœur n’écumerait pas si puissante et si belle, elle ne serait que froid esprit si ce vieux rocher muet, le Destin, ne brisait pas son élan."
C’est sans doute durant une de ses heures d’obscurité tragique qu’Hôlderlin, qui, malgré tout, se trouvait lui-même heureux dans son chant solitaire, a écrit ces lignes soulevées par la spontanéité de la force la plus profonde : « Jamais je n’avais si parfaitement éprouvé la vérité de ce mot ancien et infaillible du destin, qui nous dit qu’une félicité neuve s’ouvre pour notre cœur lorsqu’il résiste et qu’il est capable de supporter la douleur de minuit — ce mot qui nous dit que c’est seulement dans la profondeur de la souffrance que résonne en nous divinement le chant vital du monde, comme le chant du rossignol dans l’obscurité. » C’est alors seulement que la mélancolie, faite de pressentiments enfantins, qu’il y avait en Hölderlin subit la trempe qui fait d’elle une douleur tragique et que la tristesse élégiaque déborde jusqu’à atteindre l’impétuosité de l’hymne. Les étoiles de sa vie : Schiller et Diotima, sont maintenant tombées. Il est seul dans l’obscurité, et c’est alors que jaillit en lui « le chant du rossignol », ce chant qui ne périra pas, aussi longtemps que subsistera un seul mot de la langue allemande. C’est alors seulement qu’Hôlderlin est « trempé et sanctifié de part en part ». Ce que cet homme solitaire accomplit dans ces quelques années où il se trouve sur la cime abrupte qui sépare l’extase de la chute — favorisé du génie — est une œuvre parfaite : toutes les enveloppes et toutes les écorces qui cachaient le noyau ardent de son être sont déchirées ; la mélodie primitive de son moi coule librement dans le rythme incomparable du chant imposé par le destin. C’est alors que naît ce triple accord de sa vie : la poésie hölderlinienne, le roman d’Hypérion et la tragédie d’Empédocle, ces trois variantes héroïques de son apogée et de sa chute. C’est seulement dans l’effondrement tragique de son sort terrestre qu’Hôlderlin trouve la plus haute harmonie intellectuelle.
« Qui marche sur sa douleur marche vers la hauteur », dit son Hypérion. Hôlderlin a fait le pas décisif ; il se dresse désormais au-dessus de sa propre vie, au-dessus de sa souffrance personnelle. Il ne vit plus dans les tâtonnements de la sentimentalité, mais il a la conscience tragique de ce qu’est son destin. Comme son Empédocle sur l’Etna, ayant au-dessous de lui la voix des humains, au-dessus les mélodies éternelles et devant lui l’abîme de feu, il est là, dans un magnifique isolement. Les idéals d’autrefois se sont dissipés comme des nuages ; même la figure de Diotima ne brille plus que faiblement, comme au milieu de larmes.
C’est sans doute durant une de ses heures d’obscurité tragique qu’Hôlderlin, qui, malgré tout, se trouvait lui-même heureux dans son chant solitaire, a écrit ces lignes soulevées par la spontanéité de la force la plus profonde : « Jamais je n’avais si parfaitement éprouvé la vérité de ce mot ancien et infaillible du destin, qui nous dit qu’une félicité neuve s’ouvre pour notre cœur lorsqu’il résiste et qu’il est capable de supporter la douleur de minuit — ce mot qui nous dit que c’est seulement dans la profondeur de la souffrance que résonne en nous divinement le chant vital du monde, comme le chant du rossignol dans l’obscurité. » C’est alors seulement que la mélancolie, faite de pressentiments enfantins, qu’il y avait en Hölderlin subit la trempe qui fait d’elle une douleur tragique et que la tristesse élégiaque déborde jusqu’à atteindre l’impétuosité de l’hymne. Les étoiles de sa vie : Schiller et Diotima, sont maintenant tombées. Il est seul dans l’obscurité, et c’est alors que jaillit en lui « le chant du rossignol », ce chant qui ne périra pas, aussi longtemps que subsistera un seul mot de la langue allemande. C’est alors seulement qu’Hôlderlin est « trempé et sanctifié de part en part ». Ce que cet homme solitaire accomplit dans ces quelques années où il se trouve sur la cime abrupte qui sépare l’extase de la chute — favorisé du génie — est une œuvre parfaite : toutes les enveloppes et toutes les écorces qui cachaient le noyau ardent de son être sont déchirées ; la mélodie primitive de son moi coule librement dans le rythme incomparable du chant imposé par le destin. C’est alors que naît ce triple accord de sa vie : la poésie hölderlinienne, le roman d’Hypérion et la tragédie d’Empédocle, ces trois variantes héroïques de son apogée et de sa chute. C’est seulement dans l’effondrement tragique de son sort terrestre qu’Hôlderlin trouve la plus haute harmonie intellectuelle.
« Qui marche sur sa douleur marche vers la hauteur », dit son Hypérion. Hôlderlin a fait le pas décisif ; il se dresse désormais au-dessus de sa propre vie, au-dessus de sa souffrance personnelle. Il ne vit plus dans les tâtonnements de la sentimentalité, mais il a la conscience tragique de ce qu’est son destin. Comme son Empédocle sur l’Etna, ayant au-dessous de lui la voix des humains, au-dessus les mélodies éternelles et devant lui l’abîme de feu, il est là, dans un magnifique isolement. Les idéals d’autrefois se sont dissipés comme des nuages ; même la figure de Diotima ne brille plus que faiblement, comme au milieu de larmes.
« La liberté, pour celui qui comprend ce mot, c’est un mot profond. Un combat intime se livre en moi, je suis blessé comme jamais on ne l’a été, je suis sans espoir, sans but, je suis complètement dépouillé de mon honneur et pourtant il y a en moi une force, une force invincible, qui transporte mes os d’un doux enthousiasme chaque fois qu’elle s’anime en moi. » Voilà, dans cette parole, dans cette façon morale le secret d’Hôlderlin : derrière la faiblesse de son corps neurasthénique, débile et facile à briser, règne une assurance suprême, celle de l’âme : l’invulnérabilité d’un dieu. C’est pourquoi, en dernière analyse, les choses terrestres n’ont aucune puissance sur cet homme impuissant ; c’est pourquoi les événements ne sont que comme des nuages d’aurore ou de crépuscule qui ne font que passer sur le miroir toujours serein de son âme. Tout ce qui arrive à Hölderlin ne peut pas aller jusqu’au fond de son être ; même Suzanne Gontard n’est pour ses sens qu’une figure de rêve, une madone grecque, et elle disparaît ensuite comme un songe, qu’il poursuit mélancoliquement. Un enfant fera entendre une plainte plus amère et plus virile, pour un jouet qu’on lui enlève, qu’Hölderlin pour la perte de sa bien-aimée : combien faible et résigné, combien dépourvu de force sanguine et de douleur sensible est cet adieu !
"Je vais partir. Peut-être qu’un jour lointain,
O Diotima, je te reverrai. Mais évanoui sera alors le désir
Et nous serons paisibles et étrangers l’un à l’autre,
Comme ceux qui sont dans l’Au-delà."
Même ce qu’il a de plus cher reste pour sa main hors d’atteinte ; jamais il ne connaît l’intensité de l’événement vécu ; il marche toujours à travers un rêve ; il reste au-dessus de ce monde, un illuminé. La possession et la perte n’atteignent pas sa vie profonde ; de là vient que si, en lui, l’homme est d’une sensibilité extrême, son génie est invulnérable. Tout est gain à celui qui est capable de supporter toute perte, et la souffrance ne fait qu’épurer son âme en accroissant sa force créatrice : « Plus la douleur d’un homme est insondable, plus insondable est aussi sa puissance. » C’est précisément maintenant qu’il a « l’âme toute meurtrie » que, en dépit de son humiliation, il va déployer sa force suprême, le « courage poétique », qui rejette fièrement loin de lui toutes les armes de la résistance et s’avance sans peur jusqu’au seuil de la destinée :
"Est-ce que tous les vivants ne sont donc pas tes frères ?
Est-ce que la Parque elle-même ne te nourrira pas dans ton office ?
C’est pourquoi continue de passer tranquillement
À travers l’existence, sans avoir peur de rien.
Que tout ce qui arrive soit béni de toi."
Ce qui vient des hommes, en fait de détresse et d’injustice, ne peut rien contre l’homme qui est en Hölderlin. Mais ce que les dieux lui envoient comme destinée, c’est cela que son génie recueille et développe grandiosement dans son cœur sonore.
"Je vais partir. Peut-être qu’un jour lointain,
O Diotima, je te reverrai. Mais évanoui sera alors le désir
Et nous serons paisibles et étrangers l’un à l’autre,
Comme ceux qui sont dans l’Au-delà."
Même ce qu’il a de plus cher reste pour sa main hors d’atteinte ; jamais il ne connaît l’intensité de l’événement vécu ; il marche toujours à travers un rêve ; il reste au-dessus de ce monde, un illuminé. La possession et la perte n’atteignent pas sa vie profonde ; de là vient que si, en lui, l’homme est d’une sensibilité extrême, son génie est invulnérable. Tout est gain à celui qui est capable de supporter toute perte, et la souffrance ne fait qu’épurer son âme en accroissant sa force créatrice : « Plus la douleur d’un homme est insondable, plus insondable est aussi sa puissance. » C’est précisément maintenant qu’il a « l’âme toute meurtrie » que, en dépit de son humiliation, il va déployer sa force suprême, le « courage poétique », qui rejette fièrement loin de lui toutes les armes de la résistance et s’avance sans peur jusqu’au seuil de la destinée :
"Est-ce que tous les vivants ne sont donc pas tes frères ?
Est-ce que la Parque elle-même ne te nourrira pas dans ton office ?
C’est pourquoi continue de passer tranquillement
À travers l’existence, sans avoir peur de rien.
Que tout ce qui arrive soit béni de toi."
Ce qui vient des hommes, en fait de détresse et d’injustice, ne peut rien contre l’homme qui est en Hölderlin. Mais ce que les dieux lui envoient comme destinée, c’est cela que son génie recueille et développe grandiosement dans son cœur sonore.
Ce qui frappe d’abord chez nos trois poètes démoniaques c’est leur absence de lien avec le monde. Le démon détache du réel celui qu’il tient. Aucun d’eux n’a femme ni enfants (tout comme leurs frères Beethoven et Michel-Ange), ils n’ont ni biens ni foyer. Ce sont des natures nomades, des vagabonds, des originaux, des êtres spéciaux, peu appréciés et qui mènent une vie presque anonyme. Ils ne prennent racine nulle part. Eros même n’arrive pas à les retenir longtemps. Leurs amitiés se brisent, ils perdent leurs places, ils ne tirent aucun profit de leur œuvre : toujours ils sont suspendus au-dessus du vide et travaillent dans le vide. Leur vie a quelque chose de météorique, d’une étoile filante qui tournoie rapidement dans le ciel avant d’être précipitée sur la terre, tandis que celle de Goethe suit une trajectoire nette et bien définie. Goethe est profondément enraciné et ses racines s’étendent sans cesse en largeur et en profondeur. Il a épouse, enfants et petits-enfants, des femmes embellissent sa vie, des amis peu nombreux mais sûrs ne le quittent pas. Il habite une maison spacieuse et confortable qui se remplit de collections et d’objets rares, il vit dans la chaleur protectrice de la gloire dont son nom est entouré pendant plus d’un demi-siècle. Il occupe les plus hautes charges, il est comblé de dignités, il est ministre et conseiller intime, tous les ordres de la terre constellent sa large poitrine. Ses attaches avec le terrestre se développent dans la mesure que s’accroît l’envol spirituel de ceux-là, il devient de plus en plus sédentaire, sa sécurité augmente avec les années tandis que grandit l’instabilité des autres et qu’ils s’agitent comme des bêtes traquées. Là où il est se trouve le centre de son moi et en même temps le centre spirituel de la nation : d’un point fixe, Goethe, calme et actif, embrasse le monde ; son amour s’étend bien au-delà des hommes, il va jusqu’aux animaux, plantes et minéraux et réalise avec l’élément une union féconde.
C’est ainsi qu’à la fin de sa vie le maître du démon est un homme puissant alors que ceux-là sont déchirés par leur meute comme Dionysos. L’existence de Goethe est une conquête stratégique du monde, tandis que les autres, qui combattent héroïquement mais d’une façon désordonnée, sont chassés de la terre et se réfugient dans l’infini. Il faut qu’ils s’arrachent violemment du terrestre pour s’unir au supra-terrestre ; Goethe n’a pas besoin de quitter le moins du monde cette terre pour atteindre l’infini : lentement, avec patience, il l’attire à lui. Sa méthode est une méthode toute capitaliste : il met de côté régulièrement comme bénéfice spirituel une partie de l’expérience acquise qu’en fin d’année il fait figurer avec soin dans ses livres comme un commerçant ordonné ; sa vie produit un intérêt comme le champ sa moisson. Mais les autres, eux, ressemblent aux joueurs : avec une magnifique indifférence à l’égard du monde, ils risquent toute leur vie sur une seule carte, gagnent ou perdent l’infini : le démon a horreur du bénéfice accumulé patiemment sou par sou. Les expériences qui pour un Goethe sont l’essentiel de l’existence leur semblent sans valeur ; la souffrance ne leur enseignant rien sinon à sentir plus fort ces rêveurs et ces fanatiques causent leur propre perte.
C’est ainsi qu’à la fin de sa vie le maître du démon est un homme puissant alors que ceux-là sont déchirés par leur meute comme Dionysos. L’existence de Goethe est une conquête stratégique du monde, tandis que les autres, qui combattent héroïquement mais d’une façon désordonnée, sont chassés de la terre et se réfugient dans l’infini. Il faut qu’ils s’arrachent violemment du terrestre pour s’unir au supra-terrestre ; Goethe n’a pas besoin de quitter le moins du monde cette terre pour atteindre l’infini : lentement, avec patience, il l’attire à lui. Sa méthode est une méthode toute capitaliste : il met de côté régulièrement comme bénéfice spirituel une partie de l’expérience acquise qu’en fin d’année il fait figurer avec soin dans ses livres comme un commerçant ordonné ; sa vie produit un intérêt comme le champ sa moisson. Mais les autres, eux, ressemblent aux joueurs : avec une magnifique indifférence à l’égard du monde, ils risquent toute leur vie sur une seule carte, gagnent ou perdent l’infini : le démon a horreur du bénéfice accumulé patiemment sou par sou. Les expériences qui pour un Goethe sont l’essentiel de l’existence leur semblent sans valeur ; la souffrance ne leur enseignant rien sinon à sentir plus fort ces rêveurs et ces fanatiques causent leur propre perte.
Prononcer le nom de Goethe c’est évoquer le type du poète opposé aux démoniaques qui sera présent dans ce livre comme un symbole. Car non seulement en tant que naturaliste, en tant que géologue, mais aussi en art il a mis l’évolutif au-dessus de l’éruptif, il a combattu tout soubresaut, tout volcanisme avec une énergie dont il n’était pas prodigue. Et c’est là qu’il nous montre le mieux que pour lui aussi la lutte avec le démon a été le problème vital de son art. Car seul celui qui a rencontré le démon dans sa vie, qui a frémi devant son regard de méduse, qui s’est rendu compte du danger qu’il représentait, celui-là seul peut le craindre à ce point. Quelque part dans les fourrés de sa jeunesse Goethe a dû se trouver face à face avec le monstre et c’est par la création — Werther le prouve — qu’il a échappé au destin de Kleist et du Tasse, de Hôlderlin et de Nietzsche ! Cette effrayante rencontre lui a inspiré sa vie durant un profond respect pour son adversaire, une crainte non dissimulée de sa puissance. Le regard magique de Goethe a reconnu l’ennemi mortel sous tous ses aspects et métamorphoses, dans la musique de Beethoven, dans la Penthésilée de Kleist, les tragédies de Shakespeare (qu’il n’ose plus lire : « Cela me serait funeste », avoue-t-il) ; et plus il pense à son développement et à sa conservation plus il l’évite avec anxiété. Il sait ce qui arrive quand on s’abandonne au démon, c’est pourquoi il se défend, c’est la raison pour laquelle il avertit vainement les autres : Goethe emploie autant de force héroïque à se conserver que les démoniaques à se gaspiller. Pour lui aussi l’enjeu du combat est la liberté suprême : il lutte pour sa mesure contre la démesure, pour sa perfection et ceux-là pour l’infini.
Ce qui déjà unit les trois figures héroïques de Hölderlin, Kleist et Nietzsche, c’est leur destinée : ils se présentent pour ainsi dire sous le même horoscope. Tous trois sont projetés hors de leur moi par une puissance formidable, supra-terrestre, en quelque sorte, dans un violent cyclone de passions et finissent prématurément, dans la folie et le suicide. Sans lien avec leur temps, incompris de leur génération, ils passent comme des météores, rayonnant d’une brève lumière dans les ténèbres de leur mission. Eux-mêmes ignorent ce qu’ils sont et le chemin qu’ils prennent parce qu’ils ne font que venir de l’infini, pour aller à l’infini : c’est à peine si dans l’ascension et la chute rapides qu’est leur vie ils frôlent le monde réel. Quelque chose d’extra-humain agit en eux, une force au-dessus de la leur et à laquelle ils se sentent soumis ; ils n’obéissent pas (ils s’en aperçoivent, effarés, dans leurs rares moments de lucidité) à leur volonté, ce sont des possédés, des esclaves d’une puissance supérieure, d’un démon.
Goethe avait dit au poète dans son 'Euphorion' :
Doucement, doucement!
Pas d'audaces,
Pour éviter
Chute et accident...
Surmonte,
Pour l'amour de tes parents,
Tes impulsions surhumaines,
Trop violentes.
Contente-toi en silence
D'orner rustiquement ton champ.
Hölderlin, lui, répond passionnément à ces conseils de quiétisme poétique et de vie idyllique :
Pourquoi vouloir me calmer, lorsque mon âme brûle,
Dans les chaînes de cette époque d'airain?
Pourquoi, moi qui ne trouve mon salut que dans le combat,
Pourquoi, ô esprits sans ressort, m'enlevez-vous mon élément enflammé?
Cet «élément enflammé », l'enthousiasme dans lequel l'âme d'Hölderlin vit, comme la salamandre dans le feu, il a réussi à le préserver de l'emprise glaciale des classiques et ivre de sa destinée, lui «qui ne trouve son salut que dans les combats », il se jette une seconde fois dans la vie et
... c'est alors que dans cette forge
Se forge aussi toute pureté.
Ce qui doit le briser commence d'abord par tremper son âme, et ce qui trempe son âme finit par le briser.
Doucement, doucement!
Pas d'audaces,
Pour éviter
Chute et accident...
Surmonte,
Pour l'amour de tes parents,
Tes impulsions surhumaines,
Trop violentes.
Contente-toi en silence
D'orner rustiquement ton champ.
Hölderlin, lui, répond passionnément à ces conseils de quiétisme poétique et de vie idyllique :
Pourquoi vouloir me calmer, lorsque mon âme brûle,
Dans les chaînes de cette époque d'airain?
Pourquoi, moi qui ne trouve mon salut que dans le combat,
Pourquoi, ô esprits sans ressort, m'enlevez-vous mon élément enflammé?
Cet «élément enflammé », l'enthousiasme dans lequel l'âme d'Hölderlin vit, comme la salamandre dans le feu, il a réussi à le préserver de l'emprise glaciale des classiques et ivre de sa destinée, lui «qui ne trouve son salut que dans les combats », il se jette une seconde fois dans la vie et
... c'est alors que dans cette forge
Se forge aussi toute pureté.
Ce qui doit le briser commence d'abord par tremper son âme, et ce qui trempe son âme finit par le briser.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Stefan Zweig (171)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Le joueur d'échec de Zweig
Quel est le nom du champion du monde d'échecs ?
Santovik
Czentovick
Czentovic
Zenovic
9 questions
1884 lecteurs ont répondu
Thème : Le Joueur d'échecs de
Stefan ZweigCréer un quiz sur ce livre1884 lecteurs ont répondu