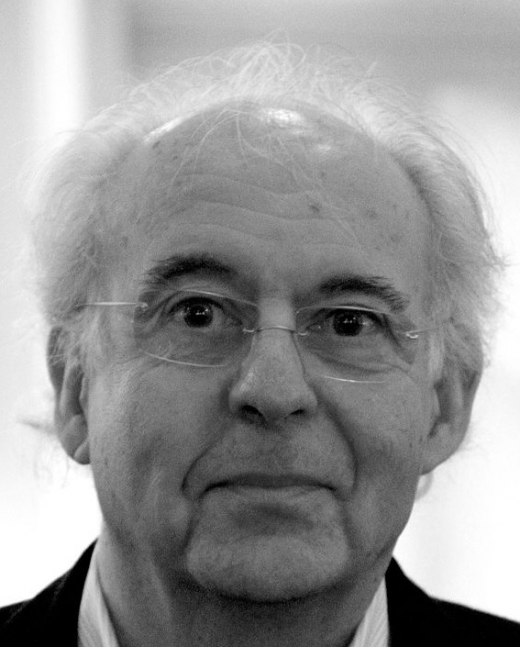Citations de Roger-Pol Droit (353)
La vie: « une entreprise qui ne couvre pas ses frais »
Il est actuel d’avoir une présence insistante, incisive, caustique, voire désespérante, des métaphores marchandes, économiques, financières, et comptables dans son œuvre. Il est rare de trouver autant sous la plume des philosophes de l’époque ou des contemporains, à l’exception de Freud. Pourtant, l’utilisation du calcul en philosophie n’est pas nouvelle (voir la parenthèse Platon, Leibniz). Mais ce calcul aboutissait à l’apologie du rationalisme et/ou du théisme, en mettant en évidence l’ordre du monde. Les calculs de Schopenhauer signifient leur défaite commune. Voilà le paradoxe schopenhauerien : le calcul de la valeur de la vie ne peut plus revendiquer les privilèges de la rationalité dogmatique. Depuis quand se pose le problème de la valeur, puisque la connaissance des choses en soi, susceptible de fonder la hiérarchie des biens véritables, n’est plus possible : la valeur « objective » a disparu. Voyons comment je peux mesurer cette valeur, avant que Nietzsche nous propose aux hommes de devenir les évaluateurs…
Il est actuel d’avoir une présence insistante, incisive, caustique, voire désespérante, des métaphores marchandes, économiques, financières, et comptables dans son œuvre. Il est rare de trouver autant sous la plume des philosophes de l’époque ou des contemporains, à l’exception de Freud. Pourtant, l’utilisation du calcul en philosophie n’est pas nouvelle (voir la parenthèse Platon, Leibniz). Mais ce calcul aboutissait à l’apologie du rationalisme et/ou du théisme, en mettant en évidence l’ordre du monde. Les calculs de Schopenhauer signifient leur défaite commune. Voilà le paradoxe schopenhauerien : le calcul de la valeur de la vie ne peut plus revendiquer les privilèges de la rationalité dogmatique. Depuis quand se pose le problème de la valeur, puisque la connaissance des choses en soi, susceptible de fonder la hiérarchie des biens véritables, n’est plus possible : la valeur « objective » a disparu. Voyons comment je peux mesurer cette valeur, avant que Nietzsche nous propose aux hommes de devenir les évaluateurs…
Il y a chez Schopenhauer la résurgence d’un thème presque oublié dans la philosophie occidentale depuis Spinoza, sinon depuis Plotin, celui de l’enracinement de l’ego individuel dans un jeu supra-personnel qui l’englobe sans le nier ou, en termes scolastiques, qui le contient non « formellement » mais « éminemment ». Ce thème serait très visible s’il n’était pas occulté ou éclipsé par un autre, omniprésent chez Schopenhauer, et qui peut se formuler ainsi : « La nature ne s’intéresse qu’à la pérennité des espèces, non à la survie des individus. » Or, ceci ne vaut que pour le vivant en général. Pour l’homme, la possibilité s’ouvre de comprendre la réversibilité de ce rapport individu-espèces : à savoir qu’il existe une dimension du jeu selon laquelle il se donne comme unique, insécable, démultiplié de manière seulement illusoire par les cadres spatio-temporels de la représentation. Métaphysiquement, « je » suis non pas semblable mais bien concrètement identique à la masse des êtres vivants d’aujourd’hui et c’est le fondement de la « pitié » mais aussi d’hier et de demain, à l’infini. Toute la force philosophique de Schopenhauer consiste ici à jouer sur les deux tableaux, c’est-à-dire à souligner d’une part l’intégration du phénomène humain dans la loi universelle du maintien des espèces, et des formes naturelles en général, à travers l’incessant renouvellement des individus, et à faire appel d’autre part au pouvoir proprement humain de la réflexion, afin que la sourde résignation de l’animal à son destin soit élevée au niveau de la conscience de soi, et par là même transmuée en consentement joyeux, voire extatique.
Rappelons les grandes lignes de la description schopenhauerienne de la souffrance : la souffrance est constitutive de la conscience elle-même, mieux : elle est « l’essence de la vie ». Cette souffrance comporte plusieurs aspects, liés à la structure même du désir.
L’insatisfaction en est l’aspect principal ; la souffrance est la qualité vécue par un désir défini essentiellement comme manque. De là découle la convoitise, l’envie, la jalousie, l’égoïsme, l’inquiétude, qui sont toutes les douleurs du manque vécu par un désir qui n’est rien d’autre que le vouloir-vivre et le mouvement de la vitalité.
Le second aspect est la perpétuité de cette souffrance : « le désir ne saurait être satisfait car il manque d’une fin dernière. » Aucun bien ne saurait combler durablement le manque ; aussi l’homme vit-il « dans un état de perpétuelle douleur ».
Le troisième aspect de la souffrance est son absurdité. Pour une expression du vouloir-vivre cosmique et universel, la souffrance est comme lui, dénuée de toute raison et finalité, est livrée à la nécessité : à la fois aveugle, nécessaire et absurde. Le quatrième aspect de la souffrance est son rapport à la mort. Celle-ci étant inéluctable et absurde, elle projette son absurdité sur toute l’existence d’un homme et accroît d’autant la souffrance du désir, qui voit toutes ses entreprises destinées à l’annulation brutale. Enfin, la souffrance exprime l’inévitable dialectique de la satiété et de l’ennui, dialectique qui, selon Schopenhauer, serait caractéristique du désir. L’homme serait nécessairement ballotté entre l’ennui, issu de l’arrêt du désir par la satisfaction, et la souffrance, issue du manque de l’objet corrélatif du désir. C’est de cette conception de la souffrance, à la fois inéluctable et absurde, que découle le pessimisme de Schopenhauer : la vie humaine, considérée telle qu’elle est, ne serait peut-être que douleur et échec. Mais ajoute-t-il, elle n’est telle que pour tous ceux qui restent au plan empirique du vouloir-vivre, c’est-à-dire du désir. Si au contraire, on vise philosophiquement la mort métaphysique et réelle de l’humanité (sans réincarnation) et cela grâce à la mort du désir par la sagesse et la contemplation (c’est-à-dire l’art et la philosophie spiritualiste), alors une « délivrance » et un « salut » peuvent être atteints.
L’insatisfaction en est l’aspect principal ; la souffrance est la qualité vécue par un désir défini essentiellement comme manque. De là découle la convoitise, l’envie, la jalousie, l’égoïsme, l’inquiétude, qui sont toutes les douleurs du manque vécu par un désir qui n’est rien d’autre que le vouloir-vivre et le mouvement de la vitalité.
Le second aspect est la perpétuité de cette souffrance : « le désir ne saurait être satisfait car il manque d’une fin dernière. » Aucun bien ne saurait combler durablement le manque ; aussi l’homme vit-il « dans un état de perpétuelle douleur ».
Le troisième aspect de la souffrance est son absurdité. Pour une expression du vouloir-vivre cosmique et universel, la souffrance est comme lui, dénuée de toute raison et finalité, est livrée à la nécessité : à la fois aveugle, nécessaire et absurde. Le quatrième aspect de la souffrance est son rapport à la mort. Celle-ci étant inéluctable et absurde, elle projette son absurdité sur toute l’existence d’un homme et accroît d’autant la souffrance du désir, qui voit toutes ses entreprises destinées à l’annulation brutale. Enfin, la souffrance exprime l’inévitable dialectique de la satiété et de l’ennui, dialectique qui, selon Schopenhauer, serait caractéristique du désir. L’homme serait nécessairement ballotté entre l’ennui, issu de l’arrêt du désir par la satisfaction, et la souffrance, issue du manque de l’objet corrélatif du désir. C’est de cette conception de la souffrance, à la fois inéluctable et absurde, que découle le pessimisme de Schopenhauer : la vie humaine, considérée telle qu’elle est, ne serait peut-être que douleur et échec. Mais ajoute-t-il, elle n’est telle que pour tous ceux qui restent au plan empirique du vouloir-vivre, c’est-à-dire du désir. Si au contraire, on vise philosophiquement la mort métaphysique et réelle de l’humanité (sans réincarnation) et cela grâce à la mort du désir par la sagesse et la contemplation (c’est-à-dire l’art et la philosophie spiritualiste), alors une « délivrance » et un « salut » peuvent être atteints.
Il n’y a rien chez Schopenhauer qui pourrait permettre d’encourager à la formulation d’un devoir être, puisque le monde est foncièrement absurde, rien non plus qui pourrait inciter la liberté à prendre en charge le réel pour le transformer, ou bien seulement le gérer, puisque l’homme est fondamentalement le jouet de la nécessité. Comment donc admettre quelques responsabilités que ce soit si l’homme est déterminé par la loi nécessaire qui régit son caractère particulier. Faut-il dire que Schopenhauer exclut toute aptitude humaine à la décision ? Bien entendu pas. Le privilège de l’espèce humaine consiste précisément dans la connaissance abstraite qui rend chacun clairvoyant sur les motifs qui l’animent et, par suite, le dispose à décider de se soumettre à tel d’entre eux plutôt qu’à un autre. Transposé sur le terrain de l’action politique, cela ne peut signifier qu’une chose : la volonté n’est jamais libre de s’autodéterminer, et toute décision obéit forcément à des fins irrationnelles.
Lourde hérédité pour Arthur Schopenhauer. Il n’a pas manqué de médecins pour la relever, certains allant jusqu’à parler de folie. C’est là une manière commode de se débarrasser de la doctrine schopenhauerienne en présentant une réponse facile à la question suivante : « Pourquoi cet homme heureux, indépendant, libre de tout souci matériel va-t-il dresser un tel réquisitoire contre l’existence ? », posée par René Laurent dans sa thèse de médecine. Avec une grande finesse, ce médecin analyse les traits généraux du comportement de Schopenhauer, son goût de la solitude et son rire bizarre, et conclut qu’on ne relève chez lui aucun signe clinique de dérangement cérébral, aucune tare physique qui pourrait influer sur le déroulement de sa pensée. Le seul point notable est la « somptueuse sensibilité » de ce cœur, qu’il a su durcir pour ne pas être déchiré, et qui est susceptible d’expliquer son isolement forcé et les particularités de son caractère. Il va de soi qu’elle ne saurait expliquer son génie philosophique. Elle a pourtant dû contribuer à la plus haute expression de celui-ci.
"Le dernier des sages ?
Schopenhauer fait explicitement l’éloge de la sagesse, et même de l’idéal ascétique. Il est sans doute le dernier à le faire, ce qui est un premier trait qui l’éloigne de nos contemporains. En un siècle où la philosophie est très généralement considérée comme une affaire purement théorique, sans finalité pratique, sans influence sur le gouvernement de soi, cet idéal peut paraître étrangement désuet.
Sans doute n’a-t-on pas assez mesuré l’originalité de la place occupée, de ce point de vue, par Schopenhauer. Cette originalité ne réside pas simplement dans le fait qu’il serait un représentant intempestif de l’axe essentiel de toute la pensée antique, égaré à l’âge où la philosophie est devenue, dit-on, pure construction de discours systématique, jugée en fonction de leur seule cohérence interne. Plutôt que le dernier spécimen repéré d’une espèce de plus en plus en voie de disparition, il faut peut-être le considérer dans son éminente modernité.
Schopenhauer fait explicitement l’éloge de la sagesse, et même de l’idéal ascétique. Il est sans doute le dernier à le faire, ce qui est un premier trait qui l’éloigne de nos contemporains. En un siècle où la philosophie est très généralement considérée comme une affaire purement théorique, sans finalité pratique, sans influence sur le gouvernement de soi, cet idéal peut paraître étrangement désuet.
Sans doute n’a-t-on pas assez mesuré l’originalité de la place occupée, de ce point de vue, par Schopenhauer. Cette originalité ne réside pas simplement dans le fait qu’il serait un représentant intempestif de l’axe essentiel de toute la pensée antique, égaré à l’âge où la philosophie est devenue, dit-on, pure construction de discours systématique, jugée en fonction de leur seule cohérence interne. Plutôt que le dernier spécimen repéré d’une espèce de plus en plus en voie de disparition, il faut peut-être le considérer dans son éminente modernité.
Aussi comprend-on, même assez largement, pourquoi les artistes, plus que d’autres, ont entendu Schopenhauer. Il leur donne une clé pour de multiples portes. Grâce à lui se met en scène autrement le tragique et le dérisoire de l’existence, les fatalités du désir et les piètres ruses de la raison, le sordide et la béatitude, le chagrin et la pitié, les calculs de l’égoïsme et les fins obstinées de la nature. L’amour et la mort, la connaissance et l’action, et même la matière et les formes, s’organisent selon de nouvelles perspectives. La religion révélée, la politique, l’histoire perdent de leur contenu. Sans cesse, le non-sens se voit redistribuer. Je peux avoir été passé sous les concepts, pour mettre un doigt sur la vie, sa souffrance et son absurdité. Voilà comment, de façon très diverse, tant de romanciers, de poètes, de dramaturges, de musiciens et de peintres ont été sensibles à cette philosophie.
Avec Schopenhauer, on comprend pour la première fois avec tant de netteté et de force, que les clartés de l’entendement sont asservies à la nuit aveugle du désir, au point que la représentation consciente n’est que l’averse d’une puissance inconsciente. Que la volonté singulière d’un individu n’a d’existence qui lui soit propre, qu’elle est immergée dans le jeu infini et absurde d’une réalité qui, de toute part, la dépasse. Habitée par l’impersonnel, la personne se révèle à la fois, si l’on ose dire, cosmique et comique.
Au commencement et à la fin, les autres
Les trois pistes ici esquissées n'ont en fait qu'un unique point de départ et d'arrivée. C'est les autres, leur présence et leur parole. L'économie de la parole est une économie circulaire. Si on l'oublie, on parle tout seul, donc on ne parle plus. La responsabilité personnelle des paroles n'a d'existence qu'envers les autres, par et pour les autres. Les décisions que je prends de parler ou de me taire, d'user de certains mots et d'en bannir d'autres, d'adopter telle attitude ou tel ton, n'ont de sens que par rapport aux autres. Un être « parlant» est, en fait, par essence, « parlant aux autres » -et non à lui-même, ni au néant. Il répond aux autres et répond d'eux. Ne plus le savoir revient à s'exposer à la disparition de soi-même, dans la solitude hallucinée et la toute- puissance fantasmagorique, et à provoquer éventuellement la disparition réelle des autres après les avoir effacés symboliquement de l'espace des échanges. L'équilibre entre émotions et raison, lui aussi, part des autres et y conduit.
Les trois pistes ici esquissées n'ont en fait qu'un unique point de départ et d'arrivée. C'est les autres, leur présence et leur parole. L'économie de la parole est une économie circulaire. Si on l'oublie, on parle tout seul, donc on ne parle plus. La responsabilité personnelle des paroles n'a d'existence qu'envers les autres, par et pour les autres. Les décisions que je prends de parler ou de me taire, d'user de certains mots et d'en bannir d'autres, d'adopter telle attitude ou tel ton, n'ont de sens que par rapport aux autres. Un être « parlant» est, en fait, par essence, « parlant aux autres » -et non à lui-même, ni au néant. Il répond aux autres et répond d'eux. Ne plus le savoir revient à s'exposer à la disparition de soi-même, dans la solitude hallucinée et la toute- puissance fantasmagorique, et à provoquer éventuellement la disparition réelle des autres après les avoir effacés symboliquement de l'espace des échanges. L'équilibre entre émotions et raison, lui aussi, part des autres et y conduit.
Piste 3. Réinventer des formes et des silences
[... ] Parmi les premières choses que l'on apprend à l'école: tout le monde ne peut parler en même temps, attendre son tour est indispensable, ne pas interrompre les autres est nécessaire. II ne serait pas superflu que des équivalents de ces règles soient imaginés pour les réseaux sociaux, et appliqués à grande échelle. L'attention accordée à l'importance et au respect des tours de parole, comme autant de codes sociaux qui structurent nos interlocutions, pourrait être une indication.
[... ]
Et, surtout, qu'on réapprenne à se taire ! Car la parole est par définition discontinue, comme l'écriture a besoin de blancs et d'espaces pour se constituer. Parler tout le temps n'est pas parler. Il est aussi important de savoir quand et comment s'abstenir que de trouver quoi dire au bon moment. L'un ne va pas sans l'autre. L'économie de la parole est aussi une économie du silence. Toutes les traditions l'ont su. Nous l'avons oublié.
[... ] Parmi les premières choses que l'on apprend à l'école: tout le monde ne peut parler en même temps, attendre son tour est indispensable, ne pas interrompre les autres est nécessaire. II ne serait pas superflu que des équivalents de ces règles soient imaginés pour les réseaux sociaux, et appliqués à grande échelle. L'attention accordée à l'importance et au respect des tours de parole, comme autant de codes sociaux qui structurent nos interlocutions, pourrait être une indication.
[... ]
Et, surtout, qu'on réapprenne à se taire ! Car la parole est par définition discontinue, comme l'écriture a besoin de blancs et d'espaces pour se constituer. Parler tout le temps n'est pas parler. Il est aussi important de savoir quand et comment s'abstenir que de trouver quoi dire au bon moment. L'un ne va pas sans l'autre. L'économie de la parole est aussi une économie du silence. Toutes les traditions l'ont su. Nous l'avons oublié.
Piste 2. Rééquilibrer la relation émotions-raison
[... ]
Entre parole émotive et parole rationnelle, il ne s'agit pas de choisir. Il faut plutôt sans cesse s'efforcer de les équilibrer : enrichir l'apport de l'une par la force de l'autre, compenser les inconvénients par les vertus sur chaque versant. Ce mouvement est permanent, jamais figé. Lui seul permet à la parole de demeurer sensible et vivante sans être dominatrice, et de garder raison sans se dessécher. Or cette économie souhaitable est fort éloignée de ce qu'on observe à présent.
[... ]
Entre parole émotive et parole rationnelle, il ne s'agit pas de choisir. Il faut plutôt sans cesse s'efforcer de les équilibrer : enrichir l'apport de l'une par la force de l'autre, compenser les inconvénients par les vertus sur chaque versant. Ce mouvement est permanent, jamais figé. Lui seul permet à la parole de demeurer sensible et vivante sans être dominatrice, et de garder raison sans se dessécher. Or cette économie souhaitable est fort éloignée de ce qu'on observe à présent.
Piste 1. Réendosser la responsabilité personnelle de ses paroles
Toute parole a des conséquences. Elle construit ou détruit. Elle n'est jamais sans aucune importance, aucun poids, aucun effet. Presque toutes les traditions du monde I'affirment. Nous l'avons presque oublié, nous n'y pensons plus. Si nous commencions à garder de nouveau cette vérité en tête, nous commencerions peut-être à changer d'attitude, à parler différemment - au sens où nous aurions repris conscience de la richesse de ce patrimoine et de notre responsabilité d'être parlant à son égard.
Toute parole a des conséquences. Elle construit ou détruit. Elle n'est jamais sans aucune importance, aucun poids, aucun effet. Presque toutes les traditions du monde I'affirment. Nous l'avons presque oublié, nous n'y pensons plus. Si nous commencions à garder de nouveau cette vérité en tête, nous commencerions peut-être à changer d'attitude, à parler différemment - au sens où nous aurions repris conscience de la richesse de ce patrimoine et de notre responsabilité d'être parlant à son égard.
La stratégie woke consiste alors à réinvoquer des oppressions historiques, à traquer des injustices encore inaperçues, pour imposer sa parole au nom de victimes jusque-là maintenues dans l'ombre. C'est d'ailleurs pourquoi les collectifs woke se constituent uniquement autour de choix sexuels identiques, d'appartenances ethniques identitaires, de singularités physiques ou psychiques similaires. Ce faisant, ils se retrouvent paradoxalement exposés à l'engrenage, à la fatalité, d'une segmentation infinie. Car la moindre différence peut toujours susciter des risques potentiels de domination et de préséance, donc de tensions et de désunions. Au sein de ces groupes, les individus ne parlent pas véritablement les uns aux autres, mais pensent s'exprimer d'une seule voix, comme un « groupe-individu ». Au jeu des sommations identitaires, I'individu finit par se perdre.
« Ne pas pouvoir se dérober, voilà le Moi », disait Levinas. En réalité, le moi n'existe et n'est assuré que si on ne se dérobe ni au corps, ni aux autres, ni au collectif, ni à sa propre responsabilité à l'égard de tout cela, une responsabilité qui se décline à travers une parole endossée et canalisée. Il se pourrait donc bien que nous arrivions au bord de cette étrangeté, où le sentiment de soi se dérobe à travers cet ultime délestage, subi ou attisé : le délestage de soi. En se combinant, les délestages successifs que nous avons évoqués conduisent à une série de séparations considérées comme aliénantes. Car d'une séparation à l'autre, l'ancrage corporel distendu, la réalité des autres larguée, le souci réel du collectif estompé, les repères spatiaux et temporels brouillés, que reste-t-il, sur quoi venir buter, pour construire sa propre réalite, son existence à soi? Rien à quoi se heurter pour se construire.
Notre époque se présente aussi comme celle d'une érosion, d'un effacement de I'idée même de responsabilité. L'impression qui submerge tout, dans les marées numériques et dans I'écume des tweets, est que règnent futilité et méchanceté, humeurs de l'heure - ironiques ou mordantes -, blagues bêtes, vulgarité et mépris. Pas seulement, certes. Mais très largement. Avec une forme d'irresponsabilité permanente, affichée, qui imprègne le flot des messages. Comme si toute parole, parce qu'instantanée, destinée à disparaître aussitôt qu'émise, était sans incidence aucune. Mort-née, somme toute.
Ce qui fait le plus défaut n'est pas la possibilité de s'exprimer, ni la volonté de changer la société, ni même le souci des mesures à prendre. Ce qui manque, cruellement, c'est essentiellement le sens du collectif. Si l'on s'en déleste, parfois sans même s'en apercevoir, c'est parce qu'il suppose d'écouter autant que de parler, parce qu'il implique de faire place à l'autre, à son existence, ses paroles, sa réalité, sa divergence, même si elles gênent.
Sa question centrale est : comment construire un monde moderne qui ne soit pas totalitaire ? La massification totalitaire se révele antipolitique en cela qu'elle projette de remplacer la pluralité par un modèle humain unique. Sous l'emprise totalitaire, paroles et actions convergent pour fabriquer un homme nouveau, dont tous les exemplaires parlent, pensent et agissent identiquement. Eradiquant la pluralité, les totalitarismes détruisent I'humain.
Mais il est illusoire de croire que l'individualisme forcené fasse mieux. Il aboutit au même résultat par des voies opposées. Bien sûr, si chacun pense ce qu'il veut, dit ce qu'il pense et agit dans son coin, la pluralité semble effectivement maintenue, voire intensifiée. Mais cette "atomisation", cet isolement de chacun, a pour effet l'annulation d'un monde commun, son remplacement par un « chaos d'intérêts individuels ». L'humanité se détruit aussi en perdant le sens et la dimension de son existence collective.
Mais il est illusoire de croire que l'individualisme forcené fasse mieux. Il aboutit au même résultat par des voies opposées. Bien sûr, si chacun pense ce qu'il veut, dit ce qu'il pense et agit dans son coin, la pluralité semble effectivement maintenue, voire intensifiée. Mais cette "atomisation", cet isolement de chacun, a pour effet l'annulation d'un monde commun, son remplacement par un « chaos d'intérêts individuels ». L'humanité se détruit aussi en perdant le sens et la dimension de son existence collective.
Parmi les penseurs contemporains, c'est Hannah Arendt qui a le plus rigoureusement élaboré la philosophie de cette parole collective constitutive du politique. Elle rappelle que ce qui fonde l'humanité, c'est la pluralité : des êtres humains uniques, donc dissemblables, mais égaux, et voués par là même à s'organiser pour construire ensemble une société. Ce qui permet aux humains de décider en commun des actions qu'ils veulent mener, insiste la philosophe, c'est justement la parole. Elle constitue la condition première, essentielle, du politique - sous la forme de délibérations à plusieurs, d'échange des expériences et des perspectives disparates, de recherche de compromis et de solutions acceptables par tous.
Il y a là une gravissime confusion entre le droit à la parole et le contenu de ce qu'on dit. Oui, tous ceux qui parlent se valent. Non, tout ce qu'ils disent ne se vaut pas. La personne émettant un message est par elle-même respectable. Ce qu'elle dit peut ne pas l'être. Je peux donc, et dans certains cas je dois même, combattre ses affirmations, ce qui ne signifie nullement disqualifier cette personne. De même, rectifier une erreur de calcul ou une faute de logique ne saurait marquer un mépris quelconque envers l'individu qui les a commises. Ce sont là des évidences élémentaires, rudimentaires même. Malgré tout, elles sont en train de s'estomper. Du désaccord au mépris, le glissement est de plus en plus fréquent. Entre paroles et personnes, I'assimilation s'intensifie : chacun est ce qu'il dit, se trouve confondu avec ses propos. On ne condamne plus une phrase, mais un être humain. Si la phrase est abjecte, on se convainc que la personne l'est également.
Chaque fois, trois éléments participent à la genèse du génocide.
D'abord la ségrégation, qui commence dans l'imaginaire et les représentations avant de se poursuivre dans les faits. Une partie de la population se trouve présentée inférieure et dangereuse, soupçonnée d'être à la fois différente et malfaisante. La construction de cette mise à l'écart mobilise des fantasme.
[... ]
Les génocides du XXe siècle ont pour condition l'avènement d'une parole toxique globale, qui s'impose à tous, sans même que chacun en ait clairement conscience. La radio des Mille Collines en fournit un exemple simple, parce qu'il est circonscrit et limité. La langue du IIIe Reich, on va le voir, est plus complexe et retorse. Le but de la parole totalitaire est constant : forger les manières de penser, canaliser les émotions, formater les actes. Le dressage passe par des tournures de phrase, des vocables nouveaux, des usages insolites de termes usuels. Cette langue inventée doit enfin être diffusée massivement. Le troisième élément indispensable aux processus exterminateurs, ce sont les moyens de communication de masse. Il faut que la parole du pouvoir soit partout, qu'elle se fasse entendre sur les ondes, dans les rues, les places, les institutions, aussi bien que dans les foyers. Elle doit habiter les consciences tout autant que les discours officiels. Omniprésente et intime. Sans délai, sans intermédiaire. Sans échappatoire. Pour instaurer l'emprise totalitaire.
D'abord la ségrégation, qui commence dans l'imaginaire et les représentations avant de se poursuivre dans les faits. Une partie de la population se trouve présentée inférieure et dangereuse, soupçonnée d'être à la fois différente et malfaisante. La construction de cette mise à l'écart mobilise des fantasme.
[... ]
Les génocides du XXe siècle ont pour condition l'avènement d'une parole toxique globale, qui s'impose à tous, sans même que chacun en ait clairement conscience. La radio des Mille Collines en fournit un exemple simple, parce qu'il est circonscrit et limité. La langue du IIIe Reich, on va le voir, est plus complexe et retorse. Le but de la parole totalitaire est constant : forger les manières de penser, canaliser les émotions, formater les actes. Le dressage passe par des tournures de phrase, des vocables nouveaux, des usages insolites de termes usuels. Cette langue inventée doit enfin être diffusée massivement. Le troisième élément indispensable aux processus exterminateurs, ce sont les moyens de communication de masse. Il faut que la parole du pouvoir soit partout, qu'elle se fasse entendre sur les ondes, dans les rues, les places, les institutions, aussi bien que dans les foyers. Elle doit habiter les consciences tout autant que les discours officiels. Omniprésente et intime. Sans délai, sans intermédiaire. Sans échappatoire. Pour instaurer l'emprise totalitaire.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur

Vive la philosophie
petitsoleil
13 livres

Courts Toujours
Kickou
21 livres

Il était une fois... L'enfance
Alzie
51 livres
Auteurs proches de Roger-Pol Droit
Lecteurs de Roger-Pol Droit (710)Voir plus
Quiz
Voir plus
Expressions musicales : les instruments
Sortir les violons
Assister à une scène très émouvante
Sortir les poubelles
10 questions
317 lecteurs ont répondu
Thèmes :
musique
, expressionsCréer un quiz sur cet auteur317 lecteurs ont répondu