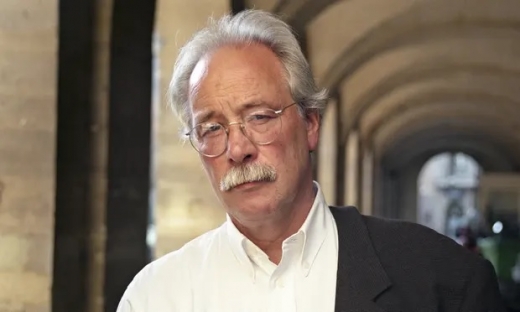Critiques de W. G. Sebald (113)
De Sebald, j’avais déjà lu Les Anneaux de saturne, et je me suis replongée avec plaisir dans ce style si particulier, aux phrases étirées sur des dizaines de lignes, parfois sur des pages entières, sans que le propos perde sa limpidité.
Les thèmes abordés dans ce roman sont le temps (et la proposition d’une conception non linéaire de celui-ci), la Shoah, la mémoire traumatique ou encore la quête des origines.
Au fil du récit enchâssé de Jacques Austerlitz qui raconte à un narrateur anonyme son histoire et sa quête, les souvenirs des personnages s’accumulent jusqu’à former des strates très denses et enchevêtrées. La chronologie des événements se trouve brouillée, le passé s’immisce dans le présent et le lecteur est aspiré dans le vertige du temps éclaté et déréglé propre au traumatisme.
Les thèmes abordés dans ce roman sont le temps (et la proposition d’une conception non linéaire de celui-ci), la Shoah, la mémoire traumatique ou encore la quête des origines.
Au fil du récit enchâssé de Jacques Austerlitz qui raconte à un narrateur anonyme son histoire et sa quête, les souvenirs des personnages s’accumulent jusqu’à former des strates très denses et enchevêtrées. La chronologie des événements se trouve brouillée, le passé s’immisce dans le présent et le lecteur est aspiré dans le vertige du temps éclaté et déréglé propre au traumatisme.
« L’une des personnes qui attendaient dans la salle des pas perdus était Austerlitz, à l’époque en 1967, encore presque jeune d’allure avec ses cheveux blonds étrangement frisés, seulement comparables à ceux du héros allemand Siegfried dans les Nibelungen de Fritz-Lang ».
Une beauté et une souffrance, voilà ce qui me vient à l’esprit pour qualifier ce récit. Une beauté tant l’écriture exigeante de Sebald est hypnotique, fascinante, des phrases longues qui défilent sous les yeux, des détails qui suintent la mélancolie, poésie qui envoûte, une lenteur qui nous oblige à nous poser, à ne rien négliger mais une lenteur qui absorbe jusqu’à notre moi intime, jusqu’à notre inconscient qui finit par s’identifier à Jacques Austerlitz pour devenir une douleur. Eprouvantes aussi, ces lignes magnétiques, ces pages qui se tournent sans chapitre, tout est écrit comme dans l’urgence, pour ne pas oublier, on suffoque entre la fascination de l’écriture et le malaise qui s’en dégage, il faut faire une pause malgré l’envie de continuer.
De cette rencontre entre notre narrateur – Sebald ? – avec Jacques Austerlitz, dans la Gare d’Anvers, va naître une intimité qui de rencontre en rencontre, de confidence en confidence, durera trente ans.
Est-ce de chez Austerlitz qu’exhale, enfoui au plus profond de lui-même, une douleur, comme un sentiment obscur d’incomplétude, une personnalité tronquée, ou bien est ce de la plume de l’auteur, de ses mots que s’exprime cette souffrance. Lui, dont le père fut sous-officier dans la Wehrmacht, lui dont les prénoms Winfried Georg Maximilian ne sont plus que des initiales, lui qui se disait un « produit du fascisme ».
En chroniqueur de la mémoire, l’auteur s’efface devant cet ami, parti de Prague en 1939 à destination d’Angleterre, à l’âge de quatre ans. Adopté par un pasteur sectaire, névrosé, dont il ne comprend pas la langue, élevé dans le silence, sous le regard d’un Dieu qui châtie, sans plus aucune marque d’affection tant de l’épouse que du pasteur, comment ne pas ressentir comme une béance affective, un vide profond traversé par des angoisses, une instabilité émotionnelle. Austerlitz ne découvrira sa véritable identité qu’à l’âge de quinze ans.
Véritable quête identitaire, Austerlitz se doit de rassembler les morceaux du puzzle pour tenter, peut-être, d’apaiser cette sensation terrible du manque, ne plus vivre la superposition du passé et du présent, cette construction qui rend votre relation au monde totalement flou. Un rien : une couleur, un lieu, un mot en relation avec le traumatisme ravive le choc, la blessure et vous envoie valser avec la détresse. Austerlitz devra parcourir un long chemin sur des lieux semés d’ombre qui se réactiveront au fur et à mesure de ses découvertes. Aidé par sa nourrice qu’il retrouvera, ses pas l’emporteront vers des lieux emblématiques comme Terezin et Gurs à la recherche de ses parents. L’émotion surprend à toutes les pages. Austerlitz en perpétuelle recherche, perpétuelle incomplétude, se questionne et questionne le monde autour de lui et nous entraîne à sa suite, épousant ses vagues émotionnelles.
Que de silence, que de douleurs, éprouvant ce sentiment de ne jamais être à la bonne place, de ne pas avoir sa propre existence, d’être à côté de la réalité « qui je suis, d’où je viens, où vais-je ».
Faisant preuve d’une grande érudition, Austerlitz est chargé de cours dans un institut d’histoire de l’art londonien, ses recherches l’ont mené à l’élaboration d’une thèse monumentale sur l’architecture, tout particulièrement sur les réseaux, tels les chemins de fer. Il ne pouvait expliquer cette fascination qui lui permettait, surtout, ne pas parler de lui, de se réfugier derrière son intellect pour ne pas affronter cette béance, un abri en quelque sorte bien dissimulé derrière la reconnaissance intellectuelle.
La rencontre entre le narrateur et Austerlitz se fait dans la gare d’Anvers, salle des pas perdus. Austerlitz observe la gare, la coupole, et couche sur le papier toutes ses réflexions, ses observations. C’est le prétexte que choisi le narrateur pour aborder Jacques Austerlitz. Ces premiers entretiens se limiteront très longtemps à l’histoire de l’architecture dont les connaissances d’Austerlitz forcent l’admiration jusqu’au jour où, la confiance aidant, une once d’estime naissante, Austerlitz s’abandonnera aux confidences.
Quatrième de couverture : « Par ce portrait saisissant d’un émigrant déraciné, fragile, érudit et digne, l’auteur élève une sorte d’anti-monument pour tous ceux qui, au cours de l’Histoire, se retrouvent pourchassés, déplacés, coupés de leurs racines – sans jamais en comprendre la raison ni le sens ».
C’est un livre sublime, sensible, à l’évocation puissante que je relirai, c’est évident ! Merci à Eduardo et à Dan pour ce conseil de lecture mais j’ai beaucoup moins souffert avec « Séfarade ».
Une beauté et une souffrance, voilà ce qui me vient à l’esprit pour qualifier ce récit. Une beauté tant l’écriture exigeante de Sebald est hypnotique, fascinante, des phrases longues qui défilent sous les yeux, des détails qui suintent la mélancolie, poésie qui envoûte, une lenteur qui nous oblige à nous poser, à ne rien négliger mais une lenteur qui absorbe jusqu’à notre moi intime, jusqu’à notre inconscient qui finit par s’identifier à Jacques Austerlitz pour devenir une douleur. Eprouvantes aussi, ces lignes magnétiques, ces pages qui se tournent sans chapitre, tout est écrit comme dans l’urgence, pour ne pas oublier, on suffoque entre la fascination de l’écriture et le malaise qui s’en dégage, il faut faire une pause malgré l’envie de continuer.
De cette rencontre entre notre narrateur – Sebald ? – avec Jacques Austerlitz, dans la Gare d’Anvers, va naître une intimité qui de rencontre en rencontre, de confidence en confidence, durera trente ans.
Est-ce de chez Austerlitz qu’exhale, enfoui au plus profond de lui-même, une douleur, comme un sentiment obscur d’incomplétude, une personnalité tronquée, ou bien est ce de la plume de l’auteur, de ses mots que s’exprime cette souffrance. Lui, dont le père fut sous-officier dans la Wehrmacht, lui dont les prénoms Winfried Georg Maximilian ne sont plus que des initiales, lui qui se disait un « produit du fascisme ».
En chroniqueur de la mémoire, l’auteur s’efface devant cet ami, parti de Prague en 1939 à destination d’Angleterre, à l’âge de quatre ans. Adopté par un pasteur sectaire, névrosé, dont il ne comprend pas la langue, élevé dans le silence, sous le regard d’un Dieu qui châtie, sans plus aucune marque d’affection tant de l’épouse que du pasteur, comment ne pas ressentir comme une béance affective, un vide profond traversé par des angoisses, une instabilité émotionnelle. Austerlitz ne découvrira sa véritable identité qu’à l’âge de quinze ans.
Véritable quête identitaire, Austerlitz se doit de rassembler les morceaux du puzzle pour tenter, peut-être, d’apaiser cette sensation terrible du manque, ne plus vivre la superposition du passé et du présent, cette construction qui rend votre relation au monde totalement flou. Un rien : une couleur, un lieu, un mot en relation avec le traumatisme ravive le choc, la blessure et vous envoie valser avec la détresse. Austerlitz devra parcourir un long chemin sur des lieux semés d’ombre qui se réactiveront au fur et à mesure de ses découvertes. Aidé par sa nourrice qu’il retrouvera, ses pas l’emporteront vers des lieux emblématiques comme Terezin et Gurs à la recherche de ses parents. L’émotion surprend à toutes les pages. Austerlitz en perpétuelle recherche, perpétuelle incomplétude, se questionne et questionne le monde autour de lui et nous entraîne à sa suite, épousant ses vagues émotionnelles.
Que de silence, que de douleurs, éprouvant ce sentiment de ne jamais être à la bonne place, de ne pas avoir sa propre existence, d’être à côté de la réalité « qui je suis, d’où je viens, où vais-je ».
Faisant preuve d’une grande érudition, Austerlitz est chargé de cours dans un institut d’histoire de l’art londonien, ses recherches l’ont mené à l’élaboration d’une thèse monumentale sur l’architecture, tout particulièrement sur les réseaux, tels les chemins de fer. Il ne pouvait expliquer cette fascination qui lui permettait, surtout, ne pas parler de lui, de se réfugier derrière son intellect pour ne pas affronter cette béance, un abri en quelque sorte bien dissimulé derrière la reconnaissance intellectuelle.
La rencontre entre le narrateur et Austerlitz se fait dans la gare d’Anvers, salle des pas perdus. Austerlitz observe la gare, la coupole, et couche sur le papier toutes ses réflexions, ses observations. C’est le prétexte que choisi le narrateur pour aborder Jacques Austerlitz. Ces premiers entretiens se limiteront très longtemps à l’histoire de l’architecture dont les connaissances d’Austerlitz forcent l’admiration jusqu’au jour où, la confiance aidant, une once d’estime naissante, Austerlitz s’abandonnera aux confidences.
Quatrième de couverture : « Par ce portrait saisissant d’un émigrant déraciné, fragile, érudit et digne, l’auteur élève une sorte d’anti-monument pour tous ceux qui, au cours de l’Histoire, se retrouvent pourchassés, déplacés, coupés de leurs racines – sans jamais en comprendre la raison ni le sens ».
C’est un livre sublime, sensible, à l’évocation puissante que je relirai, c’est évident ! Merci à Eduardo et à Dan pour ce conseil de lecture mais j’ai beaucoup moins souffert avec « Séfarade ».
À l’automne 1899, la famille du Dr Henry Selwyn quitta son petit village de Grodno, en Lituanie, et s’embarqua pour «l’Amerikum», mais après une semaine en mer, l’exode se termina pour eux à Londres où ils furent contraints d’émigrer.
Paul Bereyter, instituteur allemand «trois-quarts aryen», empêché par les nouvelles dispositions raciales d’exercer son métier d’enseignant, s’en alla de l’Allemagne une première fois, y revint en 1939, fut mobilisé au début de la guerre, puis émigra définitivement en France dans les années 1970.
Au début du XXe siècle, Ambrose Adelwarth rompait tous liens l’assujétissant à son milieu social d’origine, quittait l’Allemagne à 14 ans, partant à la conquête du monde : après avoir vécu plusieurs vies en une seule, de la Suisse à l’Amérique du Nord , en passant par le Japon ou le Moyen-Orient, ses souvenirs finiraient par s’égarer dans les couloirs de sa mémoire de nomade encombrée.
Max Ferber, artiste peintre envoyé en Angleterre en 1939 et dont les parents, déportés quelque temps après ne pourraient hélas l’y rejoindre comme prévu, n’a plus jamais voulu remettre ses pieds en Allemagne et n’a plus prononcé un seul mot en allemand depuis les adieux faits à sa famille sur l’aéroport munichois d’Oberwiensenfeld, à l’âge de 15 ans.
Quatre vies racontées, quatre destinées d’émigrants. Pourquoi celles-ci précisément, parmi tant d’autres? Quel lien réunit ces sujets-ci, au-delà de leur statut commun d’émigrés ? La réponse est toute simple : l’auteur lui-même. Paul Bereyter fut son premier instituteur, Ambros Adelwarth son grand-oncle. Quant à Henry Selwyn et Max Ferber, Sebald les avait croisés et côtoyés un temps en Angleterre où lui-même s’était expatrié à partir des années 1970.
Plutôt qu’historien, au travers de ces quatre récits l'auteur pratiquerait une sorte "d’archéologie mémoriale", fouillant systématiquement dans les débris laissés par la mémoire du XXe siècle en Europe, et plus particulièrement dans celle de son pays d’origine, l’Allemagne, ébranlée par l’irruption inconcevable de la barbarie nazie, ensevelie en grande partie sous la douleur et la destruction léguées par la Seconde Guerre Mondiale.
C’est ainsi que, pour lui, aller sur le terrain, organiser des «fouilles sur site» (dont une escapade, très édifiante sur le passage cruel du temps, à Deauville, où l’auteur était descendu au Normandy aux fins de son enquête autour d’Ambros Adelwart), extraire, ordonner et assembler les vestiges personnels que le temps et l’anonymat de ses sujets de choix auront brisés, mélangés, éparpillés, recouverts de cette poussière sépia que dépose l’oubli - photos et cartes postales, vieux albums de familles, feuillets épars, cartes de visites, carnets de voyages… - , constituent les moyens privilégiés par sa démarche, primant systématiquement sur toute tentative de conceptualisation ou de généralisation, sur toute visée analytique ou critique de l’histoire du XXe siècle.
Il ne cherchera pas à rattacher leurs choix, motivations et agissements personnels à un référentiel plus général ou à une grille particulière de lecture : chaque individualité restera chez Sebald invariablement contemplée dans son irréductibilité, rendue à son ipséité et, in fine, aussi à sa propre part de mystère.
L'auteur se cantonne en quelque sorte à essayer d’exhumer de l’incommensurable fosse commune où gisent les âmes mortes n’ayant laissé aucun registre historique de leur passage dans le monde, quelques individualités, d’en répertorier quelques-unes de leurs traces encore tangibles ou dont certains vivants pourraient encore témoigner. Afin de restituer leur parcours terrestre, tout en évitant précautionneusement de les épingler comme étant exemplaires ou emblématiques de quoi que ce soit. Au lecteur d’en tirer ses propres conclusions. Sebald, plutôt qu’interpréter, collige.
Enrichi de supports visuels (photos, dessins, feuillets, manuscrits…), d’images qui parlent quelquefois mieux que toute autre forme de discours, son récit se construit essentiellement à partir de témoignages et d’archives.
Iconographique, son travail documentaire n’exclut pas, en revanche, ni l’empathie, ni l’émotion :
«Si les inscriptions gravées n’étaient pas toutes déchiffrables, les noms encore lisibles – Hambruger, Kissinger, Wertheimer, Friedländer, Arnsberg, Frank, Auerbach, Grunwald, Leuthold, Seeligmann, Hertz, Goldstaud, Baumblatt et Blumenthal – m’inclinèrent à penser que les Allemands n’avaient peut-être rien tant envié aux Juifs que leurs beaux noms, si liés au pays et à la langue dans lesquels ils vivaient. Un frisson me parcourut devant une tombe où reposait Meier Stern, décédé le jour de ma naissance, et de même le symbole de la plume d’oie sur la stèle de Friederike Haldleib, morte le 28 mars 1912, provoqua en moi un trouble dont je dus m’avouer que je ne parviendrais jamais à percer complètement les raisons. Je me l’imaginais écrivain, penchée solitaire et le souffle court sur son travail, et à présent que j’écris ces lignes, il me semble que c’est moi qui l’ai perdue et que la douleur de sa perte reste entière malgré le long temps écoulé depuis sa disparition."
La subjectivité de l’auteur constitue ainsi, une partie essentielle du dispositif et de l’approche du chroniqueur, le tout résultant en un procédé d’autant plus percutant et riche qu’il se fait à contre-courant de la démarche d’investigation consacrée en Histoire : le général et supra-individuel passant ici avant tout par le particulier et l'infra-historique, la valeur du matériel documentaire par la puissance d’évocation émotionnelle que ce dernier recèle.
La démonstration en est d’autant plus pertinente et réussie, ou en tout cas son impact sur le lecteur sera particulièrement saisissant et convaincant de vérité.
Quoiqu’on ait pu prétendre que W. G. («Winfried Georg» – Sebald n’ayant jamais voulu signer in extenso son prénom, considéré par lui comme trop connoté à un univers symbolique nazi..), n'aurait pas été de son vivant spécialement «tendre» envers son pays d’origine, je n'ai, pour ce qui me concerne, jamais retrouvé dans ses livres -tout au moins dans ceux que j’ai eu l’occasion de lire jusqu’à présent-, aucune mise en accusation directe formulée à l’encontre du peuple allemand. Sebald, me semble-t-il, s’en réserve formellement, alors même que son expérience et son parcours personnels auront été marqués, façonnés par le souvenir funeste des crimes commis par le régime nazi, par le panurgisme ou l'indifférence manifestés par ses compatriotes, par les séquelles douloureuses, enfin, qu'aura laissé la destruction morale et matérielle de la nation allemande, reléguant à la fin de la guerre une partie considérable de la mémoire collective au silence et à l’oubli.
Qu’en est-il aujourd’hui ? Y-a-t-il une prescription aux nouvelles générations par rapport à l’effroi provoqué par l’horreur absolue perpétrée dans un passé relativement récent? Combien de temps faudra-t-il, en définitif, aux allemands avant d’avoir terminé d’ouvrir la totalité des archives de guerre, à la fois publiques et collectives, personnelles et généalogiques, et pouvoir envisager enfin, avec une certaine distance et sérénité, leur propre passé ? Cinquante ans ? Un siècle ? Qui dirait mieux ?
L’essentiel de la production littéraire qui fera la renommée de la courte carrière d’écrivain de Sebald, disparu à 57 ans dans un accident de voiture en 2001, avait commencé à prendre corps vers la fin de années 1980, moins de cinquante ans donc après la «destruction». C’est notamment grâce à une reconnaissance internationale que la critique littéraire allemande s'intéressera progressivement à son œuvre à partir du milieu des années 1990..
Comment les nouvelles générations d’allemands feuillètent aujourd’hui d’anciens albums de famille (si tant est qu’il en reste encore beaucoup qui n’aient point été détruits ou expurgés…) ? Et nous-même, partant du principe d’une certaine capacité d'identification à autrui, proprement humaine, pouvons-nous l’espace d’un instant essayer de nous mettre à leur place?
Un humanisme teinté d’empathie et de générosité, son érudition immense et en même temps humble, sa sensibilité délicate, intériorisée et réservée, l’exercice littéraire original et subtil auquel il se livre (qu’il refusait lui-même à considérer comme «romancé», y compris pour ce qui est de son chef-d’œuvre incontestable, «Austerlitz», qui ressemble cependant drôlement à un roman !) : voilà en somme ce qui me touche particulièrement chez lui.
Sebald est devenu avec le temps un de mes auteurs «compagnons-de-route», vers lequel j’éprouve le besoin de revenir régulièrement afin de réentendre une voix qui m’est devenue familière et, malgré la mélancolie susceptible de s’en dégager, qui réconforte.
Voix incitant à pratiquer une sorte de «roman de la mémoire» comme une moyen possible d’apaisement face aux souvenirs douloureux, au temps qui passe indifférent, au caractère instable et éphémère de nos existences.
Un peu comme cette vision insolite qui revient curieusement à différents passages de son livre: celle d'un inconnu qui fait subitement irruption dans le récit, en pleine lumière, image non pas d'un ange qui passe, mais d'un «butterfly man» muni d’un filet à papillons…
Paul Bereyter, instituteur allemand «trois-quarts aryen», empêché par les nouvelles dispositions raciales d’exercer son métier d’enseignant, s’en alla de l’Allemagne une première fois, y revint en 1939, fut mobilisé au début de la guerre, puis émigra définitivement en France dans les années 1970.
Au début du XXe siècle, Ambrose Adelwarth rompait tous liens l’assujétissant à son milieu social d’origine, quittait l’Allemagne à 14 ans, partant à la conquête du monde : après avoir vécu plusieurs vies en une seule, de la Suisse à l’Amérique du Nord , en passant par le Japon ou le Moyen-Orient, ses souvenirs finiraient par s’égarer dans les couloirs de sa mémoire de nomade encombrée.
Max Ferber, artiste peintre envoyé en Angleterre en 1939 et dont les parents, déportés quelque temps après ne pourraient hélas l’y rejoindre comme prévu, n’a plus jamais voulu remettre ses pieds en Allemagne et n’a plus prononcé un seul mot en allemand depuis les adieux faits à sa famille sur l’aéroport munichois d’Oberwiensenfeld, à l’âge de 15 ans.
Quatre vies racontées, quatre destinées d’émigrants. Pourquoi celles-ci précisément, parmi tant d’autres? Quel lien réunit ces sujets-ci, au-delà de leur statut commun d’émigrés ? La réponse est toute simple : l’auteur lui-même. Paul Bereyter fut son premier instituteur, Ambros Adelwarth son grand-oncle. Quant à Henry Selwyn et Max Ferber, Sebald les avait croisés et côtoyés un temps en Angleterre où lui-même s’était expatrié à partir des années 1970.
Plutôt qu’historien, au travers de ces quatre récits l'auteur pratiquerait une sorte "d’archéologie mémoriale", fouillant systématiquement dans les débris laissés par la mémoire du XXe siècle en Europe, et plus particulièrement dans celle de son pays d’origine, l’Allemagne, ébranlée par l’irruption inconcevable de la barbarie nazie, ensevelie en grande partie sous la douleur et la destruction léguées par la Seconde Guerre Mondiale.
C’est ainsi que, pour lui, aller sur le terrain, organiser des «fouilles sur site» (dont une escapade, très édifiante sur le passage cruel du temps, à Deauville, où l’auteur était descendu au Normandy aux fins de son enquête autour d’Ambros Adelwart), extraire, ordonner et assembler les vestiges personnels que le temps et l’anonymat de ses sujets de choix auront brisés, mélangés, éparpillés, recouverts de cette poussière sépia que dépose l’oubli - photos et cartes postales, vieux albums de familles, feuillets épars, cartes de visites, carnets de voyages… - , constituent les moyens privilégiés par sa démarche, primant systématiquement sur toute tentative de conceptualisation ou de généralisation, sur toute visée analytique ou critique de l’histoire du XXe siècle.
Il ne cherchera pas à rattacher leurs choix, motivations et agissements personnels à un référentiel plus général ou à une grille particulière de lecture : chaque individualité restera chez Sebald invariablement contemplée dans son irréductibilité, rendue à son ipséité et, in fine, aussi à sa propre part de mystère.
L'auteur se cantonne en quelque sorte à essayer d’exhumer de l’incommensurable fosse commune où gisent les âmes mortes n’ayant laissé aucun registre historique de leur passage dans le monde, quelques individualités, d’en répertorier quelques-unes de leurs traces encore tangibles ou dont certains vivants pourraient encore témoigner. Afin de restituer leur parcours terrestre, tout en évitant précautionneusement de les épingler comme étant exemplaires ou emblématiques de quoi que ce soit. Au lecteur d’en tirer ses propres conclusions. Sebald, plutôt qu’interpréter, collige.
Enrichi de supports visuels (photos, dessins, feuillets, manuscrits…), d’images qui parlent quelquefois mieux que toute autre forme de discours, son récit se construit essentiellement à partir de témoignages et d’archives.
Iconographique, son travail documentaire n’exclut pas, en revanche, ni l’empathie, ni l’émotion :
«Si les inscriptions gravées n’étaient pas toutes déchiffrables, les noms encore lisibles – Hambruger, Kissinger, Wertheimer, Friedländer, Arnsberg, Frank, Auerbach, Grunwald, Leuthold, Seeligmann, Hertz, Goldstaud, Baumblatt et Blumenthal – m’inclinèrent à penser que les Allemands n’avaient peut-être rien tant envié aux Juifs que leurs beaux noms, si liés au pays et à la langue dans lesquels ils vivaient. Un frisson me parcourut devant une tombe où reposait Meier Stern, décédé le jour de ma naissance, et de même le symbole de la plume d’oie sur la stèle de Friederike Haldleib, morte le 28 mars 1912, provoqua en moi un trouble dont je dus m’avouer que je ne parviendrais jamais à percer complètement les raisons. Je me l’imaginais écrivain, penchée solitaire et le souffle court sur son travail, et à présent que j’écris ces lignes, il me semble que c’est moi qui l’ai perdue et que la douleur de sa perte reste entière malgré le long temps écoulé depuis sa disparition."
La subjectivité de l’auteur constitue ainsi, une partie essentielle du dispositif et de l’approche du chroniqueur, le tout résultant en un procédé d’autant plus percutant et riche qu’il se fait à contre-courant de la démarche d’investigation consacrée en Histoire : le général et supra-individuel passant ici avant tout par le particulier et l'infra-historique, la valeur du matériel documentaire par la puissance d’évocation émotionnelle que ce dernier recèle.
La démonstration en est d’autant plus pertinente et réussie, ou en tout cas son impact sur le lecteur sera particulièrement saisissant et convaincant de vérité.
Quoiqu’on ait pu prétendre que W. G. («Winfried Georg» – Sebald n’ayant jamais voulu signer in extenso son prénom, considéré par lui comme trop connoté à un univers symbolique nazi..), n'aurait pas été de son vivant spécialement «tendre» envers son pays d’origine, je n'ai, pour ce qui me concerne, jamais retrouvé dans ses livres -tout au moins dans ceux que j’ai eu l’occasion de lire jusqu’à présent-, aucune mise en accusation directe formulée à l’encontre du peuple allemand. Sebald, me semble-t-il, s’en réserve formellement, alors même que son expérience et son parcours personnels auront été marqués, façonnés par le souvenir funeste des crimes commis par le régime nazi, par le panurgisme ou l'indifférence manifestés par ses compatriotes, par les séquelles douloureuses, enfin, qu'aura laissé la destruction morale et matérielle de la nation allemande, reléguant à la fin de la guerre une partie considérable de la mémoire collective au silence et à l’oubli.
Qu’en est-il aujourd’hui ? Y-a-t-il une prescription aux nouvelles générations par rapport à l’effroi provoqué par l’horreur absolue perpétrée dans un passé relativement récent? Combien de temps faudra-t-il, en définitif, aux allemands avant d’avoir terminé d’ouvrir la totalité des archives de guerre, à la fois publiques et collectives, personnelles et généalogiques, et pouvoir envisager enfin, avec une certaine distance et sérénité, leur propre passé ? Cinquante ans ? Un siècle ? Qui dirait mieux ?
L’essentiel de la production littéraire qui fera la renommée de la courte carrière d’écrivain de Sebald, disparu à 57 ans dans un accident de voiture en 2001, avait commencé à prendre corps vers la fin de années 1980, moins de cinquante ans donc après la «destruction». C’est notamment grâce à une reconnaissance internationale que la critique littéraire allemande s'intéressera progressivement à son œuvre à partir du milieu des années 1990..
Comment les nouvelles générations d’allemands feuillètent aujourd’hui d’anciens albums de famille (si tant est qu’il en reste encore beaucoup qui n’aient point été détruits ou expurgés…) ? Et nous-même, partant du principe d’une certaine capacité d'identification à autrui, proprement humaine, pouvons-nous l’espace d’un instant essayer de nous mettre à leur place?
Un humanisme teinté d’empathie et de générosité, son érudition immense et en même temps humble, sa sensibilité délicate, intériorisée et réservée, l’exercice littéraire original et subtil auquel il se livre (qu’il refusait lui-même à considérer comme «romancé», y compris pour ce qui est de son chef-d’œuvre incontestable, «Austerlitz», qui ressemble cependant drôlement à un roman !) : voilà en somme ce qui me touche particulièrement chez lui.
Sebald est devenu avec le temps un de mes auteurs «compagnons-de-route», vers lequel j’éprouve le besoin de revenir régulièrement afin de réentendre une voix qui m’est devenue familière et, malgré la mélancolie susceptible de s’en dégager, qui réconforte.
Voix incitant à pratiquer une sorte de «roman de la mémoire» comme une moyen possible d’apaisement face aux souvenirs douloureux, au temps qui passe indifférent, au caractère instable et éphémère de nos existences.
Un peu comme cette vision insolite qui revient curieusement à différents passages de son livre: celle d'un inconnu qui fait subitement irruption dans le récit, en pleine lumière, image non pas d'un ange qui passe, mais d'un «butterfly man» muni d’un filet à papillons…
Un livre éprouvant mais magistral, important, sur la destruction et la reconstruction de l’Allemagne à la fin la guerre : villes entières bombardées, rasées, vies anéanties, misère, lambeaux de rues et d’hommes…
Sebald se questionne sur l’absence totale de cette destruction dans la littérature allemande : il y a le tabou du « monstre allemand » qui ne peut se constituer comme victime, parce que le sommet de l’Histoire à ce moment-là était la Shoah, et aussi bien sûr la difficulté de prendre la parole pour décrire le traumatisme absolu. Mais surtout l’Allemagne a dû se reconstruire : pour se reconstruire il a fallu refouler cette destruction, de la même manière qu’il a « fallu » « oublier » la Shoah.
Ainsi les écrivains allemands n’ont pas su s’emparer de leur « propre » destruction, ou alors dans une langue convenue, qui ne faisait que masquer l’anéantissement. C’est donc à une réflexion sur la langue, sur la littérature, et sur l’Histoire et ses processus de déconstruction et de reconstruction que nous convie Sebald dans ce grand livre.
Sebald se questionne sur l’absence totale de cette destruction dans la littérature allemande : il y a le tabou du « monstre allemand » qui ne peut se constituer comme victime, parce que le sommet de l’Histoire à ce moment-là était la Shoah, et aussi bien sûr la difficulté de prendre la parole pour décrire le traumatisme absolu. Mais surtout l’Allemagne a dû se reconstruire : pour se reconstruire il a fallu refouler cette destruction, de la même manière qu’il a « fallu » « oublier » la Shoah.
Ainsi les écrivains allemands n’ont pas su s’emparer de leur « propre » destruction, ou alors dans une langue convenue, qui ne faisait que masquer l’anéantissement. C’est donc à une réflexion sur la langue, sur la littérature, et sur l’Histoire et ses processus de déconstruction et de reconstruction que nous convie Sebald dans ce grand livre.
Par cette lecture, je découvre l'écriture de W. G. Sebald, et je me félicite d'avoir lu cet ouvrage dans sa totalité, car il s'agit d'un livre qui se mérite. Je pense d'ailleurs que si je n'étais pas venue à bout du roman "Du côté de chez Swann" de Marcel Proust, j'aurais éprouvé de grandes difficultés à lire Austerlitz. Le roman est déjà épais (environ 350 pages) les caractères assez petits. Les phrases sont souvent longues. Le texte rédigé d'un seul tenant, sans paragraphes ni chapitres. Beaucoup de références littéraires ou historiques; des citations en tchèque, allemand ou anglais (non traduites)... Enfin, la lecture est encore rendue plus complexe par les digressions du principal protagoniste, Austerlitz, et l'introspection qu'il mène. Le sujet est grave, voire dramatique, car l'histoire tourne autour de la shoah, la quête d'une identité, l'implosion de familles, sans compter sur des aspects sordides : spoliation des juifs, ou les machinations terribles des S.S. déportant et massacrant ces populations, hommes, femmes ou enfants. Que de vies brisées! même pour les survivants, pantins déracinés malmenés à jamais par l'existence, victimes de leur passé ou de secrets inavouables.
Un très beau livre, malgré sa noirceur. Une superbe découverte. Une lecture qui laisse des traces. Authentique roman? Biographie? J'ai des doutes, qui sont fondés puisque les photos et illustrations sont présentes en très grand nombre tout au long de l'ouvrage, dès l'illustration de couverture d'ailleurs qui est une photographie issue des archives de l'auteur.
Un très beau livre, malgré sa noirceur. Une superbe découverte. Une lecture qui laisse des traces. Authentique roman? Biographie? J'ai des doutes, qui sont fondés puisque les photos et illustrations sont présentes en très grand nombre tout au long de l'ouvrage, dès l'illustration de couverture d'ailleurs qui est une photographie issue des archives de l'auteur.
Les anneaux de Saturne est une succession de pages superbes, animées d'une authentique curiosité pour tout, cette curiosité communicative qui peut transformer n'importe quel sujet en histoire intéressante, pour peu que l'on ait les mêmes talents de conteur que Sebald. En promeneur il sillonne les landes, les lieux souvent décatis, son regard chargé d'empathie à l'affût des signaux que ces décors envoient depuis d'autres époques ou d'autres horizons. Souvent ce signal se réduit à trois fois rien, un simple détail que seul le curieux de sa trempe aura envie de creuser : une peinture écaillée dévoilant une inscription qui avait disparu sous des coups de pinceaux donnés 100 ans en arrière, le relief curieusement découpé d'un littoral, un parc banal en apparence, etc. Lui y perçoit quelque chose, et à l'acuité des sens succède l'acuité de la plume pour le mettre en mots.
Daniel Mendelsohn, dans Trois Anneaux, un conte d'exil, m'a donné envie de lire Les émigrants.
Les Emigrants, composé de quatre récits autour d' un personnage en exil ayant quitté l'Allemagne. Leurs destins, tragique,s se terminent par la mort, suicide ou la folie. Le narrateur(Sebald lui-même?) vit aussi en errance, exilé en Angleterre. Il suit ses personnages à travers l'Europe, en France, en Suisse, les Etats Unis , et parfois beaucoup plus loin.
Je ne suis pas entrée tout de suite dans le livre.
Le narrateur, à la recherche d'un appartement dans le nord de l'Angleterre, fait la connaissance du Dr Selwyn, un homme tout à fait étrange. Juif originaire de Grodno en Lituanie, Selwyn quitte Grodno avec des émigrants en partance vers l'Amérique qu'il laisse à Londres ; étudie la médecine à Cambridge. Le récit se promène aussi bien dans l'espace que dans le temps, effectue des boucles ( comme les anneaux de Mendelsohn) qui égarent la lectrice. Je ne sais plus qui suivre, le narrateur? les propriétaires de l'appartement, ou Selwyn ? Un nouvel arrivant nous entraîne en Crête pour mon plus grand plaisir mais aussi pour ma grande confusion. Je ne sais plus à qui m'attacher, je m'égare.. Je prends un autre livre plus facile, pensant abandonner Sebald.
Bien m'en a pris de reprendre la lecture des Emigrants.
Je me suis attachée au personnage de Paul Beryter, l'instituteur qui emmène sa classe dans la montagne , siffle en marchant et joue de la clarinette...Quelles belles leçons de choses! Beryter n'est aryen qu'au trois quart, ce quart de juif lui interdit l'enseignement , mais pas l'incorporation dans la Wehrmacht! Nous retrouvons Beryter en France, dans le Jura et en Suisse. Exilé mais toujours fidèle à son village en Allemagne. Sentiments d'allers et retours, puis sans retour.
Ambros Adelwarth est plus énigmatique, il a quitté l'auberge de son père en Allemagne pour devenir garçon d'étage dans un hôtel prestigieux de Montreux, être initié à "tous les secrets de la vie hôtelière", et aux langues étrangères. Majordome stylé, il a accompagné un ambassadeur jusqu'au Japon en passant par Copenhague, Riga, Moscou et la Sibérie. Majordome d'un magnat américain, il hante les casinos de Deauville, visite Constantinople et Jérusalem. Nous suivons donc ce personnage dans ses périples et dans ses châteaux aux Etats Unis. Mais comme Sebald n'écrit pas un récit linéaire, il s'attarde à nous raconter les histoires de famille. Je me laisse porter, ayant accepté le principe des digressions (écriture circulaire de Mendelsohn). Je profite des descriptions des lieux, des rencontres fortuites. Ne pas être pressé par l'action, prendre son temps, profiter de tous les détails.
Selon ce principe énoncé ci-dessus, je profite de la découverte d' un Manchester singulier où se déroule une partie de l'histoire du peintre Max Ferber, fils d'un collectionneur d'art juif bavarois venu à Manchester en 1943. Peintre casanier d'une oeuvre obscure, malgré sa répugnance au voyage, nous offre une excursion à Colmar voir les tableaux de Grünewald puis en Suisse. Mais tout serait trop simple, une histoire allemande se greffe....
Un très beau moment de lecture, nostalgique, pittoresque, auquel il faut s'abandonner sans chercher trop d'action ou de cohérence.
Lien : https://netsdevoyages.car.blog
Les Emigrants, composé de quatre récits autour d' un personnage en exil ayant quitté l'Allemagne. Leurs destins, tragique,s se terminent par la mort, suicide ou la folie. Le narrateur(Sebald lui-même?) vit aussi en errance, exilé en Angleterre. Il suit ses personnages à travers l'Europe, en France, en Suisse, les Etats Unis , et parfois beaucoup plus loin.
Je ne suis pas entrée tout de suite dans le livre.
Le narrateur, à la recherche d'un appartement dans le nord de l'Angleterre, fait la connaissance du Dr Selwyn, un homme tout à fait étrange. Juif originaire de Grodno en Lituanie, Selwyn quitte Grodno avec des émigrants en partance vers l'Amérique qu'il laisse à Londres ; étudie la médecine à Cambridge. Le récit se promène aussi bien dans l'espace que dans le temps, effectue des boucles ( comme les anneaux de Mendelsohn) qui égarent la lectrice. Je ne sais plus qui suivre, le narrateur? les propriétaires de l'appartement, ou Selwyn ? Un nouvel arrivant nous entraîne en Crête pour mon plus grand plaisir mais aussi pour ma grande confusion. Je ne sais plus à qui m'attacher, je m'égare.. Je prends un autre livre plus facile, pensant abandonner Sebald.
Bien m'en a pris de reprendre la lecture des Emigrants.
Je me suis attachée au personnage de Paul Beryter, l'instituteur qui emmène sa classe dans la montagne , siffle en marchant et joue de la clarinette...Quelles belles leçons de choses! Beryter n'est aryen qu'au trois quart, ce quart de juif lui interdit l'enseignement , mais pas l'incorporation dans la Wehrmacht! Nous retrouvons Beryter en France, dans le Jura et en Suisse. Exilé mais toujours fidèle à son village en Allemagne. Sentiments d'allers et retours, puis sans retour.
Ambros Adelwarth est plus énigmatique, il a quitté l'auberge de son père en Allemagne pour devenir garçon d'étage dans un hôtel prestigieux de Montreux, être initié à "tous les secrets de la vie hôtelière", et aux langues étrangères. Majordome stylé, il a accompagné un ambassadeur jusqu'au Japon en passant par Copenhague, Riga, Moscou et la Sibérie. Majordome d'un magnat américain, il hante les casinos de Deauville, visite Constantinople et Jérusalem. Nous suivons donc ce personnage dans ses périples et dans ses châteaux aux Etats Unis. Mais comme Sebald n'écrit pas un récit linéaire, il s'attarde à nous raconter les histoires de famille. Je me laisse porter, ayant accepté le principe des digressions (écriture circulaire de Mendelsohn). Je profite des descriptions des lieux, des rencontres fortuites. Ne pas être pressé par l'action, prendre son temps, profiter de tous les détails.
Selon ce principe énoncé ci-dessus, je profite de la découverte d' un Manchester singulier où se déroule une partie de l'histoire du peintre Max Ferber, fils d'un collectionneur d'art juif bavarois venu à Manchester en 1943. Peintre casanier d'une oeuvre obscure, malgré sa répugnance au voyage, nous offre une excursion à Colmar voir les tableaux de Grünewald puis en Suisse. Mais tout serait trop simple, une histoire allemande se greffe....
Un très beau moment de lecture, nostalgique, pittoresque, auquel il faut s'abandonner sans chercher trop d'action ou de cohérence.
Lien : https://netsdevoyages.car.blog
Kolossal ennui, kolossale rigolade à la lecture des critiques.
Je ne conseillerai certainement pas à un lecteur curieux d'approcher l'oeuvre de Sebald de commencer par la lecture de ce livre. Personnellement, si je n'avais pas lu d'abord « Austerlitz », que je considère par ailleurs un chef d'oeuvre absolu, j'aurais sûrement moins apprécié « Les Anneaux de Saturne ».
Objet littéraire non-identifié, hybride pour ce qui est de la forme, ni roman, ni essai, on a ici d'emblée l'impression de parcourir, sans pouvoir en saisir forcément un fil conducteur, un sorte de recueil de notes personnelles de l'auteur, composées essentiellement de certaines de ses recherches documentaires, de souvenirs de ses amis, de souvenirs de voyage et de quelques rencontres fortuites restées en mémoire.
Les Anneaux de Saturne n'est à mon sens ni un roman, ni un essai, mais plutôt le récit d'une expérience vécue. Issu des déambulations à pied de l'auteur dans la côte est de l'Angleterre au mois d'août 1992, Sebald se laisse aller, à la faveur de ce périple, à un va et vient incessant dans l'espace et dans le temps, à partir des lieux et monuments visités eux-mêmes, le circuit réalisé devenant ici la source même du matériau littéraire et du développement de sa narration. Ainsi, parce qu'il croise sur son chemin le pont de Blyth - construit au XIXèmè siècle pour la circulation d'une ligne ferroviaire dont les wagons étaient à l'époque marqués d'un étrange « dragon enveloppé des vapeurs produites par son haleine » et identique en tous points à l'image de l'animal héraldique de la Chine Impériale -, Sebald nous emmène faire un détour en Chine et, par le récit de la lente dissolution de l'Empire du Milieu initiée au dix-neuvième siècle, nous apprend que les wagons qui traversaient jadis la Blyth qu'il contemple là en ce moment, étaient en fait au départ destinées à la Cité Interdite !
Empreint de poésie délicate, mélancolique et tout en filigrane, cet ouvrage, malgré un aspect en surface décousu et anecdotique, est avant tout un miroir reflétant l'âme de son auteur, même si celui-ci n'y livre guère d'éléments véritablement autobiographiques et que tout reste en fin de compte extrêmement factuel... Parmi les nombreuses références que l'on retrouve au fil de ce voyage très personnel de Sebald dans les anneaux du temps, il y en a une (issue d'Orbis Tertuis), qui pourrait à mon sens, illustrer bien le travail de mémoire qui parcourt toute son oeuvre: «..le futur n'a d'autre réalité que notre peur ou notre espérance présente, tandis que le passé n'est que ce qu'il y a dans notre mémoire».
Objet littéraire non-identifié, hybride pour ce qui est de la forme, ni roman, ni essai, on a ici d'emblée l'impression de parcourir, sans pouvoir en saisir forcément un fil conducteur, un sorte de recueil de notes personnelles de l'auteur, composées essentiellement de certaines de ses recherches documentaires, de souvenirs de ses amis, de souvenirs de voyage et de quelques rencontres fortuites restées en mémoire.
Les Anneaux de Saturne n'est à mon sens ni un roman, ni un essai, mais plutôt le récit d'une expérience vécue. Issu des déambulations à pied de l'auteur dans la côte est de l'Angleterre au mois d'août 1992, Sebald se laisse aller, à la faveur de ce périple, à un va et vient incessant dans l'espace et dans le temps, à partir des lieux et monuments visités eux-mêmes, le circuit réalisé devenant ici la source même du matériau littéraire et du développement de sa narration. Ainsi, parce qu'il croise sur son chemin le pont de Blyth - construit au XIXèmè siècle pour la circulation d'une ligne ferroviaire dont les wagons étaient à l'époque marqués d'un étrange « dragon enveloppé des vapeurs produites par son haleine » et identique en tous points à l'image de l'animal héraldique de la Chine Impériale -, Sebald nous emmène faire un détour en Chine et, par le récit de la lente dissolution de l'Empire du Milieu initiée au dix-neuvième siècle, nous apprend que les wagons qui traversaient jadis la Blyth qu'il contemple là en ce moment, étaient en fait au départ destinées à la Cité Interdite !
Empreint de poésie délicate, mélancolique et tout en filigrane, cet ouvrage, malgré un aspect en surface décousu et anecdotique, est avant tout un miroir reflétant l'âme de son auteur, même si celui-ci n'y livre guère d'éléments véritablement autobiographiques et que tout reste en fin de compte extrêmement factuel... Parmi les nombreuses références que l'on retrouve au fil de ce voyage très personnel de Sebald dans les anneaux du temps, il y en a une (issue d'Orbis Tertuis), qui pourrait à mon sens, illustrer bien le travail de mémoire qui parcourt toute son oeuvre: «..le futur n'a d'autre réalité que notre peur ou notre espérance présente, tandis que le passé n'est que ce qu'il y a dans notre mémoire».
Le titre originel de l'ouvrage est "Guerre aérienne et littérature", et il est fort peu question d'histoire naturelle, comme le titre français le laisse supposer. Les trois conférences données à Zurich par l'auteur, abordent un problème littéraire, et non pas historique, qui se résume en ces termes : ... "un peuple de 90 millions d'habitants naguère loué pour être celui des poètes et des penseurs et qui a subi la pire des catastrophes de son histoire récente en voyant ses villes effacées de la carte et sa population expulsée par millions. Il est difficile de croire que ces événements n'aient pas trouvé un puissant écho littéraire. Ils l'ont trouvé, certes. Mais rares sont les textes qui ont été publiés - ils sont restés à l'état de littérature de tiroir. Qui d'autre que les médias a érigé ce mur de tabou (...) et continue à cimenter et colmater ?" (p. 89, citation de Gerhard Keppner). Donc W. G. Sebald examine ce problème littéraire intéressant, et retrace le travail de refoulement du souvenir des grands bombardements sur l'Allemagne pendant les années de guerre. Outre les nécessités politiques du temps et l'ouvrage des médias, Sebald évoque aussi la difficulté que rencontrent les victimes à faire face à leurs traumatismes et à les formuler. Les écrivains allemands, dont c'est un peu la vocation (exprimer sous forme littéraire ce que vivent les gens, sans kitsch ni mensonge) ont failli, de l'avis de l'auteur. La tâche n'est pas facilitée par l'énorme culpabilité qui a pesé sur les Allemands, qui savent bien, dit Sebald, qu'ils sont en grande partie responsables de ce qui leur est arrivé. Malheureusement, les Anglo-Américains, très sûrs de leur bon droit, n'ont pas eu de remords avec leur propres atrocités : ils ont vite changé leur victoire militaire en victoire morale, en oubliant qu'ils avaient totalement abandonné les Juifs d'Europe à leur sort.
Une étude sur le cas d'Alfred Andersch conclut cet essai littéraire. le cas Andersch résume bien à lui seul tout l'inconfort de la situation. L'intellectuel allemand doit se justifier (d'abord à ses propres yeux) de ses actes (ou de sa passivité) sous le nazisme, il lui faut ensuite, comme il peut, se dénazifier, et se construire une personnalité esthétique. Cela requiert honnêteté et droiture : art et morale ne sont pas séparables. Andersch a échoué sur tous ces plans, et l'étude de son cas est instructive.
La lecture de ces conférences m'a rappelé deux livres brillants écrits sur un problème analogue, par David G. Roskies : "Against the Apocalypse, responses to catastrophe in modern Jewish culture" (1984), et par Alan Mintz : "Hurban, Responses to catastrophe in Hebrew Literature" (1996). Ils seront sans doute traduits en français quand le Messie viendra.
Une étude sur le cas d'Alfred Andersch conclut cet essai littéraire. le cas Andersch résume bien à lui seul tout l'inconfort de la situation. L'intellectuel allemand doit se justifier (d'abord à ses propres yeux) de ses actes (ou de sa passivité) sous le nazisme, il lui faut ensuite, comme il peut, se dénazifier, et se construire une personnalité esthétique. Cela requiert honnêteté et droiture : art et morale ne sont pas séparables. Andersch a échoué sur tous ces plans, et l'étude de son cas est instructive.
La lecture de ces conférences m'a rappelé deux livres brillants écrits sur un problème analogue, par David G. Roskies : "Against the Apocalypse, responses to catastrophe in modern Jewish culture" (1984), et par Alan Mintz : "Hurban, Responses to catastrophe in Hebrew Literature" (1996). Ils seront sans doute traduits en français quand le Messie viendra.
Dans une jambe amputée, le cerveau continue à envoyer des sensations-fantômes.
Dans la vie de son double, un jumeau prématurément disparu déploie l'ombre de la mort à jamais.
On a beau la fuir, une histoire traumatique finit toujours par ressurgir à l'instar des réflexes douloureux qui jaillissent dans le membre amputé.
C'est ce qui nous (ré)apprennent les vagues de souvenirs enfuis de Jacques Austerlitz, « Juif errant » hanté par des sensations-fantômes et par l'ombre de la mort, dans le superbe livre de W.G. Sebald.
Lecture contrariante, aussi belle qu'exigeante, s'adressant à l'inconscient du lecteur plutôt qu'à sa raison, et l'emportant dans des tourbillons d'associations et de signes qui se font et se défont dans une dynamique liquide.
Un narrateur admiratif (exécuteur testamentaire en ordre symbolique) nous donne à lire le processus tardif (et demeurant fictif, car en grande partie impossible) de recouvrement de la mémoire chez un orphelin de guerre. La conscience de sa judaïcité, redécouverte à l'âge adulte, et les échos embrumés de la petite enfance se réveillent chez Austerlitz en lien avec l'art et l'image, à travers le sentiment d'appartenance à un patrimoine partagé, qui semble nourrir l'illusion indispensable de toute reformulation du soi.
La culture servant de béquille pour un vécu devenu inaccessible, on suit la pensée d'Austerlitz opérant à travers un regard érudit, qui caresse les surfaces et les volumes, s'attarde sur toutes les catégories du vivant, sur leurs empreintes, leurs épaves et leurs traces pour y extraire des souvenirs lointains, émiettés, voire chimériques, du passé. Discours déployés dans des espaces magnifiés ; paysages dé-réalisés ; tissus urbains révélant leur étrangeté poétique ; le regard des animaux enfermés dans leurs cages de zoo ; les récits des autres, témoins de la disparition de ses parents ; dans la lecture d'Austerlitz, le monde gagne l'allure inquiétante d'un artefact guetté par la décrépitude et le chagrin.
L'art gothique codifiait le dogme, le traduisant en géométrie architecturale ; Sebald réussit à développer fastueusement toute une topographie subjective afin de dire l'Absence : « Aussi loin que je puisse revenir en arrière, dit Austerlitz, j'ai toujours eu le sentiment de ne pas avoir de place dans la réalité, de ne pas avoir d'existence » (p. 219). « Il ne m'était visiblement pas d'un grand secours d'avoir découvert les sources de ma perturbation ni d'être capable de me voir moi-même avec la plus grande acuité, tout au long de ces années révolues, en petit garçon coupé du jour au lendemain de sa vie familière : la raison ne prenait pas l'ascendant sur le sentiment d'avoir été rejeté et effacé de la vie » (p. 271).
A travers la figure d'Austerlitz, en quête de son histoire occultée par L Histoire, Sebald nous offre une véritable phénoménologie de la mémoire traumatique et du souvenir refoulé, ennoblie d'un éclat pathologique qui confère à son personnage l'aura d'un prince Myshkin et le place dans la généalogie romantique des innocents maudits.
L'écriture qui brouille les frontières des genres littéraires (« Austerlitz » est un mélange d'essai, de témoignage, de confession et de carnet de voyage nous évoquant Balzac et Stendhal, Proust, Kafka et Perec...), sert à perfection la description de cet univers fluctuant, changeant, incompréhensible, manquant de fondation : le monde d'Austerlitz et tout autant le nôtre...
Car tout le savoir du monde ne saurait racheter la chaleur d'une famille perdue et des parents disparus :
« Plusieurs fois il est également arrivé, dit Austerlitz, que des oiseaux égarés dans la forêt de la Bibliothèque aient foncé sur les arbres se reflétant dans les vitres et soient tombés raides morts après un choc sourd. Assis à ma place dans la salle de lecture, j'ai souvent réfléchi au lien qui existe entre de tels accidents imprévisibles, comme la chute mortelle d'une créature qui s'est écartée de sa voie naturelle ou encore les symptômes récurrents de paralysie affectant le réseau informatique, d'une part, et la conception d'ensemble, cartésienne, de la Bibliothèque nationale, de l'autre ; et j'en suis arrivé à la conclusion que dans chacun des projets élaborés et développés par nous, la taille et le degré de complexité des systèmes d'information et de contrôle qu'on y adjoint sont les facteurs décisifs, et qu'en conséquence la perfection exhaustive et absolue du concept peut tout à fait aller, et même, pour finir, va nécessairement de pair avec un dysfonctionnement chronique et une fragilité inhérente. Pour ce qui me concerne, du moins, moi qui ai consacré une grande partie de ma vie à étudier dans les livres et me sens presque comme chez moi à la Bodleian, au British Museum et dans la rue de Richelieu, cette gigantesque nouvelle Bibliothèque censée être, selon une expression horrible qui maintenant fait florès, le sanctuaire de tout notre patrimoine écrit, a prouvé son inutilité dans l'enquête que j'effectuais pour retrouver les traces de mon père qui se perdent à Paris » (pp. 328-329).
Dans la vie de son double, un jumeau prématurément disparu déploie l'ombre de la mort à jamais.
On a beau la fuir, une histoire traumatique finit toujours par ressurgir à l'instar des réflexes douloureux qui jaillissent dans le membre amputé.
C'est ce qui nous (ré)apprennent les vagues de souvenirs enfuis de Jacques Austerlitz, « Juif errant » hanté par des sensations-fantômes et par l'ombre de la mort, dans le superbe livre de W.G. Sebald.
Lecture contrariante, aussi belle qu'exigeante, s'adressant à l'inconscient du lecteur plutôt qu'à sa raison, et l'emportant dans des tourbillons d'associations et de signes qui se font et se défont dans une dynamique liquide.
Un narrateur admiratif (exécuteur testamentaire en ordre symbolique) nous donne à lire le processus tardif (et demeurant fictif, car en grande partie impossible) de recouvrement de la mémoire chez un orphelin de guerre. La conscience de sa judaïcité, redécouverte à l'âge adulte, et les échos embrumés de la petite enfance se réveillent chez Austerlitz en lien avec l'art et l'image, à travers le sentiment d'appartenance à un patrimoine partagé, qui semble nourrir l'illusion indispensable de toute reformulation du soi.
La culture servant de béquille pour un vécu devenu inaccessible, on suit la pensée d'Austerlitz opérant à travers un regard érudit, qui caresse les surfaces et les volumes, s'attarde sur toutes les catégories du vivant, sur leurs empreintes, leurs épaves et leurs traces pour y extraire des souvenirs lointains, émiettés, voire chimériques, du passé. Discours déployés dans des espaces magnifiés ; paysages dé-réalisés ; tissus urbains révélant leur étrangeté poétique ; le regard des animaux enfermés dans leurs cages de zoo ; les récits des autres, témoins de la disparition de ses parents ; dans la lecture d'Austerlitz, le monde gagne l'allure inquiétante d'un artefact guetté par la décrépitude et le chagrin.
L'art gothique codifiait le dogme, le traduisant en géométrie architecturale ; Sebald réussit à développer fastueusement toute une topographie subjective afin de dire l'Absence : « Aussi loin que je puisse revenir en arrière, dit Austerlitz, j'ai toujours eu le sentiment de ne pas avoir de place dans la réalité, de ne pas avoir d'existence » (p. 219). « Il ne m'était visiblement pas d'un grand secours d'avoir découvert les sources de ma perturbation ni d'être capable de me voir moi-même avec la plus grande acuité, tout au long de ces années révolues, en petit garçon coupé du jour au lendemain de sa vie familière : la raison ne prenait pas l'ascendant sur le sentiment d'avoir été rejeté et effacé de la vie » (p. 271).
A travers la figure d'Austerlitz, en quête de son histoire occultée par L Histoire, Sebald nous offre une véritable phénoménologie de la mémoire traumatique et du souvenir refoulé, ennoblie d'un éclat pathologique qui confère à son personnage l'aura d'un prince Myshkin et le place dans la généalogie romantique des innocents maudits.
L'écriture qui brouille les frontières des genres littéraires (« Austerlitz » est un mélange d'essai, de témoignage, de confession et de carnet de voyage nous évoquant Balzac et Stendhal, Proust, Kafka et Perec...), sert à perfection la description de cet univers fluctuant, changeant, incompréhensible, manquant de fondation : le monde d'Austerlitz et tout autant le nôtre...
Car tout le savoir du monde ne saurait racheter la chaleur d'une famille perdue et des parents disparus :
« Plusieurs fois il est également arrivé, dit Austerlitz, que des oiseaux égarés dans la forêt de la Bibliothèque aient foncé sur les arbres se reflétant dans les vitres et soient tombés raides morts après un choc sourd. Assis à ma place dans la salle de lecture, j'ai souvent réfléchi au lien qui existe entre de tels accidents imprévisibles, comme la chute mortelle d'une créature qui s'est écartée de sa voie naturelle ou encore les symptômes récurrents de paralysie affectant le réseau informatique, d'une part, et la conception d'ensemble, cartésienne, de la Bibliothèque nationale, de l'autre ; et j'en suis arrivé à la conclusion que dans chacun des projets élaborés et développés par nous, la taille et le degré de complexité des systèmes d'information et de contrôle qu'on y adjoint sont les facteurs décisifs, et qu'en conséquence la perfection exhaustive et absolue du concept peut tout à fait aller, et même, pour finir, va nécessairement de pair avec un dysfonctionnement chronique et une fragilité inhérente. Pour ce qui me concerne, du moins, moi qui ai consacré une grande partie de ma vie à étudier dans les livres et me sens presque comme chez moi à la Bodleian, au British Museum et dans la rue de Richelieu, cette gigantesque nouvelle Bibliothèque censée être, selon une expression horrible qui maintenant fait florès, le sanctuaire de tout notre patrimoine écrit, a prouvé son inutilité dans l'enquête que j'effectuais pour retrouver les traces de mon père qui se perdent à Paris » (pp. 328-329).
« Cette paralysie de ma mémoire persista encore, une fois que monté à la galerie supérieure j'observai, pris d'incessantes bouffées de vertige, le panorama assombri par la brume de cette ville qui m'était devenue complètement étrangère. Là où aurait dû surgir le nom de Milan, il n'y avait rien qu'un douloureux réflexe d'impuissance. »
Paru en 1990, ce livre de W.G. Sebald, est, comme à son habitude, inclassable. S'il contient bien des éléments probablement autobiographiques, et, là encore des photos, illustrations, traces des voyages évoqués, il me semble qu'ici l'auteur est davantage dans la recréation d'un univers fantasmatique, notamment autour de figures littéraires. Stendhal est au centre du premier texte intitulé « Beyle ou le singulier phénomène de l'amour ». Mais on retrouvera également Kafka.
Deux voyages distincts, entrepris par Sebald en 1980 et 1987, marqués par l'angoisse et ce qui semble bien être des hallucinations, occupent la narration des textes suivants. L'auteur voyage entre le nord de l'Italie (Venise, Milan, Vérone, la région du lac de Garde), le Tyrol et revient aussi dans le village allemand où il avait passé son enfance, seulement désigné comme « W ».
Je suis sensible au style qu'avait W.G. Sebald dans ses écrits. Je peux comprendre que ce ne soit pas le cas pour beaucoup, car l'abord de ses livres n'est pas forcément évident. Une fois encore, j'ai eu l'impression que ce «Vertiges» était pour moi. Trop tôt disparu, l'auteur n'a pas laissé une oeuvre quantitativement énorme mais qui vaut d'être découverte, en commençant peut-être par «Les anneaux de Saturne».
Paru en 1990, ce livre de W.G. Sebald, est, comme à son habitude, inclassable. S'il contient bien des éléments probablement autobiographiques, et, là encore des photos, illustrations, traces des voyages évoqués, il me semble qu'ici l'auteur est davantage dans la recréation d'un univers fantasmatique, notamment autour de figures littéraires. Stendhal est au centre du premier texte intitulé « Beyle ou le singulier phénomène de l'amour ». Mais on retrouvera également Kafka.
Deux voyages distincts, entrepris par Sebald en 1980 et 1987, marqués par l'angoisse et ce qui semble bien être des hallucinations, occupent la narration des textes suivants. L'auteur voyage entre le nord de l'Italie (Venise, Milan, Vérone, la région du lac de Garde), le Tyrol et revient aussi dans le village allemand où il avait passé son enfance, seulement désigné comme « W ».
Je suis sensible au style qu'avait W.G. Sebald dans ses écrits. Je peux comprendre que ce ne soit pas le cas pour beaucoup, car l'abord de ses livres n'est pas forcément évident. Une fois encore, j'ai eu l'impression que ce «Vertiges» était pour moi. Trop tôt disparu, l'auteur n'a pas laissé une oeuvre quantitativement énorme mais qui vaut d'être découverte, en commençant peut-être par «Les anneaux de Saturne».
Ce livre est acclamé, c'est un chef-d'oeuvre...
Je suis complètement passée à côté.
L'auteur écrit très bien, il rend les faits historiques dont il parle vivants et passionnants. Mais c'est juste que je m'attendais à lire une "histoire" et là j'ai plus l'impression d'avoir lu un livre d'histoire voire un essai.
Au fil de ses pensées, de ses pérégrinations et de ses rencontres, il évoque la vie de tel auteur, tel navigateur, les guerres, la nature... Il a un réel don de conteur.
Mais je n'ai pas accroché....Les faits historiques s'enchaînaient et je restais insensible...
Lien : https://www.labullederealita..
Je suis complètement passée à côté.
L'auteur écrit très bien, il rend les faits historiques dont il parle vivants et passionnants. Mais c'est juste que je m'attendais à lire une "histoire" et là j'ai plus l'impression d'avoir lu un livre d'histoire voire un essai.
Au fil de ses pensées, de ses pérégrinations et de ses rencontres, il évoque la vie de tel auteur, tel navigateur, les guerres, la nature... Il a un réel don de conteur.
Mais je n'ai pas accroché....Les faits historiques s'enchaînaient et je restais insensible...
Lien : https://www.labullederealita..
Campo Santo se divise en deux parties dont on peine à comprendre le lien. La première rassemble quelques nouvelles ayant pour décor la Corse : promenade à Ajaccio où tout semble se rapporter à Napoléon, description du cimetière de Piana et digression de l'auteur sur les croyances et le rapport à la mort des Corses, ou encore éloge de la forêt de Bavella qui suscite des souvenirs germaniques au narrateur...
La deuxième partie s'ouvre elle sur une quinzaine d'essai traitant tous d'écrivains allemands, que je ne connaissais pas pour la plupart (Handke, Améry...Grass, Kafka et Nabokov pour les plus connus). On y retrouve des observations propres à Sebald sur l'après-guerre et la culpabilité allemande face aux atrocités commises, ainsi que la quasi absence de cette thématique dans la littérature allemande.
Corpus finalement très curieux, je retiens surtout de cette succession d'essai une désagréable impression de dérive intellectuelle constante de l'auteur au détriment de toute narration : les propos sont intéressants mais soporifiques, tant par les remarques fleuve de Sebald que par leur caractère analytique sous un prisme académique.
Ajoutons à cela que je ne suis pas une grande amatrice de la littérature allemande, et que j'ai trouvé la mise-en-page barbare : il m'a fallu m'accrocher pour parvenir à terminer ce bouquin pourtant pas si épais...Une première rencontre peu concluante avec Sebald !
La deuxième partie s'ouvre elle sur une quinzaine d'essai traitant tous d'écrivains allemands, que je ne connaissais pas pour la plupart (Handke, Améry...Grass, Kafka et Nabokov pour les plus connus). On y retrouve des observations propres à Sebald sur l'après-guerre et la culpabilité allemande face aux atrocités commises, ainsi que la quasi absence de cette thématique dans la littérature allemande.
Corpus finalement très curieux, je retiens surtout de cette succession d'essai une désagréable impression de dérive intellectuelle constante de l'auteur au détriment de toute narration : les propos sont intéressants mais soporifiques, tant par les remarques fleuve de Sebald que par leur caractère analytique sous un prisme académique.
Ajoutons à cela que je ne suis pas une grande amatrice de la littérature allemande, et que j'ai trouvé la mise-en-page barbare : il m'a fallu m'accrocher pour parvenir à terminer ce bouquin pourtant pas si épais...Une première rencontre peu concluante avec Sebald !
Un chef-d'oeuvre absolu : que dire de plus?
C’est un grand plaisir que cette écriture remplie de passés et de subjonctifs, nostalgique et légèrement désuette qui évoque des drames de vies singulières.
Dans ce roman de non-fiction, on pense à la Mystérieuse flamme de la reine Loana d'Umberto Eco pour la forme, et pour la trame, à Danube de Claudio Magris et bien sûr à L'histoire des grands-parents que je n'ai pas eus d'Ivan Jablonka. A noter l'amusante critique de la bibliothèque François Mitterrand.
Pour moi,c’est le plus grand écrivain du XX siècle !
Tout est à lire, à relire, à relire encore et sans fin, dans l’œuvre captivante de W.G. Sebald (1944-2001), où se mêlent étroitement fiction et réalité, narration et méditation, autour des thèmes de l’exil et de la destruction.
Lien : https://www.telerama.fr/livr..
Lien : https://www.telerama.fr/livr..
Etrange texte où l'auteur au fil d'une errance dans l'est de l'Angleterre plonge dans son passé propre mais aussi dans l'histoire grande ou petite . Le texte contient des illustrations .... Trés plaisant à lire .
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur
Auteurs proches de W. G. Sebald
Quiz
Voir plus
Acteur et chanteur
Pour commencer, question facile ! Il a chanté : "Félicie aussi". Au cinéma, il a incarné Don Camillo.
Louis de Funès
Fernandel
Bourvil
Louis Jouvet
10 questions
436 lecteurs ont répondu
Thèmes :
cinema
, chanson
, personnagesCréer un quiz sur cet auteur436 lecteurs ont répondu