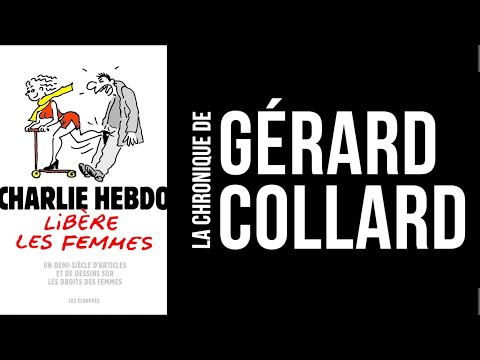Jean-Marc Parisis/5
14 notes
Résumé :
« C est chez Dayen que j avais ressenti les premiers signes d une déprise, d un départ j ignorais alors qu il serait précédé de beaucoup d autres. Un accablement, une aversion soudaine pour le décor, le décor humain j entends, car il y avait un piano. Qu est-ce que mon corps autrement dit ce qu il me restait de ma vie faisait là ? »
Qui est François Novel ? Un homme qui vit d écrire, un homme libre, qui entend bien le rester. Un événement dramatique v... >Voir plus
Qui est François Novel ? Un homme qui vit d écrire, un homme libre, qui entend bien le rester. Un événement dramatique v... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après La recherche de la couleurVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (3)
Ajouter une critique
Critique réalisée dans le cadre du Challenge de la rentrée littéraire 2012
La lecture de ce roman d'un auteur inconnu pour moi m'a laissée circonspecte.
Ma première impression a été plutôt favorable devant un style visiblement travaillé, original, inattendu, surprenant, qui laissait augurer de grands moments de plaisir.
Pourtant, au fil des pages, mon enthousiasme s'est émoussé. Toujours charmée par des formules percutantes, une écriture ironique et féroce, j'ai ressenti un malaise occasionné par ce qui m'est apparu très vite comme un défaut qui allait ternir ma lecture : au fil des pages, l'écrivain prend toute la place, je veux dire en cela que l'histoire qu'il raconte n'a pas l'épaisseur suffisante pour nous embarquer.
Par ailleurs, lisant rarement ce que l'on pourrait appeler un peu hâtivement « les auteurs français en vogue », j'ai été frappée de retrouver le même contexte géographique et social que dans le livre « Les désaxés » de C. Angot que j'ai lu en suivant. Les personnages sont des « créatifs » bobos, vivant à Saint-Germain-des-Prés, faussement dans le besoin, côtoyant une faune de parasites du monde médiatico-journalistique, et, ce qui m'agace encore davantage, j'ai retrouvé nombre de petites remarques condescendantes à l'égard de ce que les parisiens appellent « la province ». (On peut me rétorquer que c'est le personnage qui s'exprime, mais, pardon pour cette digression, il se trouve qu'à la faveur d'un zapping sur le Grand Journal de la chaîne « branchée » Canal +, j'ai retrouvé ce même ton condescendant, et qu'il me semble tout à fait représentatif de ce qu'on appelle la fracture sociale… fin de la digression).
Les personnages que décrit Jean-Marc Parisis ne manquent pas de pittoresque, il a réellement le sens de la formule qui fait mouche et qui fait rire, mais l'histoire ne décolle pas. J'ai eu le sentiment de scènes accolées les unes aux autres un peu artificiellement, bien écrites, mais au détriment de tout ressort dramatique et avancée de l'action, ce qui me paraît tout de même dommageable en fin de compte. L'auteur insère également de longs paragraphes de commentaires culturels (David Bowie, Marylin Monroe…) tout à fait intéressants mais qui n'apportent rien et pourraient être bien mieux mis en valeur dans un autre livre. Ici, ils ne sont pas à leur place, même indéniablement pertinents et originaux.
Pour dire les choses un peu durement, j'ai eu le sentiment que l'auteur se regardait écrire, et que ce manque d'humilité tue les personnages, que l'on oublie très vite. Qu'ai-je retenu de l'intrigue ? Un quinquagénaire journaliste culturel en crise après la mort de la seule femme qu'il ait aimée, sa « renaissance » dans les bras d'une jeune femme de vingt ans. Peu d'épaisseur psychologique, on a l'impression que l'auteur n'avait aucune motivation à développer les manifestations de la vie concrète pour privilégier une joute verbale avec lui-même, intelligente, brillante, mais au bout du compte un peu stérile. Je suis peut-être réactionnaire, mais j'aime que l'on me raconte des histoires, visualiser les personnages, vibrer avec eux. Pour les conversations brillantes, j'ai des amis qui me donnent entière satisfaction.
La lecture de ce roman d'un auteur inconnu pour moi m'a laissée circonspecte.
Ma première impression a été plutôt favorable devant un style visiblement travaillé, original, inattendu, surprenant, qui laissait augurer de grands moments de plaisir.
Pourtant, au fil des pages, mon enthousiasme s'est émoussé. Toujours charmée par des formules percutantes, une écriture ironique et féroce, j'ai ressenti un malaise occasionné par ce qui m'est apparu très vite comme un défaut qui allait ternir ma lecture : au fil des pages, l'écrivain prend toute la place, je veux dire en cela que l'histoire qu'il raconte n'a pas l'épaisseur suffisante pour nous embarquer.
Par ailleurs, lisant rarement ce que l'on pourrait appeler un peu hâtivement « les auteurs français en vogue », j'ai été frappée de retrouver le même contexte géographique et social que dans le livre « Les désaxés » de C. Angot que j'ai lu en suivant. Les personnages sont des « créatifs » bobos, vivant à Saint-Germain-des-Prés, faussement dans le besoin, côtoyant une faune de parasites du monde médiatico-journalistique, et, ce qui m'agace encore davantage, j'ai retrouvé nombre de petites remarques condescendantes à l'égard de ce que les parisiens appellent « la province ». (On peut me rétorquer que c'est le personnage qui s'exprime, mais, pardon pour cette digression, il se trouve qu'à la faveur d'un zapping sur le Grand Journal de la chaîne « branchée » Canal +, j'ai retrouvé ce même ton condescendant, et qu'il me semble tout à fait représentatif de ce qu'on appelle la fracture sociale… fin de la digression).
Les personnages que décrit Jean-Marc Parisis ne manquent pas de pittoresque, il a réellement le sens de la formule qui fait mouche et qui fait rire, mais l'histoire ne décolle pas. J'ai eu le sentiment de scènes accolées les unes aux autres un peu artificiellement, bien écrites, mais au détriment de tout ressort dramatique et avancée de l'action, ce qui me paraît tout de même dommageable en fin de compte. L'auteur insère également de longs paragraphes de commentaires culturels (David Bowie, Marylin Monroe…) tout à fait intéressants mais qui n'apportent rien et pourraient être bien mieux mis en valeur dans un autre livre. Ici, ils ne sont pas à leur place, même indéniablement pertinents et originaux.
Pour dire les choses un peu durement, j'ai eu le sentiment que l'auteur se regardait écrire, et que ce manque d'humilité tue les personnages, que l'on oublie très vite. Qu'ai-je retenu de l'intrigue ? Un quinquagénaire journaliste culturel en crise après la mort de la seule femme qu'il ait aimée, sa « renaissance » dans les bras d'une jeune femme de vingt ans. Peu d'épaisseur psychologique, on a l'impression que l'auteur n'avait aucune motivation à développer les manifestations de la vie concrète pour privilégier une joute verbale avec lui-même, intelligente, brillante, mais au bout du compte un peu stérile. Je suis peut-être réactionnaire, mais j'aime que l'on me raconte des histoires, visualiser les personnages, vibrer avec eux. Pour les conversations brillantes, j'ai des amis qui me donnent entière satisfaction.
La recherche de la couleur , Jean-Marc Parisis, Stock, 184 pages, 2012
Cet écrivain a un style qui vous saisit l'esprit dès les premières lignes. le milieu Germanopratin où se déroule le roman peut paraître restreint et sans grand intérêt. Que l'on fasse alors l'autodafé de Proust à cause de sa peinture des salons de Saint-Germain… Chez Jean-Marc Parisis, tout tient au style qui transmet un regard sur les êtres et notre temps. Comédie de caractères et pointe acérée qui dévoile l'époque. Au-delà de la transcription des torts et des travers contemporains, on y boit une simplicité pleine d'espérance, celle du héros qui sait quoi et qui aimer, et va jusqu'au bout de ses goûts.
Et puisque les citations sont des invitations à lire, en voici quelques-unes :
«(...) mort de la littérature, du politique, de l'histoire, de l'esprit, de la musique, du football, mort de tout. On spéculait aussi spécieusement sur la vogue d'un « sentiment apocalyptique ». On en bouffait, de l'Apocalypse. Beaucoup s'en gavaient en attendant le Déluge. L'épilogue du Nouveau Testament profitait aux Philistins, aux marchands d'épouvante, aux romanciers engagés. Un bon produit financier, l'Apocalypse, à valeur d'obligation à la bourse des foutaises et des tartufferies. En vérité l'Apocalypse avait déjà eu lieu. L'horreur avait déjà eu lieu. L'horreur du vingtième siècle n'était pas rachetable.», La recherche de la couleur , Jean-Marc Parisis, Stock, 184 pages, pages 73-74.
A propos des Champs-Elysées, « (…) Baudelaire répétait avec violence « Je vous dis que ça sent la destruction .(…) Ni la mort, ni l'Apocalypse, la destruction. Quoi qu'il en coûtât, j'aimais vivre à cette époque de destruction. La destruction était passionnante. C'est elle qui changeait la vie.» La recherche de la couleur , Jean-Marc Parisis, Stock, 184 pages, page 74
« Les sentimentaux n'avaient pas l'intelligence des sentiments. Ils compensaient par le lyrisme, le baroque, l'outrance. Ils exaltaient ou il offensaient. Gadeux m'avaient offensé en croyant que je ne verrais pas clair dans un jeu où il se défaussait de son incurie. Il m'avait fait un drame, et c'était le sien. Enfermé dans un rapport pictural à la langue, il la contemplait mieux qu'il ne la comprenait, la reproduisait plus qu'il ne l'écrivait, l'autopsiait au lieu de l'animer. Soumis à la langue, il l'imitait, l'idolâtrait. Gadeux réclamait des maîtres, des autorités. D'où son culte des Classiques et le mimétisme à l'oeuvre dans ses catalogues. » La recherche de la couleur , Jean-Marc Parisis, Stock, 184 pages, page 84
« Qu'avait fait Gadeux de toutes ces années ? Il avait écrit sans doute, à sa façon toute judiciaire, minutant comme un huissier, montant des dossiers, archivant les pages comme les photos qui lui servaient à barbouiller son impuissance. Ecrit en indic, en voyeur, contre la vie et pour la mort, la postérité. En planque dans le posthume, comme le modèle Saint-Simon, mais sans avoir vu le roi, ni fréquenté la cour.
L'extraordinaire chroniqueur de la cour de Louis XIV retrouvait d'ailleurs la cote dans les cénacles conservatoires de la mélancolie française. Symptôme du refoulé courtisan national, Saint-Simon fascinait d'avoir côtoyé les puissantes et clinquants, les people du Grand siècle. Toute cette vie d'étiquettes, de grenouillages, de reptations, revanchée, rédimée par le pouvoir absolutoire de la langue dédouanait, rassurait, faisait rêver – de Saint-Simon à Céline, l'axe d'un certain génie français passait par manifestement par une forme d'allégeance, de collaboration, de dénonciation sociale ou raciale, comme si les révolutions langagières devaient toujours se payer d'un tribut de veulerie. Au dix-septième siècle, on trouvait pourtant plus fort que le petit duc. Dans le même registre de langue, mais en plus nuancé, plus riche, plus profond, plus inquiétant. de l'homme libre, sachant rire de lui comme des autres, du frondeur définitif qui avait projeté d'assassiner Richelieu et connu les prisons de Mazarin, du cardinal de Retz, on parlait moins, évidemment. »La recherche de la couleur , Jean-Marc Parisis, Stock, 184 pages, page 85-86
« Et toutes les femmes décisives, impératives, catégoriques étaient gentilles. La gentillesse n'était pas toujours la douceur, et jamais la faiblesse. C'était un alliage rare de sensibilité, de distinction et d'intelligence, qui pouvait se révéler dangereux, fatal, comme dan le cas de Marilyn Monroe. Antonio Tabucchi l'avait bien compris : ‘Les personnes trop sensibles et trop intelligentes ont tendance à se faire du mal à elles-mêmes. Parce que ceux qui sont trop sensibles et intelligents connaissent les risques que comporte la complexité de ce que la vie choisit pour nous ou nous permet de choisir, il sont conscients de la pluralité dont nous sommes faits non seulement selon une nature double , mais triple, quadruple, avec les mille hypothèses de l'existence. Voilà le problème de ceux qui sentent trop et qui comprennent trop : que nous pourrions être tant de choses, mais qu'il n'y a qu'une vie et elle nous oblige à être une seule chose : cela que les autres pensent que nous sommes.' La conclusion de Tabucchi me paraissait trop dramatique, contredire son subtil développement. Si les personnes trop sensibles et intelligentes étaient plus que les autres conscientes de la pluralité de leur nature et des mille hypothèses de l'existence, en quoi ce savoir devait-il forcément plier devant l'unicité de la vie et les enfermer dans l'opinion des autres ? Ce savoir permettait au contraire de se libérer des autres, de s'en échapper, en volant sur les ailes d'un moi multiple sur les mille figures sans y obliger. Ce savoir étant une donnée, l'espérance était à prendre ou à laisser. » La recherche de la couleur , Jean-Marc Parisis, Stock, 184 pages, page 138-139
Patricia JARNIER -Tous droits réservés - 2012
Cet écrivain a un style qui vous saisit l'esprit dès les premières lignes. le milieu Germanopratin où se déroule le roman peut paraître restreint et sans grand intérêt. Que l'on fasse alors l'autodafé de Proust à cause de sa peinture des salons de Saint-Germain… Chez Jean-Marc Parisis, tout tient au style qui transmet un regard sur les êtres et notre temps. Comédie de caractères et pointe acérée qui dévoile l'époque. Au-delà de la transcription des torts et des travers contemporains, on y boit une simplicité pleine d'espérance, celle du héros qui sait quoi et qui aimer, et va jusqu'au bout de ses goûts.
Et puisque les citations sont des invitations à lire, en voici quelques-unes :
«(...) mort de la littérature, du politique, de l'histoire, de l'esprit, de la musique, du football, mort de tout. On spéculait aussi spécieusement sur la vogue d'un « sentiment apocalyptique ». On en bouffait, de l'Apocalypse. Beaucoup s'en gavaient en attendant le Déluge. L'épilogue du Nouveau Testament profitait aux Philistins, aux marchands d'épouvante, aux romanciers engagés. Un bon produit financier, l'Apocalypse, à valeur d'obligation à la bourse des foutaises et des tartufferies. En vérité l'Apocalypse avait déjà eu lieu. L'horreur avait déjà eu lieu. L'horreur du vingtième siècle n'était pas rachetable.», La recherche de la couleur , Jean-Marc Parisis, Stock, 184 pages, pages 73-74.
A propos des Champs-Elysées, « (…) Baudelaire répétait avec violence « Je vous dis que ça sent la destruction .(…) Ni la mort, ni l'Apocalypse, la destruction. Quoi qu'il en coûtât, j'aimais vivre à cette époque de destruction. La destruction était passionnante. C'est elle qui changeait la vie.» La recherche de la couleur , Jean-Marc Parisis, Stock, 184 pages, page 74
« Les sentimentaux n'avaient pas l'intelligence des sentiments. Ils compensaient par le lyrisme, le baroque, l'outrance. Ils exaltaient ou il offensaient. Gadeux m'avaient offensé en croyant que je ne verrais pas clair dans un jeu où il se défaussait de son incurie. Il m'avait fait un drame, et c'était le sien. Enfermé dans un rapport pictural à la langue, il la contemplait mieux qu'il ne la comprenait, la reproduisait plus qu'il ne l'écrivait, l'autopsiait au lieu de l'animer. Soumis à la langue, il l'imitait, l'idolâtrait. Gadeux réclamait des maîtres, des autorités. D'où son culte des Classiques et le mimétisme à l'oeuvre dans ses catalogues. » La recherche de la couleur , Jean-Marc Parisis, Stock, 184 pages, page 84
« Qu'avait fait Gadeux de toutes ces années ? Il avait écrit sans doute, à sa façon toute judiciaire, minutant comme un huissier, montant des dossiers, archivant les pages comme les photos qui lui servaient à barbouiller son impuissance. Ecrit en indic, en voyeur, contre la vie et pour la mort, la postérité. En planque dans le posthume, comme le modèle Saint-Simon, mais sans avoir vu le roi, ni fréquenté la cour.
L'extraordinaire chroniqueur de la cour de Louis XIV retrouvait d'ailleurs la cote dans les cénacles conservatoires de la mélancolie française. Symptôme du refoulé courtisan national, Saint-Simon fascinait d'avoir côtoyé les puissantes et clinquants, les people du Grand siècle. Toute cette vie d'étiquettes, de grenouillages, de reptations, revanchée, rédimée par le pouvoir absolutoire de la langue dédouanait, rassurait, faisait rêver – de Saint-Simon à Céline, l'axe d'un certain génie français passait par manifestement par une forme d'allégeance, de collaboration, de dénonciation sociale ou raciale, comme si les révolutions langagières devaient toujours se payer d'un tribut de veulerie. Au dix-septième siècle, on trouvait pourtant plus fort que le petit duc. Dans le même registre de langue, mais en plus nuancé, plus riche, plus profond, plus inquiétant. de l'homme libre, sachant rire de lui comme des autres, du frondeur définitif qui avait projeté d'assassiner Richelieu et connu les prisons de Mazarin, du cardinal de Retz, on parlait moins, évidemment. »La recherche de la couleur , Jean-Marc Parisis, Stock, 184 pages, page 85-86
« Et toutes les femmes décisives, impératives, catégoriques étaient gentilles. La gentillesse n'était pas toujours la douceur, et jamais la faiblesse. C'était un alliage rare de sensibilité, de distinction et d'intelligence, qui pouvait se révéler dangereux, fatal, comme dan le cas de Marilyn Monroe. Antonio Tabucchi l'avait bien compris : ‘Les personnes trop sensibles et trop intelligentes ont tendance à se faire du mal à elles-mêmes. Parce que ceux qui sont trop sensibles et intelligents connaissent les risques que comporte la complexité de ce que la vie choisit pour nous ou nous permet de choisir, il sont conscients de la pluralité dont nous sommes faits non seulement selon une nature double , mais triple, quadruple, avec les mille hypothèses de l'existence. Voilà le problème de ceux qui sentent trop et qui comprennent trop : que nous pourrions être tant de choses, mais qu'il n'y a qu'une vie et elle nous oblige à être une seule chose : cela que les autres pensent que nous sommes.' La conclusion de Tabucchi me paraissait trop dramatique, contredire son subtil développement. Si les personnes trop sensibles et intelligentes étaient plus que les autres conscientes de la pluralité de leur nature et des mille hypothèses de l'existence, en quoi ce savoir devait-il forcément plier devant l'unicité de la vie et les enfermer dans l'opinion des autres ? Ce savoir permettait au contraire de se libérer des autres, de s'en échapper, en volant sur les ailes d'un moi multiple sur les mille figures sans y obliger. Ce savoir étant une donnée, l'espérance était à prendre ou à laisser. » La recherche de la couleur , Jean-Marc Parisis, Stock, 184 pages, page 138-139
Patricia JARNIER -Tous droits réservés - 2012
Ce livre m'a tour à tour emballée, ennuyée, étonnée, parfois secouée. je l'ai cependant lu du début à la fin sans vraiment en retenir grand chose. L'écriture est facile et agréable, mais sans plus.
Citations et extraits (10)
Voir plus
Ajouter une citation
Tout était affaire de regard. Ceux à qui il restait des yeux pour voir se passaient très bien de caméras de surveillance. Le spectacle était bestial. Les politiques dansaient sur le fumier. La pensée pendait à des crocs de boucher. Les ouvriers étaient dissous dans l'acide financier. Les enfants cognaient leurs parents. L'amour était l'autre nom de la vanité. L'hystérie avait pris corps. La poésie avait valeur de regret. Le temps, celui qui donnait une chance, une petite chance, au jeu, à la liberté, s'était compressé, réduit à une peau de chagrin. Les jeunes étaient vieux. Les vieux étaient morts. Les morts étaient oubliés. Des colonnes de fantômes défilaient de l'infirmerie psy aux poubelles de la Toile. On fabriquerait bientôt de nouveaux vaccins contre la modestie, la mémoire, le secret. Sur les Champs, Baudelaire m'avait repris en écharpe : "Je demande à tout homme qui pense de me montrer ce qui subsiste de la vie."
Cette nuit là, j'avais rêvé de mon père. Il se baladait dans le quartier, rue de Richelieu, accompagné d'une jeune fille rousse aux yeux pers, dix-huit ans, ni plus ni moins. Je marchais sur le trottoir d'en face, assez discret pour qu'ils ne m'aient pas remarqué... Dans le rêve, je m'interrogeais : était-ce une sœur que mon père m'aurait cachée, une sœur sortie de ses placards de fringues à deux balles ? Était-ce ma mère à dix-huit ans ? Je me posais ces questions de l'autre côté de la rue, tandis qu'ils progressaient vers un croisement, où les feux oranges clignotaient. Ils se quittaient en s'embrassant sur la joue. Pour moi, c'était la bise de ceux qui couchent ensemble.
Ce songe avait déteint sur les premières heures du lendemain jusqu'aux environs de midi, amplifiant la force virginale des matins, toujours riches en mots nus, en idées fortes. Comme d'habitude, j'avais pris le petit-déjeuner avec Marianne, elle avait filé en voiture au labo, et j'étais entré dans mon bureau. J'écrivais à l'instinct, sans vaseline. Certaines phrases jaillissaient comme des évidences, intouchables. D'autres, plus nombreuses, réclamaient un réglage, dix réglages. Il fallait ajouter des voix, des instruments, régler les basses, les aigus, arranger, mixer. Je composais patiemment ma petite, musique dans mon bureau insonorisé. Que faire de ses pensées sinon les mener au bal, même à mon modeste niveau ?...
Le soir, au moment de me glisser dans le lit, le rêve de la nuit précédente s'était réveillé. C'était son heure, il sortait du bois. Allongé sur le dos, les yeux fermés comme un gisant, je tentais de renouer la filature onirique, de retrouver mon père et la jeune fille rousse dans les rues de Paris, mais le rêve ne se laissait pas approcher. Trop de lumière, même en fermant les yeux. Je m'étais couché sur le ventre, enfouissant mon visage dans l'oreiller. Marianne qui lisait à côté de moi m'avait doucement gratté l'épaule.
- Tout va bien ?
- Je cherche un rêve. C'est compliqué.
Elle avait pouffé.
- Il n'est point mort, il n'est point endormi ! Il s'est éveillé du songe de la vie...
Les mots de Shelley sur la tombe de Keats à Rome. Je m'étais redressé, en lui retournant sa question.
- Et toi, tout va bien ?
- Pourquoi ?
- La mort, la vie... Hier soir, déjà, en rentrant de chez Dayen...
- J'avais un peu bu.
- Pas ce soir.
- Non. Ce soir, je suis perplexe, troublée. Je sens une ombre sur toi
Ce songe avait déteint sur les premières heures du lendemain jusqu'aux environs de midi, amplifiant la force virginale des matins, toujours riches en mots nus, en idées fortes. Comme d'habitude, j'avais pris le petit-déjeuner avec Marianne, elle avait filé en voiture au labo, et j'étais entré dans mon bureau. J'écrivais à l'instinct, sans vaseline. Certaines phrases jaillissaient comme des évidences, intouchables. D'autres, plus nombreuses, réclamaient un réglage, dix réglages. Il fallait ajouter des voix, des instruments, régler les basses, les aigus, arranger, mixer. Je composais patiemment ma petite, musique dans mon bureau insonorisé. Que faire de ses pensées sinon les mener au bal, même à mon modeste niveau ?...
Le soir, au moment de me glisser dans le lit, le rêve de la nuit précédente s'était réveillé. C'était son heure, il sortait du bois. Allongé sur le dos, les yeux fermés comme un gisant, je tentais de renouer la filature onirique, de retrouver mon père et la jeune fille rousse dans les rues de Paris, mais le rêve ne se laissait pas approcher. Trop de lumière, même en fermant les yeux. Je m'étais couché sur le ventre, enfouissant mon visage dans l'oreiller. Marianne qui lisait à côté de moi m'avait doucement gratté l'épaule.
- Tout va bien ?
- Je cherche un rêve. C'est compliqué.
Elle avait pouffé.
- Il n'est point mort, il n'est point endormi ! Il s'est éveillé du songe de la vie...
Les mots de Shelley sur la tombe de Keats à Rome. Je m'étais redressé, en lui retournant sa question.
- Et toi, tout va bien ?
- Pourquoi ?
- La mort, la vie... Hier soir, déjà, en rentrant de chez Dayen...
- J'avais un peu bu.
- Pas ce soir.
- Non. Ce soir, je suis perplexe, troublée. Je sens une ombre sur toi
Mais les corps avaient changé. La mutation datait des années quatre-vingt, à la croisée de l'apparition du sida et de la disparition de la gauche. Le plaisir n'avait pu se revancher de la fin des utopies. Le peuple, les masses n'effrayaient plus. Le danger, c'était désormais le corps de l'autre, le corps singulier, possiblement infecté, létal. Le soupçon gangrenait toute rencontre. Le sexe des hommes devaient se gainer de latex. Le port de la capote avait sonné le glas des acquis muqueux des années soixante-dix. Elle préservait de tout sauf de l'ennui. Le spleen avait pris ses quartiers dans un monde sans pitié, et l'angoisse muté plus vite que le virus du sida .À la peur de faire l'amour, se greffèrent celles de perdre son métier, de manger de la viande folle, d'attraper la grippe des oiseaux, de boire de l'eau du robinet, de respirer la fumée du voisin. À la peur s'engrenait la peur de la peur, déclenchant des épidémies de précautions, d'interdictions, relayées en continu, à flux tendu, sur des murs d'écrans. En trente ans, soumis à la pression d'une énorme accélération technique, les corps avaient subi un terrible effet de blast : hématomes psychiques, décrochages du cœur, descentes d'organes. Pris dans l'étau du soupçon, certains avaient tenté de s'innocenter, en présentant des surfaces enfantines, vierges ( femmes aux ventres glabres de poupées, hommes aux crânes lisses de baigneurs ). D'autres avaient pris les devants sur les chemins de l'abattoir, en se tatouant comme des quartiers de viande, ou en se perçant le nez, les lèvres, le nombril, les organes génitaux. Les plus fragiles, les plus démunis s'étaient exilés dans l'obésité ou l'anorexie.
C'est en sortant de la voiture, sur le trottoir, à la lueur d'un réverbère qui blanchissait ses mèches blondes, que j'avais remarqué les minuscules signes d'imprimerie sur le visage de Marianne : des virgules sous les yeux, un tiret au menton, des parenthèses sur les joues, des croix dans le cou. Des pattes de mouche, trois fois rien. Ça ne devait pas dater d'hier. Pourtant il me semblait voir ses ridules pour la première fois. Comme si le temps me sautait aux yeux. Un coup de foudre à rebours, un éclair d'effroi, de pitié, aussi. Des sentiments nouveaux, encombrants. Des virgules, des parenthèses, des ratures, des croix. Et ces mots dans mes yeux que j'avais refermés de peur qu'elle ne les lise : Rien ne sera plus comme avant.
Dans le lit, une heure après, j'avais répondu à son enlacement par des gestes tendres, qui n'étaient pas feints, mais qui le devenaient, à vouloir donner le change. La tendresse du bout des doigts, des lèvres. Impossible d'aller plus loin. Marianne n'avait pas insisté. Elle s'était endormie la tête sur mon épaule...
Dans le lit, une heure après, j'avais répondu à son enlacement par des gestes tendres, qui n'étaient pas feints, mais qui le devenaient, à vouloir donner le change. La tendresse du bout des doigts, des lèvres. Impossible d'aller plus loin. Marianne n'avait pas insisté. Elle s'était endormie la tête sur mon épaule...
Vertigineux de penser que je n'ai jamais eu l'idée de toi, que je n'ai jamais pensé à toi, d'une manière ou d'une autre. Les hommes que j'ai imaginés selon mon désir ou ma volonté, les hommes de mes rêves ne te ressemblaient pas. Tu étais inimaginable. Avec toi, je suis sortie de ma pensée, j'en suis tombée.
Videos de Jean-Marc Parisis (8)
Voir plusAjouter une vidéo
Charlie Hebdo libère les femmes - Un demi-siècle d'articles et de dessins sur les droits des femmes De Collectif aux éditions Les échappés
https://www.lagriffenoire.com/1097392-humour-charlie-hebdo-libere-les-femmes---un-demi-siecle-d-articles-et-de-dessins-sur-les-droits-des-femmes.html
•
Reiser - L'Homme qui aimait les femmes de Reiser et Jean-Marc Parisis aux éditions Glénat
https://www.lagriffenoire.com/1095890-bd-reiser---l-homme-qui-aimait-les-femmes.html
•
Paris-Pontoise de Charb aux éditions Les Échappés
https://www.lagriffenoire.com/1096713-bd-charlie-hebdo---paris-pontoise.html
•
•
•
Chinez & découvrez nos livres coups d'coeur dans notre librairie en ligne lagriffenoire.com
•
Notre chaîne Youtube : Griffenoiretv
•
Notre Newsletter https://www.lagriffenoire.com/?fond=newsletter
•
Vos libraires passionnés,
Gérard Collard & Jean-Edgar Casel
•
•
•
#lagriffenoire #bookish #bookgeek #bookhoarder #igbooks #bookstagram #instabook #booklover #novel #lire #livres #conseillecture #editionslesechappes #editionsglenat
+ Lire la suite
Les plus populaires : Littérature française
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Jean-Marc Parisis (16)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Retrouvez le bon adjectif dans le titre - (2 - littérature francophone )
Françoise Sagan : "Le miroir ***"
brisé
fendu
égaré
perdu
20 questions
3663 lecteurs ont répondu
Thèmes :
littérature
, littérature française
, littérature francophoneCréer un quiz sur ce livre3663 lecteurs ont répondu