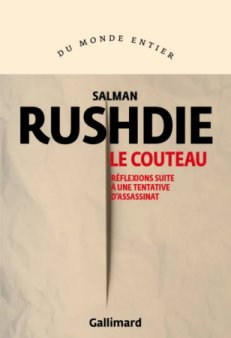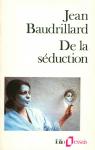Jean Baudrillard/5
35 notes
Résumé :
[Date de publication originale : 1968]
Les objets en particulier n'épuisent pas leur sens dans leur matérialité et leur fonction pratique.
Leur diffusion au gré des finalités de la production, la ventilation incohérente des besoins dans le monde des objets, leur sujétion aux consignes versatiles de la mode : tout cela, apparent, ne doit pas nous cacher que les objets tendent à se constituer en un système cohérent de signes, à partir duquel seul... >Voir plus
Les objets en particulier n'épuisent pas leur sens dans leur matérialité et leur fonction pratique.
Leur diffusion au gré des finalités de la production, la ventilation incohérente des besoins dans le monde des objets, leur sujétion aux consignes versatiles de la mode : tout cela, apparent, ne doit pas nous cacher que les objets tendent à se constituer en un système cohérent de signes, à partir duquel seul... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après Le Système des objetsVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (1)
Ajouter une critique
Il ne restait plus que quarante-six heures avant le départ. Quarante-six heures, ce n'est rien habituellement. C'est presque cinq journées dans mon algéco, mises bout à bout, en enlevant le temps que je consacre à rentrer chez moi pour manger, pour chier et pour dormir. Or, il me semble toujours que les semaines de travail passent très vite. Elles passent toujours plus vite, en tout cas, que les semaines dédiées au devoir de distraction avec les amis. En termes de distractions, j'étais vernie. Comme lorsque j'étais gamine, l'apparition de chaque heure m'était comme une fade et infinie indifférence à traverser. Nous devions encore en traverser quarante-six avant que le temps puisse recommencer à s'écouler normalement, dans le plaisir de l'absence des contraintes.
Robert était toujours terriblement fâché à cause de la contrepèterie que je n'avais pas su résoudre. Comme il m'hébergeait et que j'habitais à six heures de train de chez lui, je n'avais d'autre choix que d'assister à ce spectacle avec une modération sidérée en attendant le jour et l'heure du retour. le petit-déjeuner avait été pris à dix heures et demi. Il n'aurait pas été raisonnable de se lancer dans l'aventure du déjeuner après un si court délai. Il aurait ensuite fallu rapprocher l'heure du goûter, puis l'heure du dîner, et faire arriver l'heure du petit-déjeuner aujourd'hui, c'est-à-dire la veille du jour où il aurait dû être pris, et le problème des denrées alimentaires n'aurait pas tardé à se poser. Il est vrai qu'alors, l'Intermarché aurait constitué un objectif de promenade parfaitement indiqué. Robert y rencontrait toujours des voisins ou des camarades de cours de danse, car il était très populaire dans son quartier. Ces considérations me conduisaient sur une piste. Approfondissant l'idée d'une sortie en terrain extérieur, la rongeant même comme les dents du lapin le feraient d'une corde épaisse, je demandai, l'air de rien : qu'est-ce qu'on pourrait faire ?
Je ne sais pas, répondit Robert, de plus en plus démoralisé à l'idée de la contrepèterie que je ne me résolvais pas à résoudre, générant ainsi une habile mise en abîme.
Nous pourrions sortir, proposai-je, mine de rien. Il était temps que je prenne en main la direction de ce foyer qui, sans ma force de caractère à toute épreuve, risquait de sombrer bien plus rapidement qu'il ne le ferait de toute façon, quelle que soit la nature de mon intervention en ce domaine. Au niveau politique, les gouvernements appellent cette stratégie consistant à prolonger l'agonie et à différer le constat de l'échec : « développement durable ». Je me sentis un peu grisée de constater que j'occupais ce rôle, sans l'avoir prémédité, de stratège en développement durable de couple.
Je sentais mes intestins faire des siennes. Ce n'est pas le moment, leur intimai-je. Il est vrai que le refuge des chiottes permet toujours un intermède de solitude agréable mais je ne pouvais décidément pas m'y installer pour quarante-six heures. Une solution plus radicale devait être déployée.
La veille, j'avais plaisanté, avec cette petite intention malsaine toutefois de prouver quelque chose comme la supériorité morale, que je ne voyais pas quel était l'intérêt de vivre en plein milieu de la ville. Entendre l'heure à laquelle les voisins sortent, l'heure à laquelle ils rentrent, l'heure qui les voit rester sur le palier, les bras ballants, ne sachant plus que faire chez eux, pas plus qu'ils ne sauraient que faire s'ils franchissaient enfin ces escaliers. Un jour de pluie, trop pleine d'assurance, j'avais glissé sur une des marches de cet escalier en bois, qui n'en finissait plus de tourner. J'avais fini sur le cul, tandis que Robert cavalait marche après marche, prouvant ainsi qu'il avait passé sa vie à sillonner cet escalier maudit. Depuis, je ne le descendais plus que sur l'arrière-train, le devant du train étant occupé à chercher sa route malgré la ligne d'horizon hagarde. Et puis ensuite, parmi les autres occupations de la ville : regarder par la fenêtre, voir les fenêtres des autres voisins qui regardent eux aussi par la fenêtre, à la recherche de l'inspiration. Puis regarder par une autre fenêtre, voir la rue avec des gens qui sont sortis parce qu'ils n'en pouvaient plus de voir leurs voisins qui les regardaient à travers leurs propres fenêtres. Dans la rue, saluer les voisins qu'on ne voit plus à travers les fenêtres mais en face, avec des paniers remplis de provisions, avec une petite amie au bras, avec un futur mari autour de la taille, regarder des hommes inconnus qui pourraient être de futurs maris, si seulement il était possible de leur dire quelque chose dans la rue, et regarder des femmes qui pourraient être la cause de futurs divorces, si seulement on – c'est-à-dire je – avait été mariée. Attendre dix-neuf heures trente pour aller au cours de danse et apprendre les noms des dames par coeur. Entendre le voisin de l'étage supérieur qui téléphone pendant qu'il en lâche une dans le chiotte, en même temps que je constate avoir oublié de prendre un rouleau de papier à se torcher après avoir lâché la mienne dans le chiotte situé juste en dessous du sien.
Et désormais, je proposais de sortir se promener.
Nous pouvons aussi rester là, lâcha Robert, sans conviction, jouant à celui qui avait été trop loin dans la souffrance et que plus rien n'affectait.
Et cependant, nous prîmes les morceaux de tissus épais que nous appelons « manteaux ». Robert nouait son écharpe plusieurs fois autour de son cou et laissait pendre ce qui restait de tissu sur son ventre, puis il refermait le manteau par-dessus l'ensemble. Une protubérance se profilait ainsi, lui donnant l'air obèse de cette partie seulement du corps, lui qui était si svelte. Il se regardait, et cette allure lui convenait pourtant. Pour ma part, je ne me regardais pas, et les problèmes d'apparence étaient ainsi réglés. Je regardai cependant, car il faut faire quelque chose de ses yeux, par la fenêtre et je vis, avant que mon oeil ne tombât sur la fenêtre d'un des voisins, un morceau de ciel gris et pluvieux. Mon oeil redescendit sur les jardinières installées sur le rebord de la fenêtre. Comment ces plantes faisaient-elles pour rester aussi vertes malgré ce temps maussade ? Robert avait sans doute la main verte, contrairement à moi.
La porte s'ouvrit sur le palier. Aucun voisin n'attendait heureusement là, sur le paillasson, dans l'interrogation de savoir que faire de sa journée. Les gens des villes travaillent souvent bien peu, voire pas du tout, car il existe de nombreuses poubelles qui jalonnent les rues pour se nourrir. Je descendis les escaliers à ma plaisante manière. Robert m'attendait en bas des marches. Il me précédait toujours dans le couloir mais m'attendait malgré tout au moment fatidique pour me faire la démonstration de sa technique d'ouverture de la porte de l'immeuble. Dans le couloir, sur le mur à droite, se trouvait un bouton cerclé de bleu sur lequel l'index se posait pour une durée légèrement supérieure à celle impliquée par un simple effleurement. La porte se mettait alors à grésiller. L'index devait rapidement quitter le bouton bleu et s'emparer de la poignée de la porte pour l'ouvrir. Robert aimait à l'ouvrir d'un coup sec, comme s'il s'agissait d'une femme à laquelle il ne voulait laisser aucune possibilité de s'échapper pendant la saillie. La porte ouverte, il franchissait alors le seuil avec un léger déhanché sur la droite qui venait sans doute amortir l'élan du bras. Il se trouvait alors sur le trottoir de la rue des joyeux enfants qui, comme Robert aimait tant le claironner, était autrefois la rue des prostituées et des juifs.
N'étant pas danseuse dans l'âme, je me contentai simplement de retenir la porte derrière le passage fracassant De Robert, aucune ondulation esthétique ne venant accompagner ma déambulation. Je pliai mon bras droit, mon avant-bras formant un angle de 90° avec mon biceps, puis glissai l'ensemble dans l'espace vide entre le bras gauche De Robert, également plié à 90°, et son flanc gauche. Nous étions ainsi solidement agrippés l'un à l'autre, ne courant aucun risque de dériver trop sûrement l'un de l'autre et de nous perdre.
Aucun but de promenade n'ayant été fixé, nous vaguions.
Jusqu'à présent, nous avions évité de rencontrer le moindre voisin. Plus nous nous éloignerions, plus ce risque s'amoindrirait. J'appréciais de savoir que je me prémunissais contre autant de risques.
Après quelques minutes, nous passâmes devant un biocoop. Nous étions déjà passés devant bien des magasins, puisqu'il n'existe rien d'autre, dans les villes. Enfin, quand même, un biocoop, me disais-je, ce serait une destination plaisante. Que pourrions-nous bien y acheter ? Je me posais la question, et la devanture se rapprochait de plus en plus. J'étais sur le point de proposer d'entrer dans le magasin lorsque mes yeux tombèrent sur un panneau imitation ardoise placé à côté de la porte d'entrée. A la craie blanche, ou au feutre imitant la couleur de la craie blanche, un employé avait inscrit :
Promotion de la semaine :
Pommes Boskop à 3,89 euros le kilo !
Venez boire un café chez nous le temps d'un sourire !
Ces quelques phrases me plongèrent aussitôt dans une profonde mélancolie. Je décrétai intérieurement qu'il valait mieux ne pas entrer dans cette échoppe. Nous étions trop malheureux, accrochés l'un à l'autre comme des orvets dont les corps se seraient emmêlés après une danse macabre, et nous n'aurions pas supporté de prendre de plein fouet la bonne humeur des clients et des salariés.
Au loin se dressait le bâtiment du musée des beaux-arts. Cette fois, je n'hésitai pas une seconde. Allons au musée, proposai-je. Si tu veux, répondit Robert, qui n'en menait pas plus large qu'avant que nous sortions, lui qui disait pourtant aimer marcher plus que tout, tout du moins lorsqu'il se trouvait en ville, lui qui aimait tant la ville et ses merveilles, lui qui saisissait chaque rencontre comme l'occasion de faire preuve de son art oratoire – mais il n'avait rencontré personne, encore, mais il n'avait pu sortir de lui-même, encore, jusqu'à présent.
Robert connaissait bien le musée : il était très cultivé. Il lui suffit de passer la porte d'entrée pour que son pas devienne plus assuré. Il montrait qu'il dirigeait le bal pour faire bonne impression aux techniciennes de surface du musée. L'une d'entre elles se tenait derrière une vitre transparente. Curieuse protection, pensai-je. Qu'elle soit transparente ne permet pas d'éviter la vision réciproque des visages, et qu'elle soit en plastique ne permet pas de dissuader le psychotique en phase de décompensation ou le salafiste de commettre le crime qui lui permettra d'être soulagé de ses pulsions. Deux places pour l'exposition permanente, demanda Robert. J'étais impressionnée par le niveau de précision de la demande. Qui d'autre qu'un connaisseur aurait pu savoir qu'il existait une exposition permanente et une exposition qui ne l'était pas ? Une exposition qui restait, et une exposition qui partait ? le doute m'étreint un instant : allais-je devoir sortir mon portemonnaie pour faire semblant de payer, disons, au moins ma place ? Mais la technicienne de surface imprima deux billets à zéro euro.
Je traversai la première pièce à vive allure car un agent de surface était assis sur un tabouret et nous regardait. Notre couple était trop moribond pour être ainsi contemplé. Je fis comme si je considérais que les tableaux de cette salle ne valaient pas le coup d'être contemplés. Dans la deuxième salle, je trouvai refuge dans l'angle sud-est de la pièce, à l'abri de tout regard, le temps de retrouver mon souffle après ces émotions.
Robert s'était arrêté devant Un Repas de Noces à Yport. Je me postai à côté de lui. Aussitôt, il se dirigea vers Diomède dévoré par ses chevaux. Après cinq secondes, le temps que j'estimais être nécessaire à une évaluation correcte du premier tableau, je le suivis. Il n'attendit pas une seconde pour faire un mouvement de translation auprès d'Un Vendredi au Salon des Artistes français. Ma foi, je ne me sentais plus d'humeur à le suivre comme un petit chien affamé, bien que j'eusse quelque chose de la chienne, d'un vague rapprochement stylistique. D'ailleurs, la promenade aidant, je commençais à ressentir quelque peu, dans le mouvement de mes entrailles, cette sensation sur laquelle les hommes se sont accordés pour la désigner comme : la faim.
Comme par hasard, la salle suivante était consacrée aux natures mortes. Evidemment, certaines d'entre elles étaient des plus passables. La Nature morte à la gourde renversée me faisait par trop penser aux écorces d'orange que Robert conservait dans de petits sachets en raphia qu'il déposait sur ses radiateurs dans l'espoir d'embaumer son intérieur. La Nature morte, champignons, lézard et insectes me plaisait par sa composition qui, bien que terrestre, me faisait penser à l'exploration d'un bas-fond maritime. Une étudiante que Robert aurait sans doute aimé troncher, calepin sous le bras, traversa à son tour la salle d'un grand pas, conseillée par son audioguide. En voilà une bonne idée, exultai-je intérieurement. Il aurait suffi que nous prenions de semblables appareils pour que Robert et moi soyons justifiés de notre remarquable absence de conversation. Les Fruits ou Grappe de fruits de Jan Davidsz de Heem m'en touchèrent l'une sans faire bouger l'autre. Que dire alors du Chapeau fleuri, fleurs et fruits de Simon Saint-Jean qui commençait à faire naître en moi une sérieuse impatience ?
Je m'arrêtai alors devant la Nature morte avec un hareng de l'école flamande. Robert et moi avions décidé de manger du hareng la veille. Nous l'avions acheté à l'Intermarché. Mieux vaut acheter la vraie marque, avais-je conseillé, car les harengs des marques de distributeur ont beaucoup plus d'arrêtes et finissent par être immangeables. Les peintres de l'école flamande ne devaient pas avoir ce problème. Dans une belle assiette noire, le poisson était étalé, de la tête à la queue. Son corps était découpé en tronçons réguliers. Voici une pratique qui ne se perd pas dans le temps. Moi-même, lorsque je mange le hareng, je le coupe ainsi, en tronçons, dans le sens de la longueur. Je ne mange pas la tête, évidemment, car le hareng sous vide n'a plus de tête. D'ailleurs, il n'est pas dit que les peintres de l'école flamande mangeassent la tête. Pas plus, d'ailleurs, qu'ils ne s'emparassent de la queue. Dans le prolongement de la tête, une miche de pain appétissante était déposée sur la table. La croûte était légèrement craquelée. Les bords semblaient encore moelleux et chauds. Un léger creux dans la pâte semblait indiquer que le pain avait été serré un peu trop fort, à peine sorti du four, encore malléable. En dessous du pain, un oignon jeune et une échalote, fraîchement cueillis, pouvaient être ciselés afin de parsemer le hareng. Ou mieux encore : ils pouvaient être ciselés et déposés sur une tranche du pain, avec un tronçon de hareng. Les anciens se nourrissaient beaucoup de tartines. A présent, nous appelons ça des sandwichs. Je pensais à cette manière qu'avait ma grand-mère d'appeler « chiens chauds » ce que le commun des mortels appelait des « hotdogs ». Et pour la boisson, me demanderez-vous ? C'est peut-être là que le bât blessait. A droite de l'assiette se trouvait un premier verre vide de forme originale, qui semblait être fait pour accueillir des boissons fantaisistes à base de fruits ou de liqueurs légères. A gauche de l'assiette se trouvait en revanche un verre qui semblait plus prometteur. Classiquement cylindrique, son diamètre était plus important, rempli à ras-bord d'une mixture dont la couleur était, je dois bien l'avouer, orangeâtre. Sans doute un vin vinaigré, qui aura mal tourné, essayai-je de me convaincre. Ne nous méprenons pas sur la couleur. Il était tout à fait possible que le verre fût teinté. Il aurait alors pu contenir un bon vin blanc. D'ailleurs, quoi de mieux que le vin blanc pour accompagner du hareng ?
Il restait encore la salle des impressionnistes, la salle du grand siècle français, la salle des sculptures, la salle des portraits, et tant d'autres salles qui se perdaient dans des murs de plus en plus réduits. Il était bientôt quatorze heures. Plus que quarante-deux heures et demi. Trois heures et demi s'étaient écoulées depuis le petit-déjeuner. Il faudrait encore une heure avant de déjeuner, le temps de rentrer, de cuisiner, de préparer la table. Ce hareng m'avait donné faim. Robert était en train de sangloter devant l'Épisode de la retraite de Moscou. Je le tirai hors de cette étrange fascination et, maintenant entre nous une distance respectable de flanc à flanc de soixante centimètres, nous refluâmes à l'entrée du musée, celle-ci devenant, à l'occasion de notre départ, sortie. Cette fois, quatre techniciennes de surface occupaient le lieu. Elles s'amusaient à se tresser les cheveux, pour se faire du bien.
Une fois sortis, j'admis que Robert semblait bien connaître le musée. Il restait muet, mais il hocha la tête, positivement, dans un oui affirmatif car, enfin, ce n'est pas parce qu'on a perdu sa langue qu'on ne doit plus montrer qu'on a réussi dans la vie. Je lui demandai de quand datait sa dernière visite. Il sortit une main dont il écarta chaque doigt, puis une autre main dont il replia trois doigts, pour en laisser deux tendus. Je comptais le chiffre sept. Il s'agissait donc du mois de juillet. Peut-être cela signifiait-il également : sept ans en arrière. Je ne saurai jamais. Nous étions au début du mois de février.
La peinture du hareng m'a donné faim, déclarai-je. J'ouvris la porte de la boîte à livres située sur le parvis. Une balle de foot siffla au-dessus de mes oreilles. La boîte contenait un foulard dont les angles tenaient entre eux, accrochés par le sperme. Un livre de Frédéric Lenoir baillait aux corneilles. Ce musée était vraiment très beau.
Lien : https://hominoide.blogspot.c..
Robert était toujours terriblement fâché à cause de la contrepèterie que je n'avais pas su résoudre. Comme il m'hébergeait et que j'habitais à six heures de train de chez lui, je n'avais d'autre choix que d'assister à ce spectacle avec une modération sidérée en attendant le jour et l'heure du retour. le petit-déjeuner avait été pris à dix heures et demi. Il n'aurait pas été raisonnable de se lancer dans l'aventure du déjeuner après un si court délai. Il aurait ensuite fallu rapprocher l'heure du goûter, puis l'heure du dîner, et faire arriver l'heure du petit-déjeuner aujourd'hui, c'est-à-dire la veille du jour où il aurait dû être pris, et le problème des denrées alimentaires n'aurait pas tardé à se poser. Il est vrai qu'alors, l'Intermarché aurait constitué un objectif de promenade parfaitement indiqué. Robert y rencontrait toujours des voisins ou des camarades de cours de danse, car il était très populaire dans son quartier. Ces considérations me conduisaient sur une piste. Approfondissant l'idée d'une sortie en terrain extérieur, la rongeant même comme les dents du lapin le feraient d'une corde épaisse, je demandai, l'air de rien : qu'est-ce qu'on pourrait faire ?
Je ne sais pas, répondit Robert, de plus en plus démoralisé à l'idée de la contrepèterie que je ne me résolvais pas à résoudre, générant ainsi une habile mise en abîme.
Nous pourrions sortir, proposai-je, mine de rien. Il était temps que je prenne en main la direction de ce foyer qui, sans ma force de caractère à toute épreuve, risquait de sombrer bien plus rapidement qu'il ne le ferait de toute façon, quelle que soit la nature de mon intervention en ce domaine. Au niveau politique, les gouvernements appellent cette stratégie consistant à prolonger l'agonie et à différer le constat de l'échec : « développement durable ». Je me sentis un peu grisée de constater que j'occupais ce rôle, sans l'avoir prémédité, de stratège en développement durable de couple.
Je sentais mes intestins faire des siennes. Ce n'est pas le moment, leur intimai-je. Il est vrai que le refuge des chiottes permet toujours un intermède de solitude agréable mais je ne pouvais décidément pas m'y installer pour quarante-six heures. Une solution plus radicale devait être déployée.
La veille, j'avais plaisanté, avec cette petite intention malsaine toutefois de prouver quelque chose comme la supériorité morale, que je ne voyais pas quel était l'intérêt de vivre en plein milieu de la ville. Entendre l'heure à laquelle les voisins sortent, l'heure à laquelle ils rentrent, l'heure qui les voit rester sur le palier, les bras ballants, ne sachant plus que faire chez eux, pas plus qu'ils ne sauraient que faire s'ils franchissaient enfin ces escaliers. Un jour de pluie, trop pleine d'assurance, j'avais glissé sur une des marches de cet escalier en bois, qui n'en finissait plus de tourner. J'avais fini sur le cul, tandis que Robert cavalait marche après marche, prouvant ainsi qu'il avait passé sa vie à sillonner cet escalier maudit. Depuis, je ne le descendais plus que sur l'arrière-train, le devant du train étant occupé à chercher sa route malgré la ligne d'horizon hagarde. Et puis ensuite, parmi les autres occupations de la ville : regarder par la fenêtre, voir les fenêtres des autres voisins qui regardent eux aussi par la fenêtre, à la recherche de l'inspiration. Puis regarder par une autre fenêtre, voir la rue avec des gens qui sont sortis parce qu'ils n'en pouvaient plus de voir leurs voisins qui les regardaient à travers leurs propres fenêtres. Dans la rue, saluer les voisins qu'on ne voit plus à travers les fenêtres mais en face, avec des paniers remplis de provisions, avec une petite amie au bras, avec un futur mari autour de la taille, regarder des hommes inconnus qui pourraient être de futurs maris, si seulement il était possible de leur dire quelque chose dans la rue, et regarder des femmes qui pourraient être la cause de futurs divorces, si seulement on – c'est-à-dire je – avait été mariée. Attendre dix-neuf heures trente pour aller au cours de danse et apprendre les noms des dames par coeur. Entendre le voisin de l'étage supérieur qui téléphone pendant qu'il en lâche une dans le chiotte, en même temps que je constate avoir oublié de prendre un rouleau de papier à se torcher après avoir lâché la mienne dans le chiotte situé juste en dessous du sien.
Et désormais, je proposais de sortir se promener.
Nous pouvons aussi rester là, lâcha Robert, sans conviction, jouant à celui qui avait été trop loin dans la souffrance et que plus rien n'affectait.
Et cependant, nous prîmes les morceaux de tissus épais que nous appelons « manteaux ». Robert nouait son écharpe plusieurs fois autour de son cou et laissait pendre ce qui restait de tissu sur son ventre, puis il refermait le manteau par-dessus l'ensemble. Une protubérance se profilait ainsi, lui donnant l'air obèse de cette partie seulement du corps, lui qui était si svelte. Il se regardait, et cette allure lui convenait pourtant. Pour ma part, je ne me regardais pas, et les problèmes d'apparence étaient ainsi réglés. Je regardai cependant, car il faut faire quelque chose de ses yeux, par la fenêtre et je vis, avant que mon oeil ne tombât sur la fenêtre d'un des voisins, un morceau de ciel gris et pluvieux. Mon oeil redescendit sur les jardinières installées sur le rebord de la fenêtre. Comment ces plantes faisaient-elles pour rester aussi vertes malgré ce temps maussade ? Robert avait sans doute la main verte, contrairement à moi.
La porte s'ouvrit sur le palier. Aucun voisin n'attendait heureusement là, sur le paillasson, dans l'interrogation de savoir que faire de sa journée. Les gens des villes travaillent souvent bien peu, voire pas du tout, car il existe de nombreuses poubelles qui jalonnent les rues pour se nourrir. Je descendis les escaliers à ma plaisante manière. Robert m'attendait en bas des marches. Il me précédait toujours dans le couloir mais m'attendait malgré tout au moment fatidique pour me faire la démonstration de sa technique d'ouverture de la porte de l'immeuble. Dans le couloir, sur le mur à droite, se trouvait un bouton cerclé de bleu sur lequel l'index se posait pour une durée légèrement supérieure à celle impliquée par un simple effleurement. La porte se mettait alors à grésiller. L'index devait rapidement quitter le bouton bleu et s'emparer de la poignée de la porte pour l'ouvrir. Robert aimait à l'ouvrir d'un coup sec, comme s'il s'agissait d'une femme à laquelle il ne voulait laisser aucune possibilité de s'échapper pendant la saillie. La porte ouverte, il franchissait alors le seuil avec un léger déhanché sur la droite qui venait sans doute amortir l'élan du bras. Il se trouvait alors sur le trottoir de la rue des joyeux enfants qui, comme Robert aimait tant le claironner, était autrefois la rue des prostituées et des juifs.
N'étant pas danseuse dans l'âme, je me contentai simplement de retenir la porte derrière le passage fracassant De Robert, aucune ondulation esthétique ne venant accompagner ma déambulation. Je pliai mon bras droit, mon avant-bras formant un angle de 90° avec mon biceps, puis glissai l'ensemble dans l'espace vide entre le bras gauche De Robert, également plié à 90°, et son flanc gauche. Nous étions ainsi solidement agrippés l'un à l'autre, ne courant aucun risque de dériver trop sûrement l'un de l'autre et de nous perdre.
Aucun but de promenade n'ayant été fixé, nous vaguions.
Jusqu'à présent, nous avions évité de rencontrer le moindre voisin. Plus nous nous éloignerions, plus ce risque s'amoindrirait. J'appréciais de savoir que je me prémunissais contre autant de risques.
Après quelques minutes, nous passâmes devant un biocoop. Nous étions déjà passés devant bien des magasins, puisqu'il n'existe rien d'autre, dans les villes. Enfin, quand même, un biocoop, me disais-je, ce serait une destination plaisante. Que pourrions-nous bien y acheter ? Je me posais la question, et la devanture se rapprochait de plus en plus. J'étais sur le point de proposer d'entrer dans le magasin lorsque mes yeux tombèrent sur un panneau imitation ardoise placé à côté de la porte d'entrée. A la craie blanche, ou au feutre imitant la couleur de la craie blanche, un employé avait inscrit :
Promotion de la semaine :
Pommes Boskop à 3,89 euros le kilo !
Venez boire un café chez nous le temps d'un sourire !
Ces quelques phrases me plongèrent aussitôt dans une profonde mélancolie. Je décrétai intérieurement qu'il valait mieux ne pas entrer dans cette échoppe. Nous étions trop malheureux, accrochés l'un à l'autre comme des orvets dont les corps se seraient emmêlés après une danse macabre, et nous n'aurions pas supporté de prendre de plein fouet la bonne humeur des clients et des salariés.
Au loin se dressait le bâtiment du musée des beaux-arts. Cette fois, je n'hésitai pas une seconde. Allons au musée, proposai-je. Si tu veux, répondit Robert, qui n'en menait pas plus large qu'avant que nous sortions, lui qui disait pourtant aimer marcher plus que tout, tout du moins lorsqu'il se trouvait en ville, lui qui aimait tant la ville et ses merveilles, lui qui saisissait chaque rencontre comme l'occasion de faire preuve de son art oratoire – mais il n'avait rencontré personne, encore, mais il n'avait pu sortir de lui-même, encore, jusqu'à présent.
Robert connaissait bien le musée : il était très cultivé. Il lui suffit de passer la porte d'entrée pour que son pas devienne plus assuré. Il montrait qu'il dirigeait le bal pour faire bonne impression aux techniciennes de surface du musée. L'une d'entre elles se tenait derrière une vitre transparente. Curieuse protection, pensai-je. Qu'elle soit transparente ne permet pas d'éviter la vision réciproque des visages, et qu'elle soit en plastique ne permet pas de dissuader le psychotique en phase de décompensation ou le salafiste de commettre le crime qui lui permettra d'être soulagé de ses pulsions. Deux places pour l'exposition permanente, demanda Robert. J'étais impressionnée par le niveau de précision de la demande. Qui d'autre qu'un connaisseur aurait pu savoir qu'il existait une exposition permanente et une exposition qui ne l'était pas ? Une exposition qui restait, et une exposition qui partait ? le doute m'étreint un instant : allais-je devoir sortir mon portemonnaie pour faire semblant de payer, disons, au moins ma place ? Mais la technicienne de surface imprima deux billets à zéro euro.
Je traversai la première pièce à vive allure car un agent de surface était assis sur un tabouret et nous regardait. Notre couple était trop moribond pour être ainsi contemplé. Je fis comme si je considérais que les tableaux de cette salle ne valaient pas le coup d'être contemplés. Dans la deuxième salle, je trouvai refuge dans l'angle sud-est de la pièce, à l'abri de tout regard, le temps de retrouver mon souffle après ces émotions.
Robert s'était arrêté devant Un Repas de Noces à Yport. Je me postai à côté de lui. Aussitôt, il se dirigea vers Diomède dévoré par ses chevaux. Après cinq secondes, le temps que j'estimais être nécessaire à une évaluation correcte du premier tableau, je le suivis. Il n'attendit pas une seconde pour faire un mouvement de translation auprès d'Un Vendredi au Salon des Artistes français. Ma foi, je ne me sentais plus d'humeur à le suivre comme un petit chien affamé, bien que j'eusse quelque chose de la chienne, d'un vague rapprochement stylistique. D'ailleurs, la promenade aidant, je commençais à ressentir quelque peu, dans le mouvement de mes entrailles, cette sensation sur laquelle les hommes se sont accordés pour la désigner comme : la faim.
Comme par hasard, la salle suivante était consacrée aux natures mortes. Evidemment, certaines d'entre elles étaient des plus passables. La Nature morte à la gourde renversée me faisait par trop penser aux écorces d'orange que Robert conservait dans de petits sachets en raphia qu'il déposait sur ses radiateurs dans l'espoir d'embaumer son intérieur. La Nature morte, champignons, lézard et insectes me plaisait par sa composition qui, bien que terrestre, me faisait penser à l'exploration d'un bas-fond maritime. Une étudiante que Robert aurait sans doute aimé troncher, calepin sous le bras, traversa à son tour la salle d'un grand pas, conseillée par son audioguide. En voilà une bonne idée, exultai-je intérieurement. Il aurait suffi que nous prenions de semblables appareils pour que Robert et moi soyons justifiés de notre remarquable absence de conversation. Les Fruits ou Grappe de fruits de Jan Davidsz de Heem m'en touchèrent l'une sans faire bouger l'autre. Que dire alors du Chapeau fleuri, fleurs et fruits de Simon Saint-Jean qui commençait à faire naître en moi une sérieuse impatience ?
Je m'arrêtai alors devant la Nature morte avec un hareng de l'école flamande. Robert et moi avions décidé de manger du hareng la veille. Nous l'avions acheté à l'Intermarché. Mieux vaut acheter la vraie marque, avais-je conseillé, car les harengs des marques de distributeur ont beaucoup plus d'arrêtes et finissent par être immangeables. Les peintres de l'école flamande ne devaient pas avoir ce problème. Dans une belle assiette noire, le poisson était étalé, de la tête à la queue. Son corps était découpé en tronçons réguliers. Voici une pratique qui ne se perd pas dans le temps. Moi-même, lorsque je mange le hareng, je le coupe ainsi, en tronçons, dans le sens de la longueur. Je ne mange pas la tête, évidemment, car le hareng sous vide n'a plus de tête. D'ailleurs, il n'est pas dit que les peintres de l'école flamande mangeassent la tête. Pas plus, d'ailleurs, qu'ils ne s'emparassent de la queue. Dans le prolongement de la tête, une miche de pain appétissante était déposée sur la table. La croûte était légèrement craquelée. Les bords semblaient encore moelleux et chauds. Un léger creux dans la pâte semblait indiquer que le pain avait été serré un peu trop fort, à peine sorti du four, encore malléable. En dessous du pain, un oignon jeune et une échalote, fraîchement cueillis, pouvaient être ciselés afin de parsemer le hareng. Ou mieux encore : ils pouvaient être ciselés et déposés sur une tranche du pain, avec un tronçon de hareng. Les anciens se nourrissaient beaucoup de tartines. A présent, nous appelons ça des sandwichs. Je pensais à cette manière qu'avait ma grand-mère d'appeler « chiens chauds » ce que le commun des mortels appelait des « hotdogs ». Et pour la boisson, me demanderez-vous ? C'est peut-être là que le bât blessait. A droite de l'assiette se trouvait un premier verre vide de forme originale, qui semblait être fait pour accueillir des boissons fantaisistes à base de fruits ou de liqueurs légères. A gauche de l'assiette se trouvait en revanche un verre qui semblait plus prometteur. Classiquement cylindrique, son diamètre était plus important, rempli à ras-bord d'une mixture dont la couleur était, je dois bien l'avouer, orangeâtre. Sans doute un vin vinaigré, qui aura mal tourné, essayai-je de me convaincre. Ne nous méprenons pas sur la couleur. Il était tout à fait possible que le verre fût teinté. Il aurait alors pu contenir un bon vin blanc. D'ailleurs, quoi de mieux que le vin blanc pour accompagner du hareng ?
Il restait encore la salle des impressionnistes, la salle du grand siècle français, la salle des sculptures, la salle des portraits, et tant d'autres salles qui se perdaient dans des murs de plus en plus réduits. Il était bientôt quatorze heures. Plus que quarante-deux heures et demi. Trois heures et demi s'étaient écoulées depuis le petit-déjeuner. Il faudrait encore une heure avant de déjeuner, le temps de rentrer, de cuisiner, de préparer la table. Ce hareng m'avait donné faim. Robert était en train de sangloter devant l'Épisode de la retraite de Moscou. Je le tirai hors de cette étrange fascination et, maintenant entre nous une distance respectable de flanc à flanc de soixante centimètres, nous refluâmes à l'entrée du musée, celle-ci devenant, à l'occasion de notre départ, sortie. Cette fois, quatre techniciennes de surface occupaient le lieu. Elles s'amusaient à se tresser les cheveux, pour se faire du bien.
Une fois sortis, j'admis que Robert semblait bien connaître le musée. Il restait muet, mais il hocha la tête, positivement, dans un oui affirmatif car, enfin, ce n'est pas parce qu'on a perdu sa langue qu'on ne doit plus montrer qu'on a réussi dans la vie. Je lui demandai de quand datait sa dernière visite. Il sortit une main dont il écarta chaque doigt, puis une autre main dont il replia trois doigts, pour en laisser deux tendus. Je comptais le chiffre sept. Il s'agissait donc du mois de juillet. Peut-être cela signifiait-il également : sept ans en arrière. Je ne saurai jamais. Nous étions au début du mois de février.
La peinture du hareng m'a donné faim, déclarai-je. J'ouvris la porte de la boîte à livres située sur le parvis. Une balle de foot siffla au-dessus de mes oreilles. La boîte contenait un foulard dont les angles tenaient entre eux, accrochés par le sperme. Un livre de Frédéric Lenoir baillait aux corneilles. Ce musée était vraiment très beau.
Lien : https://hominoide.blogspot.c..
Citations et extraits (12)
Voir plus
Ajouter une citation
Cet ordre moderne, spécifiquement différent de l’ordre traditionnel de procréation, relève pourtant lui aussi d’un ordre symbolique fondamental. Si la civilisation antérieure, fondée sur l’ordre naturel des substances, peut être rattachée à des structures orales, il faut voir dans l’ordre moderne de production, de calcul et de fonctionnalité un ordre phallique, lié à l’entreprise de dépassement, de transformation du donné, d’émergence vers des structures objectives – mais aussi un ordre de la fécalité, fondé sur l’abstraction, la quintessence visant à instruire une matière homogène, sur le calcul et le découpage de matière, sur toute une agressivité anale sublimée dans le jeu, le discours, l’ordre, le classement, la distribution.
[…] à une sociologie du meuble succède une sociologie du rangement.
Ces modèles de l’avant-garde mobilière s’ordonnent selon une opposition fondamentale : ELEMENTS/SIEGES, et l’impératif pratique auquel ils obéissent est celui du RANGEMENT, ou calcul syntagmatique, auquel vient s’opposer, comme les sièges aux éléments, le concept général d’AMBIANCE.
[…] comment un système technologique cohérent diffuse-t-il en un système pratique incohérent, comment la « langue » des objets est-elle « parlée », de quelle façon ce système de la « parole » (ou intermédiaire entre la langue et la parole) oblitère-t-il celui de la langue ? Où sont finalement, non pas la cohérence abstraite, mais les contradictions vécues dans le système des objets ?
[La collection]
Tout objet a ainsi deux fonctions : l’une qui est d’être pratiqué, l’autre qui est d’être possédé. La première relève du champ de totalisation pratique du monde par le sujet, l’autre d’une entreprise de totalisation abstraite du sujet par lui-même en dehors du monde. Ces deux fonctions sont en raison inverse l’une de l’autre. A la limite, l’objet strictement pratique prend un statut social : c’est la machine. A l’inverse, l’objet pur, dénué de fonction, ou abstrait de son usage, prend un statut strictement subjectif : il devient objet de collection. Il cesse d’être tapis, table, boussole ou bibelot pour devenir « objet ». Un « bel objet » dira le collectionneur, et non pas une belle statuette. Lorsque l’objet n’est plus spécifié par sa fonction, il est qualifié par le sujet : mais alors tous les objets s’équivalent dans la possession, cette abstraction passionnée. Un seul n'y suffit plus : c’est toujours une succession d'objets, à la limite une série totale qui en est le projet accompli. C'est pourquoi la possession d'un objet quel qu'il soit est toujours si satisfaisante et si décevante à la fois : toute une série la prolonge et l'inquiète. C'est un peu la. même chose sur le plan sexuel : si la relation amoureuse vise l'être dans sa singularité, la possession amoureuse, elle, en tant que telle, ne se satisfait que d'une succession d'objets ou de la répétition du même, ou de la supposition de tous les objets. Seule une organisation plus ou moins complexe d'objets renvoyant les uns aux autres constitue chaque objet en une abstraction suffisante pour qu'il puisse être récupéré par le sujet dans l'abstraction vécue qu'est le sentiment de possession.
Cette organisation, c'est la collection. L'environnement habituel garde, lui, un statut ambigu : le fonctionnel s'y défait sans cesse dans le subjectif, la possession s'y mêle à l'usage, dans une entreprise toujours déçue d'intégration totale. La collection par contre peut nous servir de modèle : c'est là où triomphe cette entreprise passionnée de possession, là où la prose quotidienne des objets devient poésie, discours inconscient et triomphal.
Tout objet a ainsi deux fonctions : l’une qui est d’être pratiqué, l’autre qui est d’être possédé. La première relève du champ de totalisation pratique du monde par le sujet, l’autre d’une entreprise de totalisation abstraite du sujet par lui-même en dehors du monde. Ces deux fonctions sont en raison inverse l’une de l’autre. A la limite, l’objet strictement pratique prend un statut social : c’est la machine. A l’inverse, l’objet pur, dénué de fonction, ou abstrait de son usage, prend un statut strictement subjectif : il devient objet de collection. Il cesse d’être tapis, table, boussole ou bibelot pour devenir « objet ». Un « bel objet » dira le collectionneur, et non pas une belle statuette. Lorsque l’objet n’est plus spécifié par sa fonction, il est qualifié par le sujet : mais alors tous les objets s’équivalent dans la possession, cette abstraction passionnée. Un seul n'y suffit plus : c’est toujours une succession d'objets, à la limite une série totale qui en est le projet accompli. C'est pourquoi la possession d'un objet quel qu'il soit est toujours si satisfaisante et si décevante à la fois : toute une série la prolonge et l'inquiète. C'est un peu la. même chose sur le plan sexuel : si la relation amoureuse vise l'être dans sa singularité, la possession amoureuse, elle, en tant que telle, ne se satisfait que d'une succession d'objets ou de la répétition du même, ou de la supposition de tous les objets. Seule une organisation plus ou moins complexe d'objets renvoyant les uns aux autres constitue chaque objet en une abstraction suffisante pour qu'il puisse être récupéré par le sujet dans l'abstraction vécue qu'est le sentiment de possession.
Cette organisation, c'est la collection. L'environnement habituel garde, lui, un statut ambigu : le fonctionnel s'y défait sans cesse dans le subjectif, la possession s'y mêle à l'usage, dans une entreprise toujours déçue d'intégration totale. La collection par contre peut nous servir de modèle : c'est là où triomphe cette entreprise passionnée de possession, là où la prose quotidienne des objets devient poésie, discours inconscient et triomphal.
Videos de Jean Baudrillard (6)
Voir plusAjouter une vidéo
Le 13 septembre 2014, l'émission “Une vie, une oeuvre” diffusée tous les samedis sur France Culture, était consacrée à l'évocation du philosophe français, Jean Baudrillard (1929-2007). Par Delphine Japhet et Olivier Jacquemond. Réalisation : Ghislaine David. Attachée d'émission : Claire Poinsignon. Ni morale, ni critique, une « pensée radicale ». Rendre au monde son étrangeté, l’appréhender avec un regard séducteur, telle fut l’entreprise de Baudrillard. Sociologue, philosophe, poète ? Baudrillard est inclassable, et s’est toujours tenu à la marge des institutions académiques, créant son propre style. Ni morale, ni critique, il ne conçut jamais sa pensée comme édificatrice. En revanche, concepts féconds, réflexion visionnaire, il a toujours été un observateur hors norme de notre temps. Au risque de l’hostilité, de la polémique, il s’est emparé d’événements historiques aussi délicats que la Guerre du Golfe ou les attentats du 11 septembre.
Reconnu comme une icône, un gourou à l’étranger, traduit dans une trentaine de langues, il est méconnu en France. Cet épisode de « Une vie, une œuvre », traque les traces de celui qui a toujours cherché à les effacer et à faire de la pensée un jeu de piste.
Invités :
Marine Baudrillard, épouse de Jean Baudrillard.
François L’Yvonnet, professeur de philosophie et éditeur.
François Cusset, historien des idées, professeur de civilisation américaine à l’Université de Nanterre.
Sylvère Lotringer, philosophe français, professeur à l’université Columbia de New York.
Robert Maggiori, philosophe, journaliste à Libération.
Jacques Donzelot, maître de conférences en sociologie politique à l'Université de Paris X Nanterre.
Thèmes : Arts & Spectacles| Philosophie| Société| Jean Baudrillard
Source : France Culture
Thèmes : Arts & Spectacles| Philosophie| Société| Jean Baudrillard
Source : France Culture
+ Lire la suite
autres livres classés : sociologieVoir plus
Les plus populaires : Non-fiction
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Jean Baudrillard (50)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Charade-constat
Première saison d'une épopée
Iliade
Bible
Saga
Genji
6 questions
83 lecteurs ont répondu
Thèmes :
sociologie
, météorologie
, vacancesCréer un quiz sur ce livre83 lecteurs ont répondu