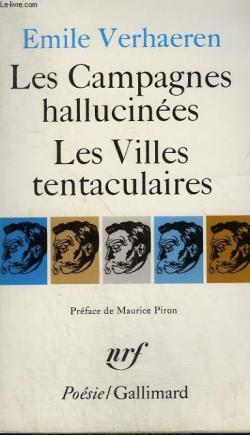Émile Verhaeren
Maurice Piron (Éditeur scientifique)/5 107 notes
Maurice Piron (Éditeur scientifique)/5 107 notes
Résumé :
On ne peut être plus explicite.
Les « Campagnes hallucinées » sont traversées d'un double courant. En marge du thème principal — l'abandon de la terre par les ruraux qu'attire le mirage de la grande ville —, se développe une poésie du non-sens représentée par les « chansons de fou ». Elles sont au nombre de sept (chiffre fatidique ?) et mettent en scène celui que la déraison investit par des hallucinations qui font s'accoupler le morbide et le grotesque. Séq... >Voir plus
Les « Campagnes hallucinées » sont traversées d'un double courant. En marge du thème principal — l'abandon de la terre par les ruraux qu'attire le mirage de la grande ville —, se développe une poésie du non-sens représentée par les « chansons de fou ». Elles sont au nombre de sept (chiffre fatidique ?) et mettent en scène celui que la déraison investit par des hallucinations qui font s'accoupler le morbide et le grotesque. Séq... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après Les campagnes hallucinées. Les villes tentaculairesVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (14)
Voir plus
Ajouter une critique
“Je suis celui qui vaticine comme les tours tocsinnent”. le poète est l'interprète des symboles, dans un monde ouaté, il est le prophète de la décadence du modernisme.
Conscient qu'il ne fait que moudre le vent, il espère embraser l'âtre des âmes. La modernité et ses fumées apportent irrémissiblement leur lot d'avanies. C'est la mort qui, tel “un fleuve de naphte”, passe dans les campagnes hallucinées, les absides deviennent le dernier refuge des paysans alors que la ville tentaculaire, dans un “vent moisi appose aux champs sa flétrissure” et pousse un “lamentable cri” tumultuaire.
Face à leur fatale et chaotique destinée, les veules campagnards, “de village en village”, implorent la mort de les épargner. Cette mort n'est-elle pas la ville tentaculaire dont le fanal igné et lugubre irradie les plaines environnantes ? Celle qui éloigne toujours davantage les frondaisons, les printemps, les ramilles, l'odeur humide des foins. Elle est la faucheuse qui moissonne les âmes des campagnes hallucinées.
Emile Verhaeren pour la poésie, Joris-Karl Huysmans au roman, Gustave Moreau et Fernand Knopff à la peinture, le grand orchestre symboliste est à l'oeuvre, sur une musique de Debussy, et veut étouffer, par sa symphonie mystique, pléthorique et décadente, les gloires des esthètes du parnasse et l'aube rougeoyante des naturalistes.
Ces vers libres du poète belge, aux rimes évidentes et éparses, me laissent l'esprit fuligineux, à peu près incapable de me faire une opinion.
Le symbolisme est une forme d'allégorie fantastique, notamment en peinture, si certains ont pu admirer « les âmes sauvages » consacrée au symbolisme balte au Musée d'Orsay, on est proche de ce que l'on trouve aujourd'hui dans le cinéma fantastique et le graphisme des jeux vidéo “d'heroic fantasy”, peut-être que le symbolisme pourrait renaître avec la B-D (si ce n'est pas déjà le cas ?).
Ce courant littéraire de l'extrême fin du XIXe siècle est apocalyptique. Ce n'est pas une lecture folichonne, tout n'est “que pourriture et bouffissure” mais la beauté et l'extrême raffinement de la langue rachètent ces excès de pessimisme dystopiques et cette atmosphère monochrome et pléonastique.
Qu'en pensez-vous ?
Conscient qu'il ne fait que moudre le vent, il espère embraser l'âtre des âmes. La modernité et ses fumées apportent irrémissiblement leur lot d'avanies. C'est la mort qui, tel “un fleuve de naphte”, passe dans les campagnes hallucinées, les absides deviennent le dernier refuge des paysans alors que la ville tentaculaire, dans un “vent moisi appose aux champs sa flétrissure” et pousse un “lamentable cri” tumultuaire.
Face à leur fatale et chaotique destinée, les veules campagnards, “de village en village”, implorent la mort de les épargner. Cette mort n'est-elle pas la ville tentaculaire dont le fanal igné et lugubre irradie les plaines environnantes ? Celle qui éloigne toujours davantage les frondaisons, les printemps, les ramilles, l'odeur humide des foins. Elle est la faucheuse qui moissonne les âmes des campagnes hallucinées.
Emile Verhaeren pour la poésie, Joris-Karl Huysmans au roman, Gustave Moreau et Fernand Knopff à la peinture, le grand orchestre symboliste est à l'oeuvre, sur une musique de Debussy, et veut étouffer, par sa symphonie mystique, pléthorique et décadente, les gloires des esthètes du parnasse et l'aube rougeoyante des naturalistes.
Ces vers libres du poète belge, aux rimes évidentes et éparses, me laissent l'esprit fuligineux, à peu près incapable de me faire une opinion.
Le symbolisme est une forme d'allégorie fantastique, notamment en peinture, si certains ont pu admirer « les âmes sauvages » consacrée au symbolisme balte au Musée d'Orsay, on est proche de ce que l'on trouve aujourd'hui dans le cinéma fantastique et le graphisme des jeux vidéo “d'heroic fantasy”, peut-être que le symbolisme pourrait renaître avec la B-D (si ce n'est pas déjà le cas ?).
Ce courant littéraire de l'extrême fin du XIXe siècle est apocalyptique. Ce n'est pas une lecture folichonne, tout n'est “que pourriture et bouffissure” mais la beauté et l'extrême raffinement de la langue rachètent ces excès de pessimisme dystopiques et cette atmosphère monochrome et pléonastique.
Qu'en pensez-vous ?
Ce recueil marche comme un diptyque à l'époque où la révolution industrielle vide les campagnes et traîne ses paysans fatigués, grisés par la promesse d'un avenir éblouissant, vers de nouvelles villes dont on ne remarque d'abord que l'ombre d'une usine dans la brume.
Les Campagnes hallucinées sont secouées de leurs derniers soubresauts. Déliquescence des générations précédentes, tout fout le camp dès lors qu'au loin, l'appel d'une ville glorieuse agite le dégoût des campagnards pour leur terre d'origine. Il ne reste plus rien des complaintes lestes et joyeuses des temps médiévaux, si ce ne sont les complaintes folles des fous, aussi nombreux que ceux qui ont gardés leur conscience pleine, mendiants, moralistes ou malades. Les dernières fêtes se transforment en manèges terrifiants, plus personne n'est capable de se réchauffer le coeur. Il est temps de partir, ou de mourir.
On arrive alors dans les Villes tentaculaires. Les fous se sont tus, on les a figés dans des statues. L'usine n'est plus un horizon lointain, elle happe les nouveaux-venus et les soumet à une valse où le métal remplace la terre, le whisky le lait, les éclairs la bougie, l'insomnie la paix. C'est l'hymne du déracinement, la complainte des nouveaux-venus qui, fuyant leurs campagnes sans avenir, contribuent désormais à un nouvel avenir qui ne les concerne en rien. Si on a ainsi l'impression qu'Emile Verhaeren écrit d'abord pour déplorer l'abandon des campagnes ancestrales et l'inhumanité des villes nouvelles, il semble que le passage de la Mort avec sa faucille l'exalte finalement à reléguer l'individu aux préoccupations d'un temps qui n'a plus lieu. Qu'il se sacrifie s'il le veut, sa courte vie et sa triste mort suffiront cependant à exalter le règne de la science et des idées. « On les rêve parmi les brumes, accoudées ; En des lointains, là-haut, près des soleils ». Les campagnes n'avaient plus rien à donner, les villes pas davantage, mais un horizon qu'on ne peut pas atteindre horizontalement, seulement verticalement, un surplus de rêve inatteignable qui apprend enfin à l'homme que sa destinée est d'une valeur dérisoire.
Ces poèmes séduisent et dégoûtent, parce qu'on sent la chair parsemée de moisissures se faire happer par les dents métalliques de l'usine, ses mycoses se faire brûler par la flamme du chalumeau, les cendres plus propres remplaçant les vieux cadavres qu'on oubliait dans les maisons humides ; ces poèmes ne laissent pas indifférents, même s'ils portent la trace d'un idéalisme dont nous sommes revenus.
Les Campagnes hallucinées sont secouées de leurs derniers soubresauts. Déliquescence des générations précédentes, tout fout le camp dès lors qu'au loin, l'appel d'une ville glorieuse agite le dégoût des campagnards pour leur terre d'origine. Il ne reste plus rien des complaintes lestes et joyeuses des temps médiévaux, si ce ne sont les complaintes folles des fous, aussi nombreux que ceux qui ont gardés leur conscience pleine, mendiants, moralistes ou malades. Les dernières fêtes se transforment en manèges terrifiants, plus personne n'est capable de se réchauffer le coeur. Il est temps de partir, ou de mourir.
On arrive alors dans les Villes tentaculaires. Les fous se sont tus, on les a figés dans des statues. L'usine n'est plus un horizon lointain, elle happe les nouveaux-venus et les soumet à une valse où le métal remplace la terre, le whisky le lait, les éclairs la bougie, l'insomnie la paix. C'est l'hymne du déracinement, la complainte des nouveaux-venus qui, fuyant leurs campagnes sans avenir, contribuent désormais à un nouvel avenir qui ne les concerne en rien. Si on a ainsi l'impression qu'Emile Verhaeren écrit d'abord pour déplorer l'abandon des campagnes ancestrales et l'inhumanité des villes nouvelles, il semble que le passage de la Mort avec sa faucille l'exalte finalement à reléguer l'individu aux préoccupations d'un temps qui n'a plus lieu. Qu'il se sacrifie s'il le veut, sa courte vie et sa triste mort suffiront cependant à exalter le règne de la science et des idées. « On les rêve parmi les brumes, accoudées ; En des lointains, là-haut, près des soleils ». Les campagnes n'avaient plus rien à donner, les villes pas davantage, mais un horizon qu'on ne peut pas atteindre horizontalement, seulement verticalement, un surplus de rêve inatteignable qui apprend enfin à l'homme que sa destinée est d'une valeur dérisoire.
Ces poèmes séduisent et dégoûtent, parce qu'on sent la chair parsemée de moisissures se faire happer par les dents métalliques de l'usine, ses mycoses se faire brûler par la flamme du chalumeau, les cendres plus propres remplaçant les vieux cadavres qu'on oubliait dans les maisons humides ; ces poèmes ne laissent pas indifférents, même s'ils portent la trace d'un idéalisme dont nous sommes revenus.
Un mot résume ce recueil de poèmes de l'immense Emile Verhaeren : carrefour. Mot dont le poète fait d'ailleurs assez régulièrement usage.
Carrefour entre deux époques, celle de l'ère agricole – qui dura des millénaires- et celle de l'ère industrielle – qui dura deux cent ans. le poète oppose ces deux époques, en partant des campagnes hallucinées où la vie est souvent une question de survie aux intempéries, aux maladies, aux famines pour arriver aux villes tentaculaires qui envahissent peu à peu les campagnes dépeuplées. Les paysans, « les gens qui n'ont rien devant eux que l'infini de la grand-route », migrent vers les villes, vers le mirage d'une vie facile. Cette ville qui va jusqu'à attirer la mer elle-même «toute la mer va en ville ! »
Carrefour entre des sentiments contradictoires : nostalgie des temps anciens, néanmoins teintée de réalisme, et fascination pour les temps modernes, tout en restant là aussi très lucide … car toujours les hommes modestes – la plupart des hommes- restent aliénés. Les hommes ont changé de croyance, abandonnant Dieu et la superstition pour épouser le nouveau culte, celui de l'argent.
Carrefour entre deux périodes de la vie de Verhaeren : entre la période très noire du début de sa vie d'adulte et des moments plus apaisés ici. D'aucuns diront qu'entretemps le poète a rencontré l'amour et s'est marié … Mais toujours l'homme éprouve des difficultés à trouver sa place.
C'est une série de tableaux de la Belgique de la fin du XIXème siècle, entrecoupés de « chansons du fou », qui apporte un peu de légèreté et de fantaisie dans ces paysages souvent mornes. Fou de douleur à cause de la vie dure, ou fou parce que personne ne viendra les sauver de leur pauvres conditions de mortels, même pas les morts, même pas la religion. Ou fou parce que tout va trop vite. Ou réaction légitime face à un monde où la Raison est placée sur un piédestal et devient mode de pensée dominant ? En opposition ou en complétement de ces chansons, dans la partie des villes hallucinées, on lit les portraits de statues, figées dans la ville, dans la mort et dans l'histoire…
C'est une poésie très picturale. Emile Verhaeren disait lui-même en 1881 : « Il faut fonder dans la Poésie une école flamande, digne de sa soeur aînée, la fille des peintres». Et certains poèmes font penser à Monet (le port, la ville …), ou au sombre Ensor et aux tableaux fantasques de Khnopff.
J'y ai trouvé les paysages de Marcinelle, les bords de Meuse à Seraing, les usines de tissage de la vallée de la Lys, du temps où la Belgique était la deuxième puissance industrielle au monde. J'y ai aussi retrouvé les paysages de mon enfance, dans cette Flandre Occidentale, de ce Westhoek si éloignée de la région d'Anvers que Verhaeren habitait. Preuve que la Flandre n'est qu'une vaste plaine, un immense plat pays qui craque sous le vent de novembre. Mais vous savez déjà tout ça.
Carrefour entre deux époques, celle de l'ère agricole – qui dura des millénaires- et celle de l'ère industrielle – qui dura deux cent ans. le poète oppose ces deux époques, en partant des campagnes hallucinées où la vie est souvent une question de survie aux intempéries, aux maladies, aux famines pour arriver aux villes tentaculaires qui envahissent peu à peu les campagnes dépeuplées. Les paysans, « les gens qui n'ont rien devant eux que l'infini de la grand-route », migrent vers les villes, vers le mirage d'une vie facile. Cette ville qui va jusqu'à attirer la mer elle-même «toute la mer va en ville ! »
Carrefour entre des sentiments contradictoires : nostalgie des temps anciens, néanmoins teintée de réalisme, et fascination pour les temps modernes, tout en restant là aussi très lucide … car toujours les hommes modestes – la plupart des hommes- restent aliénés. Les hommes ont changé de croyance, abandonnant Dieu et la superstition pour épouser le nouveau culte, celui de l'argent.
Carrefour entre deux périodes de la vie de Verhaeren : entre la période très noire du début de sa vie d'adulte et des moments plus apaisés ici. D'aucuns diront qu'entretemps le poète a rencontré l'amour et s'est marié … Mais toujours l'homme éprouve des difficultés à trouver sa place.
C'est une série de tableaux de la Belgique de la fin du XIXème siècle, entrecoupés de « chansons du fou », qui apporte un peu de légèreté et de fantaisie dans ces paysages souvent mornes. Fou de douleur à cause de la vie dure, ou fou parce que personne ne viendra les sauver de leur pauvres conditions de mortels, même pas les morts, même pas la religion. Ou fou parce que tout va trop vite. Ou réaction légitime face à un monde où la Raison est placée sur un piédestal et devient mode de pensée dominant ? En opposition ou en complétement de ces chansons, dans la partie des villes hallucinées, on lit les portraits de statues, figées dans la ville, dans la mort et dans l'histoire…
C'est une poésie très picturale. Emile Verhaeren disait lui-même en 1881 : « Il faut fonder dans la Poésie une école flamande, digne de sa soeur aînée, la fille des peintres». Et certains poèmes font penser à Monet (le port, la ville …), ou au sombre Ensor et aux tableaux fantasques de Khnopff.
J'y ai trouvé les paysages de Marcinelle, les bords de Meuse à Seraing, les usines de tissage de la vallée de la Lys, du temps où la Belgique était la deuxième puissance industrielle au monde. J'y ai aussi retrouvé les paysages de mon enfance, dans cette Flandre Occidentale, de ce Westhoek si éloignée de la région d'Anvers que Verhaeren habitait. Preuve que la Flandre n'est qu'une vaste plaine, un immense plat pays qui craque sous le vent de novembre. Mais vous savez déjà tout ça.
Fin dix-neuvième, campagnes hallucinées, des tableaux forts de misère, mort et bestialité puis vient la ville tentaculaire, ses hauts fourneaux rugissant, et le port avec ses marins et sa luxure.
A la fois versifié et violent, c'est du rap avant l'heure, c'est géant!
A la fois versifié et violent, c'est du rap avant l'heure, c'est géant!
Émile Verhaeren, né à Saint-Amand (Anvers, Belgique) en 1855 et mort à Rouen en 1916, est un poète belge d'expression française.
Les poèmes des Campagnes hallucinées (1893) sont noirs et sans espoir. Tout y est lugubre et misérable. Rien ne peut retenir les hommes dans ces campagnes sinistrées et dévastées par la disette, la maladie, la misère. Ils sont condamnés à l'exode. le décor est hallucinant de pauvreté, comme si une catastrophe avait anéantie les plaines alentour.
Les mères traînent à leurs jupes
Leur trousseau long d'enfants bêlants,
Trinqueballés, trinqueballants ;
Les yeux clignants des vieux s'occupent
A refixer, une dernière fois,
Leur coin de terre morne et grise,
Où mord l'averse, où mord la bise,
Où mord le froid.
Suivent les gars des bordes,
Les bras maigres comme des cordes,
Sans plus d'orgueil, sans même plus
Le moindre élan vers les temps révolus
Et le bonheur des autrefois,
Sans plus la force en leurs dix doigts
De se serrer en poings contre le sort
Et la colère de la mort.
Les gens des champs, les gens d'ici
Ont du malheur à l'infini.
(Extrait du poème le départ)
C'est le temps de la révolution industrielle. C'est le temps où les hommes quittent les campagnes espérant trouver des meilleures conditions de vie dans les villes.
C'est le temps de l'urbanisation galopante, de la multiplication des cités ouvrières.
Les poèmes des Villes tentaculaires (1895) sont ceux d'un constat social, la misère est partout et les rêves des hommes, ayant tout quitté, ne sont pas à la hauteur de leur espoir.
Le réalisme de ces poèmes est époustouflant. Les descriptions des différents métiers observés sont implacables de vérité, même gestes toujours recommencés.
Les décors des usines sont étouffants, mortifères, à la limite du fantastique.
Mais ils peuvent être aussi un hymne à la modernité quand ils concernent ceux de la Bourse ou de la Recherche. Enfin, une note d'espoir émerge quand Verhaeren évoque les idées :
Sur la Ville, dont les désirs flamboient
Règnent, sans qu'on les voie,
Mais évidentes, les idées.
Même si dans l'ensemble, le ton donné aux poèmes est lugubre, on est saisi par la puissance des mots, par l'évocation des métiers et de l'effort humain, par la force des descriptions de la ville qui vampirise tous ceux qui l'approchent.
Émile Verhaeren a parfaitement su traduire ce moment charnière entre la fin de l'ère agricole et celle de la révolution industrielle.
Les poèmes des Campagnes hallucinées (1893) sont noirs et sans espoir. Tout y est lugubre et misérable. Rien ne peut retenir les hommes dans ces campagnes sinistrées et dévastées par la disette, la maladie, la misère. Ils sont condamnés à l'exode. le décor est hallucinant de pauvreté, comme si une catastrophe avait anéantie les plaines alentour.
Les mères traînent à leurs jupes
Leur trousseau long d'enfants bêlants,
Trinqueballés, trinqueballants ;
Les yeux clignants des vieux s'occupent
A refixer, une dernière fois,
Leur coin de terre morne et grise,
Où mord l'averse, où mord la bise,
Où mord le froid.
Suivent les gars des bordes,
Les bras maigres comme des cordes,
Sans plus d'orgueil, sans même plus
Le moindre élan vers les temps révolus
Et le bonheur des autrefois,
Sans plus la force en leurs dix doigts
De se serrer en poings contre le sort
Et la colère de la mort.
Les gens des champs, les gens d'ici
Ont du malheur à l'infini.
(Extrait du poème le départ)
C'est le temps de la révolution industrielle. C'est le temps où les hommes quittent les campagnes espérant trouver des meilleures conditions de vie dans les villes.
C'est le temps de l'urbanisation galopante, de la multiplication des cités ouvrières.
Les poèmes des Villes tentaculaires (1895) sont ceux d'un constat social, la misère est partout et les rêves des hommes, ayant tout quitté, ne sont pas à la hauteur de leur espoir.
Le réalisme de ces poèmes est époustouflant. Les descriptions des différents métiers observés sont implacables de vérité, même gestes toujours recommencés.
Les décors des usines sont étouffants, mortifères, à la limite du fantastique.
Mais ils peuvent être aussi un hymne à la modernité quand ils concernent ceux de la Bourse ou de la Recherche. Enfin, une note d'espoir émerge quand Verhaeren évoque les idées :
Sur la Ville, dont les désirs flamboient
Règnent, sans qu'on les voie,
Mais évidentes, les idées.
Même si dans l'ensemble, le ton donné aux poèmes est lugubre, on est saisi par la puissance des mots, par l'évocation des métiers et de l'effort humain, par la force des descriptions de la ville qui vampirise tous ceux qui l'approchent.
Émile Verhaeren a parfaitement su traduire ce moment charnière entre la fin de l'ère agricole et celle de la révolution industrielle.
Citations et extraits (57)
Voir plus
Ajouter une citation
La ville
Tous les chemins vont vers la ville.
Du fond des brumes,
Avec tous ses étages en voyage
Jusques au ciel, vers de plus hauts étages,
Comme d'un rêve, elle s'exhume.
Là-bas,
Ce sont des ponts musclés de fer,
Lancés, par bonds, à travers l'air ;
Ce sont des blocs et des colonnes
Que décorent Sphinx et Gorgones ;
Ce sont des tours sur des faubourgs ;
Ce sont des millions de toits
Dressant au ciel leurs angles droits :
C'est la ville tentaculaire,
Debout,
Au bout des plaines et des domaines.
Des clartés rouges
Qui bougent
Sur des poteaux et des grands mâts,
Même à midi, brûlent encor
Comme des oeufs de pourpre et d'or ;
Le haut soleil ne se voit pas :
Bouche de lumière, fermée
Par le charbon et la fumée.
Un fleuve de naphte et de poix
Bat les môles de pierre et les pontons de bois ;
Les sifflets crus des navires qui passent
Hurlent de peur dans le brouillard ;
Un fanal vert est leur regard
Vers l'océan et les espaces.
Des quais sonnent aux chocs de lourds fourgons ;
Des tombereaux grincent comme des gonds ;
Des balances de fer font choir des cubes d'ombre
Et les glissent soudain en des sous-sols de feu ;
Des ponts s'ouvrant par le milieu,
Entre les mâts touffus dressent des gibets sombres
Et des lettres de cuivre inscrivent l'univers,
Immensément, par à travers
Les toits, les corniches et les murailles,
Face à face, comme en bataille.
Et tout là-bas, passent chevaux et roues,
Filent les trains, vole l'effort,
Jusqu'aux gares, dressant, telles des proues
Immobiles, de mille en mille, un fronton d'or.
Des rails ramifiés y descendent sous terre
Comme en des puits et des cratères
Pour reparaître au loin en réseaux clairs d'éclairs
Dans le vacarme et la poussière.
C'est la ville tentaculaire.
La rue - et ses remous comme des câbles
Noués autour des monuments -
Fuit et revient en longs enlacements ;
Et ses foules inextricables,
Les mains folles, les pas fiévreux,
La haine aux yeux,
Happent des dents le temps qui les devance.
A l'aube, au soir, la nuit,
Dans la hâte, le tumulte, le bruit,
Elles jettent vers le hasard l'âpre semence
De leur labeur que l'heure emporte.
Et les comptoirs mornes et noirs
Et les bureaux louches et faux
Et les banques battent des portes
Aux coups de vent de la démence.
Le long du fleuve, une lumière ouatée,
Trouble et lourde, comme un haillon qui brûle,
De réverbère en réverbère se recule.
La vie avec des flots d'alcool est fermentée.
Les bars ouvrent sur les trottoirs
Leurs tabernacles de miroirs
Où se mirent l'ivresse et la bataille ;
Une aveugle s'appuie à la muraille
Et vend de la lumière, en des boîtes d'un sou ;
La débauche et le vol s'accouplent en leur trou ;
La brume immense et rousse
Parfois jusqu'à la mer recule et se retrousse
Et c'est alors comme un grand cri jeté
Vers le soleil et sa clarté :
Places, bazars, gares, marchés,
Exaspèrent si fort leur vaste turbulence
Que les mourants cherchent en vain le moment de silence
Qu'il faut aux yeux pour se fermer.
Telle, le jour - pourtant, lorsque les soirs
Sculptent le firmament, de leurs marteaux d'ébène,
La ville au loin s'étale et domine la plaine
Comme un nocturne et colossal espoir ;
Elle surgit : désir, splendeur, hantise ;
Sa clarté se projette en lueurs jusqu'aux cieux,
Son gaz myriadaire en buissons d'or s'attise,
Ses rails sont des chemins audacieux
Vers le bonheur fallacieux
Que la fortune et la force accompagnent ;
Ses murs se dessinent pareils à une armée
Et ce qui vient d'elle encor de brume et de fumée
Arrive en appels clairs vers les campagnes.
C'est la ville tentaculaire,
La pieuvre ardente et l'ossuaire
Et la carcasse solennelle.
Et les chemins d'ici s'en vont à l'infini
Vers elle.
Tous les chemins vont vers la ville.
Du fond des brumes,
Avec tous ses étages en voyage
Jusques au ciel, vers de plus hauts étages,
Comme d'un rêve, elle s'exhume.
Là-bas,
Ce sont des ponts musclés de fer,
Lancés, par bonds, à travers l'air ;
Ce sont des blocs et des colonnes
Que décorent Sphinx et Gorgones ;
Ce sont des tours sur des faubourgs ;
Ce sont des millions de toits
Dressant au ciel leurs angles droits :
C'est la ville tentaculaire,
Debout,
Au bout des plaines et des domaines.
Des clartés rouges
Qui bougent
Sur des poteaux et des grands mâts,
Même à midi, brûlent encor
Comme des oeufs de pourpre et d'or ;
Le haut soleil ne se voit pas :
Bouche de lumière, fermée
Par le charbon et la fumée.
Un fleuve de naphte et de poix
Bat les môles de pierre et les pontons de bois ;
Les sifflets crus des navires qui passent
Hurlent de peur dans le brouillard ;
Un fanal vert est leur regard
Vers l'océan et les espaces.
Des quais sonnent aux chocs de lourds fourgons ;
Des tombereaux grincent comme des gonds ;
Des balances de fer font choir des cubes d'ombre
Et les glissent soudain en des sous-sols de feu ;
Des ponts s'ouvrant par le milieu,
Entre les mâts touffus dressent des gibets sombres
Et des lettres de cuivre inscrivent l'univers,
Immensément, par à travers
Les toits, les corniches et les murailles,
Face à face, comme en bataille.
Et tout là-bas, passent chevaux et roues,
Filent les trains, vole l'effort,
Jusqu'aux gares, dressant, telles des proues
Immobiles, de mille en mille, un fronton d'or.
Des rails ramifiés y descendent sous terre
Comme en des puits et des cratères
Pour reparaître au loin en réseaux clairs d'éclairs
Dans le vacarme et la poussière.
C'est la ville tentaculaire.
La rue - et ses remous comme des câbles
Noués autour des monuments -
Fuit et revient en longs enlacements ;
Et ses foules inextricables,
Les mains folles, les pas fiévreux,
La haine aux yeux,
Happent des dents le temps qui les devance.
A l'aube, au soir, la nuit,
Dans la hâte, le tumulte, le bruit,
Elles jettent vers le hasard l'âpre semence
De leur labeur que l'heure emporte.
Et les comptoirs mornes et noirs
Et les bureaux louches et faux
Et les banques battent des portes
Aux coups de vent de la démence.
Le long du fleuve, une lumière ouatée,
Trouble et lourde, comme un haillon qui brûle,
De réverbère en réverbère se recule.
La vie avec des flots d'alcool est fermentée.
Les bars ouvrent sur les trottoirs
Leurs tabernacles de miroirs
Où se mirent l'ivresse et la bataille ;
Une aveugle s'appuie à la muraille
Et vend de la lumière, en des boîtes d'un sou ;
La débauche et le vol s'accouplent en leur trou ;
La brume immense et rousse
Parfois jusqu'à la mer recule et se retrousse
Et c'est alors comme un grand cri jeté
Vers le soleil et sa clarté :
Places, bazars, gares, marchés,
Exaspèrent si fort leur vaste turbulence
Que les mourants cherchent en vain le moment de silence
Qu'il faut aux yeux pour se fermer.
Telle, le jour - pourtant, lorsque les soirs
Sculptent le firmament, de leurs marteaux d'ébène,
La ville au loin s'étale et domine la plaine
Comme un nocturne et colossal espoir ;
Elle surgit : désir, splendeur, hantise ;
Sa clarté se projette en lueurs jusqu'aux cieux,
Son gaz myriadaire en buissons d'or s'attise,
Ses rails sont des chemins audacieux
Vers le bonheur fallacieux
Que la fortune et la force accompagnent ;
Ses murs se dessinent pareils à une armée
Et ce qui vient d'elle encor de brume et de fumée
Arrive en appels clairs vers les campagnes.
C'est la ville tentaculaire,
La pieuvre ardente et l'ossuaire
Et la carcasse solennelle.
Et les chemins d'ici s'en vont à l'infini
Vers elle.
La mort
Avec ses larges corbillards
Ornés de plumes majuscules,
Par les matins, dans les brouillards,
La mort circule.
Parée et noire et opulente,
Tambours voilés, musiques lentes,
Avec ses larges corbillards,
Flanqués de quatre lampadaires,
La Mort s'étale et s'exagère.
Pareils aux nocturnes trésors,
Les gros cercueils écussonnés
- Larmes d'argent et blasons d'or -
Ecoutent l'heure éclatante des glas
Que les cloches jettent, là-bas :
L'heure qui tombe, avec des bonds
Et des sanglots, sur les maisons,
L'heure qui meurt sur les demeures,
Avec des bonds et des sanglots de plomb.
Parée et noire et opulente,
Au cri des orgues violentes
Qui la célèbrent,
La mort tout en ténèbres
Règne, comme une idole assise,
Sous la coupole des églises.
Des feux, tordus comme des hydres,
Se hérissent, autour du catafalque immense
OÙ des anges, tenant des faulx et des cleps
Dressent leur véhémence,
Clairons dardés, vers le néant.
Le vide en est grandi sous le transept béan
De hautes voix d'enfants
jettent vers les miséricordes
Des cris tordus comme des cordes,
Tandis que les vieilles murailles
Montent, comme des linceuls blancs,
Autour du bloc formidable et branlant
De ces massives funérailles.
Drapée en noir et familière,
La Mort s'en va le long des rues
Longues et linéaires.
Drapée en noir, comme le soir,
La vieille Mort agressive et bourrue
S'en va par les quartiers
Des boutiques et des métiers,
En carrosse qui se rehausse
De gros lambris exorbitants,
Couleur d'usure et d'ancien temps.
Drapée en noir, la Mort
Cassant, entre ses mains, le sort
Des gens méticuleux et réfléchis
Qui s'exténuent, en leurs logis,
Vainement, à faire fortune,
La Mort soudaine et importune
Les met en ordre dans leurs bières
Comme en des cases régulières'.
Et les cloches sonnent péniblement
Un malheureux enterrement,
Sur le défunt, que l'on trimballe,
Par les églises colossales,
Vers un coin d'ombre, où quelques cierg
Pauvres flammes, brÛlent, devant la Vieri
Vêtue en noir et besogneuse,
La Mort gagne jusqu'aux faubourgs,
En chariot branlant et lourd,
Avec de vieilles haridelles
Qu'elle flagelle
Chaque matin, vers quels destins ?
Vêtue en noir,
La Mort enjambe le trottoir
Et l'égout pâle, où se mirent les bornes,
Qui vont là-bas, une à une, vers les champs mornes;
Et leste et rude et dédaigneuse
Gagne les escaliers et s'arrête sur les paliers
OÙ l'on entend pleurer et sangloter,
Derrière la porte entr'ouverte,
Des gens laissant l'espoir tomber,
Inerte.
Et dans la pluie indéfinie,
Une petite église de banlieue,
Très maigrement, tinte un adieu,
Sur la bière de sapin blanc
Qui se rapproche, avec des gens dolents,
Par les routes, silencieusement.
Telle la Mort journalière et logique
Qui fait son ceuvre et la marque de croix
Et d'adieux mornes et de voix
Criant vers l'inconnu les espoirs liturgiques.
Mais d'autres fois, c'est la Mort grande et sa
Avec son aile au loin ramante,
Vers les villes de l'épouvante.
Un ciel étrange et roux brûle la terre moite
Des tours noires s'étirent droites
Telles des bras, dans la terreur des cré
Les nuits tombent comme épaissies,
Les nuits lourdes, les nuits moisies,
OÙ, dans l'air gras et la chaleur rancie,
Tombereaux pleins, la Mort circule.
Ample et géante comme l'ombre,
Du haut en bas des maisons sombres,
On l'écoute glisser, rapide et haletante.
La peur du jour qui vient, la peur de toute attente,
La peur de tout instant qui se décoche,
Persécute les coeurs, partout,
Et redresse, soudain, en leur sueur, debout
Ceux qui, vers le minuit, songent au matin
Les hôpitaux gonflés de maladies,
Avec les yeux fiévreux de leurs fenêtres roug
Regardent le ciel trouble, oÙ rien ne bouge
Ni ne répond aux détresses grandies.
Les égouts roulent le poison
Et les acides et les chlores,
Couleur de nacre et de phosphore,
Vainement tuent sa floraison.
De gros bourdons résonnent
Pour tout le monde, pour personne
Les églises barricadent leur seuil,
Devant la masse des cercueils.
Et l'on entend, en galops éperdus,
La mort passer et les bières que l'on transporte
Aux nécropoles, dont les portes,
Ni nuit ni jour, ne ferment plus.
Tragique et noire et légendaire,
Les pieds gluants, les gestes fous,
La Mort balaie en un grand trou
La ville entière au cimetière.
Les usines.
Se regardant avec les yeux cassés de leurs fenêtres
Et se mirant dans l'eau de poix et de salpêtre
D'un canal droit, marquant sa barre à l'infini, .
Face à face, le long des quais d'ombre et de nuit,
Par à travers les faubourgs lourds
Et la misère en pleurs de ces faubourgs,
Ronflent terriblement usine et fabriques.
Rectangles de granit et monuments de briques,
Et longs murs noirs durant des lieues,
Immensément, par les banlieues ;
Et sur les toits, dans le brouillard, aiguillonnées
De fers et de paratonnerres,
Les cheminées.
Se regardant de leurs yeux noirs et symétriques,
Par la banlieue, à l'infini.
Ronflent le jour, la nuit,
Les usines et les fabriques.
Oh les quartiers rouillés de pluie et leurs grand-rues !
Et les femmes et leurs guenilles apparues,
Et les squares, où s'ouvre, en des caries
De plâtras blanc et de scories,
Une flore pâle et pourrie.
Aux carrefours, porte ouverte, les bars :
Etains, cuivres, miroirs hagards,
Dressoirs d'ébène et flacons fols
D'où luit l'alcool
Et sa lueur vers les trottoirs.
Et des pintes qui tout à coup rayonnent,
Sur le comptoir, en pyramides de couronnes ;
Et des gens soûls, debout,
Dont les larges langues lappent, sans phrases,
Les ales d'or et le whisky, couleur topaze.
Par à travers les faubourgs lourds
Et la misère en pleurs de ces faubourgs,
Et les troubles et mornes voisinages,
Et les haines s'entre-croisant de gens à gens
Et de ménages à ménages,
Et le vol même entre indigents,
Grondent, au fond des cours, toujours,
Les haletants battements sourds
Des usines et des fabriques symétriques.
Ici, sous de grands toits où scintille le verre,
La vapeur se condense en force prisonnière :
Des mâchoires d'acier mordent et fument ;
De grands marteaux monumentaux
Broient des blocs d'or sur des enclumes,
Et, dans un coin, s'illuminent les fontes
En brasiers tors et effrénés qu'on dompte.
Là-bas, les doigts méticuleux des métiers prestes,
A bruits menus, à petits gestes,
Tissent des draps, avec des fils qui vibrent
Légers et fin comme des fibres.
Des bandes de cuir transversales
Courent de l'un à l'autre bout des salles
Et les volants larges et violents
Tournent, pareils aux ailes dans le vent
Des moulins fous, sous les rafales.
Un jour de cour avare et ras
Frôle, par à travers les carreaux gras
Et humides d'un soupirail,
Chaque travail.
Automatiques et minutieux,
Des ouvriers silencieux
Règlent le mouvement
D'universel tictacquement
Qui fermente de fièvre et de folie
Et déchiquette, avec ses dents d'entêtement,
La parole humaine abolie.
Plus loin, un vacarme tonnant de chocs
Monte de l'ombre et s'érige par blocs ;
Et, tout à coup, cassant l'élan des violences,
Des murs de bruit semblent tomber
Et se taire, dans une mare de silence,
Tandis que les appels exacerbés
Des sifflets crus et des signaux
Hurlent soudain vers les fanaux,
Dressant leurs feux sauvages,
En buissons d'or, vers les nuages.
Et tout autour, ainsi qu'une ceinture,
Là-bas, de nocturnes architectures,
Voici les docks, les ports, les ponts, les phares
Et les gares folles de tintamarres ;
Et plus lointains encor des toits d'autres usines
Et des cuves et des forges et des cuisines
Formidables de naphte et de résines
Dont les meutes de feu et de lueurs grandies
Mordent parfois le ciel, à coups d'abois et d'incendies.
Au long du vieux canal à l'infini
Par à travers l'immensité de la misère
Des chemins noirs et des routes de pierre,
Les nuits, les jours, toujours,
Ronflent les continus battements sourds,
Dans les faubourgs,
Des fabriques et des usines symétriques.
L'aube s'essuie
A leurs carrés de suie
Midi et son soleil hagard
Comme un aveugle, errent par leurs brouillards ;
Seul, quand au bout de la semaine, au soir,
La nuit se laisse en ses ténèbres choir,
L'âpre effort s'interrompt, mais demeure en arrêt,
Comme un marteau sur une enclume,
Et l'ombre, au loin, parmi les carrefours, paraît
De la brume d'or qui s'allume.
Se regardant avec les yeux cassés de leurs fenêtres
Et se mirant dans l'eau de poix et de salpêtre
D'un canal droit, marquant sa barre à l'infini, .
Face à face, le long des quais d'ombre et de nuit,
Par à travers les faubourgs lourds
Et la misère en pleurs de ces faubourgs,
Ronflent terriblement usine et fabriques.
Rectangles de granit et monuments de briques,
Et longs murs noirs durant des lieues,
Immensément, par les banlieues ;
Et sur les toits, dans le brouillard, aiguillonnées
De fers et de paratonnerres,
Les cheminées.
Se regardant de leurs yeux noirs et symétriques,
Par la banlieue, à l'infini.
Ronflent le jour, la nuit,
Les usines et les fabriques.
Oh les quartiers rouillés de pluie et leurs grand-rues !
Et les femmes et leurs guenilles apparues,
Et les squares, où s'ouvre, en des caries
De plâtras blanc et de scories,
Une flore pâle et pourrie.
Aux carrefours, porte ouverte, les bars :
Etains, cuivres, miroirs hagards,
Dressoirs d'ébène et flacons fols
D'où luit l'alcool
Et sa lueur vers les trottoirs.
Et des pintes qui tout à coup rayonnent,
Sur le comptoir, en pyramides de couronnes ;
Et des gens soûls, debout,
Dont les larges langues lappent, sans phrases,
Les ales d'or et le whisky, couleur topaze.
Par à travers les faubourgs lourds
Et la misère en pleurs de ces faubourgs,
Et les troubles et mornes voisinages,
Et les haines s'entre-croisant de gens à gens
Et de ménages à ménages,
Et le vol même entre indigents,
Grondent, au fond des cours, toujours,
Les haletants battements sourds
Des usines et des fabriques symétriques.
Ici, sous de grands toits où scintille le verre,
La vapeur se condense en force prisonnière :
Des mâchoires d'acier mordent et fument ;
De grands marteaux monumentaux
Broient des blocs d'or sur des enclumes,
Et, dans un coin, s'illuminent les fontes
En brasiers tors et effrénés qu'on dompte.
Là-bas, les doigts méticuleux des métiers prestes,
A bruits menus, à petits gestes,
Tissent des draps, avec des fils qui vibrent
Légers et fin comme des fibres.
Des bandes de cuir transversales
Courent de l'un à l'autre bout des salles
Et les volants larges et violents
Tournent, pareils aux ailes dans le vent
Des moulins fous, sous les rafales.
Un jour de cour avare et ras
Frôle, par à travers les carreaux gras
Et humides d'un soupirail,
Chaque travail.
Automatiques et minutieux,
Des ouvriers silencieux
Règlent le mouvement
D'universel tictacquement
Qui fermente de fièvre et de folie
Et déchiquette, avec ses dents d'entêtement,
La parole humaine abolie.
Plus loin, un vacarme tonnant de chocs
Monte de l'ombre et s'érige par blocs ;
Et, tout à coup, cassant l'élan des violences,
Des murs de bruit semblent tomber
Et se taire, dans une mare de silence,
Tandis que les appels exacerbés
Des sifflets crus et des signaux
Hurlent soudain vers les fanaux,
Dressant leurs feux sauvages,
En buissons d'or, vers les nuages.
Et tout autour, ainsi qu'une ceinture,
Là-bas, de nocturnes architectures,
Voici les docks, les ports, les ponts, les phares
Et les gares folles de tintamarres ;
Et plus lointains encor des toits d'autres usines
Et des cuves et des forges et des cuisines
Formidables de naphte et de résines
Dont les meutes de feu et de lueurs grandies
Mordent parfois le ciel, à coups d'abois et d'incendies.
Au long du vieux canal à l'infini
Par à travers l'immensité de la misère
Des chemins noirs et des routes de pierre,
Les nuits, les jours, toujours,
Ronflent les continus battements sourds,
Dans les faubourgs,
Des fabriques et des usines symétriques.
L'aube s'essuie
A leurs carrés de suie
Midi et son soleil hagard
Comme un aveugle, errent par leurs brouillards ;
Seul, quand au bout de la semaine, au soir,
La nuit se laisse en ses ténèbres choir,
L'âpre effort s'interrompt, mais demeure en arrêt,
Comme un marteau sur une enclume,
Et l'ombre, au loin, parmi les carrefours, paraît
De la brume d'or qui s'allume.
UNE STATUE
Prenant pour guide clair l'astre qu'était son âme,
A travers des pays d'ouragan et de flammes,
Il s'en était allé si loin vers l'inconnu
Que son siècle vieux et chenu,
Toussant la peur, au vent trop fort de sa pensée,
L'avait férocement enseveli sous la risée.
Il en était ainsi, depuis des tas d'années
Au long des temps échelonnées,
Quand un matin la ville, où son nom était mort,
Se ressouvint de lui - homme âpre et grandiose-
Et l'exalta et le grandit en une pose
De penseur accoudé sur un roc d'ombre et d'or.
On inscrivit sur ce granit de gloire
L'exil subi, la faim et la prison,
Et l'on tressa, comme une floraison,
Son crime ancien, autour de sa mémoire.
On lui pris sa pensée et l'on en fit des lois;
On lui pris sa folie et l'on en fit de l'ordre;
Et ses railleurs d'antan ne savaient plus où mordre
Le battant de tocsin qui sautait dans sa voix.
Et seul, son geste fier domina la citée
Où l'on voyait briller, agrandi de mystère,
Son front large, puissant, tranquille et comme austère
D'être à la fois d'un temps et de l'éternité.
Prenant pour guide clair l'astre qu'était son âme,
A travers des pays d'ouragan et de flammes,
Il s'en était allé si loin vers l'inconnu
Que son siècle vieux et chenu,
Toussant la peur, au vent trop fort de sa pensée,
L'avait férocement enseveli sous la risée.
Il en était ainsi, depuis des tas d'années
Au long des temps échelonnées,
Quand un matin la ville, où son nom était mort,
Se ressouvint de lui - homme âpre et grandiose-
Et l'exalta et le grandit en une pose
De penseur accoudé sur un roc d'ombre et d'or.
On inscrivit sur ce granit de gloire
L'exil subi, la faim et la prison,
Et l'on tressa, comme une floraison,
Son crime ancien, autour de sa mémoire.
On lui pris sa pensée et l'on en fit des lois;
On lui pris sa folie et l'on en fit de l'ordre;
Et ses railleurs d'antan ne savaient plus où mordre
Le battant de tocsin qui sautait dans sa voix.
Et seul, son geste fier domina la citée
Où l'on voyait briller, agrandi de mystère,
Son front large, puissant, tranquille et comme austère
D'être à la fois d'un temps et de l'éternité.
Chanson de fou
Vous aurez beau crier contre la terre,
La bouche dans le fossé,
Jamais aucun des trépassés,
Ne répondra à vos clameurs amères.
Ils sont bien morts, les morts,
Ceux qui firent jadis la campagne féconde ;
Ils font l’immense entassement de morts
Qui pourrissent, aux quatre coins du monde,
Les morts.
Alors
Les champs étaient maîtres des villes,
Le même esprit servile
Ployait partout les fronts et les échines,
Et nul encor ne pouvait voir
Dressé, au fond du soir,
Les bras hagards et formidables des machines.
Vous aurez beau crier contre la terre,
La bouche dans le fossé :
Ceux qui jadis étaient les trépassés
Sont aujourd’hui, jusqu’au fond de la terre,
Les morts.
Vous aurez beau crier contre la terre,
La bouche dans le fossé,
Jamais aucun des trépassés,
Ne répondra à vos clameurs amères.
Ils sont bien morts, les morts,
Ceux qui firent jadis la campagne féconde ;
Ils font l’immense entassement de morts
Qui pourrissent, aux quatre coins du monde,
Les morts.
Alors
Les champs étaient maîtres des villes,
Le même esprit servile
Ployait partout les fronts et les échines,
Et nul encor ne pouvait voir
Dressé, au fond du soir,
Les bras hagards et formidables des machines.
Vous aurez beau crier contre la terre,
La bouche dans le fossé :
Ceux qui jadis étaient les trépassés
Sont aujourd’hui, jusqu’au fond de la terre,
Les morts.
Videos de Émile Verhaeren (17)
Voir plusAjouter une vidéo
Les plus populaires : Littérature française
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Émile Verhaeren (82)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Testez vos connaissances en poésie ! (niveau difficile)
Dans quelle ville Verlaine tira-t-il sur Rimbaud, le blessant légèrement au poignet ?
Paris
Marseille
Bruxelles
Londres
10 questions
1228 lecteurs ont répondu
Thèmes :
poésie
, poèmes
, poètesCréer un quiz sur ce livre1228 lecteurs ont répondu