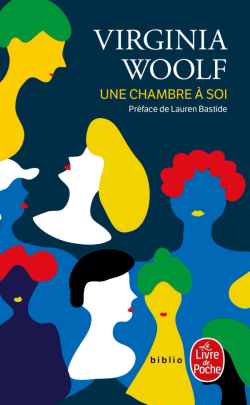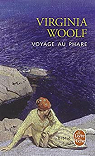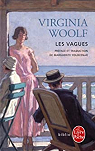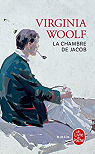Critiques filtrées sur 3 étoiles
J'ai été très déçue par cette lecture. J'imaginais que ce texte serait très puissant.
L'idée de base, très bonne, consiste à dire que pour écrire, une femme doit avoir un endroit à elle, isolé, pour travailler et de l'argent pour ne pas se soucier de problèmes matériels.
C'est tout.
Il n'y avait pas besoin d'en faire une centaine de pages...
L'idée de base, très bonne, consiste à dire que pour écrire, une femme doit avoir un endroit à elle, isolé, pour travailler et de l'argent pour ne pas se soucier de problèmes matériels.
C'est tout.
Il n'y avait pas besoin d'en faire une centaine de pages...
Le fond de cet essai est vraiment intéressant. L'autrice y raconte le destin des femmes-écrivain à travers des figures comme Jane Austen.
J'ai parfois frissonné en voyant comment les femmes étaient autrefois traitées.
J'aurai aimé accrocher beaucoup plus à ce livre.
Mais ça ne l'a pas fait. J'ai eu beaucoup de soucis avec la plume que j'ai trouvé trop recherchée, des phrases trop longues où j'ai perdu le sens du propos.
Beaucoup de fioritures dans un livre pourtant très petit.
Je ne comprenais pas certains passages que je lisais et j'avais vraiment l'impression de perdre du temps.
Du coup, j'ai préféré abandonner cette lecture à un chapitre de la fin.
J'ai parfois frissonné en voyant comment les femmes étaient autrefois traitées.
J'aurai aimé accrocher beaucoup plus à ce livre.
Mais ça ne l'a pas fait. J'ai eu beaucoup de soucis avec la plume que j'ai trouvé trop recherchée, des phrases trop longues où j'ai perdu le sens du propos.
Beaucoup de fioritures dans un livre pourtant très petit.
Je ne comprenais pas certains passages que je lisais et j'avais vraiment l'impression de perdre du temps.
Du coup, j'ai préféré abandonner cette lecture à un chapitre de la fin.
À travers cet essai, la narratrice décrit (le peu) de place qu'occupent les femmes en tant que auteures dans l'Histoire et notamment dans la littérature britannique.
Elle passe en revue les contraintes auxquelles sont confrontées les femmes dans la vie ordinaire, contraintes incompatibles la plupart du temps avec une activité d'écriture : éducation des enfants, le respect des moeurs qui interdit aux femmes de voyager seule, d'avoir accès aux bibliothèques universitaires, etc.
Elle évoque à la fois avec contrariété et admiration, les ruses de Jane Austen qui cachait ses manuscrits en s'interrompant à tout instant car son rôle dans la société ne lui permettait pas de s'isoler pour s'adonner à l'écriture. Et puisque les hommes considéraient qu'une femme n'a pas les capacités intellectuelles pour se livrer à un art quelconque, elle se protégeait ainsi des remarques sarcastiques de ceux qui auraient eu la curiosité de lire quelques unes de ses lignes.
Virginia Woolf prône ici les bases de l'indépendance des femmes : la liberté d'user de son argent et un endroit pour s'isoler. Ainsi, elles pourront donner libre court à leur talent dans des conditions propices. Il restera encore à convaincre les hommes de celui-ci.
Cet essai, resté dans les annales du militantisme féministe, d'un ton à la fois gracieux et féroce, est un modèle d'argumentaire dont la lecture, quoique laborieuse à mon goût, montre que presque un siècle après, beaucoup reste à faire.
Une chambre à soi est dans mon pense-bête depuis un long moment. J'ai fini par l'acheter et le lire, car au détour d'une allée chez un libraire, je suis tombée sur une magnifique édition de 10|18 Collector, à coup de doré sur bleu marine. Mon coeur de graphiste a fait fondre mon coeur de lectrice. Si seulement tous les livres pouvaient être si magnifiquement couverturés !
La lecture a été plus laborieuse, vu que ce livre n'est pas une fiction mais un essai pamphlétaire (j'irai voir ce que ça veut dire plus tard). Aussi, j'ai mis quelques heures à lire ces malheureuses 160 pages.
L'auteur nous dresse le parcours de la Femme avec un grand F dans la littérature. Pourquoi les femmes n'écrivent pas avant une certaine période ? Pourquoi se manifestent-elles comme auteurs à un instant donné ? Elle nous livre son analyse ainsi que ses espoirs pour le futur (le sien évidemment concrétisé actuellement, du moins, en partie).
Très belle découverte même si j'attends de lire une de ses fictions avant de me décider quant à si j'aime son oeuvre ou pas.
La lecture a été plus laborieuse, vu que ce livre n'est pas une fiction mais un essai pamphlétaire (j'irai voir ce que ça veut dire plus tard). Aussi, j'ai mis quelques heures à lire ces malheureuses 160 pages.
L'auteur nous dresse le parcours de la Femme avec un grand F dans la littérature. Pourquoi les femmes n'écrivent pas avant une certaine période ? Pourquoi se manifestent-elles comme auteurs à un instant donné ? Elle nous livre son analyse ainsi que ses espoirs pour le futur (le sien évidemment concrétisé actuellement, du moins, en partie).
Très belle découverte même si j'attends de lire une de ses fictions avant de me décider quant à si j'aime son oeuvre ou pas.
Dans cet essai qui transpose des conférences données à un auditoire féminin, VW parle des femmes et du roman, et plus précisément de la sous-représentation des femmes comme auteures. On connaît la position dont elle joue avec trois alias (« Appelez-moi Mary Beton, Mary Seton, Mary Carmichael ou de tout autre nom qui vous plaira » [p 9]) : il faut à une femme pour écrire une chambre et de l'argent. Cette exigence est précisément datée : son alias Marie Beton, morte d'une chute de cheval le jour de l'accès des femmes au droit de vote, lui a légué une rente de 500 livres, rente qui est plus précieuse à l'auteure que son droit civique.
Sur quoi vient à l'esprit que plusieurs nécessiteux ont été de grands écrivains. Mais notre auteure ajoute un argument imparable : à la différence des hommes, les femmes ont été débordées par les tâches domestiques, et, désirant écrire, n'ont pas été préparées, puis, écrivant, ont été découragées, enfermées ou moquées. Fait avéré du temps de Shakespeare, dont VW imagine la soeur, fait moins certain au dix-neuvième siècle où elle cite sa trinité (Jane Austen, George Eliot, Emily Brontë), et fait douteux pour ses contemporaines. VW insiste sur son premier argument : neuf au moins des douze écrivains de son panthéon contemporain ont été universitaires et riches — l'écriture serait une spécialité académique en Angleterre où les enseignants seraient bien payés, mais elle n'a pas cette image en France. C'est oublier un troisième obstacle, la prise de risque, qui a été surmonté par des hommes et des femmes du dix-huitième au vingtième siècle. Citons en France Olympe de Gouges, George Sand à ses débuts, ou Alexandra David Neal qui mendiait au Tibet quand VW donnait ses conférences à Oxbridge.
Bref, VW, issue d'un milieu riche et brillant, n'est guère convaincante comme féministe et — disons — faible sur le plan politique. C'est pourquoi sans doute la quatrième de couverture décrit « Une chambre à soi » par un oxymore : « Un délicieux pamphlet ». La leçon à retenir par une auteure contemporaine — à supposer qu'elle en ait besoin — est celle de Mary Carmichael, l'alias numéro trois : tenir comme stérile le débat sur le passé et ne pas écrire en complément ni par opposition aux hommes, même si sa mise en garde confine au masochisme : « Le poids, la démarche, l'allure d'un esprit masculin, sont par trop différents du poids, de la démarche, de l'allure de l'esprit d'une femme pour qu'elle puisse y prendre quelque chose de substantiel. le singe, ici, est par trop éloigné de son modèle pour persévérer dans ses efforts » (p 113).
Il faut lire « Une chambre à soi » pour d'autres plaisirs. Pour la culture, l'intelligence et la finesse de l'auteure ; pour son humour et son sens de l'observation ; pour les surprises de son raisonnement et ses coqs à l'âne : « Considérons, tout d'abord, les faits. Il faut neuf mois avant que naisse un bébé. Puis il y a la naissance du bébé, puis trois ou quatre mois passés à nourrir le bébé. Après le sevrage on peut compter sur cinq années passées à jouer avec le bébé. Car il semble qu'on ne puisse pas laisser les enfants se débrouiller seul dans les rues » (p 34). « Il y avait ces affables personnages à qui les rues servent de club, qui saluent des hommes dans des charrettes et donnent des renseignements sans y être priés. Il y avait aussi des enterrements, devant lesquels les hommes, se souvenant soudain du provisoire de leur propre corps, se découvraient. Puis un monsieur, des plus distingués, descendit lentement les marches d'une maison et s'arrêta pour éviter d'entrer en collision avec une dame tumultueuse qui, d'une façon ou d'une autre, avait acquis un splendide manteau de fourrure et un bouquet de violettes de Parme ». Et enfin, pour la colère qu'elle laisse tout de même pointer : « Je pensais à ce vieux monsieur, mort maintenant, mais qui était, je crois, évêque : il déclarait qu'il était impossible qu'une femme ait eu dans le passé, ait dans le présent ou dans l'avenir le génie de Shakespeare. Il adressait aux journaux des articles sur ce sujet. C'est lui aussi qui déclara à une dame, qui s'était renseignée auprès de lui, qu'en vérité les chats n'allaient pas au ciel bien que, ajouta-t-il, ils aient une certaine forme d'âme. Quelle somme de réflexions ces vieux messieurs ont dépensée pour notre salut ? Comme les bornes de l'ignorance ont reculé à leur approche ! Les chats ne vont pas au ciel. Les femmes ne peuvent écrire les pièces de Shakespeare » (p 70).
Sur quoi vient à l'esprit que plusieurs nécessiteux ont été de grands écrivains. Mais notre auteure ajoute un argument imparable : à la différence des hommes, les femmes ont été débordées par les tâches domestiques, et, désirant écrire, n'ont pas été préparées, puis, écrivant, ont été découragées, enfermées ou moquées. Fait avéré du temps de Shakespeare, dont VW imagine la soeur, fait moins certain au dix-neuvième siècle où elle cite sa trinité (Jane Austen, George Eliot, Emily Brontë), et fait douteux pour ses contemporaines. VW insiste sur son premier argument : neuf au moins des douze écrivains de son panthéon contemporain ont été universitaires et riches — l'écriture serait une spécialité académique en Angleterre où les enseignants seraient bien payés, mais elle n'a pas cette image en France. C'est oublier un troisième obstacle, la prise de risque, qui a été surmonté par des hommes et des femmes du dix-huitième au vingtième siècle. Citons en France Olympe de Gouges, George Sand à ses débuts, ou Alexandra David Neal qui mendiait au Tibet quand VW donnait ses conférences à Oxbridge.
Bref, VW, issue d'un milieu riche et brillant, n'est guère convaincante comme féministe et — disons — faible sur le plan politique. C'est pourquoi sans doute la quatrième de couverture décrit « Une chambre à soi » par un oxymore : « Un délicieux pamphlet ». La leçon à retenir par une auteure contemporaine — à supposer qu'elle en ait besoin — est celle de Mary Carmichael, l'alias numéro trois : tenir comme stérile le débat sur le passé et ne pas écrire en complément ni par opposition aux hommes, même si sa mise en garde confine au masochisme : « Le poids, la démarche, l'allure d'un esprit masculin, sont par trop différents du poids, de la démarche, de l'allure de l'esprit d'une femme pour qu'elle puisse y prendre quelque chose de substantiel. le singe, ici, est par trop éloigné de son modèle pour persévérer dans ses efforts » (p 113).
Il faut lire « Une chambre à soi » pour d'autres plaisirs. Pour la culture, l'intelligence et la finesse de l'auteure ; pour son humour et son sens de l'observation ; pour les surprises de son raisonnement et ses coqs à l'âne : « Considérons, tout d'abord, les faits. Il faut neuf mois avant que naisse un bébé. Puis il y a la naissance du bébé, puis trois ou quatre mois passés à nourrir le bébé. Après le sevrage on peut compter sur cinq années passées à jouer avec le bébé. Car il semble qu'on ne puisse pas laisser les enfants se débrouiller seul dans les rues » (p 34). « Il y avait ces affables personnages à qui les rues servent de club, qui saluent des hommes dans des charrettes et donnent des renseignements sans y être priés. Il y avait aussi des enterrements, devant lesquels les hommes, se souvenant soudain du provisoire de leur propre corps, se découvraient. Puis un monsieur, des plus distingués, descendit lentement les marches d'une maison et s'arrêta pour éviter d'entrer en collision avec une dame tumultueuse qui, d'une façon ou d'une autre, avait acquis un splendide manteau de fourrure et un bouquet de violettes de Parme ». Et enfin, pour la colère qu'elle laisse tout de même pointer : « Je pensais à ce vieux monsieur, mort maintenant, mais qui était, je crois, évêque : il déclarait qu'il était impossible qu'une femme ait eu dans le passé, ait dans le présent ou dans l'avenir le génie de Shakespeare. Il adressait aux journaux des articles sur ce sujet. C'est lui aussi qui déclara à une dame, qui s'était renseignée auprès de lui, qu'en vérité les chats n'allaient pas au ciel bien que, ajouta-t-il, ils aient une certaine forme d'âme. Quelle somme de réflexions ces vieux messieurs ont dépensée pour notre salut ? Comme les bornes de l'ignorance ont reculé à leur approche ! Les chats ne vont pas au ciel. Les femmes ne peuvent écrire les pièces de Shakespeare » (p 70).
Virginia Woolf s'interroge sur les femmes et le roman, les idées contenues dans ces termes et les relations qu'ils entretiennent. Tout au long d'Une Chambre à soi, retranscription de conférences que Woolf aurait données en octobre 1928 devant une assemblée d'étudiantes, le lecteur suit les pas et les humeurs de l'auteure, au bord de la rivière comme à travers les rayonnages de la bibliothèque universitaire. Faut-il aborder les femmes et le roman ? les femmes dans le roman ? les femmes lectrices ? les femmes auteures ? les relations entre les hommes et les femmes dans le roman ? Ces derniers sont omniprésents dans l'étude de Woolf : d'une part, les hommes écrivent sur les femmes, elles sont pour eux de véritables miroirs dans lesquels ils s'admirent plus grands qu'ils ne sont. D'autre part, les hommes inventent des femmes de caractère, dans le théâtre classique, entre autres, mais cette haute importance ne relève que de l'imagination ; en pratique, hélas, les femmes sont bien plus insignifiantes aux yeux des hommes. Pourtant les exemples de femmes inspiratrices sont nombreux. Elles portent en elles une puissance créatrice inégalable.
A ce titre, Virginia Woolf, femme et auteure, défend le sexe opprimé auquel il manque une chambre à soi et cinq cents livres par an pour s'épanouir pleinement dans l'écriture. L'auteure se place sous la tutelle de l'imaginaire soeur de Shakespeare, poétesse aussi brillante qu'inconnue, qui n'a jamais rien pu écrire… Lady Winchelsea, Dorothy Osborne, les soeurs Brontë, Jane Austen, Marry Carmichael…, toutes femmes d'exception, peuplent l'essai de Woolf et leur exemple appuie les arguments en faveur du combat féministe. Dans le salon commun, Austen cachait son manuscrit à chaque fois qu'elle entendait la porte s'ouvrir. Les soeurs Brontë pensaient comme des femmes, non comme on leur disait de penser. Marry Carmichael écrivait comme une femme qui aurait oublié qu'elle en est une. En effet, le génie, part féminine, part masculine, est un être, un esprit androgyne.
Pour Virginia Woolf, il manque à la femme, et c'est là la thèse de son pamphlet, une chambre à soi, un lieu où elle puisse s'isoler, et cinq cents livres par an qui suffiraient à une autonomie financière, pour développer son intelligence, son génie, être l'égale de l'homme et non plus seulement sa fille, son épouse ou son amante.
Secondée par la poétique traduction de Clara Malraux, Virginia Woolf, professeure et lectrice, malgré les méandres et les divagations de son esprit qui font parfois perdre le fil, livre un élégant et positif message d'émancipation féminine ponctué par des portraits d'auteures qui m'ont rappelé le recueil Elles. Portraits de femmes au cours duquel Woolf loue toute en sensibilité ces femmes d'exception qu'elle aurait aimé connaître.
A liker et commenter sur : https://poussedeginkgo.wordpress.com/2016/11/09/une-chambre-a-soi/
Lien : https://poussedeginkgo.wordp..
A ce titre, Virginia Woolf, femme et auteure, défend le sexe opprimé auquel il manque une chambre à soi et cinq cents livres par an pour s'épanouir pleinement dans l'écriture. L'auteure se place sous la tutelle de l'imaginaire soeur de Shakespeare, poétesse aussi brillante qu'inconnue, qui n'a jamais rien pu écrire… Lady Winchelsea, Dorothy Osborne, les soeurs Brontë, Jane Austen, Marry Carmichael…, toutes femmes d'exception, peuplent l'essai de Woolf et leur exemple appuie les arguments en faveur du combat féministe. Dans le salon commun, Austen cachait son manuscrit à chaque fois qu'elle entendait la porte s'ouvrir. Les soeurs Brontë pensaient comme des femmes, non comme on leur disait de penser. Marry Carmichael écrivait comme une femme qui aurait oublié qu'elle en est une. En effet, le génie, part féminine, part masculine, est un être, un esprit androgyne.
Pour Virginia Woolf, il manque à la femme, et c'est là la thèse de son pamphlet, une chambre à soi, un lieu où elle puisse s'isoler, et cinq cents livres par an qui suffiraient à une autonomie financière, pour développer son intelligence, son génie, être l'égale de l'homme et non plus seulement sa fille, son épouse ou son amante.
Secondée par la poétique traduction de Clara Malraux, Virginia Woolf, professeure et lectrice, malgré les méandres et les divagations de son esprit qui font parfois perdre le fil, livre un élégant et positif message d'émancipation féminine ponctué par des portraits d'auteures qui m'ont rappelé le recueil Elles. Portraits de femmes au cours duquel Woolf loue toute en sensibilité ces femmes d'exception qu'elle aurait aimé connaître.
A liker et commenter sur : https://poussedeginkgo.wordpress.com/2016/11/09/une-chambre-a-soi/
Lien : https://poussedeginkgo.wordp..
Six conférences données à Cambridge par Virginia W sur les femmes et l'ecriture. Elle remet en perspectives. Interêt de la vision historique. Les références sont british en diable. Phrases longues. Changements de ton. Digressions. J'ai eu un peu de mal à suivre, par moments. Des passages désuets. D'autres fulgurants de lucidité, d'intelligence, de clairvoyance sur la condition des femmes, leur asservissement aux tâches répétitives, leur séculaire soumission aux mâles dominants causant de fait leur impossibilité à écrire...
Voici un recueil de textes datant de 1929 intitulé précédemment « une chambre à soi ».
Marie Darrieussecq nous propose une nouvelle traduction avec un titre plus approprié. Grâce à la préface de la traductrice, nous comprenons l'importance du nouveau titre plus proche du message délivré par l'auteure.
En effet, toutes ces histoires sont là pour nous présenter la difficulté des femmes artistes au dix-neuvième et début du vingtième siècle. Comment vivre de son art ?
Par exemple, on apprend que des écrivains comme les soeurs Bronte écrivaient dans les salons car n'avaient pas de pièce pour elle.
Virginia se dit plus chanceuse car, étant rentière, elle peut exercer son art en toute liberté.
Cela explique aussi pourquoi il y avait si peu de femmes écrivains aux siècles précédents.
Un recueil résolument féministe, un beau pamphlet à mettre dans toutes les mains féminines et pourquoi pas masculines aussi, bien sûr.
Lien : http://www.despagesetdesiles..
Marie Darrieussecq nous propose une nouvelle traduction avec un titre plus approprié. Grâce à la préface de la traductrice, nous comprenons l'importance du nouveau titre plus proche du message délivré par l'auteure.
En effet, toutes ces histoires sont là pour nous présenter la difficulté des femmes artistes au dix-neuvième et début du vingtième siècle. Comment vivre de son art ?
Par exemple, on apprend que des écrivains comme les soeurs Bronte écrivaient dans les salons car n'avaient pas de pièce pour elle.
Virginia se dit plus chanceuse car, étant rentière, elle peut exercer son art en toute liberté.
Cela explique aussi pourquoi il y avait si peu de femmes écrivains aux siècles précédents.
Un recueil résolument féministe, un beau pamphlet à mettre dans toutes les mains féminines et pourquoi pas masculines aussi, bien sûr.
Lien : http://www.despagesetdesiles..
Cela faisait très longtemps que j'avais envie de lire cet essai et déjà plusieurs mois que je l'avais dans ma PAL.
De Virginia Woolf, je n'ai lu que Mrs Dalloway que j'avais adoré, un véritable coup de coeur. Mais ma lecture avait été vraiment très laborieuse et même si j'avais très envie d'en découvrir ses autres oeuvres, je n'avais pas eu le courage de m'y mettre tout de suite.
Ayant un peu de temps en ce moment, je me suis décidée à sortir quelques classiques à lire et j'ai donc sorti ce petit livre.
J'ai d'abord été étonnée par la facilité du style. Il m'arrivait parfois de devoir relire plusieurs fois des phrases dans son roman Mrs Dalloway, je devais vraiment m'immerger dans le texte, alors qu'ici, je n'ai eu aucune réelle difficulté.
Cet essai, on peut le résumé en une phrase (et d'ailleurs Virginia Woolf le fait dès le début) : pour qu'une femme puisse écrire une fiction, il lui faudrait une chambre à elle, où elle peut s'isoler dans le calme et la solitude et y rester, sans être dérangé ;de plus,elle a besoin d'argent, pour être à l'abri du besoin.
Voilà.
Elle va démontrer cette phrase durant tous son essai.
On peut se dire que maintenant cet essai date un peu, qu'il n'est plus d'actualité : les femmes sont maintenant bien implantées dans le monde littéraire.
Et pourtant, pourquoi y a-t-il si peu de femmes à l'Académie Française (7 pour être exacte!) par exemple? Pourquoi (on est dans la période des prix, cela tombe bien!) y-a-t-il toujours aussi peu de femmes primées ( dans un article sur le net, j'avais lu une fois que depuis le début du XXe siècle, il n'y avait même pas 17% des prix qui revenaient aux femmes)?
Donc si l'essai date un peu, il n'est pas tout à fait hors d'actualité, même si certains arguments qu'elle emploie le sont un peu. Mais ces deux besoins de base restent d'actualité : il faut pouvoir travailler sans être dérangé et sans avoir à se préoccuper de comment se nourrir et se loger sans cesse.
Elle nous parle de l'importance de l'éducation chez la femme : Comment les femmes pendant très longtemps étaient étrangères au principe de gagner de l'argent, puisque l'argent qu'elle recevait si jamais elles travaillaient en étant mariée ne leur appartenaient pas vraiment. Selon la loi, l'argent revenait au mari.
De toutes les manières, la fonction première des femmes étaient d'avoir des enfants et de s'occuper de son foyer.
De plus, il a été longtemps très mal vu pour les femmes d'écrire. Alors que les hommes ne rencontraient qu'indifférence ou amusement, les femmes elles, avaient la bienséance qui s'indignait de les voir écrire. On était horrifié et elles perdaient une partie de leurs réputations. C'est une des raisons pourquoi les femmes prenaient souvent un pseudonyme pour publier leurs écrits.
Cela n'a commencé à changer au XVIIIième siècle quand elles ont pu prouver qu'elles arrivaient, en écrivant, à gagner de l'argent. Cela constituait une bonne raison pour la bienséance, puisqu'elle faisait cela pour survivre et qu'elle ne pouvait pas faire autrement.
Virginia Woolf montre aussi à quel point tout change quand on a de l'argent. Cela parait évident, mais elle le souligne plusieurs fois : ne plus avoir de souci quotidien, ne pas avoir peur du futur, de ne pas être sûr de pouvoir se loger ou se nourrir… On a l'esprit disposé à d'autres choses, on peut s'ouvrir à la culture, au savoir au plaisir. On a le temps de faire d'autres choses et on a le temps de se mettre à l'écriture. Comme elle le dit si bien page 162 « la liberté intellectuelle dépend des choses matérielles », que cela soit pour les hommes ou les femmes.
J'ai beaucoup aimé tout le passage sur la supériorité prétendue des hommes. Je n'y avais jamais pensé sous cet angle-là et je trouve qu'elle n'a pas vraiment tort :
Les hommes qui insistent sur l'infériorité des femmes pensent ainsi démontrer leur propre supériorité. Ils éprouvent le besoin d'être rassuré sur leurs propre valeur et d'avoir confiance en eux-même. Et quel est le meilleur moyen si ce n'est de se croire supérieur à toute une partie de la population?
Je ne sais pas si c'est tout à fait vrai et applicable à tous les cas, mais j'ai trouvé cela assez intéressants comme manière de voir les choses.
Virginia Woolf s'interroge aussi sur le fait que les femmes avaient tendance à écrire non seulement de la fiction, mais surtout des romans. A quoi est-ce dû?
Manque de culture, de moyens, de possibilité de se déplacer : impossibilité d'écrire donc des documentaires. Seule « formation littérature » qu'elle a bien pu recevoir c'est l'observation des caractères et l'analyse des émotions, souvent chez elle dans son salon. Quand à la poésie? Celle-ci demande beaucoup de temps et de concentration. Sans pièce et temps à soi, il est peut-être plus simple d'écrire en prose et de la fiction.
Elle donne plusieurs conseils à la fin, comme d'écrire ce qu'on a envie d'écrire et pas ce qu'on pense que les autres voudraient qu'on écrive. Ou comment. le tout est d'écrire comme nous on le sent, non en tant que sexe, mais en tant que soi-même
Voilà, je pense avoir fait le tour de ce dont je me souviens dans cet essai et que j'avais envie de partager.
—————————————–
Un essai donc très intéressant, assez court et clair je trouve, qui replace bien la place de la femme dans la littérature, que cela soit en tant que personnage qu'écrivain. Je le conseille donc aux personnes intéressées par ces thèmes.
Lien : http://writeifyouplease.word..
De Virginia Woolf, je n'ai lu que Mrs Dalloway que j'avais adoré, un véritable coup de coeur. Mais ma lecture avait été vraiment très laborieuse et même si j'avais très envie d'en découvrir ses autres oeuvres, je n'avais pas eu le courage de m'y mettre tout de suite.
Ayant un peu de temps en ce moment, je me suis décidée à sortir quelques classiques à lire et j'ai donc sorti ce petit livre.
J'ai d'abord été étonnée par la facilité du style. Il m'arrivait parfois de devoir relire plusieurs fois des phrases dans son roman Mrs Dalloway, je devais vraiment m'immerger dans le texte, alors qu'ici, je n'ai eu aucune réelle difficulté.
Cet essai, on peut le résumé en une phrase (et d'ailleurs Virginia Woolf le fait dès le début) : pour qu'une femme puisse écrire une fiction, il lui faudrait une chambre à elle, où elle peut s'isoler dans le calme et la solitude et y rester, sans être dérangé ;de plus,elle a besoin d'argent, pour être à l'abri du besoin.
Voilà.
Elle va démontrer cette phrase durant tous son essai.
On peut se dire que maintenant cet essai date un peu, qu'il n'est plus d'actualité : les femmes sont maintenant bien implantées dans le monde littéraire.
Et pourtant, pourquoi y a-t-il si peu de femmes à l'Académie Française (7 pour être exacte!) par exemple? Pourquoi (on est dans la période des prix, cela tombe bien!) y-a-t-il toujours aussi peu de femmes primées ( dans un article sur le net, j'avais lu une fois que depuis le début du XXe siècle, il n'y avait même pas 17% des prix qui revenaient aux femmes)?
Donc si l'essai date un peu, il n'est pas tout à fait hors d'actualité, même si certains arguments qu'elle emploie le sont un peu. Mais ces deux besoins de base restent d'actualité : il faut pouvoir travailler sans être dérangé et sans avoir à se préoccuper de comment se nourrir et se loger sans cesse.
Elle nous parle de l'importance de l'éducation chez la femme : Comment les femmes pendant très longtemps étaient étrangères au principe de gagner de l'argent, puisque l'argent qu'elle recevait si jamais elles travaillaient en étant mariée ne leur appartenaient pas vraiment. Selon la loi, l'argent revenait au mari.
De toutes les manières, la fonction première des femmes étaient d'avoir des enfants et de s'occuper de son foyer.
De plus, il a été longtemps très mal vu pour les femmes d'écrire. Alors que les hommes ne rencontraient qu'indifférence ou amusement, les femmes elles, avaient la bienséance qui s'indignait de les voir écrire. On était horrifié et elles perdaient une partie de leurs réputations. C'est une des raisons pourquoi les femmes prenaient souvent un pseudonyme pour publier leurs écrits.
Cela n'a commencé à changer au XVIIIième siècle quand elles ont pu prouver qu'elles arrivaient, en écrivant, à gagner de l'argent. Cela constituait une bonne raison pour la bienséance, puisqu'elle faisait cela pour survivre et qu'elle ne pouvait pas faire autrement.
Virginia Woolf montre aussi à quel point tout change quand on a de l'argent. Cela parait évident, mais elle le souligne plusieurs fois : ne plus avoir de souci quotidien, ne pas avoir peur du futur, de ne pas être sûr de pouvoir se loger ou se nourrir… On a l'esprit disposé à d'autres choses, on peut s'ouvrir à la culture, au savoir au plaisir. On a le temps de faire d'autres choses et on a le temps de se mettre à l'écriture. Comme elle le dit si bien page 162 « la liberté intellectuelle dépend des choses matérielles », que cela soit pour les hommes ou les femmes.
J'ai beaucoup aimé tout le passage sur la supériorité prétendue des hommes. Je n'y avais jamais pensé sous cet angle-là et je trouve qu'elle n'a pas vraiment tort :
Les hommes qui insistent sur l'infériorité des femmes pensent ainsi démontrer leur propre supériorité. Ils éprouvent le besoin d'être rassuré sur leurs propre valeur et d'avoir confiance en eux-même. Et quel est le meilleur moyen si ce n'est de se croire supérieur à toute une partie de la population?
Je ne sais pas si c'est tout à fait vrai et applicable à tous les cas, mais j'ai trouvé cela assez intéressants comme manière de voir les choses.
Virginia Woolf s'interroge aussi sur le fait que les femmes avaient tendance à écrire non seulement de la fiction, mais surtout des romans. A quoi est-ce dû?
Manque de culture, de moyens, de possibilité de se déplacer : impossibilité d'écrire donc des documentaires. Seule « formation littérature » qu'elle a bien pu recevoir c'est l'observation des caractères et l'analyse des émotions, souvent chez elle dans son salon. Quand à la poésie? Celle-ci demande beaucoup de temps et de concentration. Sans pièce et temps à soi, il est peut-être plus simple d'écrire en prose et de la fiction.
Elle donne plusieurs conseils à la fin, comme d'écrire ce qu'on a envie d'écrire et pas ce qu'on pense que les autres voudraient qu'on écrive. Ou comment. le tout est d'écrire comme nous on le sent, non en tant que sexe, mais en tant que soi-même
Voilà, je pense avoir fait le tour de ce dont je me souviens dans cet essai et que j'avais envie de partager.
—————————————–
Un essai donc très intéressant, assez court et clair je trouve, qui replace bien la place de la femme dans la littérature, que cela soit en tant que personnage qu'écrivain. Je le conseille donc aux personnes intéressées par ces thèmes.
Lien : http://writeifyouplease.word..
Plaisir grand de retrouver, de Virginia Woolf, une quarante d'années après, «une pièce à soi» dans la nouvelle traduction de Jean-Yves Cotté.
Je me souvenais de la visite dans le riche collège masculin d'Oxbridge (semi-fiction), du dialogue après l'austère dîner dans la version féminine, tellement plus récent et moins doté, mais je n'avais plus en mémoire le délice de ce ton, de l'esprit et de la fermeté du trait, de cette impression d'être devant Virginia Woolf et de l'entendre, en sentant dans cette conférence ce que l'on imaginerait pouvoir être sa conversation (et ne sais quelle est, en cela, l'importance, certainement existante, de la nouvelle traduction).
J'avais un peu oublié le survol du début de la littérature "féminine" et même l'exposé, par petites touches, d'une théorie du roman, mais pas sa façon de montrer la difficulté pour une femme d'écrire, et les différentes raisons qu'elle en donne
"nous devons accepter le fait que tous ces grands romans - Villette, Emma, Les Hauts de Hurlevent, Middlemarch – ont été écrits par des femmes sans autre expérience de la vie que celle autorisée à pénétrer la maison d'un honnête clergyman ; écrits en outre dans le salon familial de cette demeure respectable et par des femmes si pauvres qu'elles ne pouvaient se permettre d'acheter plus que quelques mains de papier à la fois pour écrire Les Hauts de Hurlevent ou Jane Eyre."
(ce qui fait la plus grosse partie du texte, sur laquelle, tant pis, je passerai vite, comptant que vous irez la redécouvrir)
mais c'est tellement savoureux de la suivre, de contempler la façon dont son intelligence creuse sans jamais peser.. et de la voir en venir à dire, cela, avec quoi jr ne saurais qu'être d'accord : "il est néfaste pour qui écrit de penser à son sexe. Il est néfaste d'être purement et simplement un homme ou une femme ; il faut être féminin-masculin ou masculin-féminin...."
Accord aussi avec cette idée d'un regard autre qu'amène, ou qu'amenait encore en son temps, les femmes, et de sa nécessité..
Je me souvenais de la visite dans le riche collège masculin d'Oxbridge (semi-fiction), du dialogue après l'austère dîner dans la version féminine, tellement plus récent et moins doté, mais je n'avais plus en mémoire le délice de ce ton, de l'esprit et de la fermeté du trait, de cette impression d'être devant Virginia Woolf et de l'entendre, en sentant dans cette conférence ce que l'on imaginerait pouvoir être sa conversation (et ne sais quelle est, en cela, l'importance, certainement existante, de la nouvelle traduction).
J'avais un peu oublié le survol du début de la littérature "féminine" et même l'exposé, par petites touches, d'une théorie du roman, mais pas sa façon de montrer la difficulté pour une femme d'écrire, et les différentes raisons qu'elle en donne
"nous devons accepter le fait que tous ces grands romans - Villette, Emma, Les Hauts de Hurlevent, Middlemarch – ont été écrits par des femmes sans autre expérience de la vie que celle autorisée à pénétrer la maison d'un honnête clergyman ; écrits en outre dans le salon familial de cette demeure respectable et par des femmes si pauvres qu'elles ne pouvaient se permettre d'acheter plus que quelques mains de papier à la fois pour écrire Les Hauts de Hurlevent ou Jane Eyre."
(ce qui fait la plus grosse partie du texte, sur laquelle, tant pis, je passerai vite, comptant que vous irez la redécouvrir)
mais c'est tellement savoureux de la suivre, de contempler la façon dont son intelligence creuse sans jamais peser.. et de la voir en venir à dire, cela, avec quoi jr ne saurais qu'être d'accord : "il est néfaste pour qui écrit de penser à son sexe. Il est néfaste d'être purement et simplement un homme ou une femme ; il faut être féminin-masculin ou masculin-féminin...."
Accord aussi avec cette idée d'un regard autre qu'amène, ou qu'amenait encore en son temps, les femmes, et de sa nécessité..
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Virginia Woolf (144)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Virginia Woolf
Virginia Woolf a grandi dans une famille que nous qualifierions de :
classique
monoparentale
recomposée
10 questions
198 lecteurs ont répondu
Thème :
Virginia WoolfCréer un quiz sur ce livre198 lecteurs ont répondu