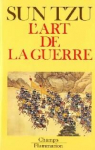Lie Yukou/5
25 notes
Résumé :
Voici un des textes les plus importants du taoïsme. Moins galvaudé que le Tao-tö king, il mêle récits magiques, entretiens philosophiques et conseils pour une vie adéquate à notre condition. II permet surtout de comprendre l'opposition radicale entre le taoïsme - refus de participer à l'agitation du monde et pratique du non-agir - et le confucianisme, activité diligente au sein du corps social. De Lie-tseu on sait peu de choses, sinon qu'il s'agit d'une personne et ... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après Le vrai classique du vide parfaitVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (4)
Ajouter une critique
Le "must" du Tao.
Lie-Tseu nous livre ici, à travers des petites scénettes et des paraboles, ce qu'est le Tao. C'est la voie de l'équilibre que doit suivre l'homme parfait, "l'homme de bien" comme disent les chinois. Pas évident ! C'est aussi trouver sa place dans L Univers.
On y trouve aussi des textes sur Confucius. Pour le lecteur occidental peu versé dans les philosophies orientales, on a tendance à mélanger un peu tout et on peut confondre le Tao avec le Bouddhisme et le Confucianisme.
Contrairement au Bouddhisme et on le voit très bien dans ce livre, le taoisme est la philosophie du non-agir, du refus de participer à l'agitation du monde. Tandis que le Bouddhisme oeuvre pour l'accès à l'éveil et en finir avec les réincarnations. le confucianisme, en revanche, est un enseignement qui vise à assoir sa position de "sage" au sein de la société.
Bon, ce livre est une petite merveille. mais il faut se mettre en condition pour en percevoir toute la finesse, en contemplation face à la mer ou en montagne, en tout cas, dans la nature, au repos.
On pourra aussi le lire en complément du Tao Te King.
Lie-Tseu nous livre ici, à travers des petites scénettes et des paraboles, ce qu'est le Tao. C'est la voie de l'équilibre que doit suivre l'homme parfait, "l'homme de bien" comme disent les chinois. Pas évident ! C'est aussi trouver sa place dans L Univers.
On y trouve aussi des textes sur Confucius. Pour le lecteur occidental peu versé dans les philosophies orientales, on a tendance à mélanger un peu tout et on peut confondre le Tao avec le Bouddhisme et le Confucianisme.
Contrairement au Bouddhisme et on le voit très bien dans ce livre, le taoisme est la philosophie du non-agir, du refus de participer à l'agitation du monde. Tandis que le Bouddhisme oeuvre pour l'accès à l'éveil et en finir avec les réincarnations. le confucianisme, en revanche, est un enseignement qui vise à assoir sa position de "sage" au sein de la société.
Bon, ce livre est une petite merveille. mais il faut se mettre en condition pour en percevoir toute la finesse, en contemplation face à la mer ou en montagne, en tout cas, dans la nature, au repos.
On pourra aussi le lire en complément du Tao Te King.
Se replonger dans les livres de lie tseu et des auteurs classiques chinois promet toujours une plongée dans un monde totalement different.Different par la structure du texte d'abord, mais aussi par le fond developpé par l'auteur et les idees mises en avant, bref un voyage en terre inconnus pour moi mais le bonheur de la decouverte est present à chaque page.
Souvent en contradiction avec Confucius, Li Tseu associe le taoïsme et le bouddhisme dans des fables simples. Il aime à décrire les avantages de l'action commune sur l'individuelle et soutient la réflexion sur les actes et les choses.
Le Taoisme comme un cristal millénaire.
Il y a deux mille cinq cents ans, un sage a su en comprendre la beauté et, sans en rayer la surface, nous en offrir un fragment.
Un superbe objet de méditation.
Il y a deux mille cinq cents ans, un sage a su en comprendre la beauté et, sans en rayer la surface, nous en offrir un fragment.
Un superbe objet de méditation.
Citations et extraits (28)
Voir plus
Ajouter une citation
F. Un membre au clan Fan, nommé Tzeu-hoa, très avide de popularité, s’était attaché tout le peuple de la principauté Tsinn. Le prince de Tsinn en avait fait son favori, et l’écoutait plus volontiers que ses ministres, distribuant à son instigation les honneurs et les blâmes. Aussi les quémandeurs faisaient-ils queue à la porte de Tzeu-hoa, lequel s’amusait à leur faire faire devant lui assaut d’esprit, à les faire même se battre, sans s’émouvoir aucunement des accidents qui arrivaient dans ces joutes. Les mœurs publiques de la principauté Tsinn pâtirent de ces excès. Un jour Ho-cheng et Tzeu-pai, qui revenaient de visiter la famille Fan, passèrent la nuit, à une étape de la ville, dans une auberge tenue par un certain Chang-K’iou-k’ai (taoïste). Ils s’entretinrent de ce qu’ils venaient de voir. Ce Tzeu-hoa, dirent-ils, est tout-puissant ; il sauve et perd qui il veut ; il enrichit ou ruine à son gré. Chang-K’iou-k’ai que la faim et le froid empêchaient de dormir, entendit cette conversation par l’imposte. Le lendemain, emportant quelques provisions, il alla en ville, et se présenta à la porte de Tzeu-hoa. Or ceux qui assiégeaient cette porte, étaient tous personnes de condition, richement habillés et venus en équipages, prétentieux et arrogants. Quand ils virent ce vieillard caduc, au visage halé, mal vêtu et mal coiffé, tous le regardèrent de haut, puis le méprisèrent, enfin se jouèrent de lui de toute manière. Quoi qu’ils dissent, Chang-K’iou-k’ai resta impassible, se prêtant à leur jeu en souriant. — Sur ces entrefaites, Tzeu-hoa ayant conduit toute la bande sur une haute terrasse, dit : Cent onces d’or sont promises à qui sautera en bas ! Les rieurs de tout à l’heure eurent peur. Chang-K’iou-k’ai sauta aussitôt, descendit doucement comme un oiseau qui plane, et se posa à terre sans se casser aucun os. C’est là un effet du hasard, dit la bande. — Ensuite Tzeu-hoa les conduisit tous au bord du Fleuve, à un coude qui produisait un profond tourbillon. A cet endroit, dit-il, tout au fond, est une perle rare ; qui l’aura retirée, pourra la garder ! Chang-K’iou-k’ai plongea aussitôt, et rapporta la perle rare du fond du gouffre. Alors la bande commença à se douter qu’elle avait affaire à un être extraordinaire. — Tzeu-hoa le fit habiller, et l’on s’attabla. Soudain un incendie éclata dans un magasin de la famille Fan. Je donne, dit Tzeu-hoa, à celui qui entrera dans ce brasier, tout ce qu’il en aura retiré ! Sans changer de visage, Chang-K’iou-k’ai entra aussitôt dans le feu, et en ressortit, sans être ni brûlé ni même roussi. — Convaincue enfin que cet homme possédait des dons transcendants, la bande, lui fit des excuses. Nous ne savions pas, dirent-ils ; voilà pourquoi nous vous avons manqué. Vous n’y avez pas fait attention, pas plus qu’un sourd ou qu’un aveugle, confirmant par ce stoïcisme votre transcendance. Veuillez nous faire part de votre formule ! — Je n’ai pas de formule, dit Chang-K’iou-k’ai. Je vais comme mon instinct naturel me pousse, sans savoir ni pourquoi ni comment. Je suis venu ici pour voir, parce que deux de mes hôtes ont parlé de vous, la distance n’étant pas grande. J’ai cru parfaitement tout ce que vous m’avez dit, et ai voulu le faire, sans arrière-pensée relative à ma personne. J’ai donc agi sous l’impulsion de mon instinct naturel complet et indivis. A qui agit ainsi, aucun être ne s’oppose, (cette action étant dans le sens du mouvement cosmique). Si vous ne veniez de me le dire, je ne me serais jamais douté que vous vous êtes moqués de moi. Maintenant que je le sais, je suis quelque peu ému. Dans cet état, je n’oserais plus, comme auparavant, affronter l’eau et le feu, car je ne le ferais pas impunément. — Depuis cette leçon, les clients de la famille Fan n’insultèrent plus personne. Ils descendaient de leurs chars, pour saluer sur la route, même les mendiants et les vétérinaires. — Tsai-no rapporta toute cette histoire à Confucius. Sans doute, dit celui-ci. Ignorais-tu que l’homme absolument simple, fléchit par cette simplicité tous les êtres, touche le ciel et la terre, propitie les mânes, si bien que rien absolument ne s’oppose à lui dans les six régions de l’espace, que rien ne lui est hostile, que le feu et l’eau ne le blessent pas ? Que si sa simplicité mal éclairée a protégé Chang-K’iou-k’ai, combien plus ma droiture avisée me protègera-t-elle moi. Retiens cela ! (Bout de l’oreille du chef d’école.)
G. L’intendant des pacages de l’empereur Suan-wang de la dynastie Tcheou, avait à son service un employé Leang-ying, lequel était doué d’un pouvoir extraordinaire sur les animaux sauvages. Quand il entrait dans leur enclos pour les nourrir, les plus réfractaires, tigres, loups, aigles pêcheurs, se soumettaient docilement à sa voix. Il pouvait les affronter impunément, dans les conjonctures les plus critiques, temps du rut ou de la lactation, ou quand des espèces ennemies se trouvaient en présence. L’empereur ayant su la chose, crut à l’usage de quelque charme, et donna ordre à l’officier Mao-K’iouyuan de s’en informer. Leang-ying dit : Moi petit employé, comment posséderais-je un charme ? Si j’en possédais quelqu’un, comment oserais-je le cacher à l’empereur ? En peu de mots, voici tout mon secret : Tous les êtres qui ont du sang dans les veines, éprouvent des attraits et des répulsions. Ces passions ne s’allument pas spontanément, mais par la présence de leur objet. C’est sur ce principe que je m’appuie, dans mes rapports avec les bêtes féroces. Je ne donne jamais à mes tigres une proie vivante, pour ne pas allumer leur passion de tuer ; ni une proie entière, pour ne pas exciter leur appétit de déchirer. Je juge de ce que doivent être leurs dispositions, d’après le degré auquel ils sont affamés ou rassasiés. Le tigre a ceci de commun avec l’homme, qu’il affectionne ceux qui le nourrissent et le caressent, et ne tue que ceux qui le provoquent. Je me garde donc de jamais irriter mes tigres, et m’efforce au contraire de leur plaire. Cela est difficile aux hommes d’humeur instable. Mon humeur est toujours la même. Contents de moi, mes animaux me regardent comme étant des leurs. Ils oublient, dans ma ménagerie, leurs forêts profondes, leurs vastes marais, leurs monts et leurs vallées. Simple effet d’un traitement rationnel.
H. Yen-Hoei dit à Confucius : Un jour que je franchissais le rapide de Chang, j’admirai la dextérité extraordinaire du passeur, et lui demandai : cet art s’apprend-il ? « Oui, dit-il. Quiconque sait nager, peut l’apprendre. Un bon nageur l’a vite appris. Un bon plongeur le sait sans l’avoir appris. » Je n’osai pas dire au passeur, que je ne comprenais pas sa réponse. Veuillez me l’expliquer, s’il vous plaît. — Ah ! dit Confucius, je t’ai dit cela souvent en d’autres termes, et tu ne comprends pas encore ! Écoute et retiens cette fois !.. Quiconque sait nager, peut l’apprendre, parce qu’il n’a pas peur de l’eau. Un bon nageur l’a vite appris, parce qu’il ne pense même plus à l’eau. Un bon plongeur le sait sans l’avoir appris, parce que l’eau étant devenue comme son élément, ne lui cause pas la moindre émotion. Rien ne gêne l’exercice des facultés de celui dont aucun trouble ne pénètre l’intérieur... Quand l’enjeu est un tesson de poterie, les joueurs sont posés.. Quand c’est de la monnaie, ils deviennent nerveux. Quand c’est de l’or, ils perdent la tête. Leur habileté acquise restant la même, Ils sont plus ou moins incapables de la déployer, l’affection d’un objet extérieur les distrayant plus ou moins. Toute attention prêtée à une chose extérieure, trouble ou altère l’intérieur.
I. Un jour que Confucius admirait la cascade de Lu-leang, saut de deux cent quarante pieds, produisant un torrent qui bouillonne sur une longueur de trente stades, si rapide que ni caïman ni tortue ni poisson ne peut le remonter, il aperçut un homme qui nageait parmi les remous. Croyant avoir affaire à un désespéré qui cherchait la mort, il dit à ses disciples de suivre la rive, afin de le retirer, s’il passait à portée. Or, à quelques centaines de pas en aval, cet homme sortit lui-même de l’eau, défit sa chevelure pour la sécher, et se mit à suivre le bord, au pied de la digue, en fredonnant. Confucius l’ayant rejoint, lui dit : Quand je vous ai aperçu nageant dans ce courant, j’ai pensé que vous vouliez en finir avec la vie. Puis, en voyant l’aisance avec laquelle vous sortiez de l’eau, je vous ai pris pour un être transcendant. Mais non, vous êtes un homme, en chair et en os. Dites-moi, je vous prie, le moyen de se jouer ainsi dans l’eau. — Je ne connais pas ce moyen, fit l’homme. Quand je commençai, je m’appliquai ; avec le temps, la chose me devint facile ; enfin je la fis naturellement, inconsciemment. Je me laisse aspirer par l’entonnoir central du tourbillon, puis rejeter par le remous périphérique. Je suis le mouvement de l’eau, sans faire moi-même aucun mouvement. Voilà tout ce que je puis vous en dire.
G. L’intendant des pacages de l’empereur Suan-wang de la dynastie Tcheou, avait à son service un employé Leang-ying, lequel était doué d’un pouvoir extraordinaire sur les animaux sauvages. Quand il entrait dans leur enclos pour les nourrir, les plus réfractaires, tigres, loups, aigles pêcheurs, se soumettaient docilement à sa voix. Il pouvait les affronter impunément, dans les conjonctures les plus critiques, temps du rut ou de la lactation, ou quand des espèces ennemies se trouvaient en présence. L’empereur ayant su la chose, crut à l’usage de quelque charme, et donna ordre à l’officier Mao-K’iouyuan de s’en informer. Leang-ying dit : Moi petit employé, comment posséderais-je un charme ? Si j’en possédais quelqu’un, comment oserais-je le cacher à l’empereur ? En peu de mots, voici tout mon secret : Tous les êtres qui ont du sang dans les veines, éprouvent des attraits et des répulsions. Ces passions ne s’allument pas spontanément, mais par la présence de leur objet. C’est sur ce principe que je m’appuie, dans mes rapports avec les bêtes féroces. Je ne donne jamais à mes tigres une proie vivante, pour ne pas allumer leur passion de tuer ; ni une proie entière, pour ne pas exciter leur appétit de déchirer. Je juge de ce que doivent être leurs dispositions, d’après le degré auquel ils sont affamés ou rassasiés. Le tigre a ceci de commun avec l’homme, qu’il affectionne ceux qui le nourrissent et le caressent, et ne tue que ceux qui le provoquent. Je me garde donc de jamais irriter mes tigres, et m’efforce au contraire de leur plaire. Cela est difficile aux hommes d’humeur instable. Mon humeur est toujours la même. Contents de moi, mes animaux me regardent comme étant des leurs. Ils oublient, dans ma ménagerie, leurs forêts profondes, leurs vastes marais, leurs monts et leurs vallées. Simple effet d’un traitement rationnel.
H. Yen-Hoei dit à Confucius : Un jour que je franchissais le rapide de Chang, j’admirai la dextérité extraordinaire du passeur, et lui demandai : cet art s’apprend-il ? « Oui, dit-il. Quiconque sait nager, peut l’apprendre. Un bon nageur l’a vite appris. Un bon plongeur le sait sans l’avoir appris. » Je n’osai pas dire au passeur, que je ne comprenais pas sa réponse. Veuillez me l’expliquer, s’il vous plaît. — Ah ! dit Confucius, je t’ai dit cela souvent en d’autres termes, et tu ne comprends pas encore ! Écoute et retiens cette fois !.. Quiconque sait nager, peut l’apprendre, parce qu’il n’a pas peur de l’eau. Un bon nageur l’a vite appris, parce qu’il ne pense même plus à l’eau. Un bon plongeur le sait sans l’avoir appris, parce que l’eau étant devenue comme son élément, ne lui cause pas la moindre émotion. Rien ne gêne l’exercice des facultés de celui dont aucun trouble ne pénètre l’intérieur... Quand l’enjeu est un tesson de poterie, les joueurs sont posés.. Quand c’est de la monnaie, ils deviennent nerveux. Quand c’est de l’or, ils perdent la tête. Leur habileté acquise restant la même, Ils sont plus ou moins incapables de la déployer, l’affection d’un objet extérieur les distrayant plus ou moins. Toute attention prêtée à une chose extérieure, trouble ou altère l’intérieur.
I. Un jour que Confucius admirait la cascade de Lu-leang, saut de deux cent quarante pieds, produisant un torrent qui bouillonne sur une longueur de trente stades, si rapide que ni caïman ni tortue ni poisson ne peut le remonter, il aperçut un homme qui nageait parmi les remous. Croyant avoir affaire à un désespéré qui cherchait la mort, il dit à ses disciples de suivre la rive, afin de le retirer, s’il passait à portée. Or, à quelques centaines de pas en aval, cet homme sortit lui-même de l’eau, défit sa chevelure pour la sécher, et se mit à suivre le bord, au pied de la digue, en fredonnant. Confucius l’ayant rejoint, lui dit : Quand je vous ai aperçu nageant dans ce courant, j’ai pensé que vous vouliez en finir avec la vie. Puis, en voyant l’aisance avec laquelle vous sortiez de l’eau, je vous ai pris pour un être transcendant. Mais non, vous êtes un homme, en chair et en os. Dites-moi, je vous prie, le moyen de se jouer ainsi dans l’eau. — Je ne connais pas ce moyen, fit l’homme. Quand je commençai, je m’appliquai ; avec le temps, la chose me devint facile ; enfin je la fis naturellement, inconsciemment. Je me laisse aspirer par l’entonnoir central du tourbillon, puis rejeter par le remous périphérique. Je suis le mouvement de l’eau, sans faire moi-même aucun mouvement. Voilà tout ce que je puis vous en dire.
L. Le prince Meou de Tchoung-chan était la forte tête de Wei. Il aimait à s’entretenir avec les habiles gens, s’occupait peu d’administration, et avait une affection déclarée pour Koungsounn-loung le sophiste de Tchao. Ce faible fit rire le maître de musique Tzeu-u. Meou lui demanda : Pourquoi riez-vous de mon affection pour Koungsounn-loung ? ... Tzeu-u dit : Cet homme-là ne reconnaît pas de maître, n’est l’ami de personne, rejette tous les principes reçus, combat toutes les écoles existantes, n’aime que les idées singulières, et ne tient que des discours étranges. Tout ce qu’il se propose, c’est d’embrouiller les gens et de les mettre à quia. A peu près comme jadis Han-Van (sophiste inconnu) et consorts. — Mécontent, le prince Heou dit : N’exagérez-vous pas ? tenez-vous dans les bornes de la vérité. — Tzeu-u reprit : Jugez vous-même. Voici ce que Koungsounn-loung dit à K’oungtch’oan : Un bon archer, lui dit-il, doit pouvoir tirer coup sur coup, si vite et si juste, que la pointe de chaque flèche suivante s’enfonçant dans la queue de la précédente, les flèches enfilées forment une ligne allant depuis la corde de l’arc jusqu’au but. ... Comme K’oung-tch’oan s’étonnait ; oh ! dit Koungsounn-loung, Houng-tch’ao, l’élève de P’eng-mong, a fait mieux que cela. Voulant faire peur à sa femme qui l’avait fâché, il banda son meilleur arc et décocha sa meilleure flèche si juste, qu’elle rasa ses pupilles sans la faire cligner des yeux, et tomba à terre sans soulever la poussière. Sont-ce là des propos d’un homme raisonnable ? — Le prince Meou dit : Parfois les propos des Sages, ne sont pas compris des sots. Tout ceux que vous venez de citer, peuvent s’expliquer raisonnablement. — Vous avez été l’élève de Koungsounn-loung, dit Tzeu-u, voilà pourquoi vous croyez devoir le blanchir. Moi qui n’ai pas vos raisons, je continuerai à le noircir. Voici quelques échantillons des paradoxes qu’il développa en présence du roi de Wei : On peut penser sans intention ; on peut toucher sans atteindre ; ce qui est, ne peut pas finir ; une ombre ne peut pas se mouvoir ; un cheveu peut supporter trente mille livres ; un cheval n’est pas un cheval ; un veau orphelin peut avoir une mère ; et autres balivernes. — Le prince Meou dit : C’est peut-être vous qui ne comprenez pas ces paroles profondes[6]. Penser sans intention, peut s’entendre de la concentration de l’esprit uni au Principe ; toucher sans atteindre, s’entend du contact universel préexistant ; que ce qui est ne peut finir, qu’une ombre ne peut se mouvoir, sont des titres pour introduire la discussion des notions de changement et de mouvement ; qu’un cheveu supporte trente mille livres, sert à introduire la question de ce que sont le continu et la pesanteur ; qu’un cheval blanc n’est pas un cheval, appelle la discussion de l’identité ou de la différence de la substance et des accidents ; un veau orphelin peut avoir une mère, s’il n’est pas orphelin ; etc. — Vous avez, dit Tzeu-u, appris à siffler la note unique de Koungsounn-loung. Il faudra que d’autres vous apprennent à vous servir des autres trous de votre flûte intellectuelle. Sous le coup de cette impertinence, le prince se tut d’abord. Quand il se fut ressaisi, il congédia Tzeu-u en lui disant : Attendez, pour reparaître devant moi, que je vous y invite.
M. Après cinquante ans de règne, Yao voulut savoir si son gouvernement avait eu d’heureux effets, et si le peuple en était content. Il interrogea donc ses conseillers ordinaires, ceux de la capitale et ceux du dehors ; mais aucun ne put lui donner de réponse positive. Alors Yao se déguisa, et alla flâner dans les carrefours. Là il entendit un garçon fredonner ce refrain : Dans la multitude du peuple, plus de méchants, tout est au mieux. Sans qu’on le leur dise, sans qu’ils s’en rendent compte, tous se conforment aux lois de l’empereur. — Plein de joie, Yao demanda au garçon, qui lui avait appris ce refrain ? ... Le maître, dit-il. — Yao demanda au maître, qui avait composé ce refrain ? ... Il vient des anciens, dit le maître. — (Heureux de ce que son règne avait conservé le statu quo antique, de ce que son gouvernement avait été si peu actif que les gouvernés ne s’en étaient même pas aperçu), Yao s’empressa d’abdiquer et de céder son trône à Chounn, (de peur de ternir sa gloire avant sa mort).
N. Koan-yinn-hi (Koan-yinn-tzeu) dit : A qui demeure dans son néant (de forme intérieur, état indéterminé), tous les êtres se manifestent. Il est sensible à leur impression comme une eau tranquille ; il les reflète comme un miroir ; il les répète comme un écho. Uni au Principe, il est en harmonie par lui, avec tous les êtres. Uni au Principe, il connaît tout par les raisons générales supérieures, et n’use plus, par suite, de ses divers sens, pour connaître en particulier et en détail. La vraie raison des choses est invisible, insaisissable, indéfinissable, indéterminable. Seul l’esprit rétabli dans l’état de simplicité naturelle parfaite, peut l’entrevoir confusément dans la contemplation profonde. Après cette révélation, ne plus rien vouloir et ne plus rien faire, voilà la vraie science et le vrai talent. Que voudrait encore, que ferait encore, celui à qui a été révélé le néant de tout vouloir et de tout agir. Se bornât-il à ramasser une motte de terre, à mettre en tas de la poussière, quoique ce ne soit pas là proprement faire quelque chose, il aurait cependant manqué aux principes, car il aurait agi.
Connaissance taoïste parfaite ; consonance de deux instruments accordés sur le même ton, le cosmos et l’individu, perçue par le sens intime, le sens global.
Sourire d’approbation. Lui aussi étant devenu taoïste, il n’avait rien à dire, dit la glose.
Fiction, dit la glose. Confucius fait la leçon au ministre, en louant des Sages imaginaires, de faire tout le contraire de ce qu’il faisait. Il ne faut pas vouloir tirer de ce texte un renseignement géographique ou historique, qui n’y est pas contenu.
Loung-chou est un indifférent taoïste presque parfait. Il ne lui reste plus qu’à se défaire de l’illusion de prendre sa sagesse pour une maladie et de vouloir en guérir.
Certains membres de ce paragraphe insérés uniquement pour cause de parallélisme, sont ineptes. Le sens général est qu’il y a deux états, celui de vie et celui de mort ; que l’inaction fait durer la vie, que l’action est un suicide. Nous savons cela.
M. Après cinquante ans de règne, Yao voulut savoir si son gouvernement avait eu d’heureux effets, et si le peuple en était content. Il interrogea donc ses conseillers ordinaires, ceux de la capitale et ceux du dehors ; mais aucun ne put lui donner de réponse positive. Alors Yao se déguisa, et alla flâner dans les carrefours. Là il entendit un garçon fredonner ce refrain : Dans la multitude du peuple, plus de méchants, tout est au mieux. Sans qu’on le leur dise, sans qu’ils s’en rendent compte, tous se conforment aux lois de l’empereur. — Plein de joie, Yao demanda au garçon, qui lui avait appris ce refrain ? ... Le maître, dit-il. — Yao demanda au maître, qui avait composé ce refrain ? ... Il vient des anciens, dit le maître. — (Heureux de ce que son règne avait conservé le statu quo antique, de ce que son gouvernement avait été si peu actif que les gouvernés ne s’en étaient même pas aperçu), Yao s’empressa d’abdiquer et de céder son trône à Chounn, (de peur de ternir sa gloire avant sa mort).
N. Koan-yinn-hi (Koan-yinn-tzeu) dit : A qui demeure dans son néant (de forme intérieur, état indéterminé), tous les êtres se manifestent. Il est sensible à leur impression comme une eau tranquille ; il les reflète comme un miroir ; il les répète comme un écho. Uni au Principe, il est en harmonie par lui, avec tous les êtres. Uni au Principe, il connaît tout par les raisons générales supérieures, et n’use plus, par suite, de ses divers sens, pour connaître en particulier et en détail. La vraie raison des choses est invisible, insaisissable, indéfinissable, indéterminable. Seul l’esprit rétabli dans l’état de simplicité naturelle parfaite, peut l’entrevoir confusément dans la contemplation profonde. Après cette révélation, ne plus rien vouloir et ne plus rien faire, voilà la vraie science et le vrai talent. Que voudrait encore, que ferait encore, celui à qui a été révélé le néant de tout vouloir et de tout agir. Se bornât-il à ramasser une motte de terre, à mettre en tas de la poussière, quoique ce ne soit pas là proprement faire quelque chose, il aurait cependant manqué aux principes, car il aurait agi.
Connaissance taoïste parfaite ; consonance de deux instruments accordés sur le même ton, le cosmos et l’individu, perçue par le sens intime, le sens global.
Sourire d’approbation. Lui aussi étant devenu taoïste, il n’avait rien à dire, dit la glose.
Fiction, dit la glose. Confucius fait la leçon au ministre, en louant des Sages imaginaires, de faire tout le contraire de ce qu’il faisait. Il ne faut pas vouloir tirer de ce texte un renseignement géographique ou historique, qui n’y est pas contenu.
Loung-chou est un indifférent taoïste presque parfait. Il ne lui reste plus qu’à se défaire de l’illusion de prendre sa sagesse pour une maladie et de vouloir en guérir.
Certains membres de ce paragraphe insérés uniquement pour cause de parallélisme, sont ineptes. Le sens général est qu’il y a deux états, celui de vie et celui de mort ; que l’inaction fait durer la vie, que l’action est un suicide. Nous savons cela.
Un homme perdit sa hache. Il soupçonna le fils du voisin et se mit à l'observer. Son allure était celle d'un voleur de hache; l'expression de son visage était celle d'un voleur de hache; sa façon de parler était tout à fait celle d'un voleur de hache. Tous ses mouvements, tout son être exprimaient distinctement le voleur de hache. Or, il arriva que l'homme qui avait perdu la hache, en creusant par hasard la terre dans la vallée, mit la main sur cet outil. Le lendemain, il regarda derechef le fils du voisin. Tous ses mouvements, tout son être n'avaient plus rien d'un voleur de hache.
C. Koan-i-ou et Pao-chou-ya, tous deux de Ts’i [2], étaient amis intimes. Koan-i-ou s’attacha au prince Kiou, Pao-chou-ya adhéra au prince Siao-pai. Par suite de la préférence accordée par le duc Hi de Ts’i à Ou-tcheu le fils d’une concubine favorite, une révolution éclata, quand il fallut pourvoir à la succession du duc défunt. Koan-i-ou et Tchao-hou se réfugièrent à Lou avec le prince Kiou, tandis que Pao-chou-ya fuyait à Kiu avec le prince Siao-pai. Ensuite ces deux princes, devenus compétiteurs au trône, s’étant déclaré la guerre, Koan-i-ou combattit du côté de Kiou quand celui-ci marcha sur Kiu, et décocha à Siao-pai une flèche qui l’aurait tué, si elle n’avait été épointée par la boucle de sa ceinture. Siao-pai ayant vaincu, exigea que ceux de Lou missent à mort son rival Kiou, ce qu’ils firent complaisamment. Tchao-hou périt, Koan-i-ou fut emprisonné. — Alors Pao-chou-ya dit à son protégé Siao-pai devenu le duc Hoan : Koan-i-ou est un politicien extrêmement habile. — Je le veux bien, dit le duc ; mais je hais cet homme, qui a failli me tuer. — Pao-chou-ya reprit : Un prince sage doit savoir étouffer ses ressentiments personnels. Les inférieurs doivent faire cela continuellement à l’égard de leurs supérieurs ; un supérieur doit le faire parfois pour quelqu’un de. ses inférieurs. Si vous avez l’intention de devenir hégémon, Koan-i-ou est le seul homme capable de faire réussir votre dessein. Il vous faut l’amnistier. — Le duc réclama donc Koan-tchoung, soi-disant pour le mettre à mort. Ceux de Lou le lui envoyèrent lié. Pao-chou-ya sortit au-devant de lui dans le faubourg, et lui enleva ses liens. Le duc Hoan le revêtit de la dignité de premier ministre. Pao-chou-ya devint son inférieur. Le duc le traita en fils, et l’appela son père. Koan-tchoung le fit hégémon. — Il disait souvent en soupirant : Quand, dans ma jeunesse, je faisais le commerce avec Pao-chou-ya, et que je m’adjugeais la bonne part, Pao-chou-ya m’excusait, sur ma pauvreté. Quand, plus tard, dans la politique, lui réussit et moi j’eus le dessous, Pao-chou-ya se dit que mon heure n’était pas encore venue, et ne douta pas de moi. Quand je pris la fuite à la déroute du prince Kiou, Pao-chou-ya ne me jugea pas lâche, mais m’excusa sur ce que j’avais encore ma vieille mère, pour laquelle je devais me conserver. Quand je fus emprisonné, Pao-chou-ya me conserva son estime, sachant que pour moi il n’y a qu’un déshonneur, à savoir de rester oisif sans travailler au bien de l’État. Ah ! si je dois la vie à mes parents, je dois plus à Pao-chou-ya qui a compris mon âme. — Depuis lors, c’est l’usage d’admirer l’amitié désintéressée de Pao-chou-ya pour Koan-i-ou, de louer le duc Hoan pour sa magnanimité et son discernement des hommes. En réalité, il ne faudrait, en cette affaire, parler, ni d’amitié, ni de discernement. La vérité est qu’il n’y a eu, ni intervention de la part des acteurs, ni revirement de la fortune. Tout fut jeu de la fatalité aveugle. Si Tchao-hou périt, c’est qu’il devait périr. Si Pao-chou-ya patronna Koan-i-ou, c’est qu’il devait le faire. Si le duc Hoan pardonna à Koan-i-ou, c’est qu’il devait lui pardonner. Nécessités fatales, et rien de plus. — Il en fut de même, à la fin de la carrière de Koan-i-ou. Quand celui-ci eut dû s’aliter, le duc alla le visiter et lui dit : Père Tchoung, vous êtes bien malade ; il me faut faire allusion à ce qu’on ne nomme pas (la mort) ; si votre maladie s’aggravait (au point de vous emporter), qui prendrai-je comme ministre à votre place ? — Qui vous voudrez, dit le mourant. — Pao-chou-ya conviendrait-il ? demanda le duc. — Non, fit Koan-i-ou ; son idéal est trop élevé ; il méprise ceux qui n’y atteignent pas, et n’oublie jamais une faute commise. Si vous le preniez pour ministre, et vous, et le peuple, s’en trouveraient mal. Vous ne le supporteriez pas longtemps. — Alors qui prendrai-je ? fit le duc. — S’il me faut parler, dit Koan-i-ou, prenez Hien-p’eng, il fera l’affaire. Il est également souple avec les supérieurs et les inférieurs. L’envie chimérique d’égaler la vertu de Hoang-ti l’absorbe. Le coup d’œil transcendant est le propre des Sages du premier ordre, la vue pratique est le propre des Sages du second rang. Faire sentir sa sagesse indispose les hommes, la faire oublier fait aimer. Hien-p’eng n’est pas un Sage du premier ordre ; il a, du Sage de second rang, l’art de s’effacer. De plus, et sa personne, et sa famille, sont inconnues. C’est pourquoi je juge qu’il convient pour la charge de premier ministre. — Que dire de cela ? Koan-i-ou ne recommanda pas Pao-chou-ya, parce que celui-ci ne devait pas être recommandé ; il patronna Hien-p’eng, parce qu’il devait le patronner. Fortune d’abord et infortune ensuite, infortune d’abord et fortune ensuite, dans toutes les vicissitudes de la destinée, rien n’est de l’homme (voulu, fait par lui) ; tout est fatalité aveugle.
D. Teng-si savait discuter le pour et le contre d’une question, en un flux de paroles intarissable. Tzeu-tch’an[3] ayant fait un code nouveau pour la principauté de Tcheng, beaucoup le critiquèrent, et Teng-si le tourna en dérision. Tzeu-tch’an sévit contre ses détracteurs, et fit mettre à mort Teng-si. En cela il n’agit pas, mais servit la fatalité. Teng-si devait mourir ainsi. Teng-si devait tourner Tzeu-tch’an en dérision, et provoquer ainsi sa mise à mort. Naître et mourir à son heure, ces deux choses sont des bonheurs. Ne pas naître, ne pas mourir à son heure, ces deux choses sont des malheurs. Ces sorts divers échoient aux uns et aux autres, non pas de leur fait, mais du fait de la fatalité. Ils sont imprévisibles. Voilà pourquoi, en en parlant, on emploie les expressions, mystère sans règle, voie du ciel qui seule se connaît, obscurité inscrutable, loi du ciel se mouvant d’elle-même, et autres analogues. Cela veut dire, que le ciel et la terre, que la science des Sages, que les mânes et les lutins, ne peuvent rien contre la fatalité. Selon son caprice, celle-ci anéantit ou édifie, écrase ou caresse, tarde ou prévient.
E. Ki-leang, un ami de Yang-tchou, étant tombé malade, se trouva à l’extrémité, au bout de sept jours. Tout en larmes, son fils courut chez tous les médecins des alentours. Le malade dit à Yang-tchou : tâche de faire entendre raison à mon imbécile de fils. ... Yang-tchou récita donc au fils la strophe : ce que le ciel ne sait pas (l’avenir), comment les hommes pourraient-ils le conjecturer ? Il n’est pas vrai que le ciel bénit, ni que personne soit maudit. Nous savons, toi et moi, que la fatalité est aveugle et inéluctable. Qu’est-ce que les médecins et les magiciens y pourront ? — Mais le fils ne démordit pas, et amena trois médecins, un Kiao, un U, et un Lou. Tous trois examinèrent le malade, l’un après l’autre. — Le Kiao dit : dans votre cas, le froid et le chaud sont déséquilibrés, le vide et le plein sont disproportionnés ; vous avez trop mangé, trop joui, trop pensé, trop fatigué ; votre maladie est naturelle. et non l’effet de quelque influx malfaisant ; quoiqu’elle soit grave, elle est guérissable. ... Celui là, dit Ki-leang, récite le boniment des livres ; qu’on le renvoie sans plus ! — Le U dit au malade : voici votre cas. Sorti du sein maternel avec une vitalité défectueuse, vous avez ensuite tété plus de lait que vous n’en pouviez digérer. L’origine de votre mal, remonte à cette époque-là. Comme il est invétéré, il ne pourra guère être guéri complètement. ... Celui-là parle bien, dit Ki-leang ; qu’on lui donne à dîner ! — Le Lou dit au malade : ni le ciel, ni un homme, ni un spectre, ne sont cause de votre maladie. Né avec un corps composé, vous êtes soumis à la loi de la dissolution, et devez comprendre que le temps approche ; aucun médicament n’y fera rien. ... Celui-là a de l’esprit, dit Ki-leang ; qu’on le paye libéralement. — Ki-leang ne prit aucune médecine, et guérit parfaitement (fatalité). — Le souci de la vie ne l’allonge pas, le défaut de soin ne l’abrège pas. L’estime du corps ne l’améliore pas, le mépris ne le détériore pas. Les suites, en cette matière, ne répondent pas aux actes posés. Elles paraissent même souvent diamétralement contraires, sans l’être en réalité. Car la fatalité n’a pas de contraire. On vit ou on meurt, parce qu’on devait vivre ou mourir. Le soin ou la négligence de la vie, du corps, n’y font rien, ni dans un sens ni dans l’autre. — Voilà pourquoi U-hioung dit à Wenn-wang : « L’homme ne peut ni ajouter ni retrancher à sa stature ; tous ses calculs ne peuvent rien à cela. ... Dans le même ordre d’idées, Lao-tan dit à Koan-yinn-tzeu : quand le ciel ne veut pas, qui dira pourquoi ? c’est-à-dire, mieux vaut se tenir tranquille, que de chercher à connaître les intentions du ciel, à deviner le faste et le néfaste. (Vains calculs, tout étant régi par une fatalité aveugle, imprévisible, inéluctable).
F. Yang-pou le frère cadet de Yang-tchou dit à son aîné : Il est des hommes tout semblables pour l’âge, l’extérieur, tous les dons naturels, qui différent absolument, pour la durée de la vie, la fortune, le succès. Je ne m’explique pas ce mystère. — Yang-tchou lui répondit : Tu as encore oublié l’adage des anciens que je t’ai répété si souvent : le mystère qu’on ne peut pas expliquer, c’est la fatalité. Il est fait d’obscurités impénétrables, de complications inextricables, d’actions et d’omissions qui s’ajoutent au jour le jour. Ceux qui sont persuadés de l’existence de cette fatalité, ne croient plus à la possibilité d’arriver, par efforts, à prolonger leur vie, à réussir dans leurs entreprises, à éviter le malheur. Ils ne comptent plus sur rien, se sachant les jouets d’un destin aveugle. Droits et intègres, ils ne tendent plus dans aucun sens ; ils ne s’affligent ni ne se réjouissent plus de rien ; ils n’agissent plus, mais laissent aller toutes choses. ... Les sentences suivantes de Hoang-ti, résument bien la conduite à tenir par l’illuminé : Que le sur-homme reste inerte comme un cadavre, et ne se meuve que passivement, parce qu’on le meut. Qu’il ne raisonne
D. Teng-si savait discuter le pour et le contre d’une question, en un flux de paroles intarissable. Tzeu-tch’an[3] ayant fait un code nouveau pour la principauté de Tcheng, beaucoup le critiquèrent, et Teng-si le tourna en dérision. Tzeu-tch’an sévit contre ses détracteurs, et fit mettre à mort Teng-si. En cela il n’agit pas, mais servit la fatalité. Teng-si devait mourir ainsi. Teng-si devait tourner Tzeu-tch’an en dérision, et provoquer ainsi sa mise à mort. Naître et mourir à son heure, ces deux choses sont des bonheurs. Ne pas naître, ne pas mourir à son heure, ces deux choses sont des malheurs. Ces sorts divers échoient aux uns et aux autres, non pas de leur fait, mais du fait de la fatalité. Ils sont imprévisibles. Voilà pourquoi, en en parlant, on emploie les expressions, mystère sans règle, voie du ciel qui seule se connaît, obscurité inscrutable, loi du ciel se mouvant d’elle-même, et autres analogues. Cela veut dire, que le ciel et la terre, que la science des Sages, que les mânes et les lutins, ne peuvent rien contre la fatalité. Selon son caprice, celle-ci anéantit ou édifie, écrase ou caresse, tarde ou prévient.
E. Ki-leang, un ami de Yang-tchou, étant tombé malade, se trouva à l’extrémité, au bout de sept jours. Tout en larmes, son fils courut chez tous les médecins des alentours. Le malade dit à Yang-tchou : tâche de faire entendre raison à mon imbécile de fils. ... Yang-tchou récita donc au fils la strophe : ce que le ciel ne sait pas (l’avenir), comment les hommes pourraient-ils le conjecturer ? Il n’est pas vrai que le ciel bénit, ni que personne soit maudit. Nous savons, toi et moi, que la fatalité est aveugle et inéluctable. Qu’est-ce que les médecins et les magiciens y pourront ? — Mais le fils ne démordit pas, et amena trois médecins, un Kiao, un U, et un Lou. Tous trois examinèrent le malade, l’un après l’autre. — Le Kiao dit : dans votre cas, le froid et le chaud sont déséquilibrés, le vide et le plein sont disproportionnés ; vous avez trop mangé, trop joui, trop pensé, trop fatigué ; votre maladie est naturelle. et non l’effet de quelque influx malfaisant ; quoiqu’elle soit grave, elle est guérissable. ... Celui là, dit Ki-leang, récite le boniment des livres ; qu’on le renvoie sans plus ! — Le U dit au malade : voici votre cas. Sorti du sein maternel avec une vitalité défectueuse, vous avez ensuite tété plus de lait que vous n’en pouviez digérer. L’origine de votre mal, remonte à cette époque-là. Comme il est invétéré, il ne pourra guère être guéri complètement. ... Celui-là parle bien, dit Ki-leang ; qu’on lui donne à dîner ! — Le Lou dit au malade : ni le ciel, ni un homme, ni un spectre, ne sont cause de votre maladie. Né avec un corps composé, vous êtes soumis à la loi de la dissolution, et devez comprendre que le temps approche ; aucun médicament n’y fera rien. ... Celui-là a de l’esprit, dit Ki-leang ; qu’on le paye libéralement. — Ki-leang ne prit aucune médecine, et guérit parfaitement (fatalité). — Le souci de la vie ne l’allonge pas, le défaut de soin ne l’abrège pas. L’estime du corps ne l’améliore pas, le mépris ne le détériore pas. Les suites, en cette matière, ne répondent pas aux actes posés. Elles paraissent même souvent diamétralement contraires, sans l’être en réalité. Car la fatalité n’a pas de contraire. On vit ou on meurt, parce qu’on devait vivre ou mourir. Le soin ou la négligence de la vie, du corps, n’y font rien, ni dans un sens ni dans l’autre. — Voilà pourquoi U-hioung dit à Wenn-wang : « L’homme ne peut ni ajouter ni retrancher à sa stature ; tous ses calculs ne peuvent rien à cela. ... Dans le même ordre d’idées, Lao-tan dit à Koan-yinn-tzeu : quand le ciel ne veut pas, qui dira pourquoi ? c’est-à-dire, mieux vaut se tenir tranquille, que de chercher à connaître les intentions du ciel, à deviner le faste et le néfaste. (Vains calculs, tout étant régi par une fatalité aveugle, imprévisible, inéluctable).
F. Yang-pou le frère cadet de Yang-tchou dit à son aîné : Il est des hommes tout semblables pour l’âge, l’extérieur, tous les dons naturels, qui différent absolument, pour la durée de la vie, la fortune, le succès. Je ne m’explique pas ce mystère. — Yang-tchou lui répondit : Tu as encore oublié l’adage des anciens que je t’ai répété si souvent : le mystère qu’on ne peut pas expliquer, c’est la fatalité. Il est fait d’obscurités impénétrables, de complications inextricables, d’actions et d’omissions qui s’ajoutent au jour le jour. Ceux qui sont persuadés de l’existence de cette fatalité, ne croient plus à la possibilité d’arriver, par efforts, à prolonger leur vie, à réussir dans leurs entreprises, à éviter le malheur. Ils ne comptent plus sur rien, se sachant les jouets d’un destin aveugle. Droits et intègres, ils ne tendent plus dans aucun sens ; ils ne s’affligent ni ne se réjouissent plus de rien ; ils n’agissent plus, mais laissent aller toutes choses. ... Les sentences suivantes de Hoang-ti, résument bien la conduite à tenir par l’illuminé : Que le sur-homme reste inerte comme un cadavre, et ne se meuve que passivement, parce qu’on le meut. Qu’il ne raisonne
M. Comme maître Lie-tzeu allait à Ts’i, il revint soudain sur ses pas. Pai-hounn-ou-jenn qu’il rencontra, lui demanda : Pourquoi rebroussez-vous chemin de la sorte ? — Parce que j’ai peur, dit Lie-tzeu. — Peur de quoi ? fit Pai-hounn-ou-jenn. — Je suis entré dans dix restaurants, dit Lie-tzeu, et cinq fois j’ai été servi le premier. Il faut que ma perfection intérieure transparaissant, ait donné dans l’œil à ces gens-là, pour qu’ils aient servi après moi des clients plus riches ou plus âgés que moi. J’ai donc eu peur que, si j’allais jusqu’à la capitale de Ts’i, ayant connu lui aussi mon mérite, le prince ne se déchargeât sur moi du gouvernement qui lui pèse. — C’est bien pensé, dit Pai-hounn-ou-jenn. Vous avez échappé à un patron princier ; mais je crains que vous n’ayez bientôt des maîtres à domicile. — Quelque temps après, Pai-hounn-ou-jenn étant allé visiter Lie-tzeu, vit devant sa porte une quantité de souliers (indice de la présence de nombreux visiteurs). S’arrêtant dans la cour, il réfléchit longuement, le menton appuyé sur le bout de son bâton, puis partit sans mot dire. Cependant le portier avait averti Lie-tzeu. Celui-ci saisit vivement ses sandales, et sans prendre le temps de les chausser, courut après son ami. Quand il l’eut rejoint à la porte extérieure, il lui dit : Pourquoi partez-vous ainsi, sans me laisser aucun avis utile ? — A quoi bon désormais ? dit Pai-hounn-ou-jenn. Ne vous l’ai-je pas dit ? Vous avez des maîtres maintenant. Sans doute, vous ne les avez pas attirés, mais vous n’avez pas non plus su les repousser. Quelle influence aurez-vous désormais sur ces gens-là ? On n’influence qu’à condition de tenir à distance. A ceux par qui l’on est gagné, on ne peut plus rien dire. Ceux avec qui l’on est lié, on ne peut pas les reprendre. Les propos de gens vulgaires, sont poison pour l’homme parfait. A quoi bon converser avec des êtres qui n’entendent ni ne comprennent ?
N. Yang-tchou allant à P’ei et Lao-tzeu allant à Ts’inn, les deux se rencontrèrent à Leang. A la vue de Yang-tchou, Lao-tzeu leva les yeux au ciel, et dit avec un soupir : J’espérais pouvoir vous instruire, mais je constate qu’il n’y a pas moyen. — Yang-tchou ne répondit rien. Quand les deux voyageurs furent arrivés à l’hôtellerie où ils devaient passer la nuit, Yang-tchou apporta d’abord lui-même tous les objets nécessaires pour la toilette. Ensuite, quand Lao-tzeu fut installé dans sa chambre, ayant quitté ses chaussures à la porte, Yang-tchou entra en marchant sur ses genoux, et dit à Lao-tzeu : Je n’ai pas compris ce que vous avez dit de moi, en levant les yeux au ciel et soupirant. Ne voulant pas retarder votre marche, je ne vous ai pas demandé d’explication alors. Mais maintenant que vous êtes libre, veuillez m’expliquer le sens de vos paroles. — Vous avez, dit Lao-tzeu, un air altier qui rebute ; tandis que le Sage est comme confus quelque irréprochable qu’il soit, et se juge insuffisant quelle que soit sa perfection. — Je profiterai de votre leçon, dit Yang-tchou, très morfondu. — Cette nuit-là même Yang-tchou s’humilia tellement, que le personnel de l’auberge qui l’avait servi avec respect le soir à son arrivée, n’eut plus aucune sorte d’égards pour lui le matin à son départ. (Le respect des valets étant, en Chine, en proportion de la morgue du voyageur.)
O. Yang-tchou passant par la principauté de Song, reçut l’hospitalité dans une hôtellerie. L’hôtelier avait deux femmes, l’une belle, l’autre laide. La laide était aimée, la belle était détestée. ... Pourquoi cela ? demanda Yang-tchou à un petit domestique. ... Parce que, dit l’enfant, la belle fait la belle, ce qui nous la rend déplaisante ; tandis que la laide se sait laide, ce qui nous fait oublier sa laideur. — Retenez ceci, disciples ! dit Yang-tchou. Etant sage, ne pas poser pour sage ; voilà le secret pour se faire aimer partout.
P. Il y a, en ce monde, comme deux voies ; celle de la subordination, la déférence ; celle de l’insubordination, l’arrogance. Leurs tenants ont été définis par les anciens en cette manière : les arrogants n’ont de sympathie que pour les plus petits que soi, les déférents affectionnent aussi ceux qui leur sont supérieurs. L’arrogance est dangereuse, car elle s’attire des ennemis ; la déférence est sûre, car elle n’a que des amis. Tout réussit au déférent, et dans la vie privée, et dans la vie publique ; tandis que l’arrogant n’a que des insuccès. Aussi U-tzeu a-t-il dit, que la puissance doit toujours être tempérée par la condescendance ; que c’est la condescendance qui rend la puissance durable ; que cette règle permet de pronostiquer à coup sûr, si tel particulier, si tel État, prospérera ou dépérira. La force n’est pas solide, tandis que rien n’égale la solidité de la douceur. Aussi Lao-tan a-t-il dit : « la puissance d’un état lui attire la ruine, comme la grandeur d’un arbre appelle la cognée. La faiblesse fait vivre, la force fait mourir. »
Q. Le Sage s’allie avec qui a les mêmes sentiments intérieurs que lui, le vulgaire se lie avec qui lui plaît par son extérieur. Or dans un corps humain peut se cacher un cœur de bête ; un corps de bête peut contenir un cœur d’homme. Dans les deux cas, juger d’après l’extérieur, induira en erreur. — Fou-hi, Niu-wa, Chenn-noung, U le Grand, eurent, qui une tête humaine sur un corps de serpent, qui une tête de bœuf, qui un museau de tigre ; mais, sous ces formes animales, ce furent de grands Sages. Tandis que Kie le dernier des Hia, Tcheou le dernier des Yinn, le duc Hoan de Lou, le duc Mou de Tch’ou, furent des bêtes sous forme humaine [1]. — Quand Hoang-ti livra bataille à Yen-ti dans la plaine de Fan-ts’uan, des bêtes féroces formèrent son front de bataille, des oiseaux de proie ses troupes légères. Il s’était attaché ces animaux par son ascendant. — Quand Yao eut chargé K’oei du soin de la musique, les animaux accoururent et dansèrent, charmés par ces accents. — Peut-on dire, après cela, qu’il y ait, entre les animaux et les hommes, une différence essentielle ? Sans doute, leurs formes et leurs langues différent de celles des hommes, mais n’y aurait-il pas moyen de s’entendre avec eux malgré cela ? Les Sages susdits, qui savaient tout et qui étendaient leur sollicitude à tous, surent gagner aussi les animaux. Il y a tant de points communs entre les instincts des animaux et les mœurs des hommes. Eux aussi vivent par couples, les parents aimant leurs enfants. Eux aussi recherchent pour s’y loger les lieux sûrs. Eux aussi préfèrent les régions tempérées aux régions froides. Eux aussi se réunissent par groupes, marchent en ordre, les petits au centre, les grands tout autour. Eux aussi s’indiquent les bons endroits pour boire ou pour brouter. — Dans les tout premiers temps, les animaux et les hommes habitaient et voyageaient ensemble. Quand les hommes se furent donné des empereurs et des rois, la défiance surgit et causa la séparation. Plus tard la crainte éloigna de plus en plus les animaux des hommes. Cependant, encore maintenant, la distance n’est pas infranchissable. A l’Est, chez les Kie-cheu, on comprend encore la langue, au moins des animaux domestiqués. Les anciens Sages comprenaient le langage et pénétraient les sentiments de tous les êtres, communiquaient avec tous comme avec leur peuple humain, aussi bien avec les koei les chenn les li les mei (êtres transcendants), qu’avec les volatiles les quadrupèdes et les insectes. Partant de ce principe, que les sentiments d’êtres qui ont même sang et qui respirent même air, ne peuvent pas être grandement différents, ils traitaient les animaux à peu près comme des hommes, avec succès. — Un éleveur de singes de la principauté Song, était arrivé à comprendre les singes, et à se faire comprendre d’eux. Il les traitait mieux que les membres de sa famille, ne leur refusant rien. Cependant il tomba dans la gène. Obligé de rationner ses singes, il s’avisa du moyen suivant, pour leur faire agréer la mesure. Désormais, leur dit-il, vous aurez chacun trois taros le matin et quatre le soir ; cela vous va-t-il ? Tous les singes se dressèrent, fort courroucés… Alors, leur dit-il, vous aurez chacun quatre taros le matin, et trois le soir ; cela vous va-t-il ?… Satisfaits qu’on eût tenu compte de leur déplaisir, tous les singes se recouchèrent, très contents… C’est ainsi qu’on gagne les animaux. Le Sage gagne de même les sots humains. Peu importe que le moyen employé soit réel ou apparent ; pourvu qu’on arrive à satisfaire, à ne pas irriter [2]. — — Autre exemple de l’analogie étroite entre les animaux et les hommes. Ki-sing-tzeu dressait un coq de combat, pour l’empereur Suan des Tcheou. Au bout de dix jours, comme on lui en demandait des nouvelles, il dit : il n’est pas encore en état de se battre ; il est encore vaniteux et entêté. — Dix jours plus tard, interrogé de nouveau, il répondit : — Pas encore ; il répond encore au chant des autres coqs. — Dix jours plus tard, il dit : Pas encore ; il est encore nerveux et passionné. — Dix jours plus tard, il dit : Maintenant il est prêt ; il ne fait plus attention au chant de ses semblables ; il ne s’émeut, à leur vue, pas plus que s’il était de bois. Toutes ses énergies sont ramassées. Aucun autre coq ne tiendra devant lui.
R. Hoei-yang, parent de Hoei-cheu, et sophiste comme lui, étant allé visiter le roi K’ang de Song, celui-ci trépigna et toussa d’impatience à sa vue, et lui dit avec volubilité : Ce que j’aime, moi, c’est la force, la bravoure ; la bonté et l’équité sont des sujets, qui ne me disent rien ; vous voilà averti ; dites maintenant ce que vous avez à me dire. — Justement, dit Hoei-yang, un de mes thèmes favoris, c’est d’expliquer pourquoi les coups des braves et des forts restent parfois sans effet ; vous plairait-il d’entendre ce discours-là ? — Très volontiers, dit le roi. — Ils restent sans effet, reprit le sophiste, quand ils ne les portent pas. Et pourquoi ne les portent-ils pas ? Soit parce qu’ils n’osent pas, soit parce qu’ils ne veulent pas. C’est là encore un de mes thèmes
N. Yang-tchou allant à P’ei et Lao-tzeu allant à Ts’inn, les deux se rencontrèrent à Leang. A la vue de Yang-tchou, Lao-tzeu leva les yeux au ciel, et dit avec un soupir : J’espérais pouvoir vous instruire, mais je constate qu’il n’y a pas moyen. — Yang-tchou ne répondit rien. Quand les deux voyageurs furent arrivés à l’hôtellerie où ils devaient passer la nuit, Yang-tchou apporta d’abord lui-même tous les objets nécessaires pour la toilette. Ensuite, quand Lao-tzeu fut installé dans sa chambre, ayant quitté ses chaussures à la porte, Yang-tchou entra en marchant sur ses genoux, et dit à Lao-tzeu : Je n’ai pas compris ce que vous avez dit de moi, en levant les yeux au ciel et soupirant. Ne voulant pas retarder votre marche, je ne vous ai pas demandé d’explication alors. Mais maintenant que vous êtes libre, veuillez m’expliquer le sens de vos paroles. — Vous avez, dit Lao-tzeu, un air altier qui rebute ; tandis que le Sage est comme confus quelque irréprochable qu’il soit, et se juge insuffisant quelle que soit sa perfection. — Je profiterai de votre leçon, dit Yang-tchou, très morfondu. — Cette nuit-là même Yang-tchou s’humilia tellement, que le personnel de l’auberge qui l’avait servi avec respect le soir à son arrivée, n’eut plus aucune sorte d’égards pour lui le matin à son départ. (Le respect des valets étant, en Chine, en proportion de la morgue du voyageur.)
O. Yang-tchou passant par la principauté de Song, reçut l’hospitalité dans une hôtellerie. L’hôtelier avait deux femmes, l’une belle, l’autre laide. La laide était aimée, la belle était détestée. ... Pourquoi cela ? demanda Yang-tchou à un petit domestique. ... Parce que, dit l’enfant, la belle fait la belle, ce qui nous la rend déplaisante ; tandis que la laide se sait laide, ce qui nous fait oublier sa laideur. — Retenez ceci, disciples ! dit Yang-tchou. Etant sage, ne pas poser pour sage ; voilà le secret pour se faire aimer partout.
P. Il y a, en ce monde, comme deux voies ; celle de la subordination, la déférence ; celle de l’insubordination, l’arrogance. Leurs tenants ont été définis par les anciens en cette manière : les arrogants n’ont de sympathie que pour les plus petits que soi, les déférents affectionnent aussi ceux qui leur sont supérieurs. L’arrogance est dangereuse, car elle s’attire des ennemis ; la déférence est sûre, car elle n’a que des amis. Tout réussit au déférent, et dans la vie privée, et dans la vie publique ; tandis que l’arrogant n’a que des insuccès. Aussi U-tzeu a-t-il dit, que la puissance doit toujours être tempérée par la condescendance ; que c’est la condescendance qui rend la puissance durable ; que cette règle permet de pronostiquer à coup sûr, si tel particulier, si tel État, prospérera ou dépérira. La force n’est pas solide, tandis que rien n’égale la solidité de la douceur. Aussi Lao-tan a-t-il dit : « la puissance d’un état lui attire la ruine, comme la grandeur d’un arbre appelle la cognée. La faiblesse fait vivre, la force fait mourir. »
Q. Le Sage s’allie avec qui a les mêmes sentiments intérieurs que lui, le vulgaire se lie avec qui lui plaît par son extérieur. Or dans un corps humain peut se cacher un cœur de bête ; un corps de bête peut contenir un cœur d’homme. Dans les deux cas, juger d’après l’extérieur, induira en erreur. — Fou-hi, Niu-wa, Chenn-noung, U le Grand, eurent, qui une tête humaine sur un corps de serpent, qui une tête de bœuf, qui un museau de tigre ; mais, sous ces formes animales, ce furent de grands Sages. Tandis que Kie le dernier des Hia, Tcheou le dernier des Yinn, le duc Hoan de Lou, le duc Mou de Tch’ou, furent des bêtes sous forme humaine [1]. — Quand Hoang-ti livra bataille à Yen-ti dans la plaine de Fan-ts’uan, des bêtes féroces formèrent son front de bataille, des oiseaux de proie ses troupes légères. Il s’était attaché ces animaux par son ascendant. — Quand Yao eut chargé K’oei du soin de la musique, les animaux accoururent et dansèrent, charmés par ces accents. — Peut-on dire, après cela, qu’il y ait, entre les animaux et les hommes, une différence essentielle ? Sans doute, leurs formes et leurs langues différent de celles des hommes, mais n’y aurait-il pas moyen de s’entendre avec eux malgré cela ? Les Sages susdits, qui savaient tout et qui étendaient leur sollicitude à tous, surent gagner aussi les animaux. Il y a tant de points communs entre les instincts des animaux et les mœurs des hommes. Eux aussi vivent par couples, les parents aimant leurs enfants. Eux aussi recherchent pour s’y loger les lieux sûrs. Eux aussi préfèrent les régions tempérées aux régions froides. Eux aussi se réunissent par groupes, marchent en ordre, les petits au centre, les grands tout autour. Eux aussi s’indiquent les bons endroits pour boire ou pour brouter. — Dans les tout premiers temps, les animaux et les hommes habitaient et voyageaient ensemble. Quand les hommes se furent donné des empereurs et des rois, la défiance surgit et causa la séparation. Plus tard la crainte éloigna de plus en plus les animaux des hommes. Cependant, encore maintenant, la distance n’est pas infranchissable. A l’Est, chez les Kie-cheu, on comprend encore la langue, au moins des animaux domestiqués. Les anciens Sages comprenaient le langage et pénétraient les sentiments de tous les êtres, communiquaient avec tous comme avec leur peuple humain, aussi bien avec les koei les chenn les li les mei (êtres transcendants), qu’avec les volatiles les quadrupèdes et les insectes. Partant de ce principe, que les sentiments d’êtres qui ont même sang et qui respirent même air, ne peuvent pas être grandement différents, ils traitaient les animaux à peu près comme des hommes, avec succès. — Un éleveur de singes de la principauté Song, était arrivé à comprendre les singes, et à se faire comprendre d’eux. Il les traitait mieux que les membres de sa famille, ne leur refusant rien. Cependant il tomba dans la gène. Obligé de rationner ses singes, il s’avisa du moyen suivant, pour leur faire agréer la mesure. Désormais, leur dit-il, vous aurez chacun trois taros le matin et quatre le soir ; cela vous va-t-il ? Tous les singes se dressèrent, fort courroucés… Alors, leur dit-il, vous aurez chacun quatre taros le matin, et trois le soir ; cela vous va-t-il ?… Satisfaits qu’on eût tenu compte de leur déplaisir, tous les singes se recouchèrent, très contents… C’est ainsi qu’on gagne les animaux. Le Sage gagne de même les sots humains. Peu importe que le moyen employé soit réel ou apparent ; pourvu qu’on arrive à satisfaire, à ne pas irriter [2]. — — Autre exemple de l’analogie étroite entre les animaux et les hommes. Ki-sing-tzeu dressait un coq de combat, pour l’empereur Suan des Tcheou. Au bout de dix jours, comme on lui en demandait des nouvelles, il dit : il n’est pas encore en état de se battre ; il est encore vaniteux et entêté. — Dix jours plus tard, interrogé de nouveau, il répondit : — Pas encore ; il répond encore au chant des autres coqs. — Dix jours plus tard, il dit : Pas encore ; il est encore nerveux et passionné. — Dix jours plus tard, il dit : Maintenant il est prêt ; il ne fait plus attention au chant de ses semblables ; il ne s’émeut, à leur vue, pas plus que s’il était de bois. Toutes ses énergies sont ramassées. Aucun autre coq ne tiendra devant lui.
R. Hoei-yang, parent de Hoei-cheu, et sophiste comme lui, étant allé visiter le roi K’ang de Song, celui-ci trépigna et toussa d’impatience à sa vue, et lui dit avec volubilité : Ce que j’aime, moi, c’est la force, la bravoure ; la bonté et l’équité sont des sujets, qui ne me disent rien ; vous voilà averti ; dites maintenant ce que vous avez à me dire. — Justement, dit Hoei-yang, un de mes thèmes favoris, c’est d’expliquer pourquoi les coups des braves et des forts restent parfois sans effet ; vous plairait-il d’entendre ce discours-là ? — Très volontiers, dit le roi. — Ils restent sans effet, reprit le sophiste, quand ils ne les portent pas. Et pourquoi ne les portent-ils pas ? Soit parce qu’ils n’osent pas, soit parce qu’ils ne veulent pas. C’est là encore un de mes thèmes
Les plus populaires : Littérature étrangère
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Lie Yukou (7)
Voir plus
Quiz
Voir plus
L'Année du Dragon
Ce samedi 10 février 2024, l'année du lapin d'eau laisse sa place à celle du dragon de bois dans le calendrier:
grégorien
chinois
hébraïque
8 questions
128 lecteurs ont répondu
Thèmes :
dragon
, Astrologie chinoise
, signes
, signes du zodiaques
, chine
, culture générale
, littérature
, cinemaCréer un quiz sur ce livre128 lecteurs ont répondu