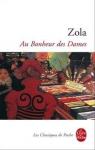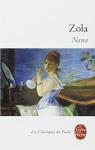Critiques filtrées sur 5 étoiles
Encore un livre lu pour éviter à mon fils (qui est en classe de première et qui passe les épreuves de français cette année) de finir traumatisé par un tel roman.
Tout y est dans cette histoire pour heurter un lecteur sensible : l'amour bestial et passionné, le meurtre planifié de manière inexorable, l'horreur des cadavres de la morgue, les cauchemars qui hantent les coupables, la cruauté envers un pauvre chat, les remords amers jusqu'à la folie et le suicide … brefs que des choses horribles, que mon fils n'auraient pas supportées.
Ce roman est néanmoins un chef d'oeuvre, d'une noirceur radicale et sans concession.
Zola est le Caravage de la littérature. Il peint l'âme humaine comme elle l'est souvent : sombre et sanglante.
Tout y est dans cette histoire pour heurter un lecteur sensible : l'amour bestial et passionné, le meurtre planifié de manière inexorable, l'horreur des cadavres de la morgue, les cauchemars qui hantent les coupables, la cruauté envers un pauvre chat, les remords amers jusqu'à la folie et le suicide … brefs que des choses horribles, que mon fils n'auraient pas supportées.
Ce roman est néanmoins un chef d'oeuvre, d'une noirceur radicale et sans concession.
Zola est le Caravage de la littérature. Il peint l'âme humaine comme elle l'est souvent : sombre et sanglante.
Attaqué par la critique de l'époque, Zola se sent obligé d'expliquer son oeuvre, prouvant qu'il ne voulait pas faire un roman pornographique mais une analyse de cas psychiatrique. Il s'en excuse d'ailleurs auprès des lecteurs qui ont compris.
A cette fin, il écrit lui-même la préface de son livre : c'est dans un but scientifique qu'il a créé ses personnages, étudiant les troubles entraînés par l'union d'une "nature sanguine" comme celle de Laurent à une "nature nerveuse", celle de Thérèse.
Les critiques ont finalement admis que Zola entre dans le mouvement Naturaliste et n'est pas le pervers qu'ils avaient imaginé.
Dès la première page du livre, Zola pose le décor, de façon cinématographique j'ai trouvé. le sens aigu du détail de l'auteur nous permet de bien visualiser ce passage du Pont-Neuf. Les descriptions nous font entrer dans ce contexte sombre et froid, comme dans un tableau. On imagine que cet endroit glauque et humide, sale, d'une noirceur profonde va influencer la vie des habitants. C'est dans ce lieu sans lumière que se trouve la Mercerie au nom de Thérèse Raquin.
Sa mère morte à sa naissance, Thérèse est confiée à l'âge de 2 ans par son père, militaire, à sa tante Madame Raquin. Elle vivra une enfance réprimée.
Madame Raquin, veuve, couve son fils, Camille, enfant souffreteux auquel elle est entièrement dévouée. Médicaments, tisanes, inactivité sont la vie de cet enfant, vie bien monotone et malsaine que va partager Thérèse, les 2 enfants étant élevés à l'identique.
Camille devient un homme faible et insignifiant auquel Madame Raquin va marier Thérèse afin de s'assurer une vieillesse confortable, entourée de sa famille.
Bien qu'aimante et dévouée, j'ai trouvé Madame Raquin intrusive, obligeant Thérèse à vivre comme Camille, les poussant à un inceste malsain.
Thérèse, au tempérament passionné, elle est la fille d'une cheffe africaine, va mener une existence bien ennuyeuse. Son hérédité et son éducation ainsi que son milieu de vie vont déterminer ses actes futurs. Madame Raquin, même si tout partait d'un bon sentiment, a pour moi une grande responsabilité dans les événements à venir.
Et oui ! Laurent arrive, grand, fort, avec "un cou de taureau", ce détail aura son importance plus tard, et Thérèse découvre un homme. Elle sort de sa résignation, les 2 vont devenir amants.
Laurent est un peintre, qui s'avère être un artiste raté, oisif, paresseux et égoïste, intéressé par l'argent de Madame Raquin qui l'accueille et finira par le considérer comme son propre fils.
Une brute, sans foi ni loi, à laquelle, contrairement à Thérèse, il est plus difficile de trouver des circonstances atténuantes pour la suite du roman. Fils d'un père procédurier, qui l'a obligé à faire des études d'avocat afin de le défendre plus tard, il est vrai que ces circonstances ne sont pas favorables à une vie épanouie.
Vous l'aurez compris, les personnages sont désagréables, pas du tout attachants, égoïstes, sauf un peu Madame Raquin, et encore... et le chat François, le seul auquel j'aurais aimé un sort de petit être choyé :)
Je ne vous en dirai pas trop mais l'ambiance glauque, la noirceur, présentes tout au long du roman vont aller crescendo jusqu'à l'inévitable drame tramé dans les cerveaux malades dont Zola fait l'étude.
A ce moment là, on pense que les amants vont avoir la belle vie qu'ils souhaitaient, c'était sans compter sur la culpabilité et le remords qui inconsciemment les domine.
Zola, avec son grand talent, réussit à aller encore plus loin ensuite dans les descriptions sordides, poussant les répétitions jusqu' à mettre le lecteur mal à l'aise. J'avoue à un moment avoir trouvé le texte redondant mais bien sûr, c'était voulu par l'auteur qui, a 27 ans seulement, était déjà un grand écrivain admiré plus tard par Freud lui-même.
On s'est demandé, lors de notre lecture commune si Thérèse et Laurent éprouvaient des remords pour leurs actes répugnants, je pense que oui. Laurent n'arrive plus à manger, à dormir, ni même à marcher, son remords se manifeste physiquement. Il fait des cauchemars, est victime d'hallucinations. Il est complètement obsédé, jusqu'à la folie.
Thérèse, quant à elle, est plus dans un remords "comédie", son esprit est en boucle sur ce qu'elle a fait et elle manifeste des regrets.
Les amants en arrivent à se détester, ne s'aiment plus, n'ont plus de désir et se renvoient la faute mutuellement. Leur tempérament change, s'inverse, Thérèse est maintenant dominée par son sang, Laurent par ses nerfs.
Je pensais faire une courte critique et je me rends compte qu'il y a encore tellement de choses à dire... Il s'en passe encore des choses... il ne vous reste plus qu'à aller les découvrir ou redécouvrir ! Beaucoup de points très intéressants ont été évoqués par mes amis de lecture, Sandrine (HundredDreams), Francine (Afriqueah), Fanny (Fanny1980) et Bernard (Berni_29) que je remercie de m'avoir entraînée dans cette lecture que je n'aurais certainement jamais faite, cela aurait été dommage.
Malgré la noirceur du roman et avec notre sensibilité différente et complémentaire, nous avons tous été passionnés par l'écriture de Zola et pris par cette histoire, nous donnant envie d'aller au bout... presque une obsession ;)
Dans Thérèse Raquin et son étude des tempéraments influencés par les milieux sociaux et les circonstances, Zola pose les bases de sa grande oeuvre : Les Rougon-Macquart que l'on a envie de lire à la fin de ce roman, mais ça, c'est un autre défi ;) !
Ah ! J'ai oublié de vous dire, pas de pornographie dans ce roman, c'était une autre époque ;), de l'horreur plutôt !
A cette fin, il écrit lui-même la préface de son livre : c'est dans un but scientifique qu'il a créé ses personnages, étudiant les troubles entraînés par l'union d'une "nature sanguine" comme celle de Laurent à une "nature nerveuse", celle de Thérèse.
Les critiques ont finalement admis que Zola entre dans le mouvement Naturaliste et n'est pas le pervers qu'ils avaient imaginé.
Dès la première page du livre, Zola pose le décor, de façon cinématographique j'ai trouvé. le sens aigu du détail de l'auteur nous permet de bien visualiser ce passage du Pont-Neuf. Les descriptions nous font entrer dans ce contexte sombre et froid, comme dans un tableau. On imagine que cet endroit glauque et humide, sale, d'une noirceur profonde va influencer la vie des habitants. C'est dans ce lieu sans lumière que se trouve la Mercerie au nom de Thérèse Raquin.
Sa mère morte à sa naissance, Thérèse est confiée à l'âge de 2 ans par son père, militaire, à sa tante Madame Raquin. Elle vivra une enfance réprimée.
Madame Raquin, veuve, couve son fils, Camille, enfant souffreteux auquel elle est entièrement dévouée. Médicaments, tisanes, inactivité sont la vie de cet enfant, vie bien monotone et malsaine que va partager Thérèse, les 2 enfants étant élevés à l'identique.
Camille devient un homme faible et insignifiant auquel Madame Raquin va marier Thérèse afin de s'assurer une vieillesse confortable, entourée de sa famille.
Bien qu'aimante et dévouée, j'ai trouvé Madame Raquin intrusive, obligeant Thérèse à vivre comme Camille, les poussant à un inceste malsain.
Thérèse, au tempérament passionné, elle est la fille d'une cheffe africaine, va mener une existence bien ennuyeuse. Son hérédité et son éducation ainsi que son milieu de vie vont déterminer ses actes futurs. Madame Raquin, même si tout partait d'un bon sentiment, a pour moi une grande responsabilité dans les événements à venir.
Et oui ! Laurent arrive, grand, fort, avec "un cou de taureau", ce détail aura son importance plus tard, et Thérèse découvre un homme. Elle sort de sa résignation, les 2 vont devenir amants.
Laurent est un peintre, qui s'avère être un artiste raté, oisif, paresseux et égoïste, intéressé par l'argent de Madame Raquin qui l'accueille et finira par le considérer comme son propre fils.
Une brute, sans foi ni loi, à laquelle, contrairement à Thérèse, il est plus difficile de trouver des circonstances atténuantes pour la suite du roman. Fils d'un père procédurier, qui l'a obligé à faire des études d'avocat afin de le défendre plus tard, il est vrai que ces circonstances ne sont pas favorables à une vie épanouie.
Vous l'aurez compris, les personnages sont désagréables, pas du tout attachants, égoïstes, sauf un peu Madame Raquin, et encore... et le chat François, le seul auquel j'aurais aimé un sort de petit être choyé :)
Je ne vous en dirai pas trop mais l'ambiance glauque, la noirceur, présentes tout au long du roman vont aller crescendo jusqu'à l'inévitable drame tramé dans les cerveaux malades dont Zola fait l'étude.
A ce moment là, on pense que les amants vont avoir la belle vie qu'ils souhaitaient, c'était sans compter sur la culpabilité et le remords qui inconsciemment les domine.
Zola, avec son grand talent, réussit à aller encore plus loin ensuite dans les descriptions sordides, poussant les répétitions jusqu' à mettre le lecteur mal à l'aise. J'avoue à un moment avoir trouvé le texte redondant mais bien sûr, c'était voulu par l'auteur qui, a 27 ans seulement, était déjà un grand écrivain admiré plus tard par Freud lui-même.
On s'est demandé, lors de notre lecture commune si Thérèse et Laurent éprouvaient des remords pour leurs actes répugnants, je pense que oui. Laurent n'arrive plus à manger, à dormir, ni même à marcher, son remords se manifeste physiquement. Il fait des cauchemars, est victime d'hallucinations. Il est complètement obsédé, jusqu'à la folie.
Thérèse, quant à elle, est plus dans un remords "comédie", son esprit est en boucle sur ce qu'elle a fait et elle manifeste des regrets.
Les amants en arrivent à se détester, ne s'aiment plus, n'ont plus de désir et se renvoient la faute mutuellement. Leur tempérament change, s'inverse, Thérèse est maintenant dominée par son sang, Laurent par ses nerfs.
Je pensais faire une courte critique et je me rends compte qu'il y a encore tellement de choses à dire... Il s'en passe encore des choses... il ne vous reste plus qu'à aller les découvrir ou redécouvrir ! Beaucoup de points très intéressants ont été évoqués par mes amis de lecture, Sandrine (HundredDreams), Francine (Afriqueah), Fanny (Fanny1980) et Bernard (Berni_29) que je remercie de m'avoir entraînée dans cette lecture que je n'aurais certainement jamais faite, cela aurait été dommage.
Malgré la noirceur du roman et avec notre sensibilité différente et complémentaire, nous avons tous été passionnés par l'écriture de Zola et pris par cette histoire, nous donnant envie d'aller au bout... presque une obsession ;)
Dans Thérèse Raquin et son étude des tempéraments influencés par les milieux sociaux et les circonstances, Zola pose les bases de sa grande oeuvre : Les Rougon-Macquart que l'on a envie de lire à la fin de ce roman, mais ça, c'est un autre défi ;) !
Ah ! J'ai oublié de vous dire, pas de pornographie dans ce roman, c'était une autre époque ;), de l'horreur plutôt !
Il y a des grands noms de la littérature qui impressionnent et pour moi, Emile Zola en fait partie. C'est pourquoi, quand des Babeliotes amis m'ont proposé une lecture commune de Thérèse Raquin, j'ai sauté sur l'occasion. Comparer les ressentis au fur et à mesure, partager sur les personnages, les situations, les descriptions permet, à mon sens, de mieux profiter de l'oeuvre. Je remercie domm33, HundredDreams, berni_29 et afriqueah pour nos échanges si enrichissants !
Thérèse Raquin, jeune fille élevée par sa tante, avec son cousin maladif qui va devenir son mari, aspire à la passion et va prendre un amant. Tous deux chercheront une solution pour une vie meilleure et seront confronter aux funestes conséquences de leurs actes.
Les deux préfaces dans mon édition de la Compagnie du Livre Français de Lausanne, rédigées par René Garguilo et par l'auteur lui-même pour la deuxième édition, sont très instructives, la première sur la biographie d'Emile Zola et la deuxième en réponse à ses détracteurs qui dénonçaient une « littérature putride ».
Quand Emile Zola écrit Thérèse Raquin, il n'a que 27 ans, n'a pas encore débuté les Rougon-Macquart, mais a déjà cette vision d'écrivain naturaliste, en étudiant les « tempéraments » des personnages de manière scientifique. Sur ce premier plan, ce texte d'Emile Zola, né 16 ans avant Freud, est déjà remarquable dans la réflexion sur le conscient et l'inconscient et les maux qui peuvent découler de ce qui est refoulé.
Emile Zola, ami d'enfance de Cézanne, qui fréquentait Edouard Manet, insère un artiste raté dans son roman et fait des descriptions très visuelles et proches de peintures, mais toujours dans un souci du réel. Tant avec les lieux, qu'avec les modes de pensées des protagonistes, Zola nous plonge dans une lecture très sombre. Il ne faut ni lire Thérèse Raquin le soir, de crainte de faire des cauchemars, ni à une période morose, car ce roman est un anti-feel-good. Les rues du Paris populaire du 19e siècle étaient obscures, glauques, et les soirées de Thérèse Raquin mornes, notamment avec le rituel hebdomadaire du jeu de dominos en présence de connaissances ennuyeuses aux idées étriquées.
A bien y réfléchir, j'ai l'impression d'avoir rarement éprouvé autant physiquement l'ambiance d'un roman. Les personnages sont passablement antipathiques, il n'y a donc pas d'attachement, et pourtant on ressent leurs maux et leur terreur.
Pour aller plus loin, j'ai eu envie de voir l'adaptation avec Simone Signoret, réalisée par Marcel Carné, sortie en 1953. Je n'ai pas apprécié car la psychologie des personnages n'est pas respectée. En outre, le fait d'introduire un maître-chanteur dénature à mon sens le roman : les vicissitudes ne sont plus la conséquence des démons intérieurs, mais d'un tiers extérieur et manipulateur.
J'ai découvert à cette occasion une autre adaptation de Thérèse Raquin datant de 2009, « Thirst, ceci est mon sang », film d'épouvante-horreur sud-coréen, intégrant des vampires, réalisé par Park Chan-Wook, prix du jury lors de la compétition officielle au Festival de Cannes en 2009. C'est particulier, mais j'ai trouvé l'approche de la psychologie des personnages assez fidèle au roman.
J'ai aimé confronter le film que j'avais imaginé avec ces deux oeuvres cinématographiques que je vous conseille, si comme moi, vous aimez comparer les points de vue.
Pour finir, cette lecture de Thérèse Raquin est de celle qu'on n'oublie pas. Elle m'a donné très envie de poursuivre la découverte des oeuvres d'Emile Zola et je pense débuter prochainement les Rougon-Macquart dans l'ordre chronologique !
Thérèse Raquin, jeune fille élevée par sa tante, avec son cousin maladif qui va devenir son mari, aspire à la passion et va prendre un amant. Tous deux chercheront une solution pour une vie meilleure et seront confronter aux funestes conséquences de leurs actes.
Les deux préfaces dans mon édition de la Compagnie du Livre Français de Lausanne, rédigées par René Garguilo et par l'auteur lui-même pour la deuxième édition, sont très instructives, la première sur la biographie d'Emile Zola et la deuxième en réponse à ses détracteurs qui dénonçaient une « littérature putride ».
Quand Emile Zola écrit Thérèse Raquin, il n'a que 27 ans, n'a pas encore débuté les Rougon-Macquart, mais a déjà cette vision d'écrivain naturaliste, en étudiant les « tempéraments » des personnages de manière scientifique. Sur ce premier plan, ce texte d'Emile Zola, né 16 ans avant Freud, est déjà remarquable dans la réflexion sur le conscient et l'inconscient et les maux qui peuvent découler de ce qui est refoulé.
Emile Zola, ami d'enfance de Cézanne, qui fréquentait Edouard Manet, insère un artiste raté dans son roman et fait des descriptions très visuelles et proches de peintures, mais toujours dans un souci du réel. Tant avec les lieux, qu'avec les modes de pensées des protagonistes, Zola nous plonge dans une lecture très sombre. Il ne faut ni lire Thérèse Raquin le soir, de crainte de faire des cauchemars, ni à une période morose, car ce roman est un anti-feel-good. Les rues du Paris populaire du 19e siècle étaient obscures, glauques, et les soirées de Thérèse Raquin mornes, notamment avec le rituel hebdomadaire du jeu de dominos en présence de connaissances ennuyeuses aux idées étriquées.
A bien y réfléchir, j'ai l'impression d'avoir rarement éprouvé autant physiquement l'ambiance d'un roman. Les personnages sont passablement antipathiques, il n'y a donc pas d'attachement, et pourtant on ressent leurs maux et leur terreur.
Pour aller plus loin, j'ai eu envie de voir l'adaptation avec Simone Signoret, réalisée par Marcel Carné, sortie en 1953. Je n'ai pas apprécié car la psychologie des personnages n'est pas respectée. En outre, le fait d'introduire un maître-chanteur dénature à mon sens le roman : les vicissitudes ne sont plus la conséquence des démons intérieurs, mais d'un tiers extérieur et manipulateur.
J'ai découvert à cette occasion une autre adaptation de Thérèse Raquin datant de 2009, « Thirst, ceci est mon sang », film d'épouvante-horreur sud-coréen, intégrant des vampires, réalisé par Park Chan-Wook, prix du jury lors de la compétition officielle au Festival de Cannes en 2009. C'est particulier, mais j'ai trouvé l'approche de la psychologie des personnages assez fidèle au roman.
J'ai aimé confronter le film que j'avais imaginé avec ces deux oeuvres cinématographiques que je vous conseille, si comme moi, vous aimez comparer les points de vue.
Pour finir, cette lecture de Thérèse Raquin est de celle qu'on n'oublie pas. Elle m'a donné très envie de poursuivre la découverte des oeuvres d'Emile Zola et je pense débuter prochainement les Rougon-Macquart dans l'ordre chronologique !
Dans la préface à sa seconde édition, Zola insiste sur le fait qu'il ne faut pas analyser son roman Thérèse Raquin d'un point de vue moral. Aucune morale n'entre en jeu, dit-il, car il veut décrire, en un travail analytique , comme un chirurgien le ferait sur des cadavres, l'influence du sang et des nerfs sur les actions humaines.
Charcot n'est pas très loin, Claude Bernard vient de publier son étude sur la médecine expérimentale, et Freud rode, pas très loin.
D'ailleurs, pour Zola qui, en 1867, parle de l' inconscient, même si le déterminisme social et racial régit les existences, ce qui les régit sont bien plutôt les tempéraments ; celui de Thérèse est un tempérament contrarié. Il éclatera.
Ils ont une enfance, pourtant, qui peut expliquer leurs actes : Thérèse, adoptée par sa tante à deux ans, est orpheline, elle n'a presque pas connu sa mère algérienne ; Zola insiste sur son tempérament, son sang africain, qui bouillonne malgré son éducation restreinte, petite, modeste, endormie, racornie : « Elle tenait soigneusement cachées, au fond d'elle, toutes les fougues de sa nature. ».
Elle est obligée, pauvre petite poupée de deux ans, de mentir, de se conformer, de se plier ( mot très souvent employé par Zola à son sujet)
Elle ment, elle doit mentir, elle apprend à mentir. « Thérèse, vivant dans une ombre humide, dans un silence morne et écrasant, voyait la vie s'étendre devant elle, toute nue, amenant chaque soir la même couche froide et chaque matin la même journée vide. »
Camille, son cousin, élevé par sa mère qui l'a sauvé mille fois de la mort, et l'a couvé avec amour comme s'il était toujours un nourrisson, développe un égoïsme mêlé à une étroitesse de tout, il n'est pas vraiment un homme, sa mère lui a interdit de lire, les livres sont dangereux, il menace sans cesse de mourir si on ne passe pas par ses caprices.
La mère, amour pur, éduque comme elle peut les deux petits, ce sont ses enfants, elle les aime, elle concocte un mariage sans amour avec les deux cousins, tout en sachant que c'est elle la première dans le coeur de son fils.
En termes freudiens, si Camille s'accroche à son narcissisme, et si sa mère se perd dans son amour oblatif, Thérèse passe de la pulsion d'autoconservation à la pulsion sexuelle pure, lorsqu'elle voit Laurent :
« Elle n'avait jamais vu un homme »
Ce n'est pas le désir qui la pousse, mais la pulsion, doublée de la perversion de tromper enfin ceux qui lui ont volé sa vie. Elle est morte avant de rencontrer Laurent.
Thérèse et Laurent sont des bêtes humaines, des loups, des fauves, qui doivent tuer pour survivre ; ils n'ont pas d'âme, ou en tous cas, ce n'est pas le propos de Zola.
La mort est présente depuis le début de l'histoire : la mère a peur de laisser seul son fils chéri en mourant avant lui et Laurent, l'amant, peint de Camille le mari qui ressemble à un noyé verdâtre.
Ainsi, l'Eros passionnel, le besoin de s'assouvir qui précipite les deux amants dans un acte irréversible, se noye dans une pulsion de mort (Thanatos )déjà présent depuis le début du livre.
Son roman joue le rôle d'expérimentation clinique : il nous dépeint les nerfs de Thérèse, et joue avec les nôtres : que ferions nous, nous ?
Pas d'espoir, semble dire Zola avec force, et une écriture à nous couper le souffle, en alternant de longues tirades sur la poussière noirâtre de la mercerie, et de petites phrases cruelles et comme inspirées par la peinture qu'il connaissait bien de par son amitié avec Cézanne: des coups de pinceau noir, l'égoïsme et la convoitise, le mensonge et la manipulation, plus que la luxure.
Avec l'enchantement d'avoir participé à ma première lecture commune, en compagnie de @ HundredDreams , Sandrine, @ Domm33, Dominique, @fanny1980, Fanny, et @Berni_29, Bernard .
Charcot n'est pas très loin, Claude Bernard vient de publier son étude sur la médecine expérimentale, et Freud rode, pas très loin.
D'ailleurs, pour Zola qui, en 1867, parle de l' inconscient, même si le déterminisme social et racial régit les existences, ce qui les régit sont bien plutôt les tempéraments ; celui de Thérèse est un tempérament contrarié. Il éclatera.
Ils ont une enfance, pourtant, qui peut expliquer leurs actes : Thérèse, adoptée par sa tante à deux ans, est orpheline, elle n'a presque pas connu sa mère algérienne ; Zola insiste sur son tempérament, son sang africain, qui bouillonne malgré son éducation restreinte, petite, modeste, endormie, racornie : « Elle tenait soigneusement cachées, au fond d'elle, toutes les fougues de sa nature. ».
Elle est obligée, pauvre petite poupée de deux ans, de mentir, de se conformer, de se plier ( mot très souvent employé par Zola à son sujet)
Elle ment, elle doit mentir, elle apprend à mentir. « Thérèse, vivant dans une ombre humide, dans un silence morne et écrasant, voyait la vie s'étendre devant elle, toute nue, amenant chaque soir la même couche froide et chaque matin la même journée vide. »
Camille, son cousin, élevé par sa mère qui l'a sauvé mille fois de la mort, et l'a couvé avec amour comme s'il était toujours un nourrisson, développe un égoïsme mêlé à une étroitesse de tout, il n'est pas vraiment un homme, sa mère lui a interdit de lire, les livres sont dangereux, il menace sans cesse de mourir si on ne passe pas par ses caprices.
La mère, amour pur, éduque comme elle peut les deux petits, ce sont ses enfants, elle les aime, elle concocte un mariage sans amour avec les deux cousins, tout en sachant que c'est elle la première dans le coeur de son fils.
En termes freudiens, si Camille s'accroche à son narcissisme, et si sa mère se perd dans son amour oblatif, Thérèse passe de la pulsion d'autoconservation à la pulsion sexuelle pure, lorsqu'elle voit Laurent :
« Elle n'avait jamais vu un homme »
Ce n'est pas le désir qui la pousse, mais la pulsion, doublée de la perversion de tromper enfin ceux qui lui ont volé sa vie. Elle est morte avant de rencontrer Laurent.
Thérèse et Laurent sont des bêtes humaines, des loups, des fauves, qui doivent tuer pour survivre ; ils n'ont pas d'âme, ou en tous cas, ce n'est pas le propos de Zola.
La mort est présente depuis le début de l'histoire : la mère a peur de laisser seul son fils chéri en mourant avant lui et Laurent, l'amant, peint de Camille le mari qui ressemble à un noyé verdâtre.
Ainsi, l'Eros passionnel, le besoin de s'assouvir qui précipite les deux amants dans un acte irréversible, se noye dans une pulsion de mort (Thanatos )déjà présent depuis le début du livre.
Son roman joue le rôle d'expérimentation clinique : il nous dépeint les nerfs de Thérèse, et joue avec les nôtres : que ferions nous, nous ?
Pas d'espoir, semble dire Zola avec force, et une écriture à nous couper le souffle, en alternant de longues tirades sur la poussière noirâtre de la mercerie, et de petites phrases cruelles et comme inspirées par la peinture qu'il connaissait bien de par son amitié avec Cézanne: des coups de pinceau noir, l'égoïsme et la convoitise, le mensonge et la manipulation, plus que la luxure.
Avec l'enchantement d'avoir participé à ma première lecture commune, en compagnie de @ HundredDreams , Sandrine, @ Domm33, Dominique, @fanny1980, Fanny, et @Berni_29, Bernard .
L'histoire de Thérèse Raquin est toute simple.
Thérèse est une orpheline recueillie par sa tante, madame Raquin, qui tient un commerce de broderie en province. Thérèse va vivre aux côtés de son cousin Camille, enfant chétif, malingre, souffreteux. Les enfants jouent comme ils peuvent dans la joie sereine d'une campagne morne, grandissent. Quand Thérèse a vingt-et-un ans, elle épouse Camille, c'est une simple formalité à laquelle elle consent comme si c'était dans le cours des jours, comme si elle ne pouvait pas s'y dérober. Une chose nécessaire et fatale... C'est ainsi, ils se marient sans amour, sans joie... Plus tard, la famille s'installe à Paris où madame Raquin va déplacer son commerce de broderie au passage du Pont-Neuf. Thérèse y travaille également, tandis que Camille trouve un emploi dans un bureau aux chemins de fer. Au contact d'une nouvelle clientèle, l'activité de la broderie va prospérer.
Ils mènent tous trois une existence monotone, où il ne se passe rien, se retrouvant le soir dans ce lieu sombre, humide et âcre, jusqu'au jour où la tranquillité de leur existence va se fissurer avec l'arrivée dans le cercle familial de Laurent, un ami d'enfance de Camille...
Thérèse est une jeune fille effacée, pourrait-elle cacher longtemps encore au fond d'elle les fougues d'une nature étouffée ? Laurent, dans une sorte d'animalité débridée n'est pas indifférent à cette jeune femme qui ne semble pas heureuse. Il revient à la boutique de plus en plus souvent, encouragé par l'amitié de Camille. Il évoque une passion ancienne, la peinture, passion qui ne l'a jamais quitté. Il propose à Thérèse de lui faire son portrait. Autant frotter une allumette devant un bidon d'essence...
Thérèse Raquin, c'est la rencontre d'un homme puissant et d'une femme inassouvie.
Thérèse Raquin, c'est l'itinéraire d'un désir à fleur de peau capable de tout faire voler en éclats, emportant dans sa trajectoire fatale deux êtres aimantés pour en faire des monstres possédés d'animalité et de folie.
Possédé je l'ai été aussi par l'écriture percutante d'Emile Zola.
Oh ! Il ne brode pas de la dentelle, notre cher ami Émile.
Ce roman est d'une noirceur abyssale. On y dégringole comme dans un puits sans fond.
Ici, point d'émotion, sauf celle qui étreint le lecteur, qui voudrait jeter dans ce récit vertigineux et cruel ses propres représentations de l'âme humaine, mais Zola s'en moque, joue de cela.
Zola a ce talent inouï pour nous entraîner avec jubilation dans la crasse et le sordide d'une histoire implacable qui nous étouffe peu à peu et l'on s'en réjouit.
Ici les personnages principaux ne nous inspirent aucune sympathie, aucune compassion. Même souffreteux et malingre, Camille nous déride à peine d'une moue dédaigneuse. À la limite, il y aurait bien la vieille madame Raquin et aussi le chat François...
Zola peint à gros traits le travail souterrain des passions pour les faire jaillir à ciel ouvert, comme un volcan.
Autant vous l'avouer, Thérèse et Laurent sont des brutes humaines, où l'âme est absente.
Dans les gestes d'un drame violent, dans les amours cruelles de Thérèse et de Laurent, Zola nous invite à chercher en eux la bête qui sommeille.
L'humanité est absente du tableau, sauf si c'est cette face cachée de l'humanité que veut nous montrer Zola. L'âpre humanité...
C'est une peinture de clair-obscur où le clair est une lumière ténue qui ne cesse de vaciller comme un crépuscule éteignant le jour... où l'obscur ouvre dans ce paysage sans horizon un dédale de ténèbres prêt à nous faire vaciller dans l'infinie folie...
Aurais-je dû lire Thérèse Raquin avant d'aborder l'oeuvre vertigineuse des Rougon-Macquart il y a de cela quatre ans ? Tout était là déjà... Tout est là comme un prélude à l'oeuvre future des Rougon-Macquart. Quand Zola écrit ce court roman, il n'a que vingt-sept ans.
Le déterminisme, la dégénérescence, le malheur implacable, l'égarement, la bassesse des personnages, l'obsession, la folie et toujours en filigrane une victime qui sera broyée par cette déferlante effroyable où se faufilent les tares de l'humanité... Tout était déjà là. Plus tard Zola y posera une trame sociale, qui manque peut-être encore ici, mais dans ce récit ce n'est pas le propos.
On pourrait croire le texte redondant, mais c'est une variation, un boléro infernal qui monte d'un cran chaque fois un peu plus loin. Cela pèse. Zola nous met les nerfs à vif, nous éprouve.
Oui dans ces scènes fiévreuses, toutes les variations se déplient, celles que peuvent éprouver deux amants que l'adultère a conduits à passer dans l'enfer du paysage... Dans cette palette de couleurs qui deviennent de plus en plus sombres, on voudrait chercher un trait de lumière, cueillir des sentiments dans l'inconscient qui les transforme. Mais le clair-obscur s'assombrit comme des volets qu'on referme sur une pièce au lit défait et vide. Ici le remords est un simple désordre organique.
Zola ne les juge pas, n'implore aucune compréhension.
Il les observe, les met en scène et se retire en nous laissant sidéré devant le tableau.
Une fois encore, la force de l'écriture de Zola m'a transporté. J'avais l'impression d'être là, dans la crasse de cette boutique obscure du passage du Pont-Neuf, où tout près de là coule la Seine... Et dans cette saleté lugubre, j'ai adoré être là...
J'ai adoré être là dans le rythme incandescent et haletant de ces amants maudits. J'ai adoré être là, même si cette ambiance est glauque, oppressante, de plus en plus...
J'ai adoré être là... effleurant la fatalité des chairs qui brisent, qui brûlent, qui broient...
J'ai adoré être là, tandis que Zola déployait son texte jusqu'au point final, qui....
Dans cette lecture commune, je remercie mes compagnes de voyage, Dominique (Domm33), Francine (Afriqueah), Fanny (Fanny1980) et Sandrine (HundredDreams), qui m'ont donné l'envie d'aller vers ce texte et dont les regards croisés ont été si inspirants.
Thérèse est une orpheline recueillie par sa tante, madame Raquin, qui tient un commerce de broderie en province. Thérèse va vivre aux côtés de son cousin Camille, enfant chétif, malingre, souffreteux. Les enfants jouent comme ils peuvent dans la joie sereine d'une campagne morne, grandissent. Quand Thérèse a vingt-et-un ans, elle épouse Camille, c'est une simple formalité à laquelle elle consent comme si c'était dans le cours des jours, comme si elle ne pouvait pas s'y dérober. Une chose nécessaire et fatale... C'est ainsi, ils se marient sans amour, sans joie... Plus tard, la famille s'installe à Paris où madame Raquin va déplacer son commerce de broderie au passage du Pont-Neuf. Thérèse y travaille également, tandis que Camille trouve un emploi dans un bureau aux chemins de fer. Au contact d'une nouvelle clientèle, l'activité de la broderie va prospérer.
Ils mènent tous trois une existence monotone, où il ne se passe rien, se retrouvant le soir dans ce lieu sombre, humide et âcre, jusqu'au jour où la tranquillité de leur existence va se fissurer avec l'arrivée dans le cercle familial de Laurent, un ami d'enfance de Camille...
Thérèse est une jeune fille effacée, pourrait-elle cacher longtemps encore au fond d'elle les fougues d'une nature étouffée ? Laurent, dans une sorte d'animalité débridée n'est pas indifférent à cette jeune femme qui ne semble pas heureuse. Il revient à la boutique de plus en plus souvent, encouragé par l'amitié de Camille. Il évoque une passion ancienne, la peinture, passion qui ne l'a jamais quitté. Il propose à Thérèse de lui faire son portrait. Autant frotter une allumette devant un bidon d'essence...
Thérèse Raquin, c'est la rencontre d'un homme puissant et d'une femme inassouvie.
Thérèse Raquin, c'est l'itinéraire d'un désir à fleur de peau capable de tout faire voler en éclats, emportant dans sa trajectoire fatale deux êtres aimantés pour en faire des monstres possédés d'animalité et de folie.
Possédé je l'ai été aussi par l'écriture percutante d'Emile Zola.
Oh ! Il ne brode pas de la dentelle, notre cher ami Émile.
Ce roman est d'une noirceur abyssale. On y dégringole comme dans un puits sans fond.
Ici, point d'émotion, sauf celle qui étreint le lecteur, qui voudrait jeter dans ce récit vertigineux et cruel ses propres représentations de l'âme humaine, mais Zola s'en moque, joue de cela.
Zola a ce talent inouï pour nous entraîner avec jubilation dans la crasse et le sordide d'une histoire implacable qui nous étouffe peu à peu et l'on s'en réjouit.
Ici les personnages principaux ne nous inspirent aucune sympathie, aucune compassion. Même souffreteux et malingre, Camille nous déride à peine d'une moue dédaigneuse. À la limite, il y aurait bien la vieille madame Raquin et aussi le chat François...
Zola peint à gros traits le travail souterrain des passions pour les faire jaillir à ciel ouvert, comme un volcan.
Autant vous l'avouer, Thérèse et Laurent sont des brutes humaines, où l'âme est absente.
Dans les gestes d'un drame violent, dans les amours cruelles de Thérèse et de Laurent, Zola nous invite à chercher en eux la bête qui sommeille.
L'humanité est absente du tableau, sauf si c'est cette face cachée de l'humanité que veut nous montrer Zola. L'âpre humanité...
C'est une peinture de clair-obscur où le clair est une lumière ténue qui ne cesse de vaciller comme un crépuscule éteignant le jour... où l'obscur ouvre dans ce paysage sans horizon un dédale de ténèbres prêt à nous faire vaciller dans l'infinie folie...
Aurais-je dû lire Thérèse Raquin avant d'aborder l'oeuvre vertigineuse des Rougon-Macquart il y a de cela quatre ans ? Tout était là déjà... Tout est là comme un prélude à l'oeuvre future des Rougon-Macquart. Quand Zola écrit ce court roman, il n'a que vingt-sept ans.
Le déterminisme, la dégénérescence, le malheur implacable, l'égarement, la bassesse des personnages, l'obsession, la folie et toujours en filigrane une victime qui sera broyée par cette déferlante effroyable où se faufilent les tares de l'humanité... Tout était déjà là. Plus tard Zola y posera une trame sociale, qui manque peut-être encore ici, mais dans ce récit ce n'est pas le propos.
On pourrait croire le texte redondant, mais c'est une variation, un boléro infernal qui monte d'un cran chaque fois un peu plus loin. Cela pèse. Zola nous met les nerfs à vif, nous éprouve.
Oui dans ces scènes fiévreuses, toutes les variations se déplient, celles que peuvent éprouver deux amants que l'adultère a conduits à passer dans l'enfer du paysage... Dans cette palette de couleurs qui deviennent de plus en plus sombres, on voudrait chercher un trait de lumière, cueillir des sentiments dans l'inconscient qui les transforme. Mais le clair-obscur s'assombrit comme des volets qu'on referme sur une pièce au lit défait et vide. Ici le remords est un simple désordre organique.
Zola ne les juge pas, n'implore aucune compréhension.
Il les observe, les met en scène et se retire en nous laissant sidéré devant le tableau.
Une fois encore, la force de l'écriture de Zola m'a transporté. J'avais l'impression d'être là, dans la crasse de cette boutique obscure du passage du Pont-Neuf, où tout près de là coule la Seine... Et dans cette saleté lugubre, j'ai adoré être là...
J'ai adoré être là dans le rythme incandescent et haletant de ces amants maudits. J'ai adoré être là, même si cette ambiance est glauque, oppressante, de plus en plus...
J'ai adoré être là... effleurant la fatalité des chairs qui brisent, qui brûlent, qui broient...
J'ai adoré être là, tandis que Zola déployait son texte jusqu'au point final, qui....
Dans cette lecture commune, je remercie mes compagnes de voyage, Dominique (Domm33), Francine (Afriqueah), Fanny (Fanny1980) et Sandrine (HundredDreams), qui m'ont donné l'envie d'aller vers ce texte et dont les regards croisés ont été si inspirants.
Quel plaisir de lire Emile Zola ! Dès les premières pages, les mots de l'auteur créent une ambiance telle qu'il nous projette dans le Paris du XIXe siècle, dans un décor fait de ruelles obscures, sordides et malfamées.
On s'y croirait, tellement l'auteur excelle à dépeindre, avec force détails, les lieux, les personnages dans des teintes grisâtres et sombres. le lecteur visualise aisément les décors en clair-obscur, comme s'il regardait un vieux film en noir et blanc : les quartiers pauvres de Paris, les ruelles étroites et sinistres, le passage du Pont-Neuf, étroit et sombre, la mercerie poussiéreuse et lugubre qui fait penser à l'antre d'une bête.
« Au bout de la rue Guénégaud, lorsqu'on vient des quais, on trouve le passage du Pont-Neuf, une sorte de corridor étroit et sombre qui va de la rue Mazarine à la rue de Seine. Ce passage a trente pas de long et deux de large, au plus ; il est pavé de dalles jaunâtres, usées, descellées, suant toujours une humidité âcre ; le vitrage qui le couvre, coupé à angle droit, est noir de crasse.
Par les beaux jours d'été, quand un lourd soleil brûle les rues, une clarté blanchâtre tombe des vitres sales et traîne misérablement dans le passage. Par les vilains jours d'hiver, par les matinées de brouillard, les vitres ne jettent que de la nuit sur les dalles gluantes, de la nuit salie et ignoble. »
*
Thérèse Raquin est l'un des portraits les plus célèbres d'Emile Zola. Il s'agit en ce qui me concerne, de l'oeuvre la plus aboutie de l'auteur avant la série romanesque des Rougon-Macquart.
Ce drame psychologique introduit de nombreux thèmes qui seront développés plus tard dans son cycle : l'étude de l'homme dominé par ses instincts, le déterminisme et les influences conjointes de l'hérédité et du milieu social, l'étude des tempéraments et la bestialité humaine.
C'est une histoire qui parle d'amour, d'adultère, de passion, de rancoeur, de haine, d'obsession allant jusqu'à la folie. Les personnages y sont dépeints dans toute leur bassesse, leur vilenie, leur égoïsme. Ils sont mauvais, détestables et malaisants pour le lecteur.
« La nature et les circonstances semblaient avoir fait cette femme pour cet homme, et les avoir poussés l'un vers l'autre. À eux deux, la femme, nerveuse et hypocrite, l'homme, sanguin et vivant en brute, ils faisaient un couple puissamment lié. Ils se complétaient, se protégeaient mutuellement. le soir, à table, dans les clartés pâles de la lampe, on sentait la force de leur union, à voir le visage épais et souriant de Laurent, en face du masque muet et impénétrable de Thérèse. »
*
Tout se déroule dans l'ambiance très sombre d'une mercerie miteuse et crasseuse du passage du Pont-Neuf à Paris.
C'est l'histoire de Thérèse, une femme secrète et taciturne, mariée selon les souhaits de sa tante, à son cousin Camille, un jeune homme souffreteux qu'elle n'aime pas.
« …elle savait qu'elle faisait le mal, et il lui prenait des envies féroces de se lever de table et d'embrasser Laurent à pleine bouche, pour montrer à son mari et à sa tante qu'elle n'était pas une bête et qu'elle avait un amant. »
Lorsque la jeune femme rencontre Laurent, elle tombe amoureuse de cet homme qui est tout l'opposé de Camille. Mais cette passion cachée ne satisfait aucun des deux amants qui aimeraient trouver un moyen de vivre leur amour au grand jour.
« … ils sentaient l'impérieuse nécessité de s'aveugler, de rêver un avenir de félicités amoureuses et de jouissances paisibles. »
Dans ce triangle amoureux, une personne est de trop et cette relation adultère ne peut avoir qu'une seule finalité, la violence et le drame.
*
La préface, signée par l'auteur lui-même, est particulièrement intéressante quant à l'accueil du roman par les critiques de l'époque. En effet, lors de sa parution en 1867, le roman a été qualifié d'obscène, d'atteinte aux moeurs pour avoir retranscrit, à travers un drame violent, les passions et les comportements brutaux et meurtriers de ses personnages. L'auteur s'est alors senti obligé d'ajouter aux éditions suivantes un prologue pour défendre et justifier son livre.
« Dans Thérèse Raquin, j'ai voulu étudier des tempéraments et non des caractères. Là est le livre entier. J'ai choisi des personnages souverainement dominés par leurs nerfs et leur sang, dépourvus de libre arbitre, entraînés à chaque acte de leur vie par les fatalités de leur chair. »
Plus d'un siècle plus tard, à la lecture de ce roman, je dois avouer que je n'ai pas du tout ressenti son côté « pornographique ».
Par contre, j'ai été particulièrement sensible à l'atmosphère pesante, sordide et claustrophobe que dégage l'histoire, à l'attitude malsaine des personnages, aux émotions très violentes qu'ils portent en eux.
L'auteur n'hésite pas à les souligner en les accordant aux décors et aux scènes.
« Rien n'est plus douloureusement calme qu'un crépuscule d'automne. Les rayons pâlissent dans l'air frissonnant, les arbres vieillis jettent leurs feuilles. La campagne, brûlée par les rayons ardents de l'été, sent la mort venir avec les premiers vents froids. Et il y a, dans les cieux, des souffles plaintifs de désespérance. La nuit descend de haut, apportant des linceuls dans son ombre. »
Ce récit très réaliste, percutant, choquant même, a contribué à me faire ressentir une sorte de mal-être, une impression d'enfermement et j'ai ressenti le besoin de faire quelques poses tout au long de cette lecture. J'en suis la première surprise car cela m'arrive très rarement.
Ce ressenti très fort, ces décharges d'émotions négatives prouvent sans aucun doute possible l'immense talent d'Émile Zola. Dans ce récit pourtant de jeunesse, il m'a fortement impressionnée : il a réussi à me faire ressentir physiquement et psychologiquement l'antipathie et le dégoût que m'inspiraient Laurent et Thérèse.
C'est une étude passionnante des émotions et des sentiments, de la peur, du remord, de la culpabilité, de la folie.
*
L'écriture de Zola est puissante, tendue, pleine d'une beauté sauvage et laide. Sans pudeur, il met à nu ses personnages. Il dissèque avec réalisme et froideur leurs motivations et la façon dont les regrets, les remords les hantent et les rongent de l'intérieur.
L'auteur maîtrise parfaitement l'intrigue, tel un marionnettiste tirant les ficelles invisibles des émotions humaines et des désirs. Il excelle à décrire ses personnages dans toute leur complexité, s'intéressant à leur évolution physiologique et psychologique, jusqu'à l'implosion. Ils apparaissent dans toute leur animalité, leurs instincts.
En cela, ce livre m'a rappelé un autre grand roman d'Emile Zola, « La bête humaine », mon préféré de l'auteur à ce jour. Thérèse et Laurent sont comme deux bêtes humaines, cherchant à satisfaire leurs désirs, leurs besoins, leurs intérêts sans tenir compte des actes et de leurs conséquences.
*
Pour conclure, malgré certains passages éprouvants, j'ai été entraînée dans ce triangle amoureux par la puissance de l'écriture d'Emile Zola. L'histoire, de plus en plus sombre et dramatique, devient aussi très prenante, encourageant le lecteur à poursuivre sa lecture pour découvrir le châtiment réservé à chacun.
"Thérèse Raquin" est sans conteste un très grand roman.
*
C'est accompagnée que j'ai entrepris cette lecture. Sans eux, je ne l'aurais peut-être jamais lu. Alors mes derniers mots seront adressés à mes compagnons de route, Dominique (Domm33), Francine (Afriqueah), Fanny (Fanny1980) et Bernard (Berni_29) que je remercie chaleureusement pour cette lecture partagée riche d'échanges et d'une belle amitié littéraire.
On s'y croirait, tellement l'auteur excelle à dépeindre, avec force détails, les lieux, les personnages dans des teintes grisâtres et sombres. le lecteur visualise aisément les décors en clair-obscur, comme s'il regardait un vieux film en noir et blanc : les quartiers pauvres de Paris, les ruelles étroites et sinistres, le passage du Pont-Neuf, étroit et sombre, la mercerie poussiéreuse et lugubre qui fait penser à l'antre d'une bête.
« Au bout de la rue Guénégaud, lorsqu'on vient des quais, on trouve le passage du Pont-Neuf, une sorte de corridor étroit et sombre qui va de la rue Mazarine à la rue de Seine. Ce passage a trente pas de long et deux de large, au plus ; il est pavé de dalles jaunâtres, usées, descellées, suant toujours une humidité âcre ; le vitrage qui le couvre, coupé à angle droit, est noir de crasse.
Par les beaux jours d'été, quand un lourd soleil brûle les rues, une clarté blanchâtre tombe des vitres sales et traîne misérablement dans le passage. Par les vilains jours d'hiver, par les matinées de brouillard, les vitres ne jettent que de la nuit sur les dalles gluantes, de la nuit salie et ignoble. »
*
Thérèse Raquin est l'un des portraits les plus célèbres d'Emile Zola. Il s'agit en ce qui me concerne, de l'oeuvre la plus aboutie de l'auteur avant la série romanesque des Rougon-Macquart.
Ce drame psychologique introduit de nombreux thèmes qui seront développés plus tard dans son cycle : l'étude de l'homme dominé par ses instincts, le déterminisme et les influences conjointes de l'hérédité et du milieu social, l'étude des tempéraments et la bestialité humaine.
C'est une histoire qui parle d'amour, d'adultère, de passion, de rancoeur, de haine, d'obsession allant jusqu'à la folie. Les personnages y sont dépeints dans toute leur bassesse, leur vilenie, leur égoïsme. Ils sont mauvais, détestables et malaisants pour le lecteur.
« La nature et les circonstances semblaient avoir fait cette femme pour cet homme, et les avoir poussés l'un vers l'autre. À eux deux, la femme, nerveuse et hypocrite, l'homme, sanguin et vivant en brute, ils faisaient un couple puissamment lié. Ils se complétaient, se protégeaient mutuellement. le soir, à table, dans les clartés pâles de la lampe, on sentait la force de leur union, à voir le visage épais et souriant de Laurent, en face du masque muet et impénétrable de Thérèse. »
*
Tout se déroule dans l'ambiance très sombre d'une mercerie miteuse et crasseuse du passage du Pont-Neuf à Paris.
C'est l'histoire de Thérèse, une femme secrète et taciturne, mariée selon les souhaits de sa tante, à son cousin Camille, un jeune homme souffreteux qu'elle n'aime pas.
« …elle savait qu'elle faisait le mal, et il lui prenait des envies féroces de se lever de table et d'embrasser Laurent à pleine bouche, pour montrer à son mari et à sa tante qu'elle n'était pas une bête et qu'elle avait un amant. »
Lorsque la jeune femme rencontre Laurent, elle tombe amoureuse de cet homme qui est tout l'opposé de Camille. Mais cette passion cachée ne satisfait aucun des deux amants qui aimeraient trouver un moyen de vivre leur amour au grand jour.
« … ils sentaient l'impérieuse nécessité de s'aveugler, de rêver un avenir de félicités amoureuses et de jouissances paisibles. »
Dans ce triangle amoureux, une personne est de trop et cette relation adultère ne peut avoir qu'une seule finalité, la violence et le drame.
*
La préface, signée par l'auteur lui-même, est particulièrement intéressante quant à l'accueil du roman par les critiques de l'époque. En effet, lors de sa parution en 1867, le roman a été qualifié d'obscène, d'atteinte aux moeurs pour avoir retranscrit, à travers un drame violent, les passions et les comportements brutaux et meurtriers de ses personnages. L'auteur s'est alors senti obligé d'ajouter aux éditions suivantes un prologue pour défendre et justifier son livre.
« Dans Thérèse Raquin, j'ai voulu étudier des tempéraments et non des caractères. Là est le livre entier. J'ai choisi des personnages souverainement dominés par leurs nerfs et leur sang, dépourvus de libre arbitre, entraînés à chaque acte de leur vie par les fatalités de leur chair. »
Plus d'un siècle plus tard, à la lecture de ce roman, je dois avouer que je n'ai pas du tout ressenti son côté « pornographique ».
Par contre, j'ai été particulièrement sensible à l'atmosphère pesante, sordide et claustrophobe que dégage l'histoire, à l'attitude malsaine des personnages, aux émotions très violentes qu'ils portent en eux.
L'auteur n'hésite pas à les souligner en les accordant aux décors et aux scènes.
« Rien n'est plus douloureusement calme qu'un crépuscule d'automne. Les rayons pâlissent dans l'air frissonnant, les arbres vieillis jettent leurs feuilles. La campagne, brûlée par les rayons ardents de l'été, sent la mort venir avec les premiers vents froids. Et il y a, dans les cieux, des souffles plaintifs de désespérance. La nuit descend de haut, apportant des linceuls dans son ombre. »
Ce récit très réaliste, percutant, choquant même, a contribué à me faire ressentir une sorte de mal-être, une impression d'enfermement et j'ai ressenti le besoin de faire quelques poses tout au long de cette lecture. J'en suis la première surprise car cela m'arrive très rarement.
Ce ressenti très fort, ces décharges d'émotions négatives prouvent sans aucun doute possible l'immense talent d'Émile Zola. Dans ce récit pourtant de jeunesse, il m'a fortement impressionnée : il a réussi à me faire ressentir physiquement et psychologiquement l'antipathie et le dégoût que m'inspiraient Laurent et Thérèse.
C'est une étude passionnante des émotions et des sentiments, de la peur, du remord, de la culpabilité, de la folie.
*
L'écriture de Zola est puissante, tendue, pleine d'une beauté sauvage et laide. Sans pudeur, il met à nu ses personnages. Il dissèque avec réalisme et froideur leurs motivations et la façon dont les regrets, les remords les hantent et les rongent de l'intérieur.
L'auteur maîtrise parfaitement l'intrigue, tel un marionnettiste tirant les ficelles invisibles des émotions humaines et des désirs. Il excelle à décrire ses personnages dans toute leur complexité, s'intéressant à leur évolution physiologique et psychologique, jusqu'à l'implosion. Ils apparaissent dans toute leur animalité, leurs instincts.
En cela, ce livre m'a rappelé un autre grand roman d'Emile Zola, « La bête humaine », mon préféré de l'auteur à ce jour. Thérèse et Laurent sont comme deux bêtes humaines, cherchant à satisfaire leurs désirs, leurs besoins, leurs intérêts sans tenir compte des actes et de leurs conséquences.
*
Pour conclure, malgré certains passages éprouvants, j'ai été entraînée dans ce triangle amoureux par la puissance de l'écriture d'Emile Zola. L'histoire, de plus en plus sombre et dramatique, devient aussi très prenante, encourageant le lecteur à poursuivre sa lecture pour découvrir le châtiment réservé à chacun.
"Thérèse Raquin" est sans conteste un très grand roman.
*
C'est accompagnée que j'ai entrepris cette lecture. Sans eux, je ne l'aurais peut-être jamais lu. Alors mes derniers mots seront adressés à mes compagnons de route, Dominique (Domm33), Francine (Afriqueah), Fanny (Fanny1980) et Bernard (Berni_29) que je remercie chaleureusement pour cette lecture partagée riche d'échanges et d'une belle amitié littéraire.
Assez sceptique jusqu'à la moitié du livre, j'ai été scotché par la deuxième partie. certains symbolismes sont trop appuyés mais certaines scènes sont incroyables. en un sens, je comprends que les critiques de l'époque aient descendu le livre. il est d'une modernité dingue dans certains traitements de la culpabilité et dans la torture d'une mère d'un fils assassine mais emprisonnée dans son corps. La fin est un peu décevante sauf pour un regard d'un des protagonistes. un coup de coeur même si pour la relation à la culpabilité du crime, j'ai trouvé Crime et châtiment plus fort et subtile.
Un classique à lire absolument. je ne l'ai pas lâché m.
Un classique à lire absolument. je ne l'ai pas lâché m.
Pour le commun des mortels (dont vous et moi faisons partie, dites-moi si je me trompe), « Thérèse Raquin » (1867) est un petit peu le poisson-pilote des Rougon-Macquart. C'est le troisième roman de Zola, après « La confession de Claude » (1865) et « Les Mystères de Marseille » (1867). Et c'est un roman expérimental. Et c'est bien le terme idoine (le mot juste, quoi, vous aviez compris), puisque l'auteur mettait en pratique dans ce roman des notions et des principes puisés dans « l'Introduction à la médecine expérimentale » de Claude Bernard, un ouvrage paru en 1865. Ces principes sont essentiellement l'observation clinique, l'expérimentation et l'étude du sujet non seulement dans sa propre personnalité (y compris son patrimoine génétique) mais aussi en par rapport à son environnement, tant physique que psychologique. Zola, déjà adepte du positivisme d'Auguste Comte et d'Hippolyte Taine, ne fait qu'appliquer ces principes à la littérature :
« Dans Thérèse Raquin, j'ai voulu étudier des tempéraments et non des caractères. Là est le livre entier. J'ai choisi des personnages souverainement dominés par leurs nerfs et leur sang, dépourvus de libre arbitre, entraînés à chaque acte de leur vie par les fatalités de leur chair. Thérèse et Laurent sont des brutes humaines, rien de plus ».
On est loin du romantisme. On est même déjà plus loin que le réalisme de Flaubert. On a pu dire que « Thérèse Raquin » était un roman sombre, d'une noirceur totale, tant dans l'ambiance générale que des sentiments exprimés : c'est d'une justesse absolue : l'histoire des amants maudits qui tuent le mari gênant et sombrent en suivant dans leur propre folie, on a connu plus sémillant comme scénario. Noir, sombre, sordide, putride même, comme l'ont souligné les critiques, le roman est tout ça. Paradoxalement, si on se place du point de vue de Zola, je dirais qu'il est d'une blancheur clinique, une blancheur d'hôpital, ou même de salle de dissection et c'est Zola tient le scalpel : si les personnages éprouvent des émotions, elles sont épidermiques, en réaction aux évènements, jamais contrôlées, et il y a un contraste entre ce débordement de passions exacerbées (dans la sensualité comme dans le meurtre) avec la froideur, l'impassibilité dans lesquelles opère , c'est le mot qui convient, le narrateur. Ici, contrairement à ce que nous pourrons constater dans les Rougon-Macquart, il y a peu de compassion, les personnages sont tellement enfoncés dans la noirceur et la médiocrité qu'ils n'engendrent ni la pitié, ni un regard bienveillant.
Roman expérimental, donc. Il faut le prendre comme tel. Mais c'est aussi (heureusement) un vrai roman littéraire : Zola fait la preuve qu'il est un véritable écrivain. Ses descriptions, toutes réalistes qu'elles soient, ont un côté impressionniste qui séduit (notamment les scènes d'extérieur). En lisant Zola, on ne peut s'empêcher d'avoir devant les yeux des scènes de Monet ou plus encore de Caillebotte ou Degas…
En tous cas un roman qu'il faut avoir lu avant (ou après) les Rougon-Macquart, si on veut saisir toute l'ampleur de cette fresque.
Au cinéma, une bonne adaptation de Marcel Carné en 1953 avec Simone Signoret, Raf Vallone et Jacques Duby.
« Dans Thérèse Raquin, j'ai voulu étudier des tempéraments et non des caractères. Là est le livre entier. J'ai choisi des personnages souverainement dominés par leurs nerfs et leur sang, dépourvus de libre arbitre, entraînés à chaque acte de leur vie par les fatalités de leur chair. Thérèse et Laurent sont des brutes humaines, rien de plus ».
On est loin du romantisme. On est même déjà plus loin que le réalisme de Flaubert. On a pu dire que « Thérèse Raquin » était un roman sombre, d'une noirceur totale, tant dans l'ambiance générale que des sentiments exprimés : c'est d'une justesse absolue : l'histoire des amants maudits qui tuent le mari gênant et sombrent en suivant dans leur propre folie, on a connu plus sémillant comme scénario. Noir, sombre, sordide, putride même, comme l'ont souligné les critiques, le roman est tout ça. Paradoxalement, si on se place du point de vue de Zola, je dirais qu'il est d'une blancheur clinique, une blancheur d'hôpital, ou même de salle de dissection et c'est Zola tient le scalpel : si les personnages éprouvent des émotions, elles sont épidermiques, en réaction aux évènements, jamais contrôlées, et il y a un contraste entre ce débordement de passions exacerbées (dans la sensualité comme dans le meurtre) avec la froideur, l'impassibilité dans lesquelles opère , c'est le mot qui convient, le narrateur. Ici, contrairement à ce que nous pourrons constater dans les Rougon-Macquart, il y a peu de compassion, les personnages sont tellement enfoncés dans la noirceur et la médiocrité qu'ils n'engendrent ni la pitié, ni un regard bienveillant.
Roman expérimental, donc. Il faut le prendre comme tel. Mais c'est aussi (heureusement) un vrai roman littéraire : Zola fait la preuve qu'il est un véritable écrivain. Ses descriptions, toutes réalistes qu'elles soient, ont un côté impressionniste qui séduit (notamment les scènes d'extérieur). En lisant Zola, on ne peut s'empêcher d'avoir devant les yeux des scènes de Monet ou plus encore de Caillebotte ou Degas…
En tous cas un roman qu'il faut avoir lu avant (ou après) les Rougon-Macquart, si on veut saisir toute l'ampleur de cette fresque.
Au cinéma, une bonne adaptation de Marcel Carné en 1953 avec Simone Signoret, Raf Vallone et Jacques Duby.
Que dire de plus que : c'est Zola ! Zola est très prévisible en ce qui concerne la manière d'écrire ses oeuvres, c'est ce que j'aime chez cet auteur. Que ce soit ici dans Thérèse Raquin, ou tous les romans compris dans la saga des Rougon-Macquart, nous retrouvons cette sensation de boucle infernale dans chacune de ses oeuvres, avec pour base de l'intrigue : un fait social. Quand je dis fait social, ici ce serait l'infidélité et le crime par exemple, nous prenons La bête humaine, autre roman d'Emile Zola, ce serait aussi le crime et l'infidélité de nouveau, chez Germinal, la lutte des classes et le dur labeur des mineurs en ce temps… Et justement ce suspens que créait Zola dans chacune de ces oeuvres, nous pousse à en demander plus. Pourquoi pas lire un autre roman d'Emile Zola, quelle sera l'intrigue et le fait social exploité dans cet autre roman ?
Un choc.
Un huis clos avec des personnages qui marquent.
Cela faisait plus de 30 ans que je n'avais pas lu du Zola. Et bien je vais m'y remettre.
J'ai redécouvert un style, une narration, une histoire.
Une époque où le temps avait du temps.
Un huis clos avec des personnages qui marquent.
Cela faisait plus de 30 ans que je n'avais pas lu du Zola. Et bien je vais m'y remettre.
J'ai redécouvert un style, une narration, une histoire.
Une époque où le temps avait du temps.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Émile Zola (293)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Thérèse Raquin - Emile Zola
Comment se nomme le premier mari de Thérèse ?
Robert
Camille
Laurent
9 questions
1104 lecteurs ont répondu
Thème : Thérèse Raquin de
Émile ZolaCréer un quiz sur ce livre1104 lecteurs ont répondu