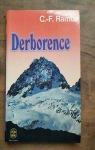Citations de Charles-Ferdinand Ramuz (534)
Il semble que tout est facile quand on aime. Le soleil est plus clair, les fleurs sont plus belles, les hommes meilleurs. Le monde se découvre à vous, paré comme un champ de fête de ses arbres, de ses prairies et de ses montagnes.
On ne l'avait pas entendue ouvrir sa porte, on ne l'a pas entendue venir, tellement elle est légère. Ses pieds touchaient la terre comme sans s'y poser. Il n'y a eu que le frôlement de sa jupe comme quand un beau papillon vous effleure de l'aile, rien que ce froissement d'étoffe qui fait pourtant que Décosterd se retourne ; alors il reste là, son verre dans la main. Rouge, à ce même moment, se redresse ; les bras lui sont tombés le long du corps, pendant que la lumière venue par l'ouverture de la porte est sur lui, sur son beau costume de serge bleu marine, sa chemise à col blanc, sa cravate, sa grosse moustache.
C'est qu'elle était plus brillante que jamais, c'est qu'on ne la reconnaissait plus.
C'est qu'elle était plus brillante que jamais, c'est qu'on ne la reconnaissait plus.
Julien dit :
— Bonjour.
Elle répondit :
— Bonjour.
C’est de cette façon qu’ils commencèrent. Julien dit ensuite :
— D’où est-ce que tu viens ?
— De chez mon oncle.
— Il fait bien chaud.
— Oh ! oui.
— Et puis c’est loin.
— Trois quarts d’heure.
— C’est que c’est pénible avec ce soleil et cette poussière.
— Oh ! je suis habituée.
Ils se tenaient l’un devant l’autre comme des connaissances qui se font la politesse de causer un peu, s’étant rencontrées. Julien avait une main dans sa poche, l’autre sur le manche de sa faux, et il tournait la tête de côté tout en parlant. Mais les oreilles d’Aline étaient devenues rouges. Et, lui aussi, malgré son air, il avait quelque chose à dire, qui n’était pas facile à dire, c’est pourquoi il ne chercha d’abord qu’à gagner du temps.
Il demanda à Aline :
— Où est-ce que tu vas ?
Elle dit :
— Je rentre.
— Moi aussi. Veux-tu qu’on fasse route ensemble ?
[C.F. RAMUZ, "Aline", Librairie académique Didier, Perrin et Cie (Paris) / Payot éditeur (Lausanne), 1905 - chapitre I]
— Bonjour.
Elle répondit :
— Bonjour.
C’est de cette façon qu’ils commencèrent. Julien dit ensuite :
— D’où est-ce que tu viens ?
— De chez mon oncle.
— Il fait bien chaud.
— Oh ! oui.
— Et puis c’est loin.
— Trois quarts d’heure.
— C’est que c’est pénible avec ce soleil et cette poussière.
— Oh ! je suis habituée.
Ils se tenaient l’un devant l’autre comme des connaissances qui se font la politesse de causer un peu, s’étant rencontrées. Julien avait une main dans sa poche, l’autre sur le manche de sa faux, et il tournait la tête de côté tout en parlant. Mais les oreilles d’Aline étaient devenues rouges. Et, lui aussi, malgré son air, il avait quelque chose à dire, qui n’était pas facile à dire, c’est pourquoi il ne chercha d’abord qu’à gagner du temps.
Il demanda à Aline :
— Où est-ce que tu vas ?
Elle dit :
— Je rentre.
— Moi aussi. Veux-tu qu’on fasse route ensemble ?
[C.F. RAMUZ, "Aline", Librairie académique Didier, Perrin et Cie (Paris) / Payot éditeur (Lausanne), 1905 - chapitre I]
Comme le soleil donne fort, une première tache brune vient d'apparaître, tout à coup. Et d'en haut la chaleur descend et agit avec sa elle flamme claire, mais d'en bas, de dessous la neige, il semble que la terre elle aussi s'aide, étant impatiente après son long sommeil d'hiver. Cependant de tous les côtés, qu'on regarde vers en haut, qu'on se tourne vers en bas, on ne voit rien que du blanc, tout est recouvert : dessus un ciel tout bleu, posé sur les arêtes, comme le toit sur la muraille. Et tout est bleu et blanc, il n'y a qu'ici cette tache brune qui sort puis qui s'élargit peu à peu, et au bord il se forme une mince croûte de glace où roulent une à une comme des perles d'eau.
[C.F. RAMUZ, "Le Village dans la montagne", éditions Payot & Cie (Lausanne) / Librairie Académique Perrin (Paris), 1908, chapitre I — réédition "Bibliothèque des Amis de Ramuz" (Loches), 2001, page 25]
[C.F. RAMUZ, "Le Village dans la montagne", éditions Payot & Cie (Lausanne) / Librairie Académique Perrin (Paris), 1908, chapitre I — réédition "Bibliothèque des Amis de Ramuz" (Loches), 2001, page 25]
Et puis peut-être qu'il ne faut pas aimer les hommes pour leurs différences, mais leurs ressemblances, et voir surtout en eux par où ils sont tous frères, ayant tous les mêmes douleurs, les mêmes joies, les mêmes peines, une même façon d'aimer.
Les voir dans le durable, dans leur fond, non dans l'accident.
[C.F. RAMUZ, "Le Village dans la montagne", éditions Payot & Cie (Lausanne) / Librairie Académique Perrin (Paris), 1908, chapitre IX — réédition "Bibliothèque des Amis de Ramuz" (Loches), 2001]
Les voir dans le durable, dans leur fond, non dans l'accident.
[C.F. RAMUZ, "Le Village dans la montagne", éditions Payot & Cie (Lausanne) / Librairie Académique Perrin (Paris), 1908, chapitre IX — réédition "Bibliothèque des Amis de Ramuz" (Loches), 2001]
Un dimanche matin, pendant qu'ils étaient ensemble, les cloches se mirent à sonner. Elles sonnaient pour avertir le monde, une heure avant le sermon. Et, comme elles étaient mal accordées, l'une très basse, l'autre très haute, l'une battant vite, l'autre à longs coups sourds, elles avaient l'air, par les champs, d'un ivrogne avec sa femme qui s'en vont se querellant.
Elle avait une jolie robe de foulard blanc avec des bouquets de fleurs bleues, un col de lingerie. Elle tenait son livre de cantiques dans la main gauche, elle avait des gants de coton blanc. Elle s’était faite belle pour lui. Elle n’avait pas plus de dix-sept ans, lui dix-huit. On lave ses cheveux blonds avec un shampooing à la camomille dans sa cuvette, avant de se coucher ; on en roule les mèches avec soin dans des papillotes de cuir ; et au matin, le soleil revenu, on voit la belle couleur de miel qu’ils ont, – et tout ça inutilement, et toutes ces choses pour rien.
Émilie n’a rien répondu. Elle redescend l’escalier. Et elle va, mais où aller ? On n’existe que là où il est ; rien n’existe où il n’est pas.
C’est la petite Émilie. Elle avait une jolie robe de toile à rayures, elle avait un chapeau de paille avec un ruban de soie, elle avait ses beaux cheveux blonds : oh ! qu’est-ce qu’on cherche dans la vie ? Elle demande aux arbres s’ils ne l’ont pas vu. Elle va sous des cerisiers dans un chemin herbeux, marqué seulement par deux ornières ; mon Dieu ! comme on est solitaire ! Elle lève les yeux, elle voit qu’il n’y a rien, qu’il n’y a personne nulle part. Personne que sa petite ombre qui est un peu à gauche et un peu en avant d’elle dans l’herbe. Elle regarde alors en arrière d’elle où on voit le village s’abaisser peu à peu, vu d’en dessus, avec ses toits ; mais ça ne compte pas, ces toits. Ni ces pommiers, ni ces noyers, ni ces poiriers, ni toutes ces barrières, ni la ligne du chemin de fer, ni la gare [...] Elle va seule, avec son ombre.
Mais quelle infériorité plus grande que celle de ne pouvoir parler naturellement, de naissance, qu'une langue et de s'entendre dire qu'on ne la sait pas? Il n'y avait pas jusqu'à notre « accent » qu'on ne nous reprochât, comme s'il n'était pas, lui-même et à lui seul, une preuve excellente de notre appartenance à cette grande communauté des dialectes et patois français, car chaque province a le sien.
...et de permettre par là même de se créer après une journée de travail une occasion de distraction où chacun oublie ce qu'il a été pour devenir momentanément ce qu'il convient qu'il soit.
L'art est fait de nouveauté, la mode d'une apparence de nouveauté: c'est par où à la fois ils se ressemblent et ils diffèrent.
Il n’y a plus de différence en rien ; tout se confond, tout se mêle ; est-ce au dedans de moi ou au-dessous que je regarde ? Mais ils sont là, et je les vois. Je ne suis plus jaloux ; eux, ils n’ont plus peur. Au lieu de reculer, ils se soulèvent sur le coude ; moi, je me penche encore un peu. Ils sont tous là, comme je dis. C’est ma chère maman qui est morte quand j’étais petit, et je l’appelle encore maman comme quand j’étais petit ; c’est M. Loup qui a été bon pour moi et pour qui je n’ai eu que de l’ingratitude ; c’est Adèle, la pauvre Adèle ; c’est le petit Henri que je n’ai pas su aimer quand j’aurais dû et je n’ai pas su le retenir près de moi quand j’aurais dû, alors il est sorti de la vie ; mais c’est surtout toi, Louise, parce que tu es quand même, parmi tous et toutes, la plus chère et douce à mon cœur. Toi non plus, je n’ai pas su t’aimer, du moins comme il aurait fallu ou comme tu aurais voulu ; je t’ai aimée à ma manière, non à la tienne ; je n’ai jamais pu m’oublier ; et ainsi tu te tourmentais, cherchant à me cacher ta peine, mais je le voyais bien quand même ; et c’était vers la fin, tu sais, pourtant tu ne te plaignais pas. Mais tu es là, et il n’en faut pas plus. Vois-tu, tout est changé, je ne suis plus le même. Je n’ai plus cet air sombre, je n’ai plus ces silences, ce pli entre les yeux ; je suis devenu le vrai Samuel ; je t’aime maintenant, Louise. Et c’est pourquoi plus rien ne nous sépare, quand je regarde ainsi et me penche vers toi, et vers tout mon passé vivant, et cette eau claire où tu te tiens ; et je dis : « Souris-moi » parce que tu sais, toi aussi. Et, toi aussi, tu te soulèves ; il me semble que je te vois monter hors de la profondeur vers moi ; je me penche davantage, tu t’élèves toujours plus ; et nos lèvres alors se touchent et ma main va dans tes cheveux.
Il ne me reste qu’à attendre et à vivre de mon mieux jusqu’au terme fixé. Car l’essentiel est qu’il faut vivre quand même et il faut mourir encore vivant. Il y en a tant qui sont déjà morts quand la mort de la chair vient les prendre. Ils sont morts dans leur cœur depuis longtemps déjà, quand arrive la mort du corps ; et c’est sur ce cœur que je veille, afin qu’il dure jusqu’au bout.
Un petit peuple inchoatif (au sens grammatical du mot), qui se préoccupe bien davantage de ce qu'il a l'intention de faire ou de ce qu'il est en train de faire, que de ce qu'il fait, comme s'il était indifférent au résultat. Un petit peuple tenu trop longtemps à l'écart de la vie, un petit peuple neutre, un petit peuple trop ménagé, un petit peuple trop confortablement installé dans ses habitudes (ou qui l'était encore en ce temps là); et il se heurte dans la personne d'un de ses ressortissants à une population qui est vive, avare de son temps, qui est dense, où les rencontres sont incessantes, où il s'agit de faire vite, et, sous peine d'être évincé, de nommer chaque chose aussitôt par son nom. Sous la communauté de la langue se dissimule sournoisement la différence des habitudes et des natures, que tout à coup un mot fait éclater, d'où un malaise (j'exagère à peine).
Le mot bourgeois a d'ailleurs ici un sens assez particulier: il faut entendre un homme qui défend coûte que coûte ses droits, même ceux qu'il a usurpés.
Ils étaient obligés de se donner rendez-vous loin du village, parce qu'il y a toujours des curieux. Il y a toujours des curieux, il y a toujours du monde qui se mêle de ce qui ne le regarde pas. Elle avait un râteau sur l'épaule ; il voyait comment, avec les dents de son râteau, elle accrochait les nuages en passant. Les nuages lui tombaient sur la tête.
Il n'y avait jamais eu autant de nez d'enfants aplatis derrière les vitres que ce matin-là, parce qu'on les empêchait de sortir.
De son côté, il s’était mis en route ; c’était son tour à lui de se remettre en route, pendant que la petite musique venait toujours, mais elle venait à présent pour lui entre les pins, bougeant doucement derrière leurs troncs rouges, et par terre aussi c’était tout rouge, à cause des aiguilles tombées sur lesquelles Victorine glissait.
Pendant que la petite musique venait, et la petite musique venait d’en haut, à leur rencontre, entre les pins ; tandis que Victorine glissait, parce qu’elle n’avait pas de clous à ses souliers. C’étaient ces petits souliers sans clous qu’elle mettait pour aller danser le dimanche ; un de ces après-midi de dimanche où ils allaient danser dans les fenils de la montagne, de l’autre côté de la forêt ; et elle glissait sur les aiguilles, ce qui la mettait en colère, ce qui la faisait rire, puis elle semblait prête à pleurer.
Il la prenait par la main, il la tirait à lui ; mais elle se fâchait de nouveau, disant qu’il allait lui déchirer son caraco de mohair, bien mince en effet, et brillant, brillant comme un morceau de ciel sous les arbres, pendant qu’il y avait là-haut entre les arbres ces autres morceaux de ciel.
« Ne tire pas si fort tu vas me déchirer… »
Pendant que la petite musique venait, et la petite musique venait d’en haut, à leur rencontre, entre les pins ; tandis que Victorine glissait, parce qu’elle n’avait pas de clous à ses souliers. C’étaient ces petits souliers sans clous qu’elle mettait pour aller danser le dimanche ; un de ces après-midi de dimanche où ils allaient danser dans les fenils de la montagne, de l’autre côté de la forêt ; et elle glissait sur les aiguilles, ce qui la mettait en colère, ce qui la faisait rire, puis elle semblait prête à pleurer.
Il la prenait par la main, il la tirait à lui ; mais elle se fâchait de nouveau, disant qu’il allait lui déchirer son caraco de mohair, bien mince en effet, et brillant, brillant comme un morceau de ciel sous les arbres, pendant qu’il y avait là-haut entre les arbres ces autres morceaux de ciel.
« Ne tire pas si fort tu vas me déchirer… »
Il pouvait être midi. Le ciel faisait ses arrangements à lui sans s’occuper de nous. Dans le chalet, ils ont essayé encore d’ouvrir la bouche aux bêtes suspectes, empoignant d’une main leur mufle rose, introduisant les doigts de l’autre main entre leurs dents, tandis qu’elles meuglaient ; – et, là-haut, le ciel faisait ses arrangements à lui. Il se couvrait, il devenait gris, avec une disposition de petits nuages, rangés à égale distance les uns des autres, tout autour de la combe, quelques-uns encapuchonnant les pointes, alors on dit qu’elles mettent leur bonnet, les autres posés à plat sur les crêtes. Il n’y avait aucun vent. Le ciel là-haut faisait sans se presser ses arrangements ; peu à peu, on voyait les petits nuages blancs descendre. De là-haut, le chalet n’aurait même pas pu se voir, avec son toit de grosses pierres se confondant avec celles d’alentour, et les bêtes non plus ne pouvaient pas se voir, tandis qu’elles s’étaient couchées dans l’herbe et faisaient silence.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur
Auteurs proches de Charles-Ferdinand Ramuz
Lecteurs de Charles-Ferdinand Ramuz (1151)Voir plus
Quiz
Voir plus
Aimé Pache, peintre vaudois de Charles-Ferdinand Ramuz
Ce roman, paru en 1911 à Paris chez Fayard et à Lausanne chez Payot, est dédié à un peintre : ...
Alexandre Cingria
René Auberjonois
Cuno Amiet
Ferdinand Hodler
15 questions
3 lecteurs ont répondu
Thème : Aimé Pache, peintre Vaudois de
Charles Ferdinand RamuzCréer un quiz sur cet auteur3 lecteurs ont répondu