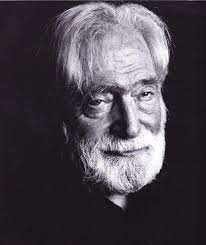Citations de Claude Louis-Combet (96)
Souvenir de son village et désir de Byzance appartenaient à tout ce qui demeurait en lui d’obscur, d’humide, de végétatif, à cette sorte de ténèbre marine qui faisait partie de lui-même et dont ses désirs inquiets recherchaient l’image dans le puits près duquel il venait de préférence travailler. Au centre du monastère de Maria Glykophilousa, au centre du Désert, au centre de la Bithynie, ce puits unique et inépuisable formait une enclave de fraîcheur dans l’inhumanité du monde – et comme une réminiscence de nuit. Frère Marinus s’y sentait bien. Il s’y sentait chez lui. Par-delà tant de renoncements, c’était comme son domaine et, dans l’absence de tout autre miroir, comme une certaine image de lui-même – cependant que le règne du soleil s’étalait à l’infini et faisait crisser les pierres, dans la solitude de leur essence.
Et maintenant, ce carrefour des directions de l’âme s’était modifié – ou plutôt déplacé. Frère Marinus occupait le Désert tout entier. À vrai dire, il ne régnait pas précisément sur l’immense étendue de pierre, de sable et de broussaille qui courait, de toutes parts, jusqu’à l’horizon. Il était plutôt comme un gravillon quelconque ou un galet ou une épine dans cette solitude – sans plus de sens ni de valeur (se disait-il). Mais si nul fût-il et si négligeable, il ne pouvait se désintéresser de ces deux mondes, hors de prise, qui, désormais, limitaient sa province : son village et Byzance. Et il comprenait bien que ces lieux, dont il ne connaissait réellement que le premier, entretenaient, dans sa mémoire et dans son imagination, un rapport essentiel avec sa féminité.
Toutes sortes de signes révélaient alors à l’adolescence religieuse sa vocation à la vacance du moi. C’était dans l’air, dans l’eau et sur la terre et toujours au-delà de toute prise immédiate, dans l’infini des rapports et des distances : affaire de vents et de senteurs, de jeux de nuages, de profils de paysages et du mouvement de la mer sur la grève. De participer à cette expansion dissolvante du réel, l’individualité perdait le sens de ses limites – et le nom qu’elle traînait avec elle en vertu du système de toutes les habitudes, voici qu’il se vidait de son épaisseur et accédait, mystérieusement, à la transparence de l’aléatoire : les trois syllabes de MA-RI-NA n’avaient alors pas plus de signification ni plus de portée que la rumeur qui émane des choses, en permanence, aux heures les plus creuses du jour – ou encore et plus encore que ce bruit de mer, en l’inconscience du temps, dont il semblait que son nom exprimât l’essence musicale dépourvue d’intention.
Il y avait, naturellement, à songer que son nom, destiné à la reconnaissance par les autres, n’avait nul autre sens que l’évocation de l’incessante fluidité des grandes eaux qui baignent le monde, une sorte de rémission de l’existence et comme le retrait des tensions, utiles à la vie de chaque jour, au profit d’un temps qui ne vise à rien d’autre qu’à son propre mouvement de prise et de reprise, d’afflux et de reflux, rejetant l’histoire, excluant le drame et réalisant une instance proche de l’éternel par la simple continuité de son rythme. Bien des récits traduisaient d’ailleurs, à leur façon, la leçon finale de la mer. C’étaient des récits d’immersion, d’érosion, de décomposition par les eaux. Ils disaient ou laissaient entendre que la mer, qui avait précédé toute forme de matière, aurait raison, inéluctablement, de toute matière et, d’abord, de toute forme – et que ce qui avait commencé par les eaux finirait par les eaux, comme si la résistance des êtres et leur obstination à faire face à la destinée n’étaient que sursis de dissolution. Et ils disaient aussi que les choses les plus belles étaient les premières à réintégrer l’océan originel : les villes, par exemple, qui avaient disparu dans les flots étaient toujours celles que l’on avait célébrées pour leur magnificence et leur prospérité et c’étaient les terres les plus fécondes et les paysages les plus intenses qu’un effondrement soudain ou un raz de marée avait un jour ramenés au bercail fondamental. Quant aux femmes, un destin de noyade était promis à celles dont la beauté réalisait tellement la perfection de l’être que la vie, pour elles, avait cessé d’être nécessaire et que, vierges ou amantes, saintes ou pécheresses, elles avaient rompu avec la consistance des choses et, se laissant aller à elles-mêmes, se laissaient aller à couler. Leurs noms avaient dû être si étranges que la mémoire humaine en avait perdu le souvenir. Mais au temps où Marina processionnait avec les jeunes filles de son village, au bord extrême de la plage, il lui semblait qu’en son propre nom courait le rappel de noms plus anciens : ceux des grandes submergées dont le rêve aquatique s’était accompli jusqu’au bout – tout comme il lui semblait que les eaux profondes et douces qui les avaient reprises faisaient partie de son corps, en un lieu charnel hors d’atteinte, dans l’ombre duquel mûrissaient ses désirs. Et c’était comme si d’être, alors, Marina, l’essence de ce qui n’est que passage, rythme et mouvance, s’équilibrait, en elle, avec le plaisir d’exister dans la richesse de son ventre et de ses membres, de sa croupe et de ses seins. Être femme, de terre et d’eau, c’était le grand bonheur bithynien que ne semblait altérer nulle saison en cette paix des jours qui liait le temps à lui-même comme une étoffe infinie et jamais rompue.
Il y avait, naturellement, à songer que son nom, destiné à la reconnaissance par les autres, n’avait nul autre sens que l’évocation de l’incessante fluidité des grandes eaux qui baignent le monde, une sorte de rémission de l’existence et comme le retrait des tensions, utiles à la vie de chaque jour, au profit d’un temps qui ne vise à rien d’autre qu’à son propre mouvement de prise et de reprise, d’afflux et de reflux, rejetant l’histoire, excluant le drame et réalisant une instance proche de l’éternel par la simple continuité de son rythme. Bien des récits traduisaient d’ailleurs, à leur façon, la leçon finale de la mer. C’étaient des récits d’immersion, d’érosion, de décomposition par les eaux. Ils disaient ou laissaient entendre que la mer, qui avait précédé toute forme de matière, aurait raison, inéluctablement, de toute matière et, d’abord, de toute forme – et que ce qui avait commencé par les eaux finirait par les eaux, comme si la résistance des êtres et leur obstination à faire face à la destinée n’étaient que sursis de dissolution. Et ils disaient aussi que les choses les plus belles étaient les premières à réintégrer l’océan originel : les villes, par exemple, qui avaient disparu dans les flots étaient toujours celles que l’on avait célébrées pour leur magnificence et leur prospérité et c’étaient les terres les plus fécondes et les paysages les plus intenses qu’un effondrement soudain ou un raz de marée avait un jour ramenés au bercail fondamental. Quant aux femmes, un destin de noyade était promis à celles dont la beauté réalisait tellement la perfection de l’être que la vie, pour elles, avait cessé d’être nécessaire et que, vierges ou amantes, saintes ou pécheresses, elles avaient rompu avec la consistance des choses et, se laissant aller à elles-mêmes, se laissaient aller à couler. Leurs noms avaient dû être si étranges que la mémoire humaine en avait perdu le souvenir. Mais au temps où Marina processionnait avec les jeunes filles de son village, au bord extrême de la plage, il lui semblait qu’en son propre nom courait le rappel de noms plus anciens : ceux des grandes submergées dont le rêve aquatique s’était accompli jusqu’au bout – tout comme il lui semblait que les eaux profondes et douces qui les avaient reprises faisaient partie de son corps, en un lieu charnel hors d’atteinte, dans l’ombre duquel mûrissaient ses désirs. Et c’était comme si d’être, alors, Marina, l’essence de ce qui n’est que passage, rythme et mouvance, s’équilibrait, en elle, avec le plaisir d’exister dans la richesse de son ventre et de ses membres, de sa croupe et de ses seins. Être femme, de terre et d’eau, c’était le grand bonheur bithynien que ne semblait altérer nulle saison en cette paix des jours qui liait le temps à lui-même comme une étoffe infinie et jamais rompue.
À quelques jours de là, un événement tout à fait extraordinaire impressionna la communauté villageoise, les hameaux et les bourgs alentour. L’église d’Épinoy possédait une très ancienne et très honorée Vierge noire installée dans une niche que l’on avait creusée dans l’un des gros piliers qui délimitaient le chœur, du côté de l’évangile. Cette Vierge que l’on honorait sous le nom de Notre-Dame de la Pile était une statue de bois revêtue d’un riche manteau de brocart doré, sous lequel elle portait une robe de fine toile blanche qui lui descendait jusqu’aux pieds. Ainsi affublée, assise sur un trône, Notre-Dame de la Pile tenant ses deux mains ouvertes appuyées sur ses genoux, paraissait en attente et en offrande – et qu’offrait-elle sinon son corps, peut-être pour rien, peut-être pour le moment d’un refuge des pécheurs (Refugium peccatorum) et comme la voie obligée d’un passage vers le paradis final (Janua cœli). Dans l’échancrure de son manteau accablé de dorure, la modeste et candide étoffe de sa robe laissait s’engouffrer toutes les plaintes de la vie, toutes les détresses, toutes les plus humbles aspirations. Cette Vierge se trouvait mise de telle façon que le priant, au pied de sa pile, n’éprouvait pas de désir plus impérieux encore qu’irréalisable que de poser son front sur les genoux et dans les mains de la toute miséricordieuse Mère de Dieu et Mère de tous les pécheurs (Mater peccatorum). Or voici : ce matin-là, le prêtre desservant de la paroisse se préparant à assurer l’office du dimanche, s’arrêta un instant, juste le temps de se recueillir par dévotion, devant la statue. À cette heure, dans cette saison, l’église était encore plongée dans l’obscurité. Cependant, levant les yeux vers la mère de Dieu et parcourant lentement de son regard, plein de lassitude et d’habitude, la totalité du corps assis, et hiératique, il remarqua à la courbure du tronc et des jambes, dans l’exact creux des cuisses, une tache étoilée, faiblement lumineuse, que l’on eût dite la respiration légère de l’obscurité. Cela brillait d’insolite façon et captait le regard et le captivait à tel point que le brave homme soudainement inspiré et bousculé dans ses manières ne put se retenir d’aller chercher une échelle qu’il appliqua contre le pilier afin de voir de plus près quel genre de phénomène se produisait là. Alors, pour ainsi dire, le visage dans le creux du corps de la Vierge, il put constater que celui-ci saignait, sourdement, et que ce qui lui avait semblé, d’en bas, pure effusion de lumière, était, vu de face, une macule sanguinolente qui trempait le vêtement. Le prêtre n’osa pas toucher la chose. Il n’osa pas porter la main sur la robe de la Vierge. Encore moins n’osa-t-il, il n’y songea pas, la soulever afin de découvrir ce qu’elle voilait. Il était lui-même un simple prêtre, nullement un esprit fort. De tels esprits ne se rencontraient, en ce temps-là, que dans les marges extrêmes de l’hérésie. Tandis que le jour se levait et que le jeune soleil se répandait à travers les vitraux, le curé d’Épinoy se contenta humblement de saluer le miracle auquel il était le premier homme à assister. La statue de la Vierge saignait, c’était manifeste, et il était manifeste aussi qu’elle saignait en un point du corps que la pudeur sacrée interdisait de nommer. Cependant l’heure de la messe était arrivée et une poignée de fidèles, des bonnes femmes surtout, serrées de petits enfants, se tenait agenouillée sur la dalle. Or étrangement, au moment de l’élévation du calice et de l’hostie, les regards qui auraient dû s’abaisser et se recueillir en direction de l’événement sacré qui se déroulait sur l’autel, s’ouvrirent et se tournèrent vers le pilier de la Vierge, comme si une force magnétique les avait captés, et bientôt, tandis que le prêtre s’efforçait de poursuivre sa cérémonie, les fidèles se levèrent, s’agitèrent, se rassemblèrent au pied de la statue et montrèrent du doigt ce qui éclatait, de toute évidence : la robe de la Vierge trempée de sang.
Un métayer, du hameau de La Poudroye, fut le témoin d’une scène étrange qu’il narra par la suite à tout venant jusqu’à la fin de ses jours. Le 19 mars, jour de saint Joseph, une vache mit bas sur la paille au petit matin. Tout se passa bien d’abord. Mais lorsqu’il fut sur ses pattes, le veau, au lieu de chercher le pis de sa mère, comme font tous les veaux, pour se désaltérer et se nourrir, chercha la cougne, c’est-à-dire la grosse fente encore toute congestionnée et dolente d’où on l’avait extirpé à grand renfort de bras. Le métayer avait beau le pousser sous le ventre de la vache, le petit animal, tout humide et tout tremblant, revenait au sexe qu’il humait et léchait. On vit alors cette chose étonnante : le veau, debout sur ses pattes arrière qui fléchissaient, au point qu’il dut s’y appliquer à maintes reprises et maladroitement, finit par appuyer son museau tout entier contre la vulve et à l’y introduire. Le pauvre débile faisait pitié mais il persévéra. La vache mugissait doucement, presque tendrement, en une vaste complicité de chair qui défiait les lois ordinaires de la nature. Et l’homme, là-devant, était tellement surpris, avait tellement conscience d’assister à un phénomène exceptionnel et quasiment miraculeux, qu’il était incapable d’intervenir et se contentait de regarder, laissant faire les bêtes entre elles. Il put donc voir le veau pousser lentement sa tête dans le vagin, tandis que tout le petit corps, surmené d’appétit indicible, bien au-delà de ses forces, s’agitait comme une chiffe, de plus en plus faiblement. À la fin, lorsque le museau fut enfoncé jusqu’aux yeux, le veau d’un jour cessa tout mouvement et resta pendu à l’arrière-train de sa mère – appendice fantasque et fantastique, suffoqué, pensera-t-on, par son bonheur et sa performance singulière, autant que par l’inévitable asphyxie, aucune mère ne s’offrant jusqu’au bout comme un objet respirable.
Il y avait eu des signes au cours des semaines précédentes, à Épinoy-en-Artois. On avait noté qu’une gargouille de l’église s’était brusquement effondrée, sans cause apparente, un dimanche de mars, à l’heure de la messe chantée. Elle était tombée contre un groupe d’enfants. Une petite fille avait été choquée et sur place avait fait des convulsions. Les bonnes gens s’étaient attroupées autour d’elle. Le prêtre l’avait aspergée d’eau bénite. Elle gisait à terre, toute secouée de soubresauts. Elle avait relevé sa jupe par-dessus la tête et personne ne pouvait la lui faire abaisser. On voyait donc son ventre nu, avec son entaille au bas clairement tracée dans le relief. Les jeunes garçons riaient en se poussant du coude et leurs mères levaient les bras au ciel. Cependant l’étrangeté de la scène tenait moins à la fillette, crispée dans l’exhibition de sa petite nudité, qu’à la présence au sol de la gargouille. Car celle-ci figurait ni plus ni moins une diablesse en gésine. Entre ses cuisses écartées, magnifiées d’une plantureuse vulve, surgissait la face pointue d’un diablotin. Plantée à la base du clocher dont elle recueillait les eaux de pluie, cette gargouille n’avait jamais attiré le regard de personne. Mais à présent elle était là, grotesque et impudique. Et les malins, voyant tout ce que montrait la petite fille, dépitée de toute ingénuité, s’attendaient à voir sortir de l’ornière un visage anguleux ou un pied lutin, par goût de la réplique et plaisir de la symétrie. Mais rien ne parut. L’enfant finit par baisser son jupon. Elle s’assit sur son séant et regarda le monde en souriant.
L’homme qui écrit n’avait pas bonne opinion de lui-même. Il se tenait en mépris face au développement de son histoire. Il n’accusait personne. Il incriminait son être même. Bien avant ce moment de l’adolescence où la lecture de Pascal lui apprit que le moi est haïssable, il avait senti – mais comme on peut sentir le poids d’une fatalité qui ne concerne que soi-même, dans une flagrante exception à la loi ordinaire – s’ouvrir en lui la faille destructrice d’un impératif catégorique, formulé en termes négatifs et à partir duquel il aurait, avec le temps, à vivre et à (se) créer : Tu ne parleras pas de toi-même.
On ne trouve, dans le Décalogue, aucune prescription particulière concernant l’écriture, à moins d’y ranger l’article qui condamne le faux témoignage (Exode 20,16) pris dans une acception surtout juridique. Ce n’est pas notre affaire. Quant à l’interdit de la parole, il porte uniquement sur l’usage du nom de Dieu : Vous ne prononcerez point en vain le nom du Seigneur votre Dieu (Exode 20, 7). Il n’y a même pas condamnation du mensonge – ce qui, aujourd’hui, à l’heure où il écrit ces lignes, frappe étrangement le narrateur qui se souvient à quel point son enfance et toute sa jeunesse subirent la culpabilité entretenue par la pratique mensongère : en une expérience intérieure où le garçon, faible devant lui-même, devant les autres et le monde, abusait des mots, pervertissait la parole, à des fins la plupart du temps misérables, comprenant intuitivement que la somme entière des mots était à sa disposition et que, faute de pouvoir accepter la réalité des événements et la vérité des êtres, il entrait dans les artifices de l’expression. Peut-être la culture du mensonge dans la vie eut-elle sa part dans la destination à l’écriture, car elle avait permis d’entendre qu’il n’y a rien d’impossible à la langue et elle avait, peu à peu, révélé l’urgence d’un huis clos de paroles où le narrateur s’efforçant de devenir tel, tracerait pour lui-même les figures de son authenticité. Le mensonge dans la vie – et jusque dans l’être – créait la nécessité de recourir à des fabulations dans l’obscurité desquelles le cœur s’appliquerait à chercher son chemin de vérité. Tel fut, au commencement, et tel demeure le sens éthique de l’écriture.
Il relit donc le Décalogue qui constitue le fondement moral de la culture à laquelle il appartient par toutes les fibres de sa sensibilité et tous les moyens de son intelligence. Il a, dans sa vie comme dans ses écrits, largement abondé du côté de la sphère convenue du mal. Pour s’en tenir à l’écriture, il l’a inscrite dans le champ clos, toujours ouvert toutefois, de maintes perversions jusqu’à celle, inévitable, de l’hagiographie – avec une détermination empreinte de gravité, comme si c’eût été une affaire majeure de copuler avec des textes spirituels dans l’ornière d’une vie exilée de toute transcendance. Il est vrai que, une fois perdue la pureté première, on peut faire son lit de n’importe quoi.
Le narrateur, donc, ayant en tête et comme sous la peau la somme bien serrée de tous ses écrits – depuis les tout premiers poèmes vers l’âge de treize ou quatorze ans jusqu’à ce livre qu’il entreprend aujourd’hui de rédiger –, interroge la Loi divine comme mesure unique de son œuvre et de sa vie, avec toujours, en lui, cette vision fantasmagorique d’une existence où l’œuvre écrite tiendrait lieu de vie vécue. Son affaire, assurément, fut bien d’écrire – il n’avait guère d’autre choix – et d’écrire bien : c’était une exigence indissociablement éthique et esthétique. Son souci, son inquiétude, puis, peu à peu, son hébétude face à l’échec de son entreprise, ce fut l’essor puis la déconfiture d’un rêve selon lequel l’homme – l’individu qu’il était, dans l’espace, dans le temps, mêlé aux autres – devait diminuer, s’effacer, s’annihiler quasiment, au profit de l’œuvre, en sorte que le livre, élaboré dans un anonymat, non pas fictif, non pas calculé, mais spirituellement nécessaire, prît tout simplement la place du vivant, couvrant celui-ci de l’ombre entière de ses pages développées. Certes, ce rêve n’est pas complètement abandonné, mais l’évidence de son irréalisation jusqu’à ce jour laisse le narrateur terriblement démuni en face de lui-même. Et c’est pourquoi, comme dans son enfance croyante et pieuse, il interroge les Dix Commandements, scrutant dans le texte son point de faillite et se demandant quel fut son péché pour être, à l’heure qu’il est, tellement exclu de la bonne conscience d’un accomplissement personnel et de la satisfaction d’une reconnaissance par ses pairs.
Lorsque le narrateur, après trente ans d’une pratique assidue de la fable, de la mythobiographie, du récit onirique et fantasmatique, se penche décidément sur l’origine d’un projet d’expression qui a occupé, comme l’on dit, le meilleur de son temps, il interroge, ainsi qu’il l’a fait si constamment dans le cours de son enfance et plus encore de son adolescence, les articles du Décalogue – lequel constituait véritablement, pour le chrétien qu’il était alors, la règle, le principe indiscutable, la norme infaillible de l’existence. Il y avait appris qu’il devait adorer son Dieu, qu’il devait honorer ses parents, qu’il ne devait ni tuer ni voler, qu’il lui était interdit de commettre l’adultère (mot dont l’enfant ignorait le sens, encore qu’il s’en doutât), de porter de faux témoignages, de cultiver dans son cœur le désir de ce qui ne lui appartenait pas.
Une bête fabuleuse,gardienne de tous les trésors de la femme avait pris possession de son corps et régnait sur le peuple des désirs obscurs,sans nom et sans forme.
Elle était allée jusqu'au bout de son fantasme,elle l'avait fixé au centre de son être et s'était construite autour de lui.
“il apparaissait, de toute évidence, que l’écriture sur laquelle on avait tellement misé, sous le rapport de la question du sens de l’existence, n’était rien de plus que la suprême vanité, la plus orgueilleuse et la plus sournoise, celle qui , par-dessus tout, interdisait même simplement d’entrevoir la vérité et le fond.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur

Le regard de Méduse
Pecosa
56 livres

Fictions biographiques
LowrySam
30 livres
Auteurs proches de Claude Louis-Combet
Lecteurs de Claude Louis-Combet (116)Voir plus
Quiz
Voir plus
Connaissez-vous...
Qu'est-ce que la mysophobie? Une phobie...
de l'eau
du contact social
de l'avion
des microbes
scolaire
1 questions
58 lecteurs ont répondu
Créer un quiz sur cet auteur58 lecteurs ont répondu