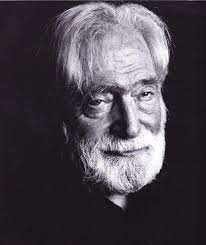Citations de Claude Louis-Combet (96)
"Écrivant ainsi, retenant longtemps sa plume au-dessus des mots, elle sentait bien qu'elle reprenait, comme d'elle-même, les iiluminations verbales de son frère. Elle pensait dans sa pensée. Elle écrivait dans ses mots. Lorsqu'il la prendrait. Elle jouirait dans sa jouissance. Elle ne serait jamais l'écho et le reflet. Mais elle ne demandait rien de plus. N'être que ce peu d'être si proche du non-être, c'était, en soi, une immensité."
“seuls les mots, selon l’ordre du rythme et le souffle du poème, détenait l’étrange et miroitant pouvoir, de rompre la compacité de l’histoire et l’enchainement des causes”
Le désir d'expression l'a toujours emporté, dans mes entreprises d'écriture, sur mon application à vouloir comprendre. C'est pourquoi je n'ai jamais eu beaucoup de difficulté à repasser par les mêmes chemins. Je les avais oubliés, je ne les reconnaissais pas. L'aventure du texte n'avait pas eu le sens d'un progrès, d'un approfondissement du savoir sur moi-même. Au terme de la tâche, j'étais aussi démuni qu'en son commencement. Je pouvais repartir du même pas. (...) Tout avait été dit. Et tout restait à dire.
Je n'ai plus à me mettre en quête. Il me reste seulement à attendre. Je n'ai plus à vouloir. Il me suffira d'accueillir.
Mieux valait tourner le dos, vider un verre, encore un verre. Peut-être y avait-il, au fond de la bouteille, cette goutte d'élixir qui rend l'âme insubmersible à la mélancolie et qui fait croire qu'un homme peut soustraire ses propres mots au vent de foire et avec eux, par eux, se sauver.
Suzanne et les croûtons
Quelques autres, parmi la population de Croûtons encasernée ici, à la Clinique du Confluent, offraient en spectacle une nature plus triviale, calculatrice et pragmatique. C’était une bande de compères, ci-devant chauds lapins, à présent frappés, comme les autres, par le mal d’impotence. À la manière de ces grands malades ou grands infirmes qui tirent vanité de leur indigence physique et se tiennent au premier rang de la foule, lorsqu’est annoncée la venue de quelque thaumaturge, aux miracles assurés, ceux-là encadraient la porte d’entrée du grand hall de l’établissement, que Suzanne devrait nécessairement franchir aussitôt qu’elle arriverait. Ils étaient entièrement nus, exhibant leurs loques sexuelles, mais comme ils n’avaient rien oublié des bonnes façons de leur passé de séducteurs et qu’ils connaissaient bien le langage des fleurs, ils tenaient piquée, dans la petite fente de leur verge, la tige d’une fleurette extasiée, un œillet de poète, une jeune marguerite, un bouton d’or, et ils avaient disposé des bribes de verdure tout autour, subtilement attachées aux poils du pubis. Ainsi ornés, ils se donnaient l’air des vieilles divinités des jardins et bosquets d’autrefois. Mais naturellement, cette opération de fleuriste, rameuteur de belles, n’avait rien de flambant. Pourvu de sa garniture, le sexe n’en était pas moins dépourvu de tout allant. La saison restait au plus morne, dans le mensonge du jardin. Cependant les ex-ripailleurs, gourmands de viandes féminines, en imposaient à tous les autres. Suzanne, comme toutes les filles, serait flattée, comme d’un bijou, d’un colifichet, d’une gâterie originale et elle aurait sur eux, les premiers, le geste qui réveille les morts. Si son fluide devait s’épuiser bientôt, au moins en auraient-ils reçu la primeur, avec tout son concentré d’énergie. Ils attendaient, ils campaient, ils montaient la garde, leur virilité déliquescente, mais le pied encore ferme. Leur imagination était restée chaude. Sans que leur chair fût même en état de frémir, ils se voyaient encore en galants verdoyants, assidus aux charmes dévoilés de la femme. Cette Suzanne que personne n’avait vue mais qui occupait les reculées inaccessibles du désir, en une attente infinie, ils en percevaient déjà les formes saines et bien remplies, les seins puissants, le ventre épanoui, la toison abondante. Celle qui, assurément, se préparait à surgir, ne pouvait que s’abandonner au culte dont elle faisait l’objet, dans ce dernier carré de vieux mâles défaits et rassis – Croûtons balayés parmi les détritus de la vie. Il y avait de l’imploration dans leur mémoire élimée, entre inertie flasque et trémulation d’impuissance chatouillée, cela n’avait pas de voix, pas de mots, mais des soupirs s’agglutinant autour d’une seule image : d’une femme nue, en toute beauté, offerte au monde pour la résurrection de la chair et le salut des agonisants. Ce fantôme du cœur et des sens, remonté de la plus profonde nuit des aspirations des mâles, allait s’incarner enfin, c’était sûr, depuis plus de quatre mille ans qu’on l’attendait, promis par les prophètes et les poètes, et ce serait dans le corps de Suzanne, selon l’abondance de ses grâces et la générosité de son sexe. Tous les Croûtons partageaient cette évidence au-dedans, comme une révélation qui n’appartenait qu’à eux.
...............................
Quelques autres, parmi la population de Croûtons encasernée ici, à la Clinique du Confluent, offraient en spectacle une nature plus triviale, calculatrice et pragmatique. C’était une bande de compères, ci-devant chauds lapins, à présent frappés, comme les autres, par le mal d’impotence. À la manière de ces grands malades ou grands infirmes qui tirent vanité de leur indigence physique et se tiennent au premier rang de la foule, lorsqu’est annoncée la venue de quelque thaumaturge, aux miracles assurés, ceux-là encadraient la porte d’entrée du grand hall de l’établissement, que Suzanne devrait nécessairement franchir aussitôt qu’elle arriverait. Ils étaient entièrement nus, exhibant leurs loques sexuelles, mais comme ils n’avaient rien oublié des bonnes façons de leur passé de séducteurs et qu’ils connaissaient bien le langage des fleurs, ils tenaient piquée, dans la petite fente de leur verge, la tige d’une fleurette extasiée, un œillet de poète, une jeune marguerite, un bouton d’or, et ils avaient disposé des bribes de verdure tout autour, subtilement attachées aux poils du pubis. Ainsi ornés, ils se donnaient l’air des vieilles divinités des jardins et bosquets d’autrefois. Mais naturellement, cette opération de fleuriste, rameuteur de belles, n’avait rien de flambant. Pourvu de sa garniture, le sexe n’en était pas moins dépourvu de tout allant. La saison restait au plus morne, dans le mensonge du jardin. Cependant les ex-ripailleurs, gourmands de viandes féminines, en imposaient à tous les autres. Suzanne, comme toutes les filles, serait flattée, comme d’un bijou, d’un colifichet, d’une gâterie originale et elle aurait sur eux, les premiers, le geste qui réveille les morts. Si son fluide devait s’épuiser bientôt, au moins en auraient-ils reçu la primeur, avec tout son concentré d’énergie. Ils attendaient, ils campaient, ils montaient la garde, leur virilité déliquescente, mais le pied encore ferme. Leur imagination était restée chaude. Sans que leur chair fût même en état de frémir, ils se voyaient encore en galants verdoyants, assidus aux charmes dévoilés de la femme. Cette Suzanne que personne n’avait vue mais qui occupait les reculées inaccessibles du désir, en une attente infinie, ils en percevaient déjà les formes saines et bien remplies, les seins puissants, le ventre épanoui, la toison abondante. Celle qui, assurément, se préparait à surgir, ne pouvait que s’abandonner au culte dont elle faisait l’objet, dans ce dernier carré de vieux mâles défaits et rassis – Croûtons balayés parmi les détritus de la vie. Il y avait de l’imploration dans leur mémoire élimée, entre inertie flasque et trémulation d’impuissance chatouillée, cela n’avait pas de voix, pas de mots, mais des soupirs s’agglutinant autour d’une seule image : d’une femme nue, en toute beauté, offerte au monde pour la résurrection de la chair et le salut des agonisants. Ce fantôme du cœur et des sens, remonté de la plus profonde nuit des aspirations des mâles, allait s’incarner enfin, c’était sûr, depuis plus de quatre mille ans qu’on l’attendait, promis par les prophètes et les poètes, et ce serait dans le corps de Suzanne, selon l’abondance de ses grâces et la générosité de son sexe. Tous les Croûtons partageaient cette évidence au-dedans, comme une révélation qui n’appartenait qu’à eux.
...............................
6.
Et plus la réalité extérieure était difficile, problématique, et plus je m’enfonçais dans l’imaginaire, dans l’affabulation, pour ne pas voir, pour ne pas avoir à prendre de décisions, etc. Le temps était arrêté. C’était une respiration, peut-être parfois artificielle, mais c’était une façon de me déconnecter de la réalité. Donc, sur un plan qui est tout à fait éthique, je peux dire que l’écriture a été une désertion. Elle a été une désertion par rapport à la vie, où il y avait autour de moi d’autres attentes que celle-là. Et donc là, je ne me fais pas de cadeaux. Aujourd’hui, je me dis que la valeur intrinsèque littéraire de mes écrits, si elle existe, si elle est reconnue un jour, la pensée de cette valeur ne m’exonère absolument pas de ma responsabilité d’homme dans le temps, dans l’espace, dans le monde, des responsabilités que je n’ai pas prises, que je n’ai pas tenues. Il y a donc tout un passif – passif au sens de la comptabilité – il y a tout un passif de la vie qui demeure et que l’écriture n’a pas aboli, n’a pas remplacé.
Mis en ligne sur Cairn.info le 01/10/2008
https://doi.org/10.3917/rdes.043.0088
Et plus la réalité extérieure était difficile, problématique, et plus je m’enfonçais dans l’imaginaire, dans l’affabulation, pour ne pas voir, pour ne pas avoir à prendre de décisions, etc. Le temps était arrêté. C’était une respiration, peut-être parfois artificielle, mais c’était une façon de me déconnecter de la réalité. Donc, sur un plan qui est tout à fait éthique, je peux dire que l’écriture a été une désertion. Elle a été une désertion par rapport à la vie, où il y avait autour de moi d’autres attentes que celle-là. Et donc là, je ne me fais pas de cadeaux. Aujourd’hui, je me dis que la valeur intrinsèque littéraire de mes écrits, si elle existe, si elle est reconnue un jour, la pensée de cette valeur ne m’exonère absolument pas de ma responsabilité d’homme dans le temps, dans l’espace, dans le monde, des responsabilités que je n’ai pas prises, que je n’ai pas tenues. Il y a donc tout un passif – passif au sens de la comptabilité – il y a tout un passif de la vie qui demeure et que l’écriture n’a pas aboli, n’a pas remplacé.
Mis en ligne sur Cairn.info le 01/10/2008
https://doi.org/10.3917/rdes.043.0088
5.
C. ENAUDEAU : Ma question n’était pas tant : comment sort-on de la relation duelle pour passer à la communauté humaine? mais : comment sort-on de l’affrontement avec les démons intérieurs pour passer à l’autre, que ce soit à l’autre de la rencontre ou les autres de la collectivité? Il y a une tension entre deux représentations que vous proposez de votre écriture. Celle où vous donnez à l’autre une place décisive dans le travail d’écriture, et même aux autres dans le travail de publication (même si vous n’êtes pas soucieux de votre audience) et celle où vous insistez sur l’absolue solitude et le silence. La confusion initiale est silencieuse, informelle. Vous soutenez d’ailleurs un refus des formes. Mais évidemment la parole, l’écriture est forme. Pourquoi publier et même pourquoi écrire, puisque ce qui est visé, ce qu’il s’agit d’éprouver et non pas seulement de dire, c’est le silence?
36C. LOUIS-COMBET : II y a là évidemment une contradiction, mais qui est peut-être plus théorique que réelle, que réellement agissante dans ma vie, dans ma démarche. Qu’il s’agisse de la relation de personne à personne, dans la relation duelle amoureuse, ou de la relation avec les lecteurs connus ou inconnus, il y a chez l’autre qui lit ces textes, il y a toujours une impression que je crois très authentique de partager l’univers de fantasmes, l’univers d’imagination. Il se retrouve dans ce qu’il lit. Il y a une convergence et un confluent fantasmatiques. Donc l’écrit n’est pas une parole perdue. Ce n’est pas une parole qui va se perdre dans l’absence. Au contraire. Les échos que j’ai eus de mes lecteurs depuis le commencement vont toujours dans ce sens, que ces récits fabuleux réveillent quelque chose qui était enfoui, qui était inconscient.
37C. ENAUDEAU : Vous insistez sur le fait que l’écriture exige passivité, contemplation, la contemplation d’un vide d’ailleurs. Cette passivité assure – et j’emploie à dessein ce terme, car l’exil c’est l’absence d’assurance –, elle assure à votre écriture son « infaillibilité », dites-vous. Puisque, si vous êtes passif, vous écoutez une voix qui n’est pas la vôtre. L’intériorité est-elle une voix intérieure infaillible, qui exige, pour être écoutée, un certain nombre de conditions? Ou bien est-ce que l’intériorité, jusque dans l’écriture, est menacée par une incertitude qui tient précisément à l’exil, à l’absence d’assurance dans l’être? Il me semble qu’il y a de nouveau une tension.
38C. LOUIS-COMBET : Oui, mais les deux pôles de cette tension se comprennent, se justifient. D’une part, dans le moment d’écriture, il y a des conditions matérielles et physiques de recueillement, et un moment d’attente. Je suis en train d’écrire un texte et je sais très bien où j’en suis. Je vais retrouver les derniers mots que j’ai écrits hier soir et je vais poursuivre. Et l’impression très profonde que j’ai, c’est que la parole, les discours, les textes, se construisent à mon insu, et que maintenant je n’ai plus qu’à l’entendre. Je suis dans un état de réceptivité. J’écris très lentement – je parle lentement, avec beaucoup de silences – j’écris lentement, mais pratiquement sans ratures. C’est là que je parle d’infaillibilité. Les manuscrits, les textes se présentent sans qu’il y ait des maladresses, des choses à reprendre, des corrections, des reprises. J’écris à la main, pas à la machine, avec un simple feutre – et l’expression est d’emblée ce qu’elle restera, sans aucune correction possible. Il y a là une espèce d’infaillibilité. Mais le doute vient de savoir si je n’aurais pas pu faire de ma vie tout autre chose que la consacrer à l’écriture, parce que j’ai sacrifié énormément de choses. Maintenant je suis conscient évidemment du temps qui passe. Et l’écriture certainement, dans une période de ma vie, m’a aidé à vivre, à me libérer de mes difficultés de communication. Elle a été aussi une discipline qui m’a obligé à construire ma vie d’une façon volontaire. Donc c’est quelque chose qui a été très utile. Je pense que si je n’avais pas écrit, je ne sais pas dans quelle pathologie je serais tombé. Donc l’écriture a certainement été une planche de salut dans ma vie. Mais par ailleurs, quand je considère tout ce que je n’ai pas vécu ou pas réalisé dans d’autres domaines que celui de l’écriture, je me dis que le partage est quand même disproportionné. L’écriture a pris une telle place dans le temps et dans l’économie de mon énergie et dans la formulation de mes projets, elle a pris tellement d’importance dans la vie que j’ai l’impression de n’avoir pas vécu à côté de cela. En même temps l’écriture est liée fondamentalement à l’expérience de l’amour, et c’est quelque chose qui est irremplaçable de ce côté-là, qui a été vraiment nourri d’amour. C’est ce qui en assure la valeur finalement. Mais c’est vrai que – je l’ai dit plusieurs fois, à la radio – que j’ai une grande admiration pour des auteurs, des écrivains, des artistes qui ont peu produit, qui ont beaucoup vécu, intensément et dans toutes sortes de directions par ailleurs, et dont l’œuvre est relativement réduite, mais avec une dimension et une valeur absolument transcendantes. Moi j’ai écrit beaucoup, j’ai écrit sans interruption, comme pour combler un vide que je sentais en moi et qui appelait le vertige.
39C. ENAUDEAU : Mais quelle chance d’écrire dans cette espèce de certitude ! Très peu d’écrivains peuvent dire cela, que corriger leur est impossible et qu’à ce titre ce qui est écrit est infaillible.
40C. LOUIS-COMBET : Dans mon cas, c’est un fait, je le constate. Je peux vous montrer les manuscrits, il n’y a pas de corrections. C’est le premier jet. Le premier et le seul. Mais cela me gêne un peu, justement parce que, quand je vois les manuscrits d’écrivains, et des écrivains que j’aime, que j’admire, ils sont couverts de ratures, de surcharges, je me dis qu’il y a quelque chose qui ne va pas de mon côté. Quand j’ai publié Marinus et Marina, la librairie Autrement dit – je crois – avait fait une exposition et m’avait réservé un coin de vitrine. Ils m’avaient demandé de leur confier des pages manuscrites, qui avaient été photocopiées et puis agrandies pour faire un placard dans la vitrine. Et j’ai falsifié mon manuscrit en ajoutant des corrections, tellement j’avais honte de montrer un manuscrit impeccable.
41C. ENAUDEAU : Quel extraordinaire aveu !
42C. LOUIS-COMBET: J’ai fait des corrections bidons pour que cela ait l’allure de quelque chose. À voir mes manuscrits authentiques, on aurait dit que j’avais recopié, comme si je recopiais une page d’un livre. Donc, c’est dans cet état de réceptivité, de passivité que la phrase se construit. La plupart du temps, quand j’écris, que ce soit le début d’un texte ou n’importe quel passage d’un chapitre, peu importe, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas ce que je vais dire, je ne sais pas ce que je vais découvrir, je ne sais pas ce qui m’attend. Quelquefois je pars sur une idée et puis, quand j’écris, c’est tout autre chose que ce à quoi j’avais pensé qui arrive. Il y a un happening très étrange. C’est un peu fascinant d’être comme cela dans l’imprévu, au bord de l’imprévu.
43C. ENAUOEAU : Je m’étais méprise. Vous dites que l’écriture elle-même, dans la modalité où elle surgit est infaillible, et que le doute porte sur le fait même d’écrire. Or j’ai cru lire dans certains de vos textes que vous doutiez de l’objet même de votre écriture, de son contenu, lorsque vous disiez que toute cette affaire d’exil et de retour n’était peut-être qu’un « conte pour enfants ». Vous avez même de la sévérité, puisque vous vous accusez de complaisance.
44C. LOUIS-COMBET : Oui, il y a aussi ce jugement critique. Mais c’est surtout sur le terrain de la vie spirituelle et de l’aspiration à l’expérience gnostique. Chez moi, l’écriture a largement pris la place de la foi absente.
45C. EAUDEAU : Ce que vous appelez « l’écriture par défaut ».
46C. LOUIS-COMBET : Oui. Je dirais, pour schématiser, que j’ai commencé à écrire quand j’ai cessé de prier. Là, il y avait un vide, il y avait un hiatus. Et c’était le point de départ de l’expérience de l’écriture. Mais par ailleurs j’ai fait beaucoup de lectures dans les domaines de la spiritualité, de la gnostique. J’ai publié des textes anciens d’auteurs spirituels, chez Jérôme Millon. Je continue, c’est un domaine qui m’intéresse beaucoup, mais jamais ce travail d’approfondissement de la perte de la foi religieuse, de l’adhésion religieuse, jamais l’effacement de l’image de Dieu, le silence de la transcendance n’ont été réduits par l’écriture. J’ai lu beaucoup de textes d’auteurs spirituels, et cela n’a jamais modifié ce sentiment radical de l’éloignement, de l’absence et de l’effacement de Dieu à l’horizon. Et donc là je subis l’échec de l’écriture. Mais – et là on revient à ce qu’on disait tout à l’heure à propos de la psychanalyse – peut-être que dans la relation analytique, le fait de passer par un tiers, qui est comme un témoin et qui, à certains moments, peut vous renvoyer des questions et orienter votre démarche intérieure, cela garantit une certaine assurance de la valeur de l’expérience que vous évoquez. Quand je raconte ces histoires de départ, d’itinéraire, de retour, je ne sais pas ce que cela signifie finalement… Peut-être que si ces textes avaient fait l’objet d’une analyse, avaient servi de matériel pour une analyse, peut-être que je serais plus dans la certitude que je ne le suis aujourd’hui. Je ne peux pas dire que l’écriture, après tant d’années de travail très introverti, d’une introversion constante chez moi, que l’écriture ait enrichi la connaissance de moi-même. On ne peut pas dire cela. Ce n’est pas une connaissance. J’ai plutôt l’impression d’une course, d’une fuite, d’une précipitation dans l’imaginaire pour ne pas voir les réels problèmes, les réelles difficultés, ne pas chercher de solutions. Dans ma vie souvent, l’écriture était le moment où je faisais le vide, où je rejetais à l’extérieur les soucis.
C. ENAUDEAU : Ma question n’était pas tant : comment sort-on de la relation duelle pour passer à la communauté humaine? mais : comment sort-on de l’affrontement avec les démons intérieurs pour passer à l’autre, que ce soit à l’autre de la rencontre ou les autres de la collectivité? Il y a une tension entre deux représentations que vous proposez de votre écriture. Celle où vous donnez à l’autre une place décisive dans le travail d’écriture, et même aux autres dans le travail de publication (même si vous n’êtes pas soucieux de votre audience) et celle où vous insistez sur l’absolue solitude et le silence. La confusion initiale est silencieuse, informelle. Vous soutenez d’ailleurs un refus des formes. Mais évidemment la parole, l’écriture est forme. Pourquoi publier et même pourquoi écrire, puisque ce qui est visé, ce qu’il s’agit d’éprouver et non pas seulement de dire, c’est le silence?
36C. LOUIS-COMBET : II y a là évidemment une contradiction, mais qui est peut-être plus théorique que réelle, que réellement agissante dans ma vie, dans ma démarche. Qu’il s’agisse de la relation de personne à personne, dans la relation duelle amoureuse, ou de la relation avec les lecteurs connus ou inconnus, il y a chez l’autre qui lit ces textes, il y a toujours une impression que je crois très authentique de partager l’univers de fantasmes, l’univers d’imagination. Il se retrouve dans ce qu’il lit. Il y a une convergence et un confluent fantasmatiques. Donc l’écrit n’est pas une parole perdue. Ce n’est pas une parole qui va se perdre dans l’absence. Au contraire. Les échos que j’ai eus de mes lecteurs depuis le commencement vont toujours dans ce sens, que ces récits fabuleux réveillent quelque chose qui était enfoui, qui était inconscient.
37C. ENAUDEAU : Vous insistez sur le fait que l’écriture exige passivité, contemplation, la contemplation d’un vide d’ailleurs. Cette passivité assure – et j’emploie à dessein ce terme, car l’exil c’est l’absence d’assurance –, elle assure à votre écriture son « infaillibilité », dites-vous. Puisque, si vous êtes passif, vous écoutez une voix qui n’est pas la vôtre. L’intériorité est-elle une voix intérieure infaillible, qui exige, pour être écoutée, un certain nombre de conditions? Ou bien est-ce que l’intériorité, jusque dans l’écriture, est menacée par une incertitude qui tient précisément à l’exil, à l’absence d’assurance dans l’être? Il me semble qu’il y a de nouveau une tension.
38C. LOUIS-COMBET : Oui, mais les deux pôles de cette tension se comprennent, se justifient. D’une part, dans le moment d’écriture, il y a des conditions matérielles et physiques de recueillement, et un moment d’attente. Je suis en train d’écrire un texte et je sais très bien où j’en suis. Je vais retrouver les derniers mots que j’ai écrits hier soir et je vais poursuivre. Et l’impression très profonde que j’ai, c’est que la parole, les discours, les textes, se construisent à mon insu, et que maintenant je n’ai plus qu’à l’entendre. Je suis dans un état de réceptivité. J’écris très lentement – je parle lentement, avec beaucoup de silences – j’écris lentement, mais pratiquement sans ratures. C’est là que je parle d’infaillibilité. Les manuscrits, les textes se présentent sans qu’il y ait des maladresses, des choses à reprendre, des corrections, des reprises. J’écris à la main, pas à la machine, avec un simple feutre – et l’expression est d’emblée ce qu’elle restera, sans aucune correction possible. Il y a là une espèce d’infaillibilité. Mais le doute vient de savoir si je n’aurais pas pu faire de ma vie tout autre chose que la consacrer à l’écriture, parce que j’ai sacrifié énormément de choses. Maintenant je suis conscient évidemment du temps qui passe. Et l’écriture certainement, dans une période de ma vie, m’a aidé à vivre, à me libérer de mes difficultés de communication. Elle a été aussi une discipline qui m’a obligé à construire ma vie d’une façon volontaire. Donc c’est quelque chose qui a été très utile. Je pense que si je n’avais pas écrit, je ne sais pas dans quelle pathologie je serais tombé. Donc l’écriture a certainement été une planche de salut dans ma vie. Mais par ailleurs, quand je considère tout ce que je n’ai pas vécu ou pas réalisé dans d’autres domaines que celui de l’écriture, je me dis que le partage est quand même disproportionné. L’écriture a pris une telle place dans le temps et dans l’économie de mon énergie et dans la formulation de mes projets, elle a pris tellement d’importance dans la vie que j’ai l’impression de n’avoir pas vécu à côté de cela. En même temps l’écriture est liée fondamentalement à l’expérience de l’amour, et c’est quelque chose qui est irremplaçable de ce côté-là, qui a été vraiment nourri d’amour. C’est ce qui en assure la valeur finalement. Mais c’est vrai que – je l’ai dit plusieurs fois, à la radio – que j’ai une grande admiration pour des auteurs, des écrivains, des artistes qui ont peu produit, qui ont beaucoup vécu, intensément et dans toutes sortes de directions par ailleurs, et dont l’œuvre est relativement réduite, mais avec une dimension et une valeur absolument transcendantes. Moi j’ai écrit beaucoup, j’ai écrit sans interruption, comme pour combler un vide que je sentais en moi et qui appelait le vertige.
39C. ENAUDEAU : Mais quelle chance d’écrire dans cette espèce de certitude ! Très peu d’écrivains peuvent dire cela, que corriger leur est impossible et qu’à ce titre ce qui est écrit est infaillible.
40C. LOUIS-COMBET : Dans mon cas, c’est un fait, je le constate. Je peux vous montrer les manuscrits, il n’y a pas de corrections. C’est le premier jet. Le premier et le seul. Mais cela me gêne un peu, justement parce que, quand je vois les manuscrits d’écrivains, et des écrivains que j’aime, que j’admire, ils sont couverts de ratures, de surcharges, je me dis qu’il y a quelque chose qui ne va pas de mon côté. Quand j’ai publié Marinus et Marina, la librairie Autrement dit – je crois – avait fait une exposition et m’avait réservé un coin de vitrine. Ils m’avaient demandé de leur confier des pages manuscrites, qui avaient été photocopiées et puis agrandies pour faire un placard dans la vitrine. Et j’ai falsifié mon manuscrit en ajoutant des corrections, tellement j’avais honte de montrer un manuscrit impeccable.
41C. ENAUDEAU : Quel extraordinaire aveu !
42C. LOUIS-COMBET: J’ai fait des corrections bidons pour que cela ait l’allure de quelque chose. À voir mes manuscrits authentiques, on aurait dit que j’avais recopié, comme si je recopiais une page d’un livre. Donc, c’est dans cet état de réceptivité, de passivité que la phrase se construit. La plupart du temps, quand j’écris, que ce soit le début d’un texte ou n’importe quel passage d’un chapitre, peu importe, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas ce que je vais dire, je ne sais pas ce que je vais découvrir, je ne sais pas ce qui m’attend. Quelquefois je pars sur une idée et puis, quand j’écris, c’est tout autre chose que ce à quoi j’avais pensé qui arrive. Il y a un happening très étrange. C’est un peu fascinant d’être comme cela dans l’imprévu, au bord de l’imprévu.
43C. ENAUOEAU : Je m’étais méprise. Vous dites que l’écriture elle-même, dans la modalité où elle surgit est infaillible, et que le doute porte sur le fait même d’écrire. Or j’ai cru lire dans certains de vos textes que vous doutiez de l’objet même de votre écriture, de son contenu, lorsque vous disiez que toute cette affaire d’exil et de retour n’était peut-être qu’un « conte pour enfants ». Vous avez même de la sévérité, puisque vous vous accusez de complaisance.
44C. LOUIS-COMBET : Oui, il y a aussi ce jugement critique. Mais c’est surtout sur le terrain de la vie spirituelle et de l’aspiration à l’expérience gnostique. Chez moi, l’écriture a largement pris la place de la foi absente.
45C. EAUDEAU : Ce que vous appelez « l’écriture par défaut ».
46C. LOUIS-COMBET : Oui. Je dirais, pour schématiser, que j’ai commencé à écrire quand j’ai cessé de prier. Là, il y avait un vide, il y avait un hiatus. Et c’était le point de départ de l’expérience de l’écriture. Mais par ailleurs j’ai fait beaucoup de lectures dans les domaines de la spiritualité, de la gnostique. J’ai publié des textes anciens d’auteurs spirituels, chez Jérôme Millon. Je continue, c’est un domaine qui m’intéresse beaucoup, mais jamais ce travail d’approfondissement de la perte de la foi religieuse, de l’adhésion religieuse, jamais l’effacement de l’image de Dieu, le silence de la transcendance n’ont été réduits par l’écriture. J’ai lu beaucoup de textes d’auteurs spirituels, et cela n’a jamais modifié ce sentiment radical de l’éloignement, de l’absence et de l’effacement de Dieu à l’horizon. Et donc là je subis l’échec de l’écriture. Mais – et là on revient à ce qu’on disait tout à l’heure à propos de la psychanalyse – peut-être que dans la relation analytique, le fait de passer par un tiers, qui est comme un témoin et qui, à certains moments, peut vous renvoyer des questions et orienter votre démarche intérieure, cela garantit une certaine assurance de la valeur de l’expérience que vous évoquez. Quand je raconte ces histoires de départ, d’itinéraire, de retour, je ne sais pas ce que cela signifie finalement… Peut-être que si ces textes avaient fait l’objet d’une analyse, avaient servi de matériel pour une analyse, peut-être que je serais plus dans la certitude que je ne le suis aujourd’hui. Je ne peux pas dire que l’écriture, après tant d’années de travail très introverti, d’une introversion constante chez moi, que l’écriture ait enrichi la connaissance de moi-même. On ne peut pas dire cela. Ce n’est pas une connaissance. J’ai plutôt l’impression d’une course, d’une fuite, d’une précipitation dans l’imaginaire pour ne pas voir les réels problèmes, les réelles difficultés, ne pas chercher de solutions. Dans ma vie souvent, l’écriture était le moment où je faisais le vide, où je rejetais à l’extérieur les soucis.
3.....
C. ENAUDEAU : L’autre n’est donc pas simplement comme une étape dans le pèlerinage, comme un moyen, un passage dans le retour à la confusion. Vous accordez à l’autre une place beaucoup plus essentielle, dans ce que vous venez de dire.
32C. LOUIS-COMBET : Oui, c’est vrai. Sans une relation amoureuse, une relation d’échange et de plénitude d’expérience, il n’y aurait jamais eu de livres, il n’y aurait aucune espèce de création. Il a fallu qu’à un moment donné une ou des rencontres aient lieu, qui libèrent les potentialités qui étaient complètement réduites et comprimées, inexprimables.
33C. ENAUDEAU : Vous laissez souvent entendre l’impuissance à communiquer. L’échange semble impossible, qu’il soit interlocution, aveu ou confession. Pourtant, dans la rencontre amoureuse, l’autre libère d’un silence, c’est-à-dire permet l’écriture. Comment le vœu de publier vient-il s’inscrire dans tout cela? Quelle est la nécessité de publier, surtout si le domaine public est fait de banalités?
34C. LOUIS-COMBET : Dans toute la période de genèse du texte, la motivation consciente, clairement avouée, est celle du dialogue amoureux, c’est-à-dire que le texte s’adresse à une personne privilégiée qui se trouve à l’origine de la décision d’écrire et qui est destinataire de cette parole écrite qu’est le texte. Donc l’écriture prend tout son sens, et un sens qui serait suffisant– je le dis au conditionnel – dans une relation duelle, une relation amoureuse de personne à personne. S’il y a tout de même la volonté de publier, c’est parce que cette relation duelle n’est pas quelque chose qui isole complètement de la communauté humaine. Là, évidemment, je perds de vue peut-être ma volonté de m’abstraire du monde – enfin, j’apporte une limite, en tout cas, au refus du temps, au refus de l’histoire, et je suis conscient que cette relation duelle que j’évoque se situe dans un monde qui est fait de proches et d’une humanité qui est en attente de quelque chose, qui est en attente de ce que je puis communiquer. Cela signifie que la relation amoureuse n’est pas quelque chose qui isole et enferme complètement dans une solitude à deux, mais c’est quelque chose qui éclate, qui s’ouvre sur une communauté humaine. Le livre est donc appelé à toucher d’autres destinataires. Je ne me suis jamais beaucoup intéressé au sort de mes livres. Je n’ai jamais cherché à me faire publiciste de mes livres ni à faire des rencontres utiles pour élargir mon audience. Je laisse faire les choses. Mais il est certain que je suis sensible aux échos qui me parviennent. Ce sont des échos personnalisés. Je ne parle pas des échos de la presse, mais des échos personnalisés de lecteurs qui me font part de leurs impressions, de leur réaction, de leurs sentiments. Et cela, je ne dirais pas que c’est absolument essentiel pour poursuivre le travail d’écriture. Je pense que, dans une sorte de silence complet, d’absence totale de réaction à mes écrits, j’aurais continué d’écrire. Mais il est vrai que c’est en même temps l’occasion de dialogues qui sont nutritifs. Je ne suis pas du tout insensible à la réalité de mon audience auprès de mon petit public de fidèles et de complices.
C. ENAUDEAU : L’autre n’est donc pas simplement comme une étape dans le pèlerinage, comme un moyen, un passage dans le retour à la confusion. Vous accordez à l’autre une place beaucoup plus essentielle, dans ce que vous venez de dire.
32C. LOUIS-COMBET : Oui, c’est vrai. Sans une relation amoureuse, une relation d’échange et de plénitude d’expérience, il n’y aurait jamais eu de livres, il n’y aurait aucune espèce de création. Il a fallu qu’à un moment donné une ou des rencontres aient lieu, qui libèrent les potentialités qui étaient complètement réduites et comprimées, inexprimables.
33C. ENAUDEAU : Vous laissez souvent entendre l’impuissance à communiquer. L’échange semble impossible, qu’il soit interlocution, aveu ou confession. Pourtant, dans la rencontre amoureuse, l’autre libère d’un silence, c’est-à-dire permet l’écriture. Comment le vœu de publier vient-il s’inscrire dans tout cela? Quelle est la nécessité de publier, surtout si le domaine public est fait de banalités?
34C. LOUIS-COMBET : Dans toute la période de genèse du texte, la motivation consciente, clairement avouée, est celle du dialogue amoureux, c’est-à-dire que le texte s’adresse à une personne privilégiée qui se trouve à l’origine de la décision d’écrire et qui est destinataire de cette parole écrite qu’est le texte. Donc l’écriture prend tout son sens, et un sens qui serait suffisant– je le dis au conditionnel – dans une relation duelle, une relation amoureuse de personne à personne. S’il y a tout de même la volonté de publier, c’est parce que cette relation duelle n’est pas quelque chose qui isole complètement de la communauté humaine. Là, évidemment, je perds de vue peut-être ma volonté de m’abstraire du monde – enfin, j’apporte une limite, en tout cas, au refus du temps, au refus de l’histoire, et je suis conscient que cette relation duelle que j’évoque se situe dans un monde qui est fait de proches et d’une humanité qui est en attente de quelque chose, qui est en attente de ce que je puis communiquer. Cela signifie que la relation amoureuse n’est pas quelque chose qui isole et enferme complètement dans une solitude à deux, mais c’est quelque chose qui éclate, qui s’ouvre sur une communauté humaine. Le livre est donc appelé à toucher d’autres destinataires. Je ne me suis jamais beaucoup intéressé au sort de mes livres. Je n’ai jamais cherché à me faire publiciste de mes livres ni à faire des rencontres utiles pour élargir mon audience. Je laisse faire les choses. Mais il est certain que je suis sensible aux échos qui me parviennent. Ce sont des échos personnalisés. Je ne parle pas des échos de la presse, mais des échos personnalisés de lecteurs qui me font part de leurs impressions, de leur réaction, de leurs sentiments. Et cela, je ne dirais pas que c’est absolument essentiel pour poursuivre le travail d’écriture. Je pense que, dans une sorte de silence complet, d’absence totale de réaction à mes écrits, j’aurais continué d’écrire. Mais il est vrai que c’est en même temps l’occasion de dialogues qui sont nutritifs. Je ne suis pas du tout insensible à la réalité de mon audience auprès de mon petit public de fidèles et de complices.
2.
C. ENAUDEAU : Vous dites que vos récits racontent finalement une seule et même chose qui aurait pour schéma : exil et retour. L’exil, c’est l’exclusion, l’expulsion, l’abandon. C’est à la fois une expérience charnelle : être coupé de la mère, ce que vous appelez « blessure », « déchirure » et « saccage », et une expérience ontologique : ne pas avoir d’assurance dans l’être, dans le sens. Et le retour, c’est la fin de la différence, différence des sexes, différence entre l’intérieur et l’extérieur, et finalement le cloaque et la mort. Le retour n’est donc pas la rencontre de l’autre, mais une incorporation fusionnelle. Dans un certain nombre de récits, la blessure est refermée par soi-même. Vous travaillez sur la bouche et les lèvres, sur les deux bouches : la bouche de la tête et la bouche qu’est le sexe de la femme. Et l’individu se replie sur lui-même dans une espèce de baiser des deux bouches. Quelle place accordez-vous alors à l’autre dans l’intériorité ou dans l’intériorisation? Quelles que soient les figures de l’autre – la sœur, la mère ou le confesseur – on a l’impression que l’autre est toujours un miroir et jamais une véritable altérité.
20C. LOUIS-COMBET: Je crois que l’œuvre c’est un poids, selon un schéma qui est fortement régressif, et que le passage dans le temps, l’exil – à l’image de ce qui se passe dans le récit du Voyage au centre de la ville, qui figure très bien cette dynamique du passage, de l’exil – l’exil est marqué par des rencontres, qui sont douloureuses, terrifiantes, exaltantes. Mais implacablement le voyage ramène à son point de départ qui est la réabsorption dans l’indifférenciation organique, fœtale, intra-utérine, ou tout ce qu’on voudra. C’est vraiment le retour à la substance, au magma originel qui est le point d’aboutissement. Donc la place de l’autre dans le processus et dans l’expérience de l’intériorité, dans le processus d’intériorisation, c’est celle de rencontres qui permettent de vivre, de construire des choses, de réfléchir, de se situer. Mais il y a un mouvement des dynamiques profondes qui est absolument inaugural, et qui est celui du retour à la confusion. Les rencontres amoureuses ou les rencontres qui ont un sens d’éveil religieux n’empêchent absolument pas, ne peuvent pas retenir cette démarche qui est toujours la chute, le retour dans la nostalgie. Donc l’altérité existe, je crois, dans les écrits : il y a différentes figures par rapport auxquelles le narrateur – pour ne pas dire moi – va se situer. Cela lui permet de prendre conscience de lui-même, mais en même temps le destin de sa solitude, c’est finalement de revenir à ce point de départ qui est la confusion originelle. Il y a une réflexion récurrente dans mes livres, c’est celle de la fragilité de la beauté qui est promise à la mort, qui est promise à la décomposition. Les rencontres qui jalonnent le parcours apportent cette note de beauté qui dans l’instant suscite une sorte d’extase, de libération, mais c’est ensuite pour retomber dans cette détermination, insurmontable comme peut l’être un destin. Les doctrines spirituelles, évidemment, ne voient pas les choses de cette façon-là. Le salut, dans la religion chrétienne par exemple, n’est pas du tout un retour à l’indistinction. C’est une personne originale qui est promise, par la vision béatifique, à la rencontre avec Dieu. Ce n’est pas du tout une fusion dans la divinité ni une confusion consubstantielle avec l’univers. S’il y a une note de spiritualité à laquelle j’adhère à travers tout ce que j’ai écrit sur des auteurs spirituels, ce serait une spiritualité panthéiste ou panthéistique. Dans les philosophies, dans les spiritualités de type panthéiste, l’après-mort, c’est le retour à l’universel et à la confusion.
21C. ENAUDEAU : Vous dites « retour implacable au point de départ », parce que c’est l’objet d’un désir inscrit en nous et qui fait notre destin.
22C. LOUIS-COMBET : II y a désir. C’est pourquoi la perspective du déclin et de la mort peut être assumée avec reconnaissance.
23C. ENAUDEAU : Et même : enthousiasme.
24C. LOUIS-COMBET : Avec enthousiasme, oui, peut-être jusque-là. Oui, c’est un accomplissement. C’est un accomplissement dans l’anéantissement. L’anéantissement, la perte d’identité, la perte de substance, la perte de conscience représentent l’aboutissement.
25C. ENAUDEAU : Ce qui est en même temps paradoxal, s’il faut aussi protéger l’identité par le secret. On a l’impression que vous êtes partagé entre l’idée qu’on ne peut se construire qu’en se protégeant d’une intrusion et l’idée qu’on désire pourtant la perte d’identité, l’indifférence.
26C. LOUIS-COMBET: Mais la protection, c’est un moment. C’est un moment qui occupe justement le passage, l’itinéraire. L’image du pèlerinage, par exemple, qui est occupé à l’affirmation de l’identité et donc à la protection du secret de base, en même temps que voué à la vénération, à l’adoration de l’Autre.
27C. ENAUDEAU : Vous liez l’écriture et l’amour. Donc, vous voyez l’écriture comme faisant partie de ce pèlerinage.
28C. LOUIS-COMBET : Oui.
29C. EAUDEAU : Comme les rencontres.
30C. LOUIS-COMBET : Le sens de l’écriture, c’est quand même de dire ce qui est : ce qui est à l’origine, ce qui est vécu fondamentalement, et ce qui attend l’homme au terme de son itinéraire. Et l’écriture est une œuvre d’amour parce qu’elle est fondamentalement initiée et informée, mais au sens philosophique du terme, par la rencontre amoureuse. C’est la rencontre amoureuse qui permet cette libération temporaire, à partir de laquelle l’écriture devient possible. Sans une rencontre amoureuse essentielle à un moment donné de la vie, le noyau de silence aurait tellement grossi qu’il aurait occupé absolument l’être tout entier. Et la relation amoureuse permet à l’homme, à l’être, au narrateur, de sortir de ce carcan intérieur qui tendait à l’immobiliser, à le paralyser et à le stériliser.
C. ENAUDEAU : Vous dites que vos récits racontent finalement une seule et même chose qui aurait pour schéma : exil et retour. L’exil, c’est l’exclusion, l’expulsion, l’abandon. C’est à la fois une expérience charnelle : être coupé de la mère, ce que vous appelez « blessure », « déchirure » et « saccage », et une expérience ontologique : ne pas avoir d’assurance dans l’être, dans le sens. Et le retour, c’est la fin de la différence, différence des sexes, différence entre l’intérieur et l’extérieur, et finalement le cloaque et la mort. Le retour n’est donc pas la rencontre de l’autre, mais une incorporation fusionnelle. Dans un certain nombre de récits, la blessure est refermée par soi-même. Vous travaillez sur la bouche et les lèvres, sur les deux bouches : la bouche de la tête et la bouche qu’est le sexe de la femme. Et l’individu se replie sur lui-même dans une espèce de baiser des deux bouches. Quelle place accordez-vous alors à l’autre dans l’intériorité ou dans l’intériorisation? Quelles que soient les figures de l’autre – la sœur, la mère ou le confesseur – on a l’impression que l’autre est toujours un miroir et jamais une véritable altérité.
20C. LOUIS-COMBET: Je crois que l’œuvre c’est un poids, selon un schéma qui est fortement régressif, et que le passage dans le temps, l’exil – à l’image de ce qui se passe dans le récit du Voyage au centre de la ville, qui figure très bien cette dynamique du passage, de l’exil – l’exil est marqué par des rencontres, qui sont douloureuses, terrifiantes, exaltantes. Mais implacablement le voyage ramène à son point de départ qui est la réabsorption dans l’indifférenciation organique, fœtale, intra-utérine, ou tout ce qu’on voudra. C’est vraiment le retour à la substance, au magma originel qui est le point d’aboutissement. Donc la place de l’autre dans le processus et dans l’expérience de l’intériorité, dans le processus d’intériorisation, c’est celle de rencontres qui permettent de vivre, de construire des choses, de réfléchir, de se situer. Mais il y a un mouvement des dynamiques profondes qui est absolument inaugural, et qui est celui du retour à la confusion. Les rencontres amoureuses ou les rencontres qui ont un sens d’éveil religieux n’empêchent absolument pas, ne peuvent pas retenir cette démarche qui est toujours la chute, le retour dans la nostalgie. Donc l’altérité existe, je crois, dans les écrits : il y a différentes figures par rapport auxquelles le narrateur – pour ne pas dire moi – va se situer. Cela lui permet de prendre conscience de lui-même, mais en même temps le destin de sa solitude, c’est finalement de revenir à ce point de départ qui est la confusion originelle. Il y a une réflexion récurrente dans mes livres, c’est celle de la fragilité de la beauté qui est promise à la mort, qui est promise à la décomposition. Les rencontres qui jalonnent le parcours apportent cette note de beauté qui dans l’instant suscite une sorte d’extase, de libération, mais c’est ensuite pour retomber dans cette détermination, insurmontable comme peut l’être un destin. Les doctrines spirituelles, évidemment, ne voient pas les choses de cette façon-là. Le salut, dans la religion chrétienne par exemple, n’est pas du tout un retour à l’indistinction. C’est une personne originale qui est promise, par la vision béatifique, à la rencontre avec Dieu. Ce n’est pas du tout une fusion dans la divinité ni une confusion consubstantielle avec l’univers. S’il y a une note de spiritualité à laquelle j’adhère à travers tout ce que j’ai écrit sur des auteurs spirituels, ce serait une spiritualité panthéiste ou panthéistique. Dans les philosophies, dans les spiritualités de type panthéiste, l’après-mort, c’est le retour à l’universel et à la confusion.
21C. ENAUDEAU : Vous dites « retour implacable au point de départ », parce que c’est l’objet d’un désir inscrit en nous et qui fait notre destin.
22C. LOUIS-COMBET : II y a désir. C’est pourquoi la perspective du déclin et de la mort peut être assumée avec reconnaissance.
23C. ENAUDEAU : Et même : enthousiasme.
24C. LOUIS-COMBET : Avec enthousiasme, oui, peut-être jusque-là. Oui, c’est un accomplissement. C’est un accomplissement dans l’anéantissement. L’anéantissement, la perte d’identité, la perte de substance, la perte de conscience représentent l’aboutissement.
25C. ENAUDEAU : Ce qui est en même temps paradoxal, s’il faut aussi protéger l’identité par le secret. On a l’impression que vous êtes partagé entre l’idée qu’on ne peut se construire qu’en se protégeant d’une intrusion et l’idée qu’on désire pourtant la perte d’identité, l’indifférence.
26C. LOUIS-COMBET: Mais la protection, c’est un moment. C’est un moment qui occupe justement le passage, l’itinéraire. L’image du pèlerinage, par exemple, qui est occupé à l’affirmation de l’identité et donc à la protection du secret de base, en même temps que voué à la vénération, à l’adoration de l’Autre.
27C. ENAUDEAU : Vous liez l’écriture et l’amour. Donc, vous voyez l’écriture comme faisant partie de ce pèlerinage.
28C. LOUIS-COMBET : Oui.
29C. EAUDEAU : Comme les rencontres.
30C. LOUIS-COMBET : Le sens de l’écriture, c’est quand même de dire ce qui est : ce qui est à l’origine, ce qui est vécu fondamentalement, et ce qui attend l’homme au terme de son itinéraire. Et l’écriture est une œuvre d’amour parce qu’elle est fondamentalement initiée et informée, mais au sens philosophique du terme, par la rencontre amoureuse. C’est la rencontre amoureuse qui permet cette libération temporaire, à partir de laquelle l’écriture devient possible. Sans une rencontre amoureuse essentielle à un moment donné de la vie, le noyau de silence aurait tellement grossi qu’il aurait occupé absolument l’être tout entier. Et la relation amoureuse permet à l’homme, à l’être, au narrateur, de sortir de ce carcan intérieur qui tendait à l’immobiliser, à le paralyser et à le stériliser.
Entretien avec Claude Louis-Combet
Claude Louis-Combet
Dans Rue Descartes 2004/1 (n° 43), pages 88 à 101
CORINNE ENAUDEAU : Vous affirmez, dans plusieurs de vos textes, un parti pris antiréaliste et dites n’accorder de « patience et de passion » qu’à la seule intériorité. Vous refusez pour cette raison le récit, l’anecdote, la circonstance, c’est-à-dire l’inscription dans l’espace et dans le temps, ce qui vous conduit à préférer la mythobiographie à l’autobiographie. Or, paradoxalement, vous justifiez ce parti pris par une expérience tout à fait personnelle, celle que l’enfant et le jeune clerc ont faite d’un exil intérieur. Pourquoi alors placez-vous l’écriture sous la contrainte d’exprimer une intériorité impersonnelle, archaïque, mythique, donc collective et vous refusez-vous à l’autobiographie?
2CLAUDE LOUIS-COMBET : II ne s’agit pas d’un refus absolu. Quand je dis que je me détourne du réel, de l’anecdote, de l’autobiographie, il faut quand même relativiser les choses. En fait, il y a beaucoup de textes qui ont une dimension autobiographique dans mes écrits. Je suis parti de l’autobiographie avec Infernaux paluds. C’était un premier roman, une autobiographie qui se présentait comme un roman, avec des éléments qui étaient objectivement autobiographiques, et puis un travail qui portait plus sur l’imaginaire, qui apportait des nuances par rapport au récit autobiographique. Mais, au terme de cette première tentative d’expression, j’ai éprouvé une insatisfaction profonde qui tenait au fait que je m’enfermais dans des détails, dans des situations qui ne m’apprenaient rien finalement, puisque je les avais connus, je les avais vécus. Donc c’était un travail de mémoire et ce n’était pas un travail de véritable invention. Et j’ai cherché par la suite dans l’écriture à créer un univers différent de celui de la réalité vécue, quotidienne, et qui me permettait, je crois, d’atteindre à une authenticité beaucoup plus grande que celle de la narration banale des événements de la vie. Quand je dis le parti que j’ai pris, le parti de me détourner de la réalité – de la réalité historique, de la réalité sociale, politique… –, cela ne concerne bien que l’activité d’écriture. L’écriture, pour moi, doit se réserver à un champ qui n’est pas celui de l’expérience quotidienne, des soucis et préoccupations de la vie ordinaire. Ce qui évidemment ne signifie pas que, dans ma vie quotidienne, ordinaire, je me tiens à l’abri des préoccupations ou des soucis qui m’entourent. Je crois que je suis très ouvert sur le monde extérieur, sauf dans le moment que je réserve à l’écriture et qui est vraiment un enfoncement dans l’imaginaire, dans l’imaginaire fantasmatique. Là, je retrouve effectivement une certaine universalité, parce que les fantasmes, c’est quelque chose qui est en partage de l’humanité tout entière. Je ne sens pas du tout cette mise à l’écart du monde comme une contrainte artificielle que je m’impose, mais c’est la condition pour retrouver une intériorité et une antériorité fondamentales. C’est comme de fermer les yeux un moment pour s’isoler de la vision du monde extérieur, se recueillir. Cette attitude de recueillement est pour moi, à la fois le moyen et la fin de l’activité d’écriture.
3C. ENAUDEAU : À lire votre dernier livre publié, L’homme du texte, il y a pourtant une sorte de bataille entre deux intériorités, ou, pour prendre votre vocabulaire, « deux âmes ». Une âme que vous appelez matérielle, psychique, l’âme archaïque, mythique, mais dont vous dites qu’elle est irresponsable, sans péché, qu’elle n’a rien à avouer. C’est « la mémoire de toute l’humanité », la mémoire du cosmos lui-même, une âme universelle donc. Et puis il y a une autre âme, « plus spirituelle », dites-vous, qui est l’âme éthique, responsable et, d’une certaine façon, l’âme coupable, l’âme individuelle cette fois. Or vous laissez entendre que votre écriture est sous le coup de l’aveu d’un secret. Est-ce que la mythobiographie n’élude pas la question de l’aveu, ce que vous semblez vous-même craindre? Est-ce que, au niveau du mythe, on peut toucher la question du secret?
4C. LOUIS-COMBET : Je pense que le recours à l’imaginaire mythique, aux légendes hagiographiques, à l’imaginaire chrétien est à la fois une façon de voiler et de dévoiler le secret. Je crois que le secret n’est pas du tout aboli, il n’est pas refusé, mais il cherche sa voie d’expression, il s’aventure à travers des existences fabuleuses, à travers les produits de l’imaginaire. Il s’aventure vers un horizon dicible. Il y a quelque chose qui peut être dit, qui est sur le point d’être dit. L’aveu peut-être retenu, encore réservé, mais il va aussi loin que possible sur la voie de l’expression. Et c’est cela ou rien. C’est-à-dire que si je m’en étais tenu à l’autobiographie stricto sensu, l’aveu aurait été impossible de toute façon. Donc recourir à des personnages, à des figures mythologiques ou légendaires pour avancer quelque chose du plus profond de soi-même, c’est une issue. C’est une issue qui n’est peut-être pas complète, qui n’est pas définitive, mais c’est tout ce qui est possible… dans mon cas.
5C. ENAUDEAU : Le secret n’est pas aboli, mais la faute n’est-elle pas abolie? Vous dites que cette âme intemporelle est sans péché et qu’elle n’a rien à avouer.
6C. LOUIS-COMBET : Je crois que le travail d’écriture repose sur une contradiction fondamentale qui est justement celle du désir d’échapper à l’histoire et, par opposition, de reconnaître et accepter l’évidence du mal, ou de la faute, des contradictions de la vie. Il y a, si vous voulez, une voie, une aspiration à l’unité, et en même temps l’évidence de cette impossibilité d’y accéder.
7C. ENAUDEAU : Mais la faute est-elle seulement l’impossibilité d’accéder à l’unité?
8C. LOUIS-COMBET : Elle fonde cette impossibilité, me semble-t-il. C’est-à-dire que la faute est séparation, c’est la chute dans le multiple. Au fond, je crois profondément que je suis plutôt marqué par le gnosticisme, une forme de pensée gnostique, antique, qui – sans que j’aie particulièrement cultivé le sujet – est quelque chose que je sens et qui me domine. Un immense besoin de réunification, d’instauration d’une unité qui est impossible, étant donné cette chute initiale, dans la matière, dans le temps et dans l’histoire, dans la diversité. Et l’écriture, à défaut de pouvoir concilier ces inconciliables, permet de ressentir intensément ce conflit, qui est un conflit fondamental entre le désir et la réalité. Le désir veut l’éternité, le désir veut l’absolu, veut l’unité. Et il se heurte à une temporalité, à une historicité qui l’oblige à composer, à retomber sans cesse dans l’insatisfaction, dans la vulgarité du jour. Or l’écriture, elle, dit cela. Elle l’exprime comme un rêve, par exemple, dans l’utilisation que je fais de la figure de l’androgyne, qui est, à l’horizon de la conscience, cette hypostase de l’unité, de la fusion du masculin et du féminin en une seule entité, totalement homme et totalement femme. C’est quelque chose qui est évidemment absolument idéal, mais qui remplit un désir essentiel.
9C. EAUDEAU : On va revenir sur cette question de l’androgyne. Mais comment comprendre l’articulation entre la faute, le mal et le secret? Vous dites : le mal c’est ce qui empêche l’unité, et l’unité est l’objet du désir. Est-ce que le secret à avouer, c’est le secret de la faute? Mais de quelle faute, de quel mal? Vous écrivez aussi, par exemple dans « Procuste » (dans Augias et autres infamies) que le secret s’ignore lui-même, c’est-à-dire que, s’il ne peut pas être avoué, c’est qu’on connaît son existence, mais qu’on ignore sa nature.
10C. LOUIS-COMBET : On ignore sa nature. On sait, je crois – en tout cas dans une dimension essentielle qui n’est sans doute pas toute la dimension du secret – qu’il y a des racines profondes du secret qui sont à chercher du côté de la sexualité, de la relation à la mère, ce qui renvoie à un stade d’élaboration du moi très primitif, peut-être antérieur au développement des sentiments œdipiens, qui sont vraiment très anciens dans l’histoire de la structuration de l’âme individuelle. Je dirais aussi que, si je regarde du côté des expériences infantiles fondamentales, du côté du secret qui se développe en moi et qui forme un noyau dans le fond de l’enfance et de l’enfant que j’ai été, il s’agit en grande partie de l’intériorisation d’un secret qui était celui des adultes autour de moi, qui était quelque chose de familial, un non-dit familial, enveloppant, englobant et finalement complètement intériorisé. Si bien que, arrivé à l’âge où l’être est capable de s’exprimer par écrit, par création, le secret est présent et il ne peut pas être révélé, de même qu’il n’était pas révélé à l’extérieur dans une relation orale, une relation de confiance ou une relation de parole avec les adultes. Ces relations étaient impraticables et donc le secret alentour pesait et écrasait. À partir du moment où le secret est complètement intériorisé et où il s’agit d’exprimer un noyau de souffrance, un noyau de désespérance et de solitude, il n’arrive pas ressortir. Comme le secret, par nature, par définition, est le non-dit de ce qui est complètement indicible, informulable, toute tentative pour l’exprimer est nécessairement vouée à l’échec. Et donc, tout ce que l’écrivain peut faire, c’est de repérer des analogies de son propre secret dans les expériences des autres qu’il va exploiter. Par exemple, des personnages légendaires ou historiques comme sainte Rosa ou Antoinette Bourignon ou sainte Marina. Ce sont des êtres qui comportent une part aussi de secret, d’inavouable, d’ambiguïté insurmontable, et ce sont autant de figures comme des masques, comme des figures spéculaires avec lesquels le narrateur peut s’identifier. Donc il va chercher – c’est le fond de la démarche autobiographique – il va chercher dans ces existences de personnages légendaires ou imaginaires des analogies avec ses propres expériences.
Claude Louis-Combet
Dans Rue Descartes 2004/1 (n° 43), pages 88 à 101
CORINNE ENAUDEAU : Vous affirmez, dans plusieurs de vos textes, un parti pris antiréaliste et dites n’accorder de « patience et de passion » qu’à la seule intériorité. Vous refusez pour cette raison le récit, l’anecdote, la circonstance, c’est-à-dire l’inscription dans l’espace et dans le temps, ce qui vous conduit à préférer la mythobiographie à l’autobiographie. Or, paradoxalement, vous justifiez ce parti pris par une expérience tout à fait personnelle, celle que l’enfant et le jeune clerc ont faite d’un exil intérieur. Pourquoi alors placez-vous l’écriture sous la contrainte d’exprimer une intériorité impersonnelle, archaïque, mythique, donc collective et vous refusez-vous à l’autobiographie?
2CLAUDE LOUIS-COMBET : II ne s’agit pas d’un refus absolu. Quand je dis que je me détourne du réel, de l’anecdote, de l’autobiographie, il faut quand même relativiser les choses. En fait, il y a beaucoup de textes qui ont une dimension autobiographique dans mes écrits. Je suis parti de l’autobiographie avec Infernaux paluds. C’était un premier roman, une autobiographie qui se présentait comme un roman, avec des éléments qui étaient objectivement autobiographiques, et puis un travail qui portait plus sur l’imaginaire, qui apportait des nuances par rapport au récit autobiographique. Mais, au terme de cette première tentative d’expression, j’ai éprouvé une insatisfaction profonde qui tenait au fait que je m’enfermais dans des détails, dans des situations qui ne m’apprenaient rien finalement, puisque je les avais connus, je les avais vécus. Donc c’était un travail de mémoire et ce n’était pas un travail de véritable invention. Et j’ai cherché par la suite dans l’écriture à créer un univers différent de celui de la réalité vécue, quotidienne, et qui me permettait, je crois, d’atteindre à une authenticité beaucoup plus grande que celle de la narration banale des événements de la vie. Quand je dis le parti que j’ai pris, le parti de me détourner de la réalité – de la réalité historique, de la réalité sociale, politique… –, cela ne concerne bien que l’activité d’écriture. L’écriture, pour moi, doit se réserver à un champ qui n’est pas celui de l’expérience quotidienne, des soucis et préoccupations de la vie ordinaire. Ce qui évidemment ne signifie pas que, dans ma vie quotidienne, ordinaire, je me tiens à l’abri des préoccupations ou des soucis qui m’entourent. Je crois que je suis très ouvert sur le monde extérieur, sauf dans le moment que je réserve à l’écriture et qui est vraiment un enfoncement dans l’imaginaire, dans l’imaginaire fantasmatique. Là, je retrouve effectivement une certaine universalité, parce que les fantasmes, c’est quelque chose qui est en partage de l’humanité tout entière. Je ne sens pas du tout cette mise à l’écart du monde comme une contrainte artificielle que je m’impose, mais c’est la condition pour retrouver une intériorité et une antériorité fondamentales. C’est comme de fermer les yeux un moment pour s’isoler de la vision du monde extérieur, se recueillir. Cette attitude de recueillement est pour moi, à la fois le moyen et la fin de l’activité d’écriture.
3C. ENAUDEAU : À lire votre dernier livre publié, L’homme du texte, il y a pourtant une sorte de bataille entre deux intériorités, ou, pour prendre votre vocabulaire, « deux âmes ». Une âme que vous appelez matérielle, psychique, l’âme archaïque, mythique, mais dont vous dites qu’elle est irresponsable, sans péché, qu’elle n’a rien à avouer. C’est « la mémoire de toute l’humanité », la mémoire du cosmos lui-même, une âme universelle donc. Et puis il y a une autre âme, « plus spirituelle », dites-vous, qui est l’âme éthique, responsable et, d’une certaine façon, l’âme coupable, l’âme individuelle cette fois. Or vous laissez entendre que votre écriture est sous le coup de l’aveu d’un secret. Est-ce que la mythobiographie n’élude pas la question de l’aveu, ce que vous semblez vous-même craindre? Est-ce que, au niveau du mythe, on peut toucher la question du secret?
4C. LOUIS-COMBET : Je pense que le recours à l’imaginaire mythique, aux légendes hagiographiques, à l’imaginaire chrétien est à la fois une façon de voiler et de dévoiler le secret. Je crois que le secret n’est pas du tout aboli, il n’est pas refusé, mais il cherche sa voie d’expression, il s’aventure à travers des existences fabuleuses, à travers les produits de l’imaginaire. Il s’aventure vers un horizon dicible. Il y a quelque chose qui peut être dit, qui est sur le point d’être dit. L’aveu peut-être retenu, encore réservé, mais il va aussi loin que possible sur la voie de l’expression. Et c’est cela ou rien. C’est-à-dire que si je m’en étais tenu à l’autobiographie stricto sensu, l’aveu aurait été impossible de toute façon. Donc recourir à des personnages, à des figures mythologiques ou légendaires pour avancer quelque chose du plus profond de soi-même, c’est une issue. C’est une issue qui n’est peut-être pas complète, qui n’est pas définitive, mais c’est tout ce qui est possible… dans mon cas.
5C. ENAUDEAU : Le secret n’est pas aboli, mais la faute n’est-elle pas abolie? Vous dites que cette âme intemporelle est sans péché et qu’elle n’a rien à avouer.
6C. LOUIS-COMBET : Je crois que le travail d’écriture repose sur une contradiction fondamentale qui est justement celle du désir d’échapper à l’histoire et, par opposition, de reconnaître et accepter l’évidence du mal, ou de la faute, des contradictions de la vie. Il y a, si vous voulez, une voie, une aspiration à l’unité, et en même temps l’évidence de cette impossibilité d’y accéder.
7C. ENAUDEAU : Mais la faute est-elle seulement l’impossibilité d’accéder à l’unité?
8C. LOUIS-COMBET : Elle fonde cette impossibilité, me semble-t-il. C’est-à-dire que la faute est séparation, c’est la chute dans le multiple. Au fond, je crois profondément que je suis plutôt marqué par le gnosticisme, une forme de pensée gnostique, antique, qui – sans que j’aie particulièrement cultivé le sujet – est quelque chose que je sens et qui me domine. Un immense besoin de réunification, d’instauration d’une unité qui est impossible, étant donné cette chute initiale, dans la matière, dans le temps et dans l’histoire, dans la diversité. Et l’écriture, à défaut de pouvoir concilier ces inconciliables, permet de ressentir intensément ce conflit, qui est un conflit fondamental entre le désir et la réalité. Le désir veut l’éternité, le désir veut l’absolu, veut l’unité. Et il se heurte à une temporalité, à une historicité qui l’oblige à composer, à retomber sans cesse dans l’insatisfaction, dans la vulgarité du jour. Or l’écriture, elle, dit cela. Elle l’exprime comme un rêve, par exemple, dans l’utilisation que je fais de la figure de l’androgyne, qui est, à l’horizon de la conscience, cette hypostase de l’unité, de la fusion du masculin et du féminin en une seule entité, totalement homme et totalement femme. C’est quelque chose qui est évidemment absolument idéal, mais qui remplit un désir essentiel.
9C. EAUDEAU : On va revenir sur cette question de l’androgyne. Mais comment comprendre l’articulation entre la faute, le mal et le secret? Vous dites : le mal c’est ce qui empêche l’unité, et l’unité est l’objet du désir. Est-ce que le secret à avouer, c’est le secret de la faute? Mais de quelle faute, de quel mal? Vous écrivez aussi, par exemple dans « Procuste » (dans Augias et autres infamies) que le secret s’ignore lui-même, c’est-à-dire que, s’il ne peut pas être avoué, c’est qu’on connaît son existence, mais qu’on ignore sa nature.
10C. LOUIS-COMBET : On ignore sa nature. On sait, je crois – en tout cas dans une dimension essentielle qui n’est sans doute pas toute la dimension du secret – qu’il y a des racines profondes du secret qui sont à chercher du côté de la sexualité, de la relation à la mère, ce qui renvoie à un stade d’élaboration du moi très primitif, peut-être antérieur au développement des sentiments œdipiens, qui sont vraiment très anciens dans l’histoire de la structuration de l’âme individuelle. Je dirais aussi que, si je regarde du côté des expériences infantiles fondamentales, du côté du secret qui se développe en moi et qui forme un noyau dans le fond de l’enfance et de l’enfant que j’ai été, il s’agit en grande partie de l’intériorisation d’un secret qui était celui des adultes autour de moi, qui était quelque chose de familial, un non-dit familial, enveloppant, englobant et finalement complètement intériorisé. Si bien que, arrivé à l’âge où l’être est capable de s’exprimer par écrit, par création, le secret est présent et il ne peut pas être révélé, de même qu’il n’était pas révélé à l’extérieur dans une relation orale, une relation de confiance ou une relation de parole avec les adultes. Ces relations étaient impraticables et donc le secret alentour pesait et écrasait. À partir du moment où le secret est complètement intériorisé et où il s’agit d’exprimer un noyau de souffrance, un noyau de désespérance et de solitude, il n’arrive pas ressortir. Comme le secret, par nature, par définition, est le non-dit de ce qui est complètement indicible, informulable, toute tentative pour l’exprimer est nécessairement vouée à l’échec. Et donc, tout ce que l’écrivain peut faire, c’est de repérer des analogies de son propre secret dans les expériences des autres qu’il va exploiter. Par exemple, des personnages légendaires ou historiques comme sainte Rosa ou Antoinette Bourignon ou sainte Marina. Ce sont des êtres qui comportent une part aussi de secret, d’inavouable, d’ambiguïté insurmontable, et ce sont autant de figures comme des masques, comme des figures spéculaires avec lesquels le narrateur peut s’identifier. Donc il va chercher – c’est le fond de la démarche autobiographique – il va chercher dans ces existences de personnages légendaires ou imaginaires des analogies avec ses propres expériences.
Druon avait l’impression d’avoir été jeté dans l’espace sans fin d’un monde entièrement nouveau. L’absence de forêt lui faisait mal, comme si une part essentielle d’obscurité et de mystère lui avait été arrachée des entrailles.
Puis la Dame s’en alla, laissant son image dans le cœur de Druon. Elle était entourée d’un petit groupe de servantes affairées et babillardes. Leur départ ramena dans l’étable la pénombre ordinaire.
Et cette petite chose de douceur tiède, on devine bien qu’elle fut l’enfance — peut-être même qu’elle fut l’enfant, mon enfant, mon petit garçon. Mais c’est là un souvenir si antédiluvien que lui non plus n’affecte nullement la qualité de mon sourire. Il est sans importance, en effet, d’imaginer ce que pouvait être cette petite chose avant d’en arriver là, de lui prêter un visage, de lui donner la parole, de l’infléchir jusqu’à la ressemblance avec tel petit garçon brun ou blond, tel petit écolier rêvant sur la cour de récréation ou se débattant parmi les taches d’encre tombées de la nuit, tel petit frère familier du silence que nous aurions connu, que nous aurions aimé. En vérité, c’est sans importance. Il n’y a rien à imaginer en dehors de la douce tiédeur sans nom d’une étrange petite chose existant dans mon sourire et dont la soumission infinie me promet, je le crois, toutes les chances de l’extase.
Douce, doucement tiède, doucement douceâtre et sans énergie, vidée de tensions, vidée de passions, simplement douce, simplement tiède et sans autre épaisseur d’être que sa douceur, que sa tiédeur…
Je me suis demandé ce que je serais devenue, au fond de moi-même, si, ayant d’abord mis au monde un petit veau, j’avais repris ensuite ma forme et mon être de femme. Mais mon divin amant, le plus attentionné des dieux à mon égard, eut le tact de ne pas m’infliger une telle épreuve. J’enfantai un beau petit garçon, et je lui donnais le doux nom d’Épaphos — bruit des baisers mouillés que je laissais sur sa peau tandis qu’il tétait mes seins. Beaucoup de noms, dans notre langue, ont rapport aux œuvres de la bouche et au souffle, comme si l’enfant, conçu dans l’amour et par le sexe, trouvait dans les parties plus élevées du corps et dans ses plus nobles fonctions, l’achèvement spirituel que lui apporte sa nomination.
Le moment se déroulait à l’embouchure d’un grand fleuve étalé comme un miroir quasiment infini pour refléter le bleu du ciel. Pas un humain ne se trouvait à proximité pour m’aider dans le travail des couches. Je dus tirer le petit corps hors de moi, comme un gros phalle languide et fangeux, et de mes dents, à la façon des premières femelles, couper le cordon qui le liait à ma chair — et toute la suite, que l’on peut imaginer, jusqu’au moment où j’engageai entre ses lèvres le bout considérable de mes seins.
Ainsi, longtemps, le temps passa.
Avec mes dents, j’appris à l’enfant la ténacité. Avec mon cœur, la réceptivité à toutes les métamorphoses. Avec mon nombril, sur lequel il aimait poser son doigt, la fidélité à soi-même. Avec tout mon corps de femme, avec mes seins et mon sexe, le désir et la volupté.
Le moment venu, et comme j’étais recrue d’expérience et de plaisir, je l’envoyai chercher fortune vers le sud. Un jour, il construirait Memphis et deviendrait roi d’Égypte.
Et moi, comme si j’étais restée petite fille en mal de son père, je me coucherais dans le lit du grand Nil jusqu’à ce que mon fils et ses enfants et petits-enfants et tout leur peuple viennent chercher mon corps parmi les eaux profondes et le limon et que leur vénération me réveille à la vie, sous le nom d’Isis, tout sonore du sifflement de l’air salubre, qui est, dans leur langue, le même que Io : le baiser.
Le moment se déroulait à l’embouchure d’un grand fleuve étalé comme un miroir quasiment infini pour refléter le bleu du ciel. Pas un humain ne se trouvait à proximité pour m’aider dans le travail des couches. Je dus tirer le petit corps hors de moi, comme un gros phalle languide et fangeux, et de mes dents, à la façon des premières femelles, couper le cordon qui le liait à ma chair — et toute la suite, que l’on peut imaginer, jusqu’au moment où j’engageai entre ses lèvres le bout considérable de mes seins.
Ainsi, longtemps, le temps passa.
Avec mes dents, j’appris à l’enfant la ténacité. Avec mon cœur, la réceptivité à toutes les métamorphoses. Avec mon nombril, sur lequel il aimait poser son doigt, la fidélité à soi-même. Avec tout mon corps de femme, avec mes seins et mon sexe, le désir et la volupté.
Le moment venu, et comme j’étais recrue d’expérience et de plaisir, je l’envoyai chercher fortune vers le sud. Un jour, il construirait Memphis et deviendrait roi d’Égypte.
Et moi, comme si j’étais restée petite fille en mal de son père, je me coucherais dans le lit du grand Nil jusqu’à ce que mon fils et ses enfants et petits-enfants et tout leur peuple viennent chercher mon corps parmi les eaux profondes et le limon et que leur vénération me réveille à la vie, sous le nom d’Isis, tout sonore du sifflement de l’air salubre, qui est, dans leur langue, le même que Io : le baiser.
Le dieu n’était pas bavard. Il n’avait surtout pas à me donner d’explications. Mais le regard qu’il m’adressait, plein d’admiration, de désir et de résolution devait me suffire. Mon ravisseur s’était emparé de moi. Je souhaitais seulement qu’il jouît de sa possession et que l’instant durât autant que moi.
Il me saisit par la main et m’entraîna dans la forêt. À travers les feuillages s’agitait la poussière d’or du soleil montant. Les arbres très serrés et touffus à cet endroit formaient la figure même du jaillissement. Je voyais à présent le sexe du dieu se dresser. Il appartenait à la forêt comme à son corps. La fête serait celle de toutes les espèces mêlées et érigées. Je doutais seulement d’avoir la chair assez profonde, et de porter en moi tout le feu et toute l’eau qu’il faudrait, pour la magnificence du désir universel.
Notre couche serait d’humus et de mousse. Elle formait, à elle seule, une clairière très close. J’attendais un geste du dieu pour m’allonger. Mais mon désir de tout savoir et d’aller jusqu’au bout, jusqu’au point d’irréversion, fut piqué au vif lorsqu’il me fit seulement me pencher en avant, debout, les reins tendus, toute ma fente exposée à sa vue et à son appétit, comme sont les femelles pour les mâles.
Sa main de tout-puissant me parcourut alors depuis la tête et le long du dos jusqu’aux cuisses, et remonta sous mon ventre jusqu’à mes seins. Ce ne fut qu’une immense, une prodigieuse, caresse. Tout mon corps, comme pétri, se transforma et mon âme s’enfonça dans une infinitude de chair dont elle saisissait l’ébauche sans percevoir l’achèvement. Mes bras et mes jambes munis de sabots de corne s’appuyaient énergiquement sur le sol. Ma croupe s’était élargie et je la devinais somptueuse, à l’abri d’un appendice caudal que je pouvais librement manœuvrer. J’avais des flancs rebondis, tendus par une échine d’amoureuse, apte à toutes les étreintes. Mes seins avaient migré vers le bas de mon ventre et s’exhibaient à l’ombre de mes cuisses en mamelles plantureuses couronnées de manières de phalles flaccides dont la seule présence appelait la main pour en soutirer la substance. Mais je n’avais plus de mains. J’avais, par contre, une tête volumineuse, toute en mufle et ornée d’une lyrique paire de cornes. Si je voulais parler, je poussais de longs et caverneux meuglements.
J’en poussai quelques-uns, certes, et déchirants, et véhéments et exultants lorsque le dieu, me couvrant par-derrière, plongea en moi son sexe de géant et me posséda comme jamais, je crois, taureau n’eût pu le faire, car sa sagesse aguisait son désir et son amour insufflait en moi son immortalité.
Inondée de jouissance au-dedans et recrue de plaisir jusqu’aux naseaux, Io Io, jeune vache que j’étais, incertaine de mon corps mais souveraine de ma vulve, j’entendis à peine, comme un sifflement de serpent, l’aigre voix de femme qui appelait du fond du ciel et réclamait son bien.
Le dieu posa son bras sur mes épaules comme il eût fait d’un harnais et d’un licol et me guida sur son propre chemin, vers les hauteurs et les lointains.
Il me saisit par la main et m’entraîna dans la forêt. À travers les feuillages s’agitait la poussière d’or du soleil montant. Les arbres très serrés et touffus à cet endroit formaient la figure même du jaillissement. Je voyais à présent le sexe du dieu se dresser. Il appartenait à la forêt comme à son corps. La fête serait celle de toutes les espèces mêlées et érigées. Je doutais seulement d’avoir la chair assez profonde, et de porter en moi tout le feu et toute l’eau qu’il faudrait, pour la magnificence du désir universel.
Notre couche serait d’humus et de mousse. Elle formait, à elle seule, une clairière très close. J’attendais un geste du dieu pour m’allonger. Mais mon désir de tout savoir et d’aller jusqu’au bout, jusqu’au point d’irréversion, fut piqué au vif lorsqu’il me fit seulement me pencher en avant, debout, les reins tendus, toute ma fente exposée à sa vue et à son appétit, comme sont les femelles pour les mâles.
Sa main de tout-puissant me parcourut alors depuis la tête et le long du dos jusqu’aux cuisses, et remonta sous mon ventre jusqu’à mes seins. Ce ne fut qu’une immense, une prodigieuse, caresse. Tout mon corps, comme pétri, se transforma et mon âme s’enfonça dans une infinitude de chair dont elle saisissait l’ébauche sans percevoir l’achèvement. Mes bras et mes jambes munis de sabots de corne s’appuyaient énergiquement sur le sol. Ma croupe s’était élargie et je la devinais somptueuse, à l’abri d’un appendice caudal que je pouvais librement manœuvrer. J’avais des flancs rebondis, tendus par une échine d’amoureuse, apte à toutes les étreintes. Mes seins avaient migré vers le bas de mon ventre et s’exhibaient à l’ombre de mes cuisses en mamelles plantureuses couronnées de manières de phalles flaccides dont la seule présence appelait la main pour en soutirer la substance. Mais je n’avais plus de mains. J’avais, par contre, une tête volumineuse, toute en mufle et ornée d’une lyrique paire de cornes. Si je voulais parler, je poussais de longs et caverneux meuglements.
J’en poussai quelques-uns, certes, et déchirants, et véhéments et exultants lorsque le dieu, me couvrant par-derrière, plongea en moi son sexe de géant et me posséda comme jamais, je crois, taureau n’eût pu le faire, car sa sagesse aguisait son désir et son amour insufflait en moi son immortalité.
Inondée de jouissance au-dedans et recrue de plaisir jusqu’aux naseaux, Io Io, jeune vache que j’étais, incertaine de mon corps mais souveraine de ma vulve, j’entendis à peine, comme un sifflement de serpent, l’aigre voix de femme qui appelait du fond du ciel et réclamait son bien.
Le dieu posa son bras sur mes épaules comme il eût fait d’un harnais et d’un licol et me guida sur son propre chemin, vers les hauteurs et les lointains.
Alors, je vis le dieu sourire dans sa barbe, et son œil pétiller malicieusement. Il fit un grand geste du bras, comme un tourbillon, et aussitôt le ciel se couvrit et un épais nuage blanc nous enveloppa, lui et moi. Nous pouvions nous croire à l’abri de toute fureur, réfugiés dans un œuf ouaté, imperméable au bruit.
Un espace si doux, si tendre et tiède que je fus un moment à me demander si je ne me trouvais pas, moi-même, enfouie au-dedans de mon corps — visage, épaules, buste et ventre réintégrés dans la chair primitive du sexe et du creux d’origine.
Jamais, je n’avais été aussi près de ressembler à la sphère du commencement, enveloppée que j’étais dans le tissu interne de ma nudité.
La rondeur de mon désir me comblait. Mon âme se concentrait entièrement dans les replis généreux et les noires complications de ma fente de femme. C’était par là seulement que je vivais, sentais et pensais, tandis que le dieu, maître du temps, se préparait à m’aimer.
Je me disais, presque à l’écart des mots, tant ma certitude était immédiate : « Quand il me possédera, je serai égale à la nuit et à la lumière, femme à l’infini, amante uniquement. »
Mais un éclat de rire, féminin, soudain déchaîné de son aître céleste, fendit d’un coup le blanc nuage qui tomba à mes pieds comme un drap sale rejeté du lit.
Un espace si doux, si tendre et tiède que je fus un moment à me demander si je ne me trouvais pas, moi-même, enfouie au-dedans de mon corps — visage, épaules, buste et ventre réintégrés dans la chair primitive du sexe et du creux d’origine.
Jamais, je n’avais été aussi près de ressembler à la sphère du commencement, enveloppée que j’étais dans le tissu interne de ma nudité.
La rondeur de mon désir me comblait. Mon âme se concentrait entièrement dans les replis généreux et les noires complications de ma fente de femme. C’était par là seulement que je vivais, sentais et pensais, tandis que le dieu, maître du temps, se préparait à m’aimer.
Je me disais, presque à l’écart des mots, tant ma certitude était immédiate : « Quand il me possédera, je serai égale à la nuit et à la lumière, femme à l’infini, amante uniquement. »
Mais un éclat de rire, féminin, soudain déchaîné de son aître céleste, fendit d’un coup le blanc nuage qui tomba à mes pieds comme un drap sale rejeté du lit.
Le dieu avait d’abord posé sa main sur ma tête, dans un geste de protection et de bénédiction. Puis il l’avait glissée dans mes cheveux. Et elle avait suivi leur cours jusqu’à mes reins. Je sentais son poids léger et sa douce façon d’appuyer, juste au-dessus de ma croupe.
Nous marchions ensemble le long du fleuve. Je laissais la main du dieu suivre les courbes de mon corps. J’aurais aimé être liée davantage afin qu’elle me délie et moins creuse que je n’étais afin qu’elle me plie et me déploie et m’ouvre à moi-même jusqu'au cœur. Tantôt elle reposait sur mes hanches, tantôt elle remontait jusqu’à mes seins qu’elle effleurait, comme du plus impondérable des souffles. Une braise obscure ardait au bas de mon ventre. J’étais assoiffée et attendais la pluie.
Pas de paroles entre nous, pas de phrases galantes, pas de déclaration d’amour. Nous respirions ensemble et le silence était plein. Je n’avais pas de mots pour dire : « Je suis à vous, Seigneur, faites de moi ce qu’il vous plaira. »
Je n’avais jamais vu un sexe d’homme. Je le regardais avec tant d’admiration que je cessais de voir autour de nous la beauté du monde en plein midi. Il me semblait aussi que je mourrais de bonheur si je venais à le toucher.
Notre désir approchait du zénith. Toute ma chair priait en moi, implorant le suspens du temps.
Mais soudain du fond du ciel dévoré de lumière, une voix d’orage éclata, tonnante et tonitruante, une violence inouïe de mots déchaînés et cinglants — voix de femme, de déesse, d’épouse en colère, dont je ne saisissais pas les paroles.
La main du dieu desserra son étreinte. Tout mon corps se prit à trembler.
Nous marchions ensemble le long du fleuve. Je laissais la main du dieu suivre les courbes de mon corps. J’aurais aimé être liée davantage afin qu’elle me délie et moins creuse que je n’étais afin qu’elle me plie et me déploie et m’ouvre à moi-même jusqu'au cœur. Tantôt elle reposait sur mes hanches, tantôt elle remontait jusqu’à mes seins qu’elle effleurait, comme du plus impondérable des souffles. Une braise obscure ardait au bas de mon ventre. J’étais assoiffée et attendais la pluie.
Pas de paroles entre nous, pas de phrases galantes, pas de déclaration d’amour. Nous respirions ensemble et le silence était plein. Je n’avais pas de mots pour dire : « Je suis à vous, Seigneur, faites de moi ce qu’il vous plaira. »
Je n’avais jamais vu un sexe d’homme. Je le regardais avec tant d’admiration que je cessais de voir autour de nous la beauté du monde en plein midi. Il me semblait aussi que je mourrais de bonheur si je venais à le toucher.
Notre désir approchait du zénith. Toute ma chair priait en moi, implorant le suspens du temps.
Mais soudain du fond du ciel dévoré de lumière, une voix d’orage éclata, tonnante et tonitruante, une violence inouïe de mots déchaînés et cinglants — voix de femme, de déesse, d’épouse en colère, dont je ne saisissais pas les paroles.
La main du dieu desserra son étreinte. Tout mon corps se prit à trembler.
Puis vint le jour, en vérité nuit de lune à son plein, où coula mon premier sang de femme.
Une fleur toute rouge jaillit soudain de la noire corolle au bas de mon corps et, comme la semence de mon père, se mêla au courant.
Je contemplais, en grand émoi de chair, ce qui sortait de moi. Comme les devineresses, les prophétesses et les artistes de tous les temps, je scrutais le dessin que formait mon sang au fil de l’eau. J’aurais voulu y lire les promesses de mon avenir. Mais le sens m’échappait. Je voyais seulement une traînée d’ombre que la vague nonchalante ramenait sur elle-même, sans échappatoire, pareille à un approximatif tracé de cercle.
Je voyais aussi de minuscules poissons, plus sombres que mon sang, se presser dans mon flux qu’ils absorbaient goulûment. J’éprouvais l’heureuse impression d’être la nourrice de la vie.
Jamais je n’avais connu bonheur plus certain et plus intime. Du bout des doigts je flattais ma fente comme pour la féliciter d’être ce qu’elle était avec tant de générosité.
Au soir du troisième jour, la source était tarie, les poissons avaient disparu dans des eaux plus profondes. Alors je sortis du fleuve paternel et fis mes premiers pas sur la terre ferme.
Le plaisir de mes pieds s’empara de mon corps tout entier et remonta jusqu’à ma bouche. Je me mis à chanter. C’était ma vraie naissance, toute mêlée à ma joie d’être femme. J’étais si heureuse que je m’accroupis dans l’herbe pour uriner.
Ce matin-là, d’un jour magnifique aux confins du printemps et de l’été, je suis sortie très tôt : je voulais, depuis la rive, voir le soleil se lever sur le fleuve.
Je n’avais à moi, pour ce moment de contemplation, que la nudité de mon corps sans apprêt — ma chevelure fastueuse, encore toute sombre des vestiges de la nuit, la touffe très noire de mon sexe pour signature de ma beauté.
La rive était basse à cet endroit et consistait en une brève prairie close par des fourrés de buissons et d’arbustes. C’était la saison des nids. Des myriades d’oiseaux invisibles chantaient et pépiaient. L’espace était saturé de leur fête et de leur plaisir.
La lumière s’épandait, s’épanchait, conçue pouvais-je croire, comme moi, dans la profondeur des eaux. Elle sourdait du fleuve et sa grâce irrésistible occupa bientôt tout l’espace céleste, terrestre et aquatique. Il me semblait qu’à cette heure, j’étais le seul témoin du mariage des éléments, tandis que le feu du soleil empourprait la nature sans fin.
C’est alors que le dieu surgit soudain devant moi, comme échappé du noyau solaire, dans la splendeur de son corps d’homme.
Il m’appela par mon nom : « Io ! » murmura-t-il et cette syllabe unique, qui fait que je suis ce que je suis, coulait dans sa bouche comme une source.
Mon souffle lui répondit : « Seigneur ! » et toute mon attitude lui disait que j’appartenais à son désir et qu’il pouvait user de moi selon son goût, sans réserve.
Non seulement le soleil poursuivait son ascension dans le ciel, mais il était là pour moi seule, j’étais à hauteur de son épaule et tout mon être aspirait à céder, à s’ouvrir et se blottir.
Une fleur toute rouge jaillit soudain de la noire corolle au bas de mon corps et, comme la semence de mon père, se mêla au courant.
Je contemplais, en grand émoi de chair, ce qui sortait de moi. Comme les devineresses, les prophétesses et les artistes de tous les temps, je scrutais le dessin que formait mon sang au fil de l’eau. J’aurais voulu y lire les promesses de mon avenir. Mais le sens m’échappait. Je voyais seulement une traînée d’ombre que la vague nonchalante ramenait sur elle-même, sans échappatoire, pareille à un approximatif tracé de cercle.
Je voyais aussi de minuscules poissons, plus sombres que mon sang, se presser dans mon flux qu’ils absorbaient goulûment. J’éprouvais l’heureuse impression d’être la nourrice de la vie.
Jamais je n’avais connu bonheur plus certain et plus intime. Du bout des doigts je flattais ma fente comme pour la féliciter d’être ce qu’elle était avec tant de générosité.
Au soir du troisième jour, la source était tarie, les poissons avaient disparu dans des eaux plus profondes. Alors je sortis du fleuve paternel et fis mes premiers pas sur la terre ferme.
Le plaisir de mes pieds s’empara de mon corps tout entier et remonta jusqu’à ma bouche. Je me mis à chanter. C’était ma vraie naissance, toute mêlée à ma joie d’être femme. J’étais si heureuse que je m’accroupis dans l’herbe pour uriner.
Ce matin-là, d’un jour magnifique aux confins du printemps et de l’été, je suis sortie très tôt : je voulais, depuis la rive, voir le soleil se lever sur le fleuve.
Je n’avais à moi, pour ce moment de contemplation, que la nudité de mon corps sans apprêt — ma chevelure fastueuse, encore toute sombre des vestiges de la nuit, la touffe très noire de mon sexe pour signature de ma beauté.
La rive était basse à cet endroit et consistait en une brève prairie close par des fourrés de buissons et d’arbustes. C’était la saison des nids. Des myriades d’oiseaux invisibles chantaient et pépiaient. L’espace était saturé de leur fête et de leur plaisir.
La lumière s’épandait, s’épanchait, conçue pouvais-je croire, comme moi, dans la profondeur des eaux. Elle sourdait du fleuve et sa grâce irrésistible occupa bientôt tout l’espace céleste, terrestre et aquatique. Il me semblait qu’à cette heure, j’étais le seul témoin du mariage des éléments, tandis que le feu du soleil empourprait la nature sans fin.
C’est alors que le dieu surgit soudain devant moi, comme échappé du noyau solaire, dans la splendeur de son corps d’homme.
Il m’appela par mon nom : « Io ! » murmura-t-il et cette syllabe unique, qui fait que je suis ce que je suis, coulait dans sa bouche comme une source.
Mon souffle lui répondit : « Seigneur ! » et toute mon attitude lui disait que j’appartenais à son désir et qu’il pouvait user de moi selon son goût, sans réserve.
Non seulement le soleil poursuivait son ascension dans le ciel, mais il était là pour moi seule, j’étais à hauteur de son épaule et tout mon être aspirait à céder, à s’ouvrir et se blottir.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur

Le regard de Méduse
Pecosa
56 livres

Fictions biographiques
LowrySam
30 livres
Auteurs proches de Claude Louis-Combet
Lecteurs de Claude Louis-Combet (116)Voir plus
Quiz
Voir plus
Dragon ball et Dragon ball Z
(Super facile) Combien d'enfant a Son Goku ?
1
2
3
4
10 questions
760 lecteurs ont répondu
Créer un quiz sur cet auteur760 lecteurs ont répondu