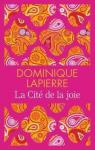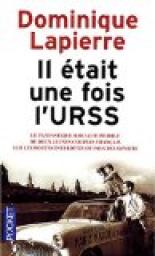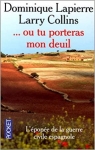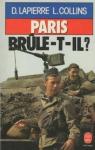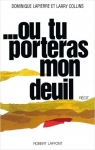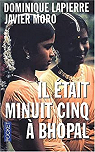Critiques de Dominique Lapierre (291)
« Les Saints vont en enfer » ce titre de Gilbert Cesbron pourrait servir de sous-titre à ce roman (si toutefois c’est un roman), magnifique témoignage d’amour, d’espérance et de charité (trois vertus « chrétiennes »), d’humilité, de sagesse, de tolérance et d’acceptation (vertus hautement humanistes toutes religions confondues). « La Cité de la joie » est un manifeste pour la défense de l’humain contre toutes les agressions extérieures, qu’elles soient naturelles, liées au climat, aux maladies, à la pauvreté, ou hélas humaines, liées principalement à la violence et à la corruption.
Calcutta c’est « Enfer-sur-Terre ». Les statistiques (2011) donnent 4 millions et demi d’habitants et une densité de 21800 habitants au km2 ! Dans les années 1980, où se passe l’action, c’était un peu moins, sans doute, mais le drame de la surpopulation existait depuis des siècles. Avec tout ce que cela suppose comme effets catastrophiques. Et pourtant les gens vivent dans cet enfer, vivent et meurent, bien sûr, vivent ou survivent, dans des conditions que nous, nantis des pays occidentaux, avons peine à imaginer.
Ce que nous montre Dominique Lapierre, c’est que ces gens, qui vivent dans l’extrême pauvreté, qui cohabitent avec les rats, les serpents et d’autres colocataires (à deux pattes, parfois) tout aussi dangereux, ces gens qui n’ont pas à manger, qui travaillent (quand ils ont un travail) au jour le jour, ces gens qui pataugent dans la boue dans la crainte des inondations, eh bien ces gens ne sont pas « malheureux » (au sens que nous donnons, chez nous, aux mots « bonheur » et malheur »). Ils ont une résilience qui leur fait accepter leur sort, avec résignation, certes, mais avec aussi confiance et espérance. Ce message est d’une portée incalculable
L’histoire (bien que la narration ne soit pas le thème premier du livre) est celle d’une poignée de bénévoles, « saints » religieux ou laïcs qui se plongent au milieu de cette population dans le seul but d’aider et de soulager, sans rien attendre en retour : un prêtre français Paul Lambert, qui recherche la source même de sa vocation, plus proche de Vincent de Paul que de Bossuet, un jeune médecin américain, une infirmière, plusieurs Indiens dont un tireur de pousse-pousse, une poignée de héros du quotidien dont la raison de vivre est de soulager la misère du monde. Tâche immense, incommensurable, à la mesure de cette ville, de ce pays, de ce peuple où les dieux avoisinent avec les humains, où les traditions perdurent même au plus fort de la misère, où les traditions freinent la modernité mais n’empêchent pas de regarder l’avenir avec une sorte de sérénité dont nous, occidentaux, serions incapables.
Calcutta pour tous ces personnages, est un lieu de rencontres. Peut-être même plus, un lieu d’osmose, ils se fondent dans cette population pour en épouser les joies et les peines, les déceptions et les espérances.
C’est aussi le cas de l’auteur. Venu ici avec Larry Collins pour écrire « Cette nuit la liberté » il a eu le coup de cœur pour ce pays d’une richesse absolue en même temps que d’une pauvreté indicible, pays de contrastes tellement forts, pays surtout habité par un peuple multimillénaire, d’une immense profondeur spirituelle, qui le fait survivre au-delà de l’enfer terrestre où il est confiné.
Ce que Dominique Lapierre a mis dans ce livre dépasse le travail du journaliste, du reporter, du romancier. C’est un chant d’amour pour un pays, un hymne à la vie, et tout en même temps, un appel à la tolérance universelle, à l’espérance, et à la paix.
Un chef-d’œuvre, parmi les plus grands témoignages du XXème siècle, à lire absolument.
Calcutta c’est « Enfer-sur-Terre ». Les statistiques (2011) donnent 4 millions et demi d’habitants et une densité de 21800 habitants au km2 ! Dans les années 1980, où se passe l’action, c’était un peu moins, sans doute, mais le drame de la surpopulation existait depuis des siècles. Avec tout ce que cela suppose comme effets catastrophiques. Et pourtant les gens vivent dans cet enfer, vivent et meurent, bien sûr, vivent ou survivent, dans des conditions que nous, nantis des pays occidentaux, avons peine à imaginer.
Ce que nous montre Dominique Lapierre, c’est que ces gens, qui vivent dans l’extrême pauvreté, qui cohabitent avec les rats, les serpents et d’autres colocataires (à deux pattes, parfois) tout aussi dangereux, ces gens qui n’ont pas à manger, qui travaillent (quand ils ont un travail) au jour le jour, ces gens qui pataugent dans la boue dans la crainte des inondations, eh bien ces gens ne sont pas « malheureux » (au sens que nous donnons, chez nous, aux mots « bonheur » et malheur »). Ils ont une résilience qui leur fait accepter leur sort, avec résignation, certes, mais avec aussi confiance et espérance. Ce message est d’une portée incalculable
L’histoire (bien que la narration ne soit pas le thème premier du livre) est celle d’une poignée de bénévoles, « saints » religieux ou laïcs qui se plongent au milieu de cette population dans le seul but d’aider et de soulager, sans rien attendre en retour : un prêtre français Paul Lambert, qui recherche la source même de sa vocation, plus proche de Vincent de Paul que de Bossuet, un jeune médecin américain, une infirmière, plusieurs Indiens dont un tireur de pousse-pousse, une poignée de héros du quotidien dont la raison de vivre est de soulager la misère du monde. Tâche immense, incommensurable, à la mesure de cette ville, de ce pays, de ce peuple où les dieux avoisinent avec les humains, où les traditions perdurent même au plus fort de la misère, où les traditions freinent la modernité mais n’empêchent pas de regarder l’avenir avec une sorte de sérénité dont nous, occidentaux, serions incapables.
Calcutta pour tous ces personnages, est un lieu de rencontres. Peut-être même plus, un lieu d’osmose, ils se fondent dans cette population pour en épouser les joies et les peines, les déceptions et les espérances.
C’est aussi le cas de l’auteur. Venu ici avec Larry Collins pour écrire « Cette nuit la liberté » il a eu le coup de cœur pour ce pays d’une richesse absolue en même temps que d’une pauvreté indicible, pays de contrastes tellement forts, pays surtout habité par un peuple multimillénaire, d’une immense profondeur spirituelle, qui le fait survivre au-delà de l’enfer terrestre où il est confiné.
Ce que Dominique Lapierre a mis dans ce livre dépasse le travail du journaliste, du reporter, du romancier. C’est un chant d’amour pour un pays, un hymne à la vie, et tout en même temps, un appel à la tolérance universelle, à l’espérance, et à la paix.
Un chef-d’œuvre, parmi les plus grands témoignages du XXème siècle, à lire absolument.
Dominique Lapierre et Larry Collins savent comment mettre à portée de chacun les grands évènements historiques complexes et aux multiples implications. Cette nuit la liberté ne fait pas exception à la règle.
Leur technique est simple mais efficace : raconter l’Histoire comme un roman en passant rapidement d’une vue d’ensemble des faits à une vision à hauteur d’homme, que les acteurs aient un rôle majeur ou minuscule.
Le lecteur passe de la complexité politique de la décolonisation d’un pays de 400 millions d’habitants à l’époque, à des anecdotes faites pour éclairer les situations en particulier les facteurs humains qui influencent la Grande Histoire. L’indépendance de l’Inde ne se serait pas déroulée de la même manière avec d’autres meneurs que Gandhi, Nehru, Jinnah et Mountbatten.
Ce dernier est le personnage pivot du livre. Le gouvernement britannique ayant compris que, affaiblit par la 2ème guerre mondiale, la Grande Bretagne ne pouvait plus dominer l’Inde et qu’il fallait lui rendre sa liberté dans les meilleures conditions malgré le déchirement que cela représentait. C’est à lord Mountbatten qu’est confiée cette mission difficile voire impossible.
Bien qu’opposé à celle-ci il sera battu par la stratégie séparatiste de Jinnah qui obtiendra la division de l’Inde et le Pakistan pour les musulmans, ce qui sera aussi la défaite de Gandhi. Celui-ci apparait sous un jour contrasté : messie héroïque de la non-violence mais jusqu’à l’absurde, partisan des traditions hindoues mais jusqu’à l’obscurantisme.
Mené à un rythme vif dans une langue accessible, le pavé se dévore avec facilité. Le sérieux historique et les émotions des acteurs cohabitent harmonieusement. Les pages sur la mort et les funérailles de Gandhi étant particulièrement émouvantes.
De ce document passionnant on peut aussi tirer une dure leçon, il n’est pas possible à des peuples de religions différentes de cohabiter pacifiquement dans un même pays, pour preuve le « nettoyage » meurtrier dès le lendemain de l’indépendance qui a conduit au massif exode croisé entre l’Inde et le Pakistan.
Depuis lors les exemples n’ont pas manqué : Palestine, Yougoslavie, Chypre, Nigéria, Birmanie, Chine… etc. A méditer.
Leur technique est simple mais efficace : raconter l’Histoire comme un roman en passant rapidement d’une vue d’ensemble des faits à une vision à hauteur d’homme, que les acteurs aient un rôle majeur ou minuscule.
Le lecteur passe de la complexité politique de la décolonisation d’un pays de 400 millions d’habitants à l’époque, à des anecdotes faites pour éclairer les situations en particulier les facteurs humains qui influencent la Grande Histoire. L’indépendance de l’Inde ne se serait pas déroulée de la même manière avec d’autres meneurs que Gandhi, Nehru, Jinnah et Mountbatten.
Ce dernier est le personnage pivot du livre. Le gouvernement britannique ayant compris que, affaiblit par la 2ème guerre mondiale, la Grande Bretagne ne pouvait plus dominer l’Inde et qu’il fallait lui rendre sa liberté dans les meilleures conditions malgré le déchirement que cela représentait. C’est à lord Mountbatten qu’est confiée cette mission difficile voire impossible.
Bien qu’opposé à celle-ci il sera battu par la stratégie séparatiste de Jinnah qui obtiendra la division de l’Inde et le Pakistan pour les musulmans, ce qui sera aussi la défaite de Gandhi. Celui-ci apparait sous un jour contrasté : messie héroïque de la non-violence mais jusqu’à l’absurde, partisan des traditions hindoues mais jusqu’à l’obscurantisme.
Mené à un rythme vif dans une langue accessible, le pavé se dévore avec facilité. Le sérieux historique et les émotions des acteurs cohabitent harmonieusement. Les pages sur la mort et les funérailles de Gandhi étant particulièrement émouvantes.
De ce document passionnant on peut aussi tirer une dure leçon, il n’est pas possible à des peuples de religions différentes de cohabiter pacifiquement dans un même pays, pour preuve le « nettoyage » meurtrier dès le lendemain de l’indépendance qui a conduit au massif exode croisé entre l’Inde et le Pakistan.
Depuis lors les exemples n’ont pas manqué : Palestine, Yougoslavie, Chypre, Nigéria, Birmanie, Chine… etc. A méditer.
Le duo Lapierre et Collins est déjà l’auteur de trois magnifiques documents-reportages qui tous trois ont marqué leur époque : « Paris brûle-t-l ? » (1965), « …Ou tu porters mon deuil » (1968), « O Jérusalem » (1971). Le quatrième, « Cette nuit la liberté », non seulement ne dépare la série, mais encore en est peut-être le plus pur joyau.
Comme le précédent « O Jérusalem », « Cette nuit la liberté » raconte la naissance d’un état. Mais le propos est différent, car l’histoire des deux pays est différente, à tous points de vue, dimension territoriale, dimension historique, dimension politique, dimension religieuse… C’est à une tâche colossale que se sont livrés Dominique Lapierre et Larry Collins. En 1946-1948, dates où se place le récit, l’Inde est un pays de contrastes : l’Inde anglaise et l’Inde des maharadjahs, l’Inde riche et l’Inde pauvre, l’Inde hindoue et l’Inde musulmane… Et pour nos deux enquêteurs il y a contraste aussi entre l’Inde qu’ils étudient (antérieure de près de trente ans) et celle dans laquelle ils vivent au moment de leur enquête, l’Inde indépendante et partagée avec le Pakistan et le Bangladesh. C’est surtout le pays de la démesure : le pays de quatre cents millions d’habitants qui aspirent à la liberté. Après la Chine, c’est le pays le plus peuplé du monde, et celui qui représente la plus grande diversité de populations, et le plus grand écart entre ces différentes populations, accentué par un système de castes sociales très rigide, et bien entendu par les antagonismes religieux. Dans ces conditions, comment parler d’indépendance, comment unifier cet univers morcelé, comment arriver à donner une âme commune à ces quatre cents millions d’êtres que tout sépare ? Qui pourrait incarner cette espérance et la mener à bien ? Cet homme existe. Il s’appelle Mahandas Karamchand Gandhi, ou tout simplement Gandhi, ou Bapu (père), et très vite Mahatma (grande âme), au vu de ses qualités morales hors du commun : déjà célèbre pour ses combats (pacifistes) pour la dignité humaine, la justice sociale, apôtre de la non-violence, guide spirituel de tout un continent, il s’est trouvé tout naturellement à la tête du combat pour l’indépendance, avec ses principaux adjoints, Nehru, séduisant et pragmatique, et Jinnah, qui représente la partie musulmane de la population. A partir de là, c’est de l’Histoire : les grandes marches de protestation, les grèves de la faim, les palabres sans fin avec les Anglais, l’indépendance au bout du compte (15 août 1947), la partition du pays en deux états (Inde hindoue et Pakistan musulman, l’immense exode entre les deux communautés, les dérapages en guerre civile, et finalement l’assassinat de Gandhi le 30 janvier 1948 par Nathuram Godse, un nationaliste exalté qui reprochait à Gandhi la partition du pays.
C’est plus qu’une page d’Histoire qui est ici décrite par Lapierre et Collins, c’est une véritable épopée tragique et somptueuse dans un cadre difficile à imaginer pour qui ne connaît pas la dimension à la fois territoriale et culturelle de ce pays, sans parler du foisonnement de son Histoire. Le tour de force des auteurs est de restituer la grandeur de l’Inde dans toutes ses contradictions, de montrer le cheminement lent et difficile vers une indépendance qui, on le sait dès le départ, n’aura pas que des avantages, et risque de tourner à la tragédie, de faire le portrait de ces personnages devenus mythiques que sont Gandhi (un saint laïc comme Martin Luther King, doublé d’un éminent homme politique) Nehru et Jinnah, avec leurs convictions parfois réprouvées, mais animés d’un réel amour pour leur pays, chacun à sa façon, et aussi lord et lady Mountbatten, qui jouent la partie « anglaise », en essayant de limiter les dégâts au maximum.
Par leur sens du récit, la somme ahurissante des documents qu’ils ont amassés, par la restitution minutieuse, vivante et captivante qu’ils en ont fait, Dominique Lapierre et Larry Collins ont écrit un chef d’œuvre non pas de compte rendu historique, mais de tout un pan d’Histoire rendu à la dimension humaine. Un document exceptionnel que tout amateur d’Histoire (de cette Histoire-là en tous cas) se doit de connaître.
Deux conseils pour compléter cette lecture :
Le film « Gandhi » de Richard Attenborough (1982) a fait l’unanimité pour la fidélité historique au personnage ainsi qu’à son parcours, autant que pour la réalisation l’interprétation (extraordinaire Ben Kingsley) et toute la partie technique. Les évènements racontés dans « Cette nuit la liberté » sont restitués avec une rare authenticité.
Dans toute la bibliographie consacrée au Mahatma, j’ai particulièrement apprécié celle réalisée par Christine Jordis « Gandhi », dans la (très conseillée) collection « Biographies-Gallimard » (2006) : simple et pratique, elle va droit à l’essentiel, et donne une idée générale très convaincante de ce personnage hors du commun.
Comme le précédent « O Jérusalem », « Cette nuit la liberté » raconte la naissance d’un état. Mais le propos est différent, car l’histoire des deux pays est différente, à tous points de vue, dimension territoriale, dimension historique, dimension politique, dimension religieuse… C’est à une tâche colossale que se sont livrés Dominique Lapierre et Larry Collins. En 1946-1948, dates où se place le récit, l’Inde est un pays de contrastes : l’Inde anglaise et l’Inde des maharadjahs, l’Inde riche et l’Inde pauvre, l’Inde hindoue et l’Inde musulmane… Et pour nos deux enquêteurs il y a contraste aussi entre l’Inde qu’ils étudient (antérieure de près de trente ans) et celle dans laquelle ils vivent au moment de leur enquête, l’Inde indépendante et partagée avec le Pakistan et le Bangladesh. C’est surtout le pays de la démesure : le pays de quatre cents millions d’habitants qui aspirent à la liberté. Après la Chine, c’est le pays le plus peuplé du monde, et celui qui représente la plus grande diversité de populations, et le plus grand écart entre ces différentes populations, accentué par un système de castes sociales très rigide, et bien entendu par les antagonismes religieux. Dans ces conditions, comment parler d’indépendance, comment unifier cet univers morcelé, comment arriver à donner une âme commune à ces quatre cents millions d’êtres que tout sépare ? Qui pourrait incarner cette espérance et la mener à bien ? Cet homme existe. Il s’appelle Mahandas Karamchand Gandhi, ou tout simplement Gandhi, ou Bapu (père), et très vite Mahatma (grande âme), au vu de ses qualités morales hors du commun : déjà célèbre pour ses combats (pacifistes) pour la dignité humaine, la justice sociale, apôtre de la non-violence, guide spirituel de tout un continent, il s’est trouvé tout naturellement à la tête du combat pour l’indépendance, avec ses principaux adjoints, Nehru, séduisant et pragmatique, et Jinnah, qui représente la partie musulmane de la population. A partir de là, c’est de l’Histoire : les grandes marches de protestation, les grèves de la faim, les palabres sans fin avec les Anglais, l’indépendance au bout du compte (15 août 1947), la partition du pays en deux états (Inde hindoue et Pakistan musulman, l’immense exode entre les deux communautés, les dérapages en guerre civile, et finalement l’assassinat de Gandhi le 30 janvier 1948 par Nathuram Godse, un nationaliste exalté qui reprochait à Gandhi la partition du pays.
C’est plus qu’une page d’Histoire qui est ici décrite par Lapierre et Collins, c’est une véritable épopée tragique et somptueuse dans un cadre difficile à imaginer pour qui ne connaît pas la dimension à la fois territoriale et culturelle de ce pays, sans parler du foisonnement de son Histoire. Le tour de force des auteurs est de restituer la grandeur de l’Inde dans toutes ses contradictions, de montrer le cheminement lent et difficile vers une indépendance qui, on le sait dès le départ, n’aura pas que des avantages, et risque de tourner à la tragédie, de faire le portrait de ces personnages devenus mythiques que sont Gandhi (un saint laïc comme Martin Luther King, doublé d’un éminent homme politique) Nehru et Jinnah, avec leurs convictions parfois réprouvées, mais animés d’un réel amour pour leur pays, chacun à sa façon, et aussi lord et lady Mountbatten, qui jouent la partie « anglaise », en essayant de limiter les dégâts au maximum.
Par leur sens du récit, la somme ahurissante des documents qu’ils ont amassés, par la restitution minutieuse, vivante et captivante qu’ils en ont fait, Dominique Lapierre et Larry Collins ont écrit un chef d’œuvre non pas de compte rendu historique, mais de tout un pan d’Histoire rendu à la dimension humaine. Un document exceptionnel que tout amateur d’Histoire (de cette Histoire-là en tous cas) se doit de connaître.
Deux conseils pour compléter cette lecture :
Le film « Gandhi » de Richard Attenborough (1982) a fait l’unanimité pour la fidélité historique au personnage ainsi qu’à son parcours, autant que pour la réalisation l’interprétation (extraordinaire Ben Kingsley) et toute la partie technique. Les évènements racontés dans « Cette nuit la liberté » sont restitués avec une rare authenticité.
Dans toute la bibliographie consacrée au Mahatma, j’ai particulièrement apprécié celle réalisée par Christine Jordis « Gandhi », dans la (très conseillée) collection « Biographies-Gallimard » (2006) : simple et pratique, elle va droit à l’essentiel, et donne une idée générale très convaincante de ce personnage hors du commun.
Les deux auteurs sont des specialistes du roman historique avec des titres légendaires et ce roman qui retrace la vie de Gandhi et la lutte pour l'independance de l'inde est un page turner qui se devore dn un clin d'oeuil.L'actualite avec le deces d'Elisabeth 2 remet des personnages de ce livre sur le devant de la scene,l'Inde ayant ete une colonie britannique pendant tres longtemps.Un superbe livre a decouvrir.
Grande aventure de Dominique Lapierre dans sa jeunesse à travers l'URSS du temps de Krouchtchev. Des contacts surveillés avec les gens du peuple russe, de nombreuses analyses par l'auteur de chaque instant vécu derrière le rideau de fer, le livre foisonne d'anecdotes sous la belle plume de Lapierre plus connu pour ses best sellers, mais ce livre moins célèbre vaut vraiment le détour.
Ils sont partis, Dominique Lapierre et Jean-Pierre Pedrazzini, accompagnés de leurs épouses, il y a bien longtemps, dans les annnées Krouchtchev, en 1956, pour 13 000 kilomètres en URSS, minis de toutes les autorisations nécessaires, surtout celle du Premier Secrétaire du Parti.
Leur voyage est un tissu de rencontres saisissantes, des plus humbles jusqu’à Krouchtchev lui-même, des jeunes, des vieux, des russes de l’époque, écrasés sous le joug d’un système qui leur donnait à cette époque l’illusion d’une légère émancipation.
Ils ont certainement vu ce que l’on a bien voulu leur laisser voir, ils ont échangé avec les gens, mais n’ont sûrement pas pénétré le coeur du système soviétique.
Leur livre constitue un récit intéressant. Je préfère néanmoins les autres oeuvres de Lapierre, particulièrement lorsqu’il écrivait en partenariat avec Larry Collins.
Ils sont partis, Dominique Lapierre et Jean-Pierre Pedrazzini, accompagnés de leurs épouses, il y a bien longtemps, dans les annnées Krouchtchev, en 1956, pour 13 000 kilomètres en URSS, minis de toutes les autorisations nécessaires, surtout celle du Premier Secrétaire du Parti.
Leur voyage est un tissu de rencontres saisissantes, des plus humbles jusqu’à Krouchtchev lui-même, des jeunes, des vieux, des russes de l’époque, écrasés sous le joug d’un système qui leur donnait à cette époque l’illusion d’une légère émancipation.
Ils ont certainement vu ce que l’on a bien voulu leur laisser voir, ils ont échangé avec les gens, mais n’ont sûrement pas pénétré le coeur du système soviétique.
Leur livre constitue un récit intéressant. Je préfère néanmoins les autres oeuvres de Lapierre, particulièrement lorsqu’il écrivait en partenariat avec Larry Collins.
Avant d’entamer le début du commencement des prémices de la mise en place de la présentation de cette chronique, il convient de faire deux ou trois précisions, et tout particulièrement de dire ce que n’est pas « … Ou tu porteras mon deuil » (ou plus exactement, ce qu’il n’est qu’en partie). Ce récit (ni un roman, ni un essai historique) n’est pas une « histoire de la Guerre d’Espagne » ni une « histoire de l’Espagne au XXème siècle » même si cette période (1936-1968) en constitue le décor, et même en détermine les épisodes particuliers. Ce n’est pas non plus, à proprement parler, une biographie d’El Cordobès, puisque l’intéressé est toujours de ce monde (2022), disons que c’est une évocation visant à expliquer la naissance d’une vocation et son épanouissement dans un contexte historique spécifique, le second expliquant en grande partie la première. Enfin, ce n’est pas un livre sur la corrida. Si El Cordobès avait fait sa fortune dans un autre domaine, le problème aurait été le même, il s’agit de la réussite d’un homme dans un art particulier (si on peut dire que la corrida est un art), quelle que soit l’activité choisie. D’ailleurs les auteurs, intelligemment, ne prennent pas parti quand ils évoquent ce monument de la culture hispanique : s’ils en saluent la beauté formelle, et les valeurs de courage qui l’accompagnent, ils en soulignent également la cruauté et la souffrance des animaux.
Ces quelques mises au point effectuées, vamonos !
Au moment (1968) où ce récit est publié, le franquisme est toujours tout puissant en Espagne. Franco lui-même est aux commandes pour encore sept ans. Les évènements racontés dans le livre sont encore tous frais dans les souvenirs (y compris pour nous, français, et particulièrement les frontaliers pyrénéens). Parmi mes voisins, mes amis et mes copains de classe, beaucoup étaient des réfugiés républicains qui avaient passé la frontière pendant et après la Guerre civile, pour fuir les geôles du Caudillo. Et par ailleurs, El Cordobès était venu souvent toréer dans les arènes du Sud de la France.
Manuel Benitez Perez est né en 1936 à Palma del Rio (près de Cordoue). Il n’aura pas à chercher bien loin pour trouver un nom de torero : « El Cordobès » signifie « Le Cordouan ». Très tôt, il perd sa mère, morte d’épuisement, puis son père, mort en prison de tuberculose et des suites de la guerre. L’enfance, misérable, se déroule entre pauvreté, famine, exploitation par les riches propriétaires terriens, et persécutions de la part des autorités, la violence fait partie du quotidien. L’échappatoire, pour Manuel, est dans la corrida : le sport national, il y voit conjugués son amour des taureaux et ses rêves de gloire. Le récit raconte tout son parcours : des modestes cours où il s’exrece à toréer aux plus grandes arènes du monde entier. Le petit Manuel, devient le grand El Cordobès, le cinquième calife (le top 5 des toreros de l’Histoire : il fait suite à Lagartijo, Guerrita, Machaquito et le légendaire Manolete, je dis ça pour faire mon intéressant devant les aficionados).
« Ou tu porteras mon deuil », c’est ce que dit Manuel à sa sœur Angelita, le 20 mai 1964, le jour de la confirmation de son alternative : « Ne pleure pas, ce soir, je t’achèterai une maison ou tu porteras mon deuil ».
Au-delà du récit purement personnel, les auteurs ont voulu montrer une destinée individuelle, celle d’une icône du XXème siècle, et plus encore, le triomphe de la volonté sur l’adversité. Bien sûr, ce n’est pas une hagiographie, El Cordobès a sûrement des zones d’ombre, mais son parcours, s’il n’est pas explicitement exemplaire, est symbolique d’une « carrière » comme on voit peu, de la construction d’une légende.
Ce genre de récit, et celui-là particulièrement, est conseillé à tous : amateurs d’Histoire, adeptes de la peoplemania (eh oui, El Cordobès, était l’équivalent des Beatles, et à la même époque !), aficionados de ce bel art de la corrida ou ennemis de cette boucherie organisée (je vous laisse choisir), ou simplement curieux de bonne curiosité, vous serez subjugués par cette histoire racontée de main de maître, puisée aux sources mêmes de ceux et celles qui en ont été et sont encore les acteurs.
Ces quelques mises au point effectuées, vamonos !
Au moment (1968) où ce récit est publié, le franquisme est toujours tout puissant en Espagne. Franco lui-même est aux commandes pour encore sept ans. Les évènements racontés dans le livre sont encore tous frais dans les souvenirs (y compris pour nous, français, et particulièrement les frontaliers pyrénéens). Parmi mes voisins, mes amis et mes copains de classe, beaucoup étaient des réfugiés républicains qui avaient passé la frontière pendant et après la Guerre civile, pour fuir les geôles du Caudillo. Et par ailleurs, El Cordobès était venu souvent toréer dans les arènes du Sud de la France.
Manuel Benitez Perez est né en 1936 à Palma del Rio (près de Cordoue). Il n’aura pas à chercher bien loin pour trouver un nom de torero : « El Cordobès » signifie « Le Cordouan ». Très tôt, il perd sa mère, morte d’épuisement, puis son père, mort en prison de tuberculose et des suites de la guerre. L’enfance, misérable, se déroule entre pauvreté, famine, exploitation par les riches propriétaires terriens, et persécutions de la part des autorités, la violence fait partie du quotidien. L’échappatoire, pour Manuel, est dans la corrida : le sport national, il y voit conjugués son amour des taureaux et ses rêves de gloire. Le récit raconte tout son parcours : des modestes cours où il s’exrece à toréer aux plus grandes arènes du monde entier. Le petit Manuel, devient le grand El Cordobès, le cinquième calife (le top 5 des toreros de l’Histoire : il fait suite à Lagartijo, Guerrita, Machaquito et le légendaire Manolete, je dis ça pour faire mon intéressant devant les aficionados).
« Ou tu porteras mon deuil », c’est ce que dit Manuel à sa sœur Angelita, le 20 mai 1964, le jour de la confirmation de son alternative : « Ne pleure pas, ce soir, je t’achèterai une maison ou tu porteras mon deuil ».
Au-delà du récit purement personnel, les auteurs ont voulu montrer une destinée individuelle, celle d’une icône du XXème siècle, et plus encore, le triomphe de la volonté sur l’adversité. Bien sûr, ce n’est pas une hagiographie, El Cordobès a sûrement des zones d’ombre, mais son parcours, s’il n’est pas explicitement exemplaire, est symbolique d’une « carrière » comme on voit peu, de la construction d’une légende.
Ce genre de récit, et celui-là particulièrement, est conseillé à tous : amateurs d’Histoire, adeptes de la peoplemania (eh oui, El Cordobès, était l’équivalent des Beatles, et à la même époque !), aficionados de ce bel art de la corrida ou ennemis de cette boucherie organisée (je vous laisse choisir), ou simplement curieux de bonne curiosité, vous serez subjugués par cette histoire racontée de main de maître, puisée aux sources mêmes de ceux et celles qui en ont été et sont encore les acteurs.
Entre le travail d'historien, le compte rendu journalistique et le récit romancé, est né un nouveau genre audiovisuel et littéraire la "docufiction", qui consiste à présenter sous une forme de fiction un évènement historique parfaitement référencé et documenté.
Dominique Lapierre (né en 1931) et Larry Collins (1929-2005) sont des précurseurs de cet exercice : "Paris brûle-t-il", sur la libération de Paris, "Ou tu porteras mon deuil " sur la vie d’El Cordobès et la Guerre d’Espagne, "O Jérusalem " sur la naissance d’Israël, et "Cette nuit la liberté " sur Gandhi et la naissance de l’Inde moderne. A quoi il convient d'ajouter deux chefs-d’œuvre individuels : pour le premier "La cité de la joie ", un reportage bouleversant sur les bidonvilles de Calcutta, pour le second "Fortitude ", un roman sur fond historique, (le leurre concernant l’endroit exact du débarquement).
"Paris brûle-t-il" relate la libération de Paris le 25 août 1944. En exergue du récit, les auteurs produisent un ordre ultra secret et ultra urgent, émanant du Grand Quartier Général de Hitler, en date du 23 août 1944, et adressé à tous les chefs d'Etat-major sur le territoire français.
"... Dans l'Histoire, la perte de Paris a toujours entraîné jusqu'ici la perte de toute la France... Paris ne doit pas tomber aux mains de l'ennemi, ou l'ennemi ne doit trouver qu'un champ de ruines..."
Lapierre et Collins nous racontent comment, dans ces jours dramatiques, des hommes et des femmes ont tout mis en œuvre pour que l'exécution de cet ordre ne soit pas possible, comment les Allemands ont réagi, comment les Alliés ont dû négocier pour faire coïncider les insurrections dans Paris avec l'arrivée des Américains, et celle de la 2ème DB de Leclerc, enfin comment les Parisiens ont libéré Paris.
"Paris ! Paris outragé ! Paris brisé ! Paris martyrisé ! mais Paris libéré ! Libéré par lui-même, libéré par son peuple avec le concours des armées de la France, avec l'appui et le concours de la France tout entière, de la France qui se bat, de la seule France, de la vraie France, de la France éternelle". (discours du Général De Gaulle le 25 août 1944)
Des années d'enquête, des milliers de témoins interrogés, des plus humbles aux plus célèbres, des tonnes d'archives, françaises, allemandes, anglaises ou américaines consultées, des kilomètres de microfilms déchiffrés...
Une mise en page exceptionnelle dans un style clair, accessible et passionnée, laissant facilement la place à l'anecdote, sans perdre de vue le moment historique...
Le tout donne un modèle d'Histoire didactique, toujours intéressant et captivant, jamais rébarbatif, mettant en lumière aussi bien les grands personnages que les plus humbles, montrant l'héroïsme et la solidarité des résistants (toutes origines confondues)...
Un roman qui parle d'Histoire... Une page d'Histoire qui se lit comme un roman...
Dominique Lapierre (né en 1931) et Larry Collins (1929-2005) sont des précurseurs de cet exercice : "Paris brûle-t-il", sur la libération de Paris, "Ou tu porteras mon deuil " sur la vie d’El Cordobès et la Guerre d’Espagne, "O Jérusalem " sur la naissance d’Israël, et "Cette nuit la liberté " sur Gandhi et la naissance de l’Inde moderne. A quoi il convient d'ajouter deux chefs-d’œuvre individuels : pour le premier "La cité de la joie ", un reportage bouleversant sur les bidonvilles de Calcutta, pour le second "Fortitude ", un roman sur fond historique, (le leurre concernant l’endroit exact du débarquement).
"Paris brûle-t-il" relate la libération de Paris le 25 août 1944. En exergue du récit, les auteurs produisent un ordre ultra secret et ultra urgent, émanant du Grand Quartier Général de Hitler, en date du 23 août 1944, et adressé à tous les chefs d'Etat-major sur le territoire français.
"... Dans l'Histoire, la perte de Paris a toujours entraîné jusqu'ici la perte de toute la France... Paris ne doit pas tomber aux mains de l'ennemi, ou l'ennemi ne doit trouver qu'un champ de ruines..."
Lapierre et Collins nous racontent comment, dans ces jours dramatiques, des hommes et des femmes ont tout mis en œuvre pour que l'exécution de cet ordre ne soit pas possible, comment les Allemands ont réagi, comment les Alliés ont dû négocier pour faire coïncider les insurrections dans Paris avec l'arrivée des Américains, et celle de la 2ème DB de Leclerc, enfin comment les Parisiens ont libéré Paris.
"Paris ! Paris outragé ! Paris brisé ! Paris martyrisé ! mais Paris libéré ! Libéré par lui-même, libéré par son peuple avec le concours des armées de la France, avec l'appui et le concours de la France tout entière, de la France qui se bat, de la seule France, de la vraie France, de la France éternelle". (discours du Général De Gaulle le 25 août 1944)
Des années d'enquête, des milliers de témoins interrogés, des plus humbles aux plus célèbres, des tonnes d'archives, françaises, allemandes, anglaises ou américaines consultées, des kilomètres de microfilms déchiffrés...
Une mise en page exceptionnelle dans un style clair, accessible et passionnée, laissant facilement la place à l'anecdote, sans perdre de vue le moment historique...
Le tout donne un modèle d'Histoire didactique, toujours intéressant et captivant, jamais rébarbatif, mettant en lumière aussi bien les grands personnages que les plus humbles, montrant l'héroïsme et la solidarité des résistants (toutes origines confondues)...
Un roman qui parle d'Histoire... Une page d'Histoire qui se lit comme un roman...
R.Laffont, l'éditeur, vient de rééditer cet ouvrage remarquable et salué par la critique depuis sa parution, mais en occultant le nom du Cordobès et les termes tauromachiques, ainsi qu'ne ajoutant un sous-titre trompeur. Cela s'appelle la censure, et s'apparente au révisionnisme ayant cours dans toute dictature qui se respecte. Laffont, lui, ne respecte ni les auteurs, ni les lecteurs.
R.Laffont, l'éditeur, vient de rééditer cet ouvrage remarquable et salué par la critique depuis sa parution, mais en occultant le nom du Cordobès et les termes tauromachiques, ainsi qu'ne ajoutant un sous-titre trompeur. Cela s'appelle la censure, et s'apparente au révisionnisme ayant cours dans toute dictature qui se respecte. Laffont, lui, ne respecte ni les auteurs, ni les lecteurs.
Désireux de partager la souffrance des plus démunis, un prêtre français part pour Calcutta. Les premiers jours sont difficiles…. La vie dans un bidonville n'’a rien de commun avec celle que connaît l’'occidental au grand cœur. Il lui faudra du temps pour comprendre et apprécier les coutumes de ce pays. Mais la gentillesse et le dévouement des habitants de la cité de la joie l’'aideront à s'’adapter à sa nouvelle vie.
Ce roman est tout simplement prodigieux ! L’'écriture, le style de les descriptions entraînent le lecteur dans cet univers si exotique qu'’est l’'Inde… sans jamais l’'ennuyer. Les personnages sont incarnés de façon admirable. L'’émotion qui se dégage de l’œ'oeuvre est incomparable… et surprenante. En effet, l’'auteur réussit à nous émouvoir plus souvent par les joies que par les douleurs endurées par ces héros peu ordinaires.
Dominique Lapierre met tout son talent au service des merveilles et des souffrances indiennes. Ce chef d’œ'oeuvre m’'a énormément plu et beaucoup marquée. On ne ressort pas indemne de cette lecture.
Ce roman est tout simplement prodigieux ! L’'écriture, le style de les descriptions entraînent le lecteur dans cet univers si exotique qu'’est l’'Inde… sans jamais l’'ennuyer. Les personnages sont incarnés de façon admirable. L'’émotion qui se dégage de l’œ'oeuvre est incomparable… et surprenante. En effet, l’'auteur réussit à nous émouvoir plus souvent par les joies que par les douleurs endurées par ces héros peu ordinaires.
Dominique Lapierre met tout son talent au service des merveilles et des souffrances indiennes. Ce chef d’œ'oeuvre m’'a énormément plu et beaucoup marquée. On ne ressort pas indemne de cette lecture.
Pour une immersion complète dans ce pays de lumière et de traditions qu’est l’Espagne, comme je partais en Andalousie, j’ai lu en même temps cet extraordinaire document relatant l’histoire du non moins extraordinaire torero « El Cordobés », histoire liée intimement à celle de l’Espagne depuis 1936.
Le récit commence à la naissance de Manuel Benitez, en 1936. L’Espagne à ce moment connait des heures très sombres, la presque totalité des Espagnols ploie sous la pauvreté extrême à cause de quelques propriétaires terriens se croyant encore au Moyen-Age. Horrifiée par une description sans filtre de cette vie de travail non-stop et de faim perpétuelle, j’ai suivi l’enfance et l’adolescence de Manuel obsédé par les « toros » et le désir absolu de devenir riche grâce à eux. Parcours semé d’embûches, de blessures, de bastonnades : on ne rigolait pas au temps de Franco ! Devenir torero était pour lui, sans éducation, illettré, orphelin de mère très jeune et de père un peu plus tard, la seule façon d’accéder à cette vie dont il rêvait, d’autant plus que Manuel est doté d’un courage hors du commun.
Il arrivera à ses fins et deviendra « El Cordobés », adulé pour les émotions intenses qu’il suscite à chaque corrida.
Subjuguée ! J’ai été totalement subjuguée par cette façon de raconter, vivante, ultra documentée, avec des témoignages réels et intimes. L’histoire de l’Espagne est très bien expliquée, la vie privée et publique d’El Cordobés également. J’ai vibré de ce désir de « toros », moi qui déteste la corrida !
Les deux auteurs ont approché de très près le fameux torero, sa famille, ses amis, ses managers, le médecin, le curé, ainsi que tous ceux qui font d’une corrida ce qu’elle est. Chaque métier est incarné par une personne réelle. Tout est décortiqué avec passion mais de façon objective.
« Je t’achèterai une maison, ou tu porteras mon deuil », a dit Manuel à sa sœur avant la corrida qui devait faire de lui un héros national.
Un immense bravo pour ce récit où la pauvreté est intimement liée au désir de s’élever par la corrida et d’offrir à tous une vie plus décente.
Le récit commence à la naissance de Manuel Benitez, en 1936. L’Espagne à ce moment connait des heures très sombres, la presque totalité des Espagnols ploie sous la pauvreté extrême à cause de quelques propriétaires terriens se croyant encore au Moyen-Age. Horrifiée par une description sans filtre de cette vie de travail non-stop et de faim perpétuelle, j’ai suivi l’enfance et l’adolescence de Manuel obsédé par les « toros » et le désir absolu de devenir riche grâce à eux. Parcours semé d’embûches, de blessures, de bastonnades : on ne rigolait pas au temps de Franco ! Devenir torero était pour lui, sans éducation, illettré, orphelin de mère très jeune et de père un peu plus tard, la seule façon d’accéder à cette vie dont il rêvait, d’autant plus que Manuel est doté d’un courage hors du commun.
Il arrivera à ses fins et deviendra « El Cordobés », adulé pour les émotions intenses qu’il suscite à chaque corrida.
Subjuguée ! J’ai été totalement subjuguée par cette façon de raconter, vivante, ultra documentée, avec des témoignages réels et intimes. L’histoire de l’Espagne est très bien expliquée, la vie privée et publique d’El Cordobés également. J’ai vibré de ce désir de « toros », moi qui déteste la corrida !
Les deux auteurs ont approché de très près le fameux torero, sa famille, ses amis, ses managers, le médecin, le curé, ainsi que tous ceux qui font d’une corrida ce qu’elle est. Chaque métier est incarné par une personne réelle. Tout est décortiqué avec passion mais de façon objective.
« Je t’achèterai une maison, ou tu porteras mon deuil », a dit Manuel à sa sœur avant la corrida qui devait faire de lui un héros national.
Un immense bravo pour ce récit où la pauvreté est intimement liée au désir de s’élever par la corrida et d’offrir à tous une vie plus décente.
Je me souviens un cours de droit de l’environnement, à l’Université Toulouse 1 : « Après la catastrophe industrielle de Bhopal de 1984 qui fit… puis AZF en 2001… le législateur modifia la loi… ». C’est tout.
Dominique Lapierre et Javier Moro ont mené des recherches pour nous présenter la genèse de cette fuite de gaz dans une usine de pesticide, dans la nuit du 2 au 3 décembre 1984, qui provoqua la mort officielle 3828 personnes (le chiffre exact se situe entre 15000-30000) et 500 000 blessés.
Pourquoi une telle catastrophe ?
La mégalomanie de certains ingénieurs américains qui imaginaient écouler d’énormes quantités de pesticides sans tenir compte des aléas climatiques : en période de grande sécheresse, pas un paysan n’achetait de l’insecticide.
Le stockage en énormes quantités d’isocyanate de méthyle, ce qui avait affolé des ingénieurs allemands et français consultés en amont.
La logique financière qui pousse à des économies dérisoires, au mépris des règles élémentaires de sécurité, quand l’usine n’était pas rentable.
La désinvolture de nombreux ouvriers, contremaîtres et chefs, peu familiarisés par l’importance des règles de sécurité.
Et bien sûr, comme dans tout accident : l’absence en même temps du fonctionnement des mesures de sécurité. Une seule d’entre elle, en fonctionnement, aurait évité le pire.
Si certaines pages ont pu me paraître longues ou techniques, si la catastrophe proprement dite n’occupe que la fin du livre, vous l’aurez compris, ce livre est une mine d’informations. Un livre à offrir à tous ceux qui s’intéressent à l’Inde, à l’environnement et à l’industrie.
Lien : https://benjaminaudoye.com/2..
Dominique Lapierre et Javier Moro ont mené des recherches pour nous présenter la genèse de cette fuite de gaz dans une usine de pesticide, dans la nuit du 2 au 3 décembre 1984, qui provoqua la mort officielle 3828 personnes (le chiffre exact se situe entre 15000-30000) et 500 000 blessés.
Pourquoi une telle catastrophe ?
La mégalomanie de certains ingénieurs américains qui imaginaient écouler d’énormes quantités de pesticides sans tenir compte des aléas climatiques : en période de grande sécheresse, pas un paysan n’achetait de l’insecticide.
Le stockage en énormes quantités d’isocyanate de méthyle, ce qui avait affolé des ingénieurs allemands et français consultés en amont.
La logique financière qui pousse à des économies dérisoires, au mépris des règles élémentaires de sécurité, quand l’usine n’était pas rentable.
La désinvolture de nombreux ouvriers, contremaîtres et chefs, peu familiarisés par l’importance des règles de sécurité.
Et bien sûr, comme dans tout accident : l’absence en même temps du fonctionnement des mesures de sécurité. Une seule d’entre elle, en fonctionnement, aurait évité le pire.
Si certaines pages ont pu me paraître longues ou techniques, si la catastrophe proprement dite n’occupe que la fin du livre, vous l’aurez compris, ce livre est une mine d’informations. Un livre à offrir à tous ceux qui s’intéressent à l’Inde, à l’environnement et à l’industrie.
Lien : https://benjaminaudoye.com/2..
Une longue page de l’histoire indienne qui se lit comme un roman. Cette façon de raconter, ménageant une place importante à des personnages secondaires mais représentatifs, à des descriptions des lieux et de l’ambiance, à l’humanité des hommes politiques, présente l’avantage d’être très vivante. Ce n’est pas seulement un chapitre d’un livre d’histoire, mais une aventure passionnante que nous déroulent les auteurs sur la base d’une documentation sérieuse. Que demander de plus?
Quelle fresque historique, cadeau de mon amie avant mon départ en Inde. Une mine d'informations sur l'indépendance : Gandhi, Nehru, Mountbatten, Ali Jinnah. Même sans aimer l'histoire, comment rester insensible à la partition des Indes ? Un livre indispensable pour tous les amoureux de l'Inde et ceux qui veulent impressionner leur beau-frère polytechnicien. Il est intéressant de voir aussi après le film Gandhi de 1983.
En 1992, j’ai vu le film et j’ai lu le livre. J’avais 10 ans. L’ai-je vraiment lu ? Je me rappelle l’avoir eu entre mes mains, lu quelques pages, mais suis-je allé au bout ? Je n’ai pas pu tout comprendre, il se peut que je l’aie lu avec mon regard d’enfant. J’ai sûrement saisi l’essentiel : un prêtre français, un Indien tireur de rickshaw et un médecin américain arrive dans ce quartier où règne la grande misère. Le religieux veut ressentir toute sa foi, épurée des conditions matérielles. L’Indien doit nourrir sa famille après avoir dû quitter ses terres. Le médecin cherche à vivre une forte expérience avant de rejoindre sa vie dorée à Miami.
Trente ans plus tard, je le relis. L’Inde a changé et moi aussi. Certains reprochent à ce livre d’être misérabiliste et d’avoir donné une mauvaise image de l’Inde. Dominique Lapierre en est conscient et avertit le lecteur.
De toute manière, est-ce la faute d’un auteur si des lecteurs extrapolent ? Un livre sur la France rurale n’aurait rien à voir avec celle des banlieues, et pourtant c’est la France. Il faut méconnaître l’Inde pour croire que l’Inde de Calcutta des années 1970 représente Calcutta en 2020 et a fortiori, le reste de l’Inde qui est un sous-continent, vaste et complexe. Je n’ai connu qu’une goutte d’eau de l’océan Indien, comme professeur dans un collège huppé, et toute une vie ne suffirait pas. Toutefois, j’ai été ravi de retrouver les méandres de l’Administration indienne « Please, sit », « Have a tea », « tomorrow ». Et La Cité de la joie prouve encore que les Indiens acceptent toutes les religions ou les sectes. Le pire semble pour eux l’absence de religion.
Ce livre, loin d’avoir mal vieilli, reste un livre catholique, je veux dire par là « universel » (katholikos = universel en grec). Oui, Dominique Lapierre croit surement en Dieu. Jean-Paul II trouvait que ce livre est « une leçon d’espoir et de foi pour le monde ». L’auteur s’est inspiré de deux religieux occidentaux pour créer le personnage du prêtre. J’imagine bien que ces hommes en prêchant la bonne parole ont converti des Indiens. Il ne l’écrit pas dans le livre, au contraire, car cela rendrait le prêtre agaçant.
Le style de Dominique Lapierre se montre toujours aussi clair et précis. Un point particulier : il sait restituer des monologues, des témoignages, en les insérant dans le texte, avec juste des guillemets français « » puis des guillemets anglais « » pour un dialogue à l’intérieur.
Gandhi aurait aimé ce livre pour la tolérance, l’amour, la simplicité qu’il prône, sans être naïf. Ce qui doit énerver certains est qu’un aussi bel ouvrage soit le fruit d’un Occidental, suivant le créneau de « Les Indiens écrivent mieux sur leur propre pays ». Avec un tel raisonnement, Patrick Süskind n’aurait pas pu offrir son chef-d’œuvre, Le Parfum.
40 millions d’exemplaires vendus pour La Cité de la joie et il ne cessera jamais d’être lu.
Lien : https://benjaminaudoye.com/2..
Trente ans plus tard, je le relis. L’Inde a changé et moi aussi. Certains reprochent à ce livre d’être misérabiliste et d’avoir donné une mauvaise image de l’Inde. Dominique Lapierre en est conscient et avertit le lecteur.
De toute manière, est-ce la faute d’un auteur si des lecteurs extrapolent ? Un livre sur la France rurale n’aurait rien à voir avec celle des banlieues, et pourtant c’est la France. Il faut méconnaître l’Inde pour croire que l’Inde de Calcutta des années 1970 représente Calcutta en 2020 et a fortiori, le reste de l’Inde qui est un sous-continent, vaste et complexe. Je n’ai connu qu’une goutte d’eau de l’océan Indien, comme professeur dans un collège huppé, et toute une vie ne suffirait pas. Toutefois, j’ai été ravi de retrouver les méandres de l’Administration indienne « Please, sit », « Have a tea », « tomorrow ». Et La Cité de la joie prouve encore que les Indiens acceptent toutes les religions ou les sectes. Le pire semble pour eux l’absence de religion.
Ce livre, loin d’avoir mal vieilli, reste un livre catholique, je veux dire par là « universel » (katholikos = universel en grec). Oui, Dominique Lapierre croit surement en Dieu. Jean-Paul II trouvait que ce livre est « une leçon d’espoir et de foi pour le monde ». L’auteur s’est inspiré de deux religieux occidentaux pour créer le personnage du prêtre. J’imagine bien que ces hommes en prêchant la bonne parole ont converti des Indiens. Il ne l’écrit pas dans le livre, au contraire, car cela rendrait le prêtre agaçant.
Le style de Dominique Lapierre se montre toujours aussi clair et précis. Un point particulier : il sait restituer des monologues, des témoignages, en les insérant dans le texte, avec juste des guillemets français « » puis des guillemets anglais « » pour un dialogue à l’intérieur.
Gandhi aurait aimé ce livre pour la tolérance, l’amour, la simplicité qu’il prône, sans être naïf. Ce qui doit énerver certains est qu’un aussi bel ouvrage soit le fruit d’un Occidental, suivant le créneau de « Les Indiens écrivent mieux sur leur propre pays ». Avec un tel raisonnement, Patrick Süskind n’aurait pas pu offrir son chef-d’œuvre, Le Parfum.
40 millions d’exemplaires vendus pour La Cité de la joie et il ne cessera jamais d’être lu.
Lien : https://benjaminaudoye.com/2..
Un roman historique qui a nécessité 3 ans d'enquête aux deux journalistes. Près de 3000 personnes interrogées dans le monde. Un travail gigantesque couché sur papier avec une succession d'anecdotes plus ou moins dramatiques. Un docu-fiction avant l'heure. Les auteurs vous racontent la libération de Paris à hauteur d'homme.
Un livre de grande valeur pour ces témoignages récoltés seulement 20 ans après les faits qui mêle astucieusement la petite et la grande histoire.
À lire quand on s'intéresse à cette période sombre de la France.
Un livre de grande valeur pour ces témoignages récoltés seulement 20 ans après les faits qui mêle astucieusement la petite et la grande histoire.
À lire quand on s'intéresse à cette période sombre de la France.
Un travail exceptionnel de documentation !
Un documentaire écrit de 820 pages qui se lit comme un roman grâce au talent des auteurs Lapierre et Collins.
indispensable récit pour comprendre cette guerre interminable.
Je termine cette lecture éclairée mais un poil abattue … Ce conflit, si il n'a plus l'intensité de l'époque est toujours d'actualité et au vue de sa génèse , la solution n'est pas pour demain !
Un documentaire écrit de 820 pages qui se lit comme un roman grâce au talent des auteurs Lapierre et Collins.
indispensable récit pour comprendre cette guerre interminable.
Je termine cette lecture éclairée mais un poil abattue … Ce conflit, si il n'a plus l'intensité de l'époque est toujours d'actualité et au vue de sa génèse , la solution n'est pas pour demain !
Quelle fresque !
Un de mes livres de chevet étant Plus grands que l'amour, des mêmes auteurs, je souhaitais lire un autre de leurs ouvrages depuis plusieurs années
Au détour d'une boite à livres j'ai saisi l'occasion, et je me suis lancée dans Cette nuit la liberté.
Au début, je l'avoue, j'ai eu un peu de mal à entrer dans le livre. Mais j'ai fini par me laisser emporter par l'histoire incroyable de l'indépendance de l'Inde et de ses principaux protagonistes. Assez ignorante jusqu'ici de ce volet de l'Histoire, j'ai pu apprendre foule de choses au fil des pages.
Le récit est bien écrit, extrêmement documenté. J'apprécie les "petites" histoires qui le jalonnent car ils apportent au lecteur une proximité, une empathie vis à vis du peuple indien, qui manquerait peut-être si les auteurs étaient restés au niveau des dirigeants.
Enfin, coup de chapeau aux auteurs pour le travail de fourmi qu'ils ont accompli, il suffit de lire la liste des remerciements à la fin de l'ouvrage, elle est interminable !
Un de mes livres de chevet étant Plus grands que l'amour, des mêmes auteurs, je souhaitais lire un autre de leurs ouvrages depuis plusieurs années
Au détour d'une boite à livres j'ai saisi l'occasion, et je me suis lancée dans Cette nuit la liberté.
Au début, je l'avoue, j'ai eu un peu de mal à entrer dans le livre. Mais j'ai fini par me laisser emporter par l'histoire incroyable de l'indépendance de l'Inde et de ses principaux protagonistes. Assez ignorante jusqu'ici de ce volet de l'Histoire, j'ai pu apprendre foule de choses au fil des pages.
Le récit est bien écrit, extrêmement documenté. J'apprécie les "petites" histoires qui le jalonnent car ils apportent au lecteur une proximité, une empathie vis à vis du peuple indien, qui manquerait peut-être si les auteurs étaient restés au niveau des dirigeants.
Enfin, coup de chapeau aux auteurs pour le travail de fourmi qu'ils ont accompli, il suffit de lire la liste des remerciements à la fin de l'ouvrage, elle est interminable !
Ce portrait de l'Espagne et plus particulièrement du monde de la corrida, indissociable de ce beau pays est splendide et doit être lu a tout prix ! Que l'on soit afficionado ou simple curieux la description est si bien réussi que vous vous y croirez ! Nitre duo d'auteur nous livre ici pour moi leur meilleur livre, un récit inoubliable a lire absolument.
Ecrit quarante ans après le périple objet du livre, cet exercice sent l'ouvrage de commande devant bénéficier de la notoriété de l'auteur, notoriété acquise, notamment, avec son collègue Collins grâce à leur “Paris brule-t-il ?ˮ. Avant cette publication tardive, des dizaines de récits ont été publiés sur ce thème, autrement dit, ça sent le réchauffé éditorial. Tissus de banalités mainte fois lues, de lieux communs et de clichés, on n'y découvre absolument rien. Mélange de niaiseries et de bisounours. Lecture inutile, il y a beaucoup mieux sur le sujet.
Question subsidiaire : Peut-on imaginer Nicolas Bouvier ou Sylvain Tesson voyager en couple ?........
Question subsidiaire : Peut-on imaginer Nicolas Bouvier ou Sylvain Tesson voyager en couple ?........
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur
Auteurs proches de Dominique Lapierre
Lecteurs de Dominique Lapierre Voir plus
Quiz
Voir plus
La cité de la joie est en pleurs
J'ai commencé ma carrière littéraire très fort, à 18 ans, en payant mes 1000 premiers kilomètres, seulement ...?... nous étions alors en 1949
Un franc
Un dollar
Une peseta
Un real
10 questions
25 lecteurs ont répondu
Thème :
Dominique LapierreCréer un quiz sur cet auteur25 lecteurs ont répondu