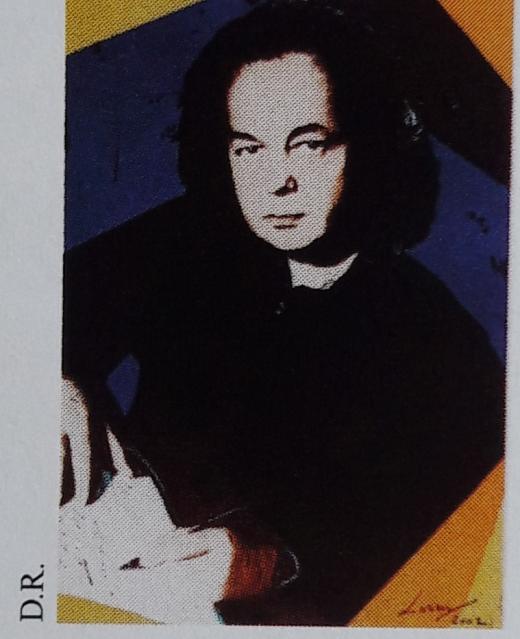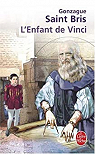Citations de Gonzague Saint Bris (133)
Un tableau allégorique du temps résume parfaitement la portée de l'Edit : on y voit Henri IV, vêtu à la romaine, "s'appuyant sur la Religion pour donner la Paix à la France". Si la Paix tient, comme il se doit, un rameau, la Religion, elle, porte un crucifix, cher aux catholiques, et une Bible, chère aux protestants. Si l'idée de tolérance, quatre siècles plus tard, nous paraît aller de soi et, avec elle, cette spécificité toute française qu'est la laïcité, inventée au début du XXème siècle, force est de constater que ce n'était pas du tout le cas en cette extrême fin du XVIème siècle. On estimait alors qu'il ne pouvait y avoir qu'une seule façon de servir Dieu, que tout le reste était hérésie et que les hérétiques devaient être physiquement éliminés, soit par les voies de la justice ordinaire ou extraordinaire, soit par la guerre. C'est dire le génie novateur du Béarnais qui, brisant net une tradition totalement figée, invente une nouvelle approche de la conscience humaine, qui prépare la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen. La coexistence pacifique doit se substituer progressivement à l'agressive hégémonie de la religion officielle. Au siècle des Lumières, Voltaire ne s'y trompera pas, qui, écrivant "La Henriade", fera d'Henri IV la pierre angulaire de son combat contre le fanatisme.
En proclamant l'édit de Nantes, Henri IV renvoie en quelque sorte Genève et Rome dos à dos, et annonce, avec trois siècles d'avance, la séparation du politique et du religieux, en un mot la laïcisation de l'Etat : c'est au nom des mêmes principes que la IIIème République dotera la France d'une autre longue et pérenne période de paix. Grâce au roi cessent, ce jour-là, les guerres de religion proprement dites ; grâce à lui, femmes, hommes et enfants peuvent à nouveau vivre en paix, sinon dans la fraternité retrouvée, du moins dans le respect de l'autre. Aucun souverain n'était allé aussi loin jusque-là : aucun autre, de son propre consentement tout au moins, n'ira jamais assez loin ! Le pape a beau s'écrier : "On me crucifie !", l'Edit entre en application parce que le roi le veut. L'absolutisme de la monarchie française en sort renforcé : seul le souverain décide de ce qui est bien ou mal, utile ou inutile, juste ou faux. Au reste, même s'il communique impeccablement, Henri ne s'en cache pas, aimant à répéter cet axiome dont ses successeurs feront leur miel : "Un roi n'est responsable qu'à Dieu seul et à sa conscience."
Pages 227-229
En proclamant l'édit de Nantes, Henri IV renvoie en quelque sorte Genève et Rome dos à dos, et annonce, avec trois siècles d'avance, la séparation du politique et du religieux, en un mot la laïcisation de l'Etat : c'est au nom des mêmes principes que la IIIème République dotera la France d'une autre longue et pérenne période de paix. Grâce au roi cessent, ce jour-là, les guerres de religion proprement dites ; grâce à lui, femmes, hommes et enfants peuvent à nouveau vivre en paix, sinon dans la fraternité retrouvée, du moins dans le respect de l'autre. Aucun souverain n'était allé aussi loin jusque-là : aucun autre, de son propre consentement tout au moins, n'ira jamais assez loin ! Le pape a beau s'écrier : "On me crucifie !", l'Edit entre en application parce que le roi le veut. L'absolutisme de la monarchie française en sort renforcé : seul le souverain décide de ce qui est bien ou mal, utile ou inutile, juste ou faux. Au reste, même s'il communique impeccablement, Henri ne s'en cache pas, aimant à répéter cet axiome dont ses successeurs feront leur miel : "Un roi n'est responsable qu'à Dieu seul et à sa conscience."
Pages 227-229
Héros romantique, Henri IV ? Incontestablement, comme l'avaient sans doute perçu les volontaires de l'an II qui, spontanément, s'étaient réunis sous sa statue au Pont-Neuf. Ils avaient fait de ce roi qui fut le dernier à combattre au milieu de ses troupes un symbole du patriotisme. Mais aussi, en termes psychanalytiques, la juste référence au père de la Nation, doux et ferme, dur mais juste, tendre avec ses enfants et impitoyable envers ses ennemis. Drôle mais aussi capable de profondeur, ennemi du gaspillage inutile mais pas du faste nécessaire à l'éclat d'une couronne, provincial invétéré mais imprimant sa griffe à Paris, intelligent mais pragmatique, simple mais avec panache, prudent mais courageux et enfin (qualité suprême chez les Français, contrairement à leurs voisins, surtout anglo-saxons) bon vivant et grand coureur de filles devant l'Eternel. Chez Henri IV, il y a du Louis XI pour la ruse, du François Ier pour le charme, du Louis XIV pour la gloire, du Danton pour la gueule, du Napoléon pour le génie stratégique, mais aussi du De Gaulle pour la réunification de la Nation, toujours menacée par l'ennemi étranger. Au fond, chaque français, qu'il soit monarchiste ou républicain, catholique ou protestant, de droite ou de gauche, se reconnait en lui, parce qu'il a su manier au plus haut degré cet art de la synthèse.
Il incarne, dans l'inconscient collectif de la Nation, l'idée, ou mieux le sentiment que les Français se font du dirigeant idéal, c'est-à-dire d'eux-mêmes, à la manière d'un paradigme. A croire que si, à l'orée du XVIIème siècle, des élections avaient existé, à coup sûr Henri IV eût été élu président de la République. Chez lui on retrouve tout à la fois la virilité de Félix Faure, la bonhomie d'Armand Fallières, la probité de Raymond Poincaré, l'autorité de Charles de Gaulle, l'intelligence de Valéry Giscard d'Estaing, la subtilité de François Mitterrand, la simplicité de Jacques Chirac ou l'énergie de Nicolas Sarkozy, comme si la personnalité de ceux qui ont exercé la magistrature suprême depuis plus d'un siècle devait obligatoirement puiser dans les vertus du plus populaire de nos rois.
Pages 18-19
Il incarne, dans l'inconscient collectif de la Nation, l'idée, ou mieux le sentiment que les Français se font du dirigeant idéal, c'est-à-dire d'eux-mêmes, à la manière d'un paradigme. A croire que si, à l'orée du XVIIème siècle, des élections avaient existé, à coup sûr Henri IV eût été élu président de la République. Chez lui on retrouve tout à la fois la virilité de Félix Faure, la bonhomie d'Armand Fallières, la probité de Raymond Poincaré, l'autorité de Charles de Gaulle, l'intelligence de Valéry Giscard d'Estaing, la subtilité de François Mitterrand, la simplicité de Jacques Chirac ou l'énergie de Nicolas Sarkozy, comme si la personnalité de ceux qui ont exercé la magistrature suprême depuis plus d'un siècle devait obligatoirement puiser dans les vertus du plus populaire de nos rois.
Pages 18-19
Des vagues monumentales balaient le pont, les passagers sont terrorisés. Le navire se couche, puis se relève, craquant de toute sa membrure sous le regard terrifié de l'équipage, qui semble avoir perdu la foi. Le bateau va-t-il sombrer ? Accrochés les uns aux autres, les passagers ont été réunis dans l'entrepont. La peur se lit sur les visages. Soudain, au milieu de tout ce désespoir, une voix s'élève et chante l'Alléluia de Mozart. Les âmes désolées, les corps perdus retrouvent soudainement le secret des vaillants. Ceux qui se voyaient déjà noyés renaissent à la vie. Maria chante, et on n'entend plus que sa voix, cette musique qui fait taire le malheur.
Vous me tenez lieu de tout. Il semble que je doive vous rencontrer, après quoi je serais morte et je vous aimerais encore. Comme c'est beau, l'éternité, en ce cas !
... tiens, voilà trois baisers que je t'envoie, et une demi-feuille en blanc pour que tu en imagines autant que tu voudras.
Lors de mes vagabondages dans les verdures éternelles j’avais l’impression de lire l’univers et la forêt était pour moi la plus belle des bibliothèques
Pointez votre doigt ans le pot de l’histoire et pourléchez- vous des confitures de sang.
Oui, oui, tu le savais, et que, dans cette vie,
Rien n'est bon que d'aimer, n'est vrai que de souffrir.
Chaque soir dans tes chants tu te sentais pâlir.
Tu connaissais le monde, et la foule, et l'envie,
Et, dans ce corps brisé concentrant ton génie,
Tu regardais aussi la Malibran mourir.
Alfred de Musset, "A la Malibran"
Rien n'est bon que d'aimer, n'est vrai que de souffrir.
Chaque soir dans tes chants tu te sentais pâlir.
Tu connaissais le monde, et la foule, et l'envie,
Et, dans ce corps brisé concentrant ton génie,
Tu regardais aussi la Malibran mourir.
Alfred de Musset, "A la Malibran"
Enfant, j’habitais Londres où mon père était un jeune attaché d’ambassade. C’était la vie rêvée. Hyde Park et son allée de fleurs violettes, les musées gratuits où l’on pouvait jouer avec des trains électriques, les magasins de jouets extraordinaires, les cantiques dans la brume, les policemen polis qui ne regardaient pas ma nurse avec insistance. Elle était suisse et s’appelait Nana. Le prince Charles enfant nous faisait parfois des signes du balcon de Buckingham. Je lui répondais. Après tout, nous avions le même âge et on nous coiffait de la même manière : de l’eau sur la tête et la raie sur le côté.
Tout cela aurait pu être une charmante histoire, avec les casquettes bleu et jaune de notre école, la St Philip’s School, les « bats » de cricket, des rues de Londres où l’on jouait avec de petites voitures Dinky Toys contre les murs gris en se salissant les mains. Je croyais vivre un « Nursery Rimes », mais je ne savais pas encore que c’était celui de Humpty Dumpty, le petit homme fragile à l’énorme tête d’œuf qui, assis, en haut d’un mur, n’ose plus bouger de crainte de se fracasser le crâne. Pour moi, l’omelette était proche, la catastrophe imminente. J’avais cinq ans, l’âge de l’innocence, l’âge où pourtant j’ai dit adieu à l’innocence. Pardonnez-nous nos enfances !
C’est vrai, j’avais un caractère difficile, je restais enfermé des heures sans jamais vouloir demander pardon. Je croyais que la colère était ma noblesse. J’explorais mes haines intérieures. Mais il faut bien avouer que j’étais très violent. Un jour mon père me surprit dans une lutte acharnée avec mon frère aîné, dont je croyais qu’il était le préféré de mes parents. J’étais en train de frapper sa tête contre les carreaux de la cuisine.
Pour apaiser la situation, mes parents décidèrent qu’un éloignement me serait profitable. On leur avait dit : « L’air de Brighton est bon pour les nerveux. » Aussi, un après-midi nous quittâmes Londres dans la belle Frégate grise qui faisait notre fierté, une vraie voiture française, et je ne compris pas pourquoi je partais seul avec mon père, sans mes frères, ni ma mère. Peut-être, au fond, me prenait-il pour un adulte. Voulait-il me parler ? Qu’allions-nous découvrir ? Je m’imaginais qu’il avait remarqué la grandeur de mon caractère et allait me confier à l’amiral Nelson qui, dans les jours à venir, me donnerait, peut-être, le commandement d’un « brick ». Mais, plus que du voyage, c’est de l’arrivée dont je me souviens. Brighton, une ville élégante mais qui fait peur par sa distinction froide ; des villas telles qu’on les imagine chez Agatha Christie, où les crimes se mitonnent dans la camomille, des gazons verts et tendres comme dans les films de Losey, où l’on ne tond que la surface de drames affreux et enterrés.
La voiture de mon père glissa dans une allée ombragée. Belle maison haute, sorte de manoir entouré d’arbres au-delà duquel on entendait le bruit de la mer. Je ne quittais pas ma petite valise dans laquelle j’avais rangé mes soldats de plomb. Nous étions arrivés. Une religieuse m’accueillit. Je laissai mon père sans émotion, tout intrigué d’abord par ce que je découvrais. Mais je ne savais pas encore l’horreur que cachaient ces murs. Le soir venait et l’on m’attribua un lit dans le grand dortoir. Vastes parquets glissants et sombres, odeurs d’encaustique et d’urine, de linge pourri et de fin de vie. O surprise, j’étais dans un asile de vieillards ; j’allais connaître le bout de la nuit.
A l’heure du goûter on m’avait déjà couché. Puis, ils vinrent et le cortège des vieillards défila sous mes yeux. Ils se déshabillaient lentement, je voyais leur peau parcheminée, lambeaux de chair, leurs chemises de nuit jaunies, leurs gestes comme livrés à l’éternité. Ils ne me regardaient pas et je sentis combien j’étais seul au milieu d’eux. Ils étaient les fantômes d’un autre monde qui surgissaient dès que le jour finissait. Mary Shelley, reine de l’effroi, avait-elle assisté au même spectacle quand petite fille, le soir, elle défaisait ses nattes ?
Comment ai-je réussi à jouer l’indifférence ? La terreur m’étreignait, mais je compris que je ne devais pas le montrer. Aussi, j’installai tranquillement sur la table de nuit mes petits soldats, « Horse Guards », « Queen’s Horses », « King’s Men »... Leurs vestes rouges étaient le témoignage éclatant de la vie. Mais, soudain d’un geste brutal, mon voisin, vieillard irritable, les balaya de la main. Ils tombèrent à terre. Bouleversé, j’éclatai en sanglots. Je les ramassai et je ne sais où je trouvai le courage de les ranger, tant bien que mal. Je me recouchai et pleurai dans mon lit. Je ne savais plus où j’en étais. Ma vie allait-elle se rétrécir et s’achever ou ne faisait-elle que commencer ?
Le lendemain matin, le soleil par la fenêtre ouverte et l’odeur des feuilles me redonnèrent du courage. Les morts ressuscitaient, mais plus humains que la veille. Ils faisaient leur toilette, et il me sembla que leurs visages étaient différents ; l’un d’entre eux m’adressa la parole. C’était un jour nouveau. Je me mis à croire à l’espoir, mais à midi au réfectoire le cauchemar recommença. Nous étions par table de six. Et j’étais assis en face d’une dame effrayante aux yeux d’un bleu intense, « Faïence-Folie ». Ses longs cheveux gris mal soignés pendaient en désordre de son front comme des mèches d’étoupe. Elle me regardait fixement et fit ce geste que j’aurais du mal à oublier ; avec sa cuillère, elle raclait bruyamment le fond de l’assiette vide, sans que la soupe nous ait été servie. Elle ne mangeait rien, et s’appliquait à ce geste absurde comme un automate. J’entends encore le bruit martelé de sa cuillère contre le fond de l’assiette vide. Je crois que j’en ai toujours peur.
Les jours passaient et je ne savais plus où j’étais. Parfois la religieuse m’emmenait avec elle, faire une promenade, regarder le ciel. Devant les devantures d’un magasin de jouets où étaient exposés les soldats de mes rêves, elle proposa de m’en offrir mais j’avais déjà sombré dans une sorte d’hébétude et je me souvenais qu’il fallait répondre poliment « Non, merci ». Le soir venu, je le regrettai amèrement. Si j’avais réagi de la sorte, n’était-ce pas la preuve que je n’étais plus un enfant ? En quelques semaines, j’avais changé de statut. Comme ceux avec qui je vivais, j’étais devenu un petit vieillard.
Quelques jours plus tard, j’eus l’impression de m’être fait un copain du même âge.
Le dimanche suivant, il m’emmène en promenade au golf de Brighton. Je vois passer d’autres enfants mais je les ignore. Ils ne peuvent pas comprendre. Quand le soir nous rentrons à l’hospice, je me retrouve en robe de chambre comme les vieillards. Un petit mouchoir sale, en guise de pochette, pour faire chic. Je me sens très à l’aise et il m’arrive même de plaisanter avec les sœurs. Je suis devenu assez vite un habitué de la maison et je me veux propret et distingué. J’ai des chaussons. Il m’arrive de sortir, mais cela m’ennuie un peu.
Je n’attends rien et je sais tout. J’ai cinq ans et je suis vieux.
Tout cela aurait pu être une charmante histoire, avec les casquettes bleu et jaune de notre école, la St Philip’s School, les « bats » de cricket, des rues de Londres où l’on jouait avec de petites voitures Dinky Toys contre les murs gris en se salissant les mains. Je croyais vivre un « Nursery Rimes », mais je ne savais pas encore que c’était celui de Humpty Dumpty, le petit homme fragile à l’énorme tête d’œuf qui, assis, en haut d’un mur, n’ose plus bouger de crainte de se fracasser le crâne. Pour moi, l’omelette était proche, la catastrophe imminente. J’avais cinq ans, l’âge de l’innocence, l’âge où pourtant j’ai dit adieu à l’innocence. Pardonnez-nous nos enfances !
C’est vrai, j’avais un caractère difficile, je restais enfermé des heures sans jamais vouloir demander pardon. Je croyais que la colère était ma noblesse. J’explorais mes haines intérieures. Mais il faut bien avouer que j’étais très violent. Un jour mon père me surprit dans une lutte acharnée avec mon frère aîné, dont je croyais qu’il était le préféré de mes parents. J’étais en train de frapper sa tête contre les carreaux de la cuisine.
Pour apaiser la situation, mes parents décidèrent qu’un éloignement me serait profitable. On leur avait dit : « L’air de Brighton est bon pour les nerveux. » Aussi, un après-midi nous quittâmes Londres dans la belle Frégate grise qui faisait notre fierté, une vraie voiture française, et je ne compris pas pourquoi je partais seul avec mon père, sans mes frères, ni ma mère. Peut-être, au fond, me prenait-il pour un adulte. Voulait-il me parler ? Qu’allions-nous découvrir ? Je m’imaginais qu’il avait remarqué la grandeur de mon caractère et allait me confier à l’amiral Nelson qui, dans les jours à venir, me donnerait, peut-être, le commandement d’un « brick ». Mais, plus que du voyage, c’est de l’arrivée dont je me souviens. Brighton, une ville élégante mais qui fait peur par sa distinction froide ; des villas telles qu’on les imagine chez Agatha Christie, où les crimes se mitonnent dans la camomille, des gazons verts et tendres comme dans les films de Losey, où l’on ne tond que la surface de drames affreux et enterrés.
La voiture de mon père glissa dans une allée ombragée. Belle maison haute, sorte de manoir entouré d’arbres au-delà duquel on entendait le bruit de la mer. Je ne quittais pas ma petite valise dans laquelle j’avais rangé mes soldats de plomb. Nous étions arrivés. Une religieuse m’accueillit. Je laissai mon père sans émotion, tout intrigué d’abord par ce que je découvrais. Mais je ne savais pas encore l’horreur que cachaient ces murs. Le soir venait et l’on m’attribua un lit dans le grand dortoir. Vastes parquets glissants et sombres, odeurs d’encaustique et d’urine, de linge pourri et de fin de vie. O surprise, j’étais dans un asile de vieillards ; j’allais connaître le bout de la nuit.
A l’heure du goûter on m’avait déjà couché. Puis, ils vinrent et le cortège des vieillards défila sous mes yeux. Ils se déshabillaient lentement, je voyais leur peau parcheminée, lambeaux de chair, leurs chemises de nuit jaunies, leurs gestes comme livrés à l’éternité. Ils ne me regardaient pas et je sentis combien j’étais seul au milieu d’eux. Ils étaient les fantômes d’un autre monde qui surgissaient dès que le jour finissait. Mary Shelley, reine de l’effroi, avait-elle assisté au même spectacle quand petite fille, le soir, elle défaisait ses nattes ?
Comment ai-je réussi à jouer l’indifférence ? La terreur m’étreignait, mais je compris que je ne devais pas le montrer. Aussi, j’installai tranquillement sur la table de nuit mes petits soldats, « Horse Guards », « Queen’s Horses », « King’s Men »... Leurs vestes rouges étaient le témoignage éclatant de la vie. Mais, soudain d’un geste brutal, mon voisin, vieillard irritable, les balaya de la main. Ils tombèrent à terre. Bouleversé, j’éclatai en sanglots. Je les ramassai et je ne sais où je trouvai le courage de les ranger, tant bien que mal. Je me recouchai et pleurai dans mon lit. Je ne savais plus où j’en étais. Ma vie allait-elle se rétrécir et s’achever ou ne faisait-elle que commencer ?
Le lendemain matin, le soleil par la fenêtre ouverte et l’odeur des feuilles me redonnèrent du courage. Les morts ressuscitaient, mais plus humains que la veille. Ils faisaient leur toilette, et il me sembla que leurs visages étaient différents ; l’un d’entre eux m’adressa la parole. C’était un jour nouveau. Je me mis à croire à l’espoir, mais à midi au réfectoire le cauchemar recommença. Nous étions par table de six. Et j’étais assis en face d’une dame effrayante aux yeux d’un bleu intense, « Faïence-Folie ». Ses longs cheveux gris mal soignés pendaient en désordre de son front comme des mèches d’étoupe. Elle me regardait fixement et fit ce geste que j’aurais du mal à oublier ; avec sa cuillère, elle raclait bruyamment le fond de l’assiette vide, sans que la soupe nous ait été servie. Elle ne mangeait rien, et s’appliquait à ce geste absurde comme un automate. J’entends encore le bruit martelé de sa cuillère contre le fond de l’assiette vide. Je crois que j’en ai toujours peur.
Les jours passaient et je ne savais plus où j’étais. Parfois la religieuse m’emmenait avec elle, faire une promenade, regarder le ciel. Devant les devantures d’un magasin de jouets où étaient exposés les soldats de mes rêves, elle proposa de m’en offrir mais j’avais déjà sombré dans une sorte d’hébétude et je me souvenais qu’il fallait répondre poliment « Non, merci ». Le soir venu, je le regrettai amèrement. Si j’avais réagi de la sorte, n’était-ce pas la preuve que je n’étais plus un enfant ? En quelques semaines, j’avais changé de statut. Comme ceux avec qui je vivais, j’étais devenu un petit vieillard.
Quelques jours plus tard, j’eus l’impression de m’être fait un copain du même âge.
Le dimanche suivant, il m’emmène en promenade au golf de Brighton. Je vois passer d’autres enfants mais je les ignore. Ils ne peuvent pas comprendre. Quand le soir nous rentrons à l’hospice, je me retrouve en robe de chambre comme les vieillards. Un petit mouchoir sale, en guise de pochette, pour faire chic. Je me sens très à l’aise et il m’arrive même de plaisanter avec les sœurs. Je suis devenu assez vite un habitué de la maison et je me veux propret et distingué. J’ai des chaussons. Il m’arrive de sortir, mais cela m’ennuie un peu.
Je n’attends rien et je sais tout. J’ai cinq ans et je suis vieux.
G.S.B. - C'est très difficile d'apprendre à vivre. Cela me fait penser à un autre livre (...) formidable, c'est "Le Métier de vivre" de Cesare Pavese. Au fond, vivre est un métier qui s'apprend. Savoir vivre, cela n'est pas ne plus s'indigner, bien sûr, mais c'est apprendre à ne plus laisser cette indignation se porter sur les autres, au risque de leur causer un préjudice, mais la canaliser en soi, afin qu'elle donne naissance à des choses nouvelles au plus profond de nous-mêmes. Cela veut dire tout simplement que dans la vie il faut toujours essayer de faire d'un mal un bien.
386 - [Le Livre de Poche n°5340, p. 406]
386 - [Le Livre de Poche n°5340, p. 406]
Tout ce qui était n'est plus; tout ce qui sera n'est pas encore. Ne cherchez pas ailleurs le secret de nos maux.
La Renaissance, c'est cela : cette égalité acquise par les grands artistes avec les maîtres du monde : François Ier écoutant, penché, les maximes murmurées de Vinci, et Charles Quint plié en deux pour ramasser le pinceau échappé des mains de Titien.
Il ne suffit pas de couler à l'oreille de son maître le mot juste ou la formule idéale pour recueillir l'estime des puissants. Nicolas Machiavel devrait le savoir, lui qui écrit : "Le temps n'attend pas, la bonté est impuissante, la fortune inconstante et la méchanceté insatiable".
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur
Auteurs proches de Gonzague Saint Bris
Lecteurs de Gonzague Saint Bris (680)Voir plus
Quiz
Voir plus
Les personnages de Tintin
Je suis un physicien tête-en-l'air et un peu dur d'oreille. J'apparais pour la première fois dans "Le Trésor de Rackham le Rouge". Mon personnage est inspiré d'Auguste Piccard (un physicien suisse concepteur du bathyscaphe) à qui je ressemble physiquement, mais j'ai fait mieux que mon modèle : je suis à l'origine d'un ambitieux programme d'exploration lunaire.
Tintin
Milou
Le Capitaine Haddock
Le Professeur Tournesol
Dupond et Dupont
Le Général Alcazar
L'émir Ben Kalish Ezab
La Castafiore
Oliveira da Figueira
Séraphin Lampion
Le docteur Müller
Nestor
Rastapopoulos
Le colonel Sponsz
Tchang
15 questions
5251 lecteurs ont répondu
Thèmes :
bd franco-belge
, bande dessinée
, bd jeunesse
, bd belge
, bande dessinée aventure
, aventure jeunesse
, tintinophile
, ligne claire
, personnages
, Personnages fictifsCréer un quiz sur cet auteur5251 lecteurs ont répondu