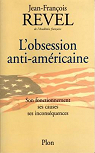Citations de Jean-François Revel (237)
Ce à quoi les États-Unis nous servent: à nous consoler de nos propres échecs en entretenant la fable qu'eux font encore plus mal que nous - et que ce qui va mal chez nous vient de chez eux. (p.290)
La leçon multimillénaire de l'histoire des civilisations: c'est le cloisonnement qui lamine et stérilise les cultures, c'est la compénétration qui les enrichit et les inspire. (p.199)
L'on impose jamais par la contrainte, ni même par la publicité une œuvre littéraire ou artistique, encore moins une œuvre de simple divertissement, à un public qu'elles ne séduisent pas. (p.194)
Quant à l'antiaméricanisme d'extrême droite, il a pour moteur, comme celui d'extrême gauche, simplement la haine de la démocratie et de l'économie libérale qui en est la condition. (p.16)
Ainsi, « être philosophe » au XVIIIe (et non "faire de la philosophie" expression affreuse, chère à d'autres époques) c'est reprendre les valeurs grecques de désintéressement personnel et d'amour de la connaissance pour elle-même, mais c'est les reprendre en les sécularisant et en les laïcisant. Le but suprême n'est plus, du fait de l'effondrement de la métaphysique, le Souverain Bien ni la révélation d'un Intelligible situé au-delà des phénomènes. La confiance dans la fonction libératrice de la connaissance subsiste, mais cette libération a lieu non plus seulement au bénéfice de l'individu qui la pratique, mais au bénéfice de I'humanité. Elle s'accomplit d'une part directement, par la diffusion de l'information et la levée de toutes les censures (c'est le principe même des Lumières ), d'autre part indirectement par la médiation de la technique, c'est-à- dire des sciences appliquées, devant affranchir peu à peu l'homme de l'esclavage du travail manuel.
(Simultanément se font jour dès cette époque les premières nostalgies modernes pour le monde rural et artisanal qui était en train d'amorcer son processus de recul devant l'urbanisation et l'industrialisation.) Ce sont là deux composantes de la notion de progrès, telle qu'elle a été formulée au XVIe siècle et sera idéalisée au XIXe. « Etre philosophe » c'est donc pratiguer une forme moderne de "vertu" (...). [p.489]
(Simultanément se font jour dès cette époque les premières nostalgies modernes pour le monde rural et artisanal qui était en train d'amorcer son processus de recul devant l'urbanisation et l'industrialisation.) Ce sont là deux composantes de la notion de progrès, telle qu'elle a été formulée au XVIe siècle et sera idéalisée au XIXe. « Etre philosophe » c'est donc pratiguer une forme moderne de "vertu" (...). [p.489]
Au XVIIIe siècle, la philosophie constitue le fonds général de la création intellectuelle plutôt qu'une discipline distincte des autres aspects du savoir, de l'éthique, de la politique. Elle peut se définir comme I'état d'esprit commun à toutes les formes de pensée révolutionnaires, comme l'ensemble des conditions morales, psychologiques et pédagogiques de leur possibilité, et non plus comme l'unique source substantielle de lumière et son ultime point de convergence. Au XVIIe siècle elle avait voulu redevenir la Cour suprême de la science, cour soumise elle-même à une Cour de cassation : la théologie. A vrai dire, la signification du concept de philosophie avait toujours été assez large : totalité des sciences, fondement des sciences, méthode de pensée, règle de conduite, école de sagesse, école de bonheur, connaissance de la réalité et des réalités - ainsi que de la réalité des réalités (...). [p.485]
Paru en 1649, le traité des Passions de l'Ame est son dernier livre, et il se présente à la lecture comme un mélange de physiologie fantaisiste et de psychologie sommaire. L'homme a une double nature : comment fonctionnent-elles ensemble? Je suis d'une part une « chose qui pense »- mon âme -, d'autre part j'ai un corps, qui est une « chose étendue» et qui, en tant que tel, entre, ou entrerait - dans la catégorie des animaux-machines. Mais il se trouve que la substance pensante et la substance étendue sont unies en l'homme, et elles sont en l'homme seulement suscep tibles d'interaction. [p.387]
L'œuvre de Bacon est un manifeste en faveur de ce que l'on pourrait appeler une nouvelle éthique scientifique, fondée sur la collaboration, et l'égalité de principe, des intelligences. Fondée également sur la communication des connaissances et des techniques, considérées comme bien commun à toute l'humanité. Car jusqu'alors la coutume avait été de garder le secret des connaissances. Non pas le secret au sens purement technique où l'on parle aujourd'hui de secret scientifique gardé par une grande puissance ou par une équipe de chercheurs, mais dans un sens initiatique et presque religieux. Ainsi par exemple I'homonyme médiéval de Francis, Roger Bacon, dont on fait souvent un précurseur de la conception expérimentale de la science, considère que cette méthode doit rester confidentielle et n'être dévoilée qu'à une minorité. L'idée est que la connaissance est un bien précieux qui doit rester le monopole des esprits dignes d'en être les dépositaires. L'obstacle à la transmission n'est donc pas en l'occurrence d'ordre pédagogique ou pratique, il est d'ordre moral. Certains humains sont considérés comme naturellement inférieurs aux autres et indignes d'être éclairés, parce que cette substance divine qu'est la connaissance risquerait de se corrompre au contact de leur trop rugueuse nature. [p.354]
En effet, ce que la magie et la science future ont en commun, c'est la notion d'une connaissance opératoire. La magie reposait sur ce concept que le savoir véritable ne va jamais sans le pouvoir, la puissance d'agir. Si la magie rationnelle apparaissait à certains, au XVIe siècle, comme moderne et révolutionnaire, c'est parce qu'elle apparaissait comme le prolongement de la connaissance dans l'action, de l'intelligence des lois dans la transformation de la nature, de l'explication dans l'opération. Les trois termes, définissant la pratique scientifique à venir, se trouvaient réunis dans la magie : le savoir et le pouvoir unis dans et par la rationalité. [p.351]
Car un système intellectuel satisfait bien d'autres besoins que celui de connaître, de même qu'une œuvre d'art se prête à bien plus de choses qu'à procurer une émotion esthétique. L'un et l'autre ont des fonctions sociales et psychologiques, servent à des groupes restreints ou larges à cimenter ou à défaire leur union, servent aux individus à cimenter ou à défaire leur image d'eux-mêmes, selon une dynamique semi-consciente de compensation, de domination, de stabilisation, ou au contraire d'autopunition et d'effacement, dans laquelle la part d'éléments étrangers à l'affaire est souvent la plus forte. C'est pourquoi l'argumentation est parfois un facteur secondaire, voire inexistant, de l'adhésion à une doctrine philosophique, et la réalité de l'émoi esthétique un facteur accessoire, ou même nul, de l'admiration, et d'une admiration, d'une adhésion d'autant plus intransigeantes et expansionnistes, dans leurs extériorisations agressives, que rien ne les nourrit dans la solitude du jugement. [p.341 - 342]
Mais ce n'est pas seulement parce qu'ils étaient matériellement égarés ou falsifiés que les textes étaient corrompus : c'est aussi parce qu'ils étaient commentés. On pratiquait couramment au Moyen Âge des textes de Platon, de Virgile et d'Aristote, mais on les enduisait et renduisait inlassablement d'une problématique qui n'était pas la leur. "Retrouver" les textes ne consista pas seulement pour les lettrés de la Renaissance à les restituer philologiquement mais aussi intellec- tuellement. La discipline de l'explication de textes, qui devait rester pendant si longtemps à la base de l'enseignement occidental, et qui consistait en un examen méticuleux non seulement du texte même mais du contexte et de l'encadrement historique, est née au début du XV siècle en Italie, comme un antidote aux superstructures fantaisistes de commentateurs irresponsables ou malhonnêtes. La nature est abordée en sa qualité de document authentique, comme le sont les textes, le corps humain ou l'expérience politique. Il n'y a pas, dans la pensée de la Renaissance, du moins en sa partie créatrice, de fétichisme des auteurs anciens. [p.288 - 289]
Alors qu'à d'autres époques la philosophie, retranchée en elle-même, distincte des autres activités spirituelles, se prononce de l'extérieur sur I'art, la physique, la politique, la religion ou la morale, à l'époque de la Renaissance au contraire elle est répandue au-dehors et intimement mêlée aux expressions multiples du savoir, du savoir-faire, de la littérature et de l'art, souvent à l'état de traces à peine perceptibles. Au lieu de constituer un corps autonome aux frontières marquées, elle est immanente aux autres disciplines, elle se lit dans le plan des édifices et I'iconographie des tableaux, dans les poèmes d'amour et les programmes d'études, elle grandit comme un arbre invisible dont n'apparaitraient que les fruits. [p.282]
Les représentants de la première école de pensée insistent avant tout sur l'expérience, la nature, I'observation, les mathématiques. Ils abhorrent la rhétorique, l'étalage d'érudition pour le plaisir de l'étaler, et, par-dessus tout, les constructions théoriques impossibles à démontrer. Ils sont critiques, satiriques et sceptiques à l'égard des conventions sociales et de toute espèce d'autorité injustifiée, politique, intellectuelle ou religieuse. Ils pensent qu'un homme neuf doit émerger d'une éducation neuve, libératrice et libérée, dont ils nous ont laissé tant de programmes minutieux, et que cet homme nouveau deviendra le soutien et le produit d'une société égalitaire, heureuse, libre, pacifique et savante. Ils pensent que la connaissance doit s'accompagner de la technique et réciproquement : ils sont curieux de nouvelles machines, de nouvelles sources d'énergie, afin d'épargner le travail humain, ils recommandent ou pratiquent la dissection, pour qu'on sache enfin comment fonctionne notre organisme; cer- tains sont ingénieurs, entrepreneurs de travaux publics, urbanistes, diététiciens et chimistes. Ils reviennent aux textes originaux, et délaissent les commentateurs. Alberti a incarné à peu près toutes les virtualités de ce type de "philosophe antiphilosophe", philosophe au sens où les Encyclopédistes le seront au XVIIIe siècle. [p.278]
La philosophie, ce n'était pas uniquement la connaissance, mais c'était la connaissance, et la seule homologué. On ne saurait donc s'étonner que les philosophes voient d'un mauvais œil ces mêmes ambitions réalisées par la mise en œuvre d'un type de pensée qui constitue en partie la négation du leur, ou du moins de l'une de ses tendances. Aussi ne compte pas, au cours de l'histoire moderne, et surtout depuis le début du 19e siècle, les termes de mépris forgés par les philosophes pour désigner l'esprit scientifique. Ces termes reviennent toujours plus ou moins à faire contraster la luxuriance généreuse de l'imagination philosophique avec la sécheresse appauvrissante de la science. [p.256]
La philosophie occupe à cet égard une situation intermédiaire entre la science -où il existe un progrès effectivement mesurable- et l'art, où la notion de progrès n'a aucune signification. Il existe en effet en philosophie une manière de progrès, en ce sens qu'il y existe des arguments, et que l'on peut tenir compte des arguments déjà formulés. Mais on peut aussi quelque fois les ignorer et repartir à un niveau inférieur ou extérieur à ce qui semblait acquis. Cela est possible parce que le savoir philosophique n'est pas cumulatif par essence, comme l'est le savoir scientifique -et s'apparente ainsi, par une autre de ses faces, à l'art, ce qui l'affranchit de la loi stricte du progrès. Obligatoire en science, illusoire en art, le progrès est facultatif en philosophie. [p.144]
Cette méthode socratique, à laquelle Platon donne le nom de "maïeutique" -ce qui signifie littéralement "art d'accoucher"-, a une grande portée pédagogique, puisque le disciple en l'occurrence n'est pas enseigné par le maître mais incité par le maître à découvrir par lui-même, par sa propre réflexion, les implications d'une idée. La maïeutique passe par le dialogue, et cette méthode d'investigation par questions et réponses est le premier sens -il y en aura d'autres- du mot dialectique, ce qui signifie d'abord art de discuter, de "conférer", dira Montaigne. La dialectique est le seul moyen de couper court au dogmatisme du monologue philosophique solitaire (...). [p.102]
Pour Socrate, le but de la philosophie n'est pas l'étude des phénomènes naturels, mais celle de l'homme, plus précisément de la conduite humaine, d'un art de vivre moralement et d'être heureux. Qu'il ait substitué à l'ancien but philosophique ce nouveau but, ou du moins qu'il lui ait donné la priorité, c'est indéniable pour ce qui le concerne lui-même. Qu'il ait réussi à convaincre tout le monde d'en faire autant et qu'on puisse parler de révolution philosophique opérée par Socrate, c'est faux, il suffit pour le constater de voir que le plus important des philosophes de la période post-plastonicienne, Aristote, est avant tout un philosophe de la connaissance pure, et non pas de la connaissance subordonnée à la morale ni de la morale subordonnée à la connaissance. [p.101 - 102]
Hécatée, au VIe siècle, fondé l'histoire moderne. Cette "histoire", -rappelons le sens du mot, -est d'abord une "enquête" sur les faits humains. Aujourd'hui, l'histoire s'est renouvelée en cessant d'être seulement "événementielle" et en s'alliant en profondeur à la sociologie, à l'étude des civilisations. Mais cette alliance allait de soi aux yeux des premiers historiens. Hécatée de Milet est avant tout géographe, et il n'est pas indifférent de mentionner qu'Anaximandre lui-même fut nommé le "père de la géographie" : on peut saisir ainsi en quoi consistait alors l'esprit d'investigation philosophique. [p.88]
Ce qui domine les textes de la collection hippocratique, c'est donc d'abord une tentative de physiologie naturelle, de compréhension de l'organisme au sein du monde bio-physique, ensuite la poursuite d'une science au service de l'homme, attachée à l'étudier dans ses faits et gestes pour améliorer sa condition. C'est le même esprit que nous trouvons précisément chez les premiers représentants de ce que nous appellerions aujourd'hui les sciences humaines et chez les historiens. [p.88]
J’avais le sentiment de rester sur ma faim car en dépit de mon admiration, je ne pouvais manquer de constater que le génie manifesté par ces hommes, dans un domaine particulier, ne s’accompagnait par des perfections humaines les plus simples, comme l’altruisme, la bonté, la sincérité.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur
Auteurs proches de Jean-François Revel
Lecteurs de Jean-François Revel (929)Voir plus
Quiz
Voir plus
Compléter les titres
Orgueil et ..., de Jane Austen ?
Modestie
Vantardise
Innocence
Préjugé
10 questions
20394 lecteurs ont répondu
Thèmes :
humourCréer un quiz sur cet auteur20394 lecteurs ont répondu