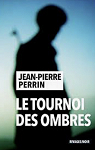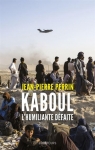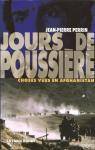Né(e) à : Dijon , le 04/04/1951
Jean-Pierre Perrin est un journaliste, correspondant de guerre et écrivain français, auteur de récits d'actualité et de romans policiers.
Il est grand reporter au quotidien "Libération", spécialiste du Proche-Orient, du Moyen-Orient et de l'Afghanistan. Après sa carrière de journalisme, il se consacre à l'écriture de romans.
Il nous parle de ses guerres au Proche-Orient, en Irak, en Iran, mais aussi de tout ce que n'évoquent pas les journaux : les odeurs, les sentiments, l'aridité de la terre, et l’hospitalité sacrée des habitants de ces régions. Il a consacré plusieurs récits et relations de voyages à cette région.
En 2002, il publie "Jours de poussière : choses vues en Afghanistan" qui remporte le grand prix des lectrices de Elle 2003 dans la catégorie Documents. En 2003, il fait paraître "Les Rolling Stones sont à Bagdad : Irak, dans les coulisses d'une guerre" racontant la Guerre d’Irak et la fin du régime de Saddam Hussein.
Il est également l’auteur d’un article sur l’Iran paru au printemps 2006 dans la revue "Politique Internationale". Il coordonne en 2011 l'ouvrage "Nouvelles du bout du monde", publié chez Hoëbek.
"La mort est ma servante" (2013, Fayard) est plus qu’un récit de guerre ; c’est l’hommage poignant de Jean-Pierre Perrin à un ami, Samir Kassir, intellectuel arabe, "le plus prometteur de sa génération". Ce dernier est assassiné en juin 2005, à Beyrouth, non loin du café où les deux amis devaient justement se retrouver.
Dans "Menaces sur la mémoire mondiale de l’humanité" (2016, Hoëbeke), Jean-Pierre Perrin revient sur l’histoire mouvementée de sites historiques du Moyen-Orient (comme la cité antique de Palmyre, reprise par la Syrie des mains de l’EI le 27 mars 2016).
En 2017, il a obtenu le prix Joseph Kessel pour son récit "Le djihad contre le rêve d'Alexandre" (Seuil). Jean-Pierre Perrin est lauréat du prix FDBDA-SEF 2021.
Il est également l'auteur d'ouvrages de littérature policière comme "Chiens et Louves", paru en 1999 dans la collection Série noire.
https://www.laprocure.com/product/1395404/femme-vie-liberteFemme, vie, libertéMarjane Satrapi, Farid Vahid, Jean-Pierre Perrin, Abbas Milani et al. Éditions l'Iconoclaste « À l'heure où nous célébrons le premier anniversaire de la Révolution des femmes en Iran, il y a un an, en septembre dernier, voici que la maison de l'Iconoclaste publie sa première bande dessinée qui s'appelle Femme, vie, liberté. C'est une bande dessinée qui est un immense coup de coeur et on peut dire que pour L'Iconoclaste, dont c'est la première bande dessinée, c'est vraiment un coup de maître. [...] C'est une bande dessinée qui a été réalisée sous la direction de Marjane Satrapi, cette auteure iranienne... » Caroline Tison, libraire à La Procure de Paris
Hafez le poète est aussi grand que mystérieux . Et l'Iran est à son image : un grand mystère .
Perrin le regarde un peu hébété. Puis il pose une question qui, à sa manière, est une bombe : « Pourquoi il n’y a aucune femme parmi les blessés ? » Le dentiste baisse les yeux et le Dr Mohammed reprend sa pince à shrapnels pour rejoindre la salle d’opération. Perrin insiste et hausse la voix : « Aucune femme parmi les blessés. Pourquoi ? » La réponse il la connaît bien sûr. Une femme ne peut être déshabillée si les médecins ou les infirmiers sont des hommes, et il vaut mieux la laisser mourir, fût-ce dans les pires souffrances, plutôt que d’offenser la religion.
Les femmes sont le bétail de ces vallées. Elles ne servent qu'à travailler du matin au soir et à faire des gosses - malheur à celles qui ne font que des filles. On ne les aperçoit que pliées en deux dans les champs ou portant sur la tête d'imposants fagots de bois ou des seaux de linge et, occasionnellement, au bazar, revêtues de la burqa à la place du voile. Même si certains anthropologues assurent qu'elles sont reines du foyer, on les exploite, on les marie à des veillards, on les brutalise, on les frappe, on les vend; il arrive qu'on les brûle et qu'on les tue. Parfois, pour mettre fin à un badal, on les livre dès l'adolescence à la famille ennemie, ce qui les condamne à un esclavage domestique qui durera jusqu'à leur mort'.
p. 70
L'Iran est moderne mais demeure archaïque.
L'Iran aime les sciences mais les superstitions y sont solidement ancrées.
L'Iran est mystique mais amoureux des plaisirs les plus terrestres.
L'Iran produit un cinéma inventif mais la censure pèse toujours lourdement sur les réalisateurs.
L'Iran des poètes pardonne mais l'Iran des juges islamiques condamne à mort le plus grand nombre de mineurs au monde.
L'Iran est une république islamique mais le nombre des iraniens pratiquant est estimé à seulement 30%.
On pourrait continuer longtemps cette dualité qui vaut pour la vie quotidienne.
Les omniprésents mollahs, par exemple, sont sans cesse moqués, affublés de sobriquets ridicules, maudits, voire insultés. Mais peu d'iraniens voudraient qu'ils ne fassent plus partie du paysage.
Je me surprends à boire le ciel bleu à la façon d’un homme mourant de soif qui chute dans une rivière. Je ne l’avais pas oublié pendant tous ces mois. Mais je ne me souvenais pas que sa couleur pouvait contenir tant de force. Bleu brûlant tonitruant, l’incandescence d’une aridité océanique, le ciel de Tolède sans ses lourds nuages crémeux qui sont des promesses d’ombres et d’humanité, annonciateurs de pluie et de salut
Ne vous avais-je pas dit:
La tempête va venir
Et votre barque est pitoyable
Et la rivière sera couteau, vertige, tourbillon,
Des rocs se dresseront, creusant lames et gouffres
Et vous verrez un Monstre, ensuite,
En chaque grain de sable, en chaque goutte d'eau?
Ne vous avais-je pas dit les profondeurs,
Les déferlantes, les écrasements?
Ne vous avais-je pas dit le naufrage,
Votre esquif trop gracile
Et cet oeil effroyable où roulait une eau trouble?
Et tant et tant ont péri
Et tant et tant que les Monstre a broyés!
Sayd Bahaodine Majrouh
Le voyageur de minuit
Hernani
Hernani est une pièce composée de ?
526 lecteurs ont répondu