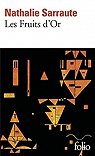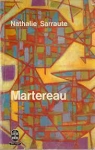Critiques de Nathalie Sarraute (279)
Derrière toutes les interventions de Nathalie Sarraute se trouve une même exigence : saisir les plus fines parcelles de réalité sous l’épaisseur des stéréotypes qui la recouvrent.
Lien : https://www.lemonde.fr/livre..
Lien : https://www.lemonde.fr/livre..
Une quarantaine d'années après Tropismes, Nathalie Sarraute poursuit sa réflexion et apporte des réponses là où elle nous avait laissés avec nos interrogations sur le lien entre ces fameux tropismes et le langage. Elle les situaient à la limite de la conscience, en amont du langage, à la base de l'ensemble des comportements humains, des actions, des sentiments.
Dans l'usage de la parole, elle reprend le procédé des très courts textes, au nombre de dix ici, indépendants les uns des autres. Petits exercices de style, les saynètes, toujours empreintes de poésie et d'une légère irréalité, sont inspirées, pour chacune d'entre elles, par des expressions toutes faites, des locutions, des bouts de phrases extraits de la langue courante, "Et pourquoi pas", "Ne me parlez pas de ça", "Eh bien quoi, c'est un dingue"...
Dans chaque texte, Nathalie Sarraute s'emploie de manière magistrale, en alliant concision, précision et étrangeté, à décortiquer, démonter des situations, comme un horloger le ferait avec une pendule. Des personnages, souvent des silhouettes anonymes, des poupées découpées dans le carton par des enfants selon les pointillés, se rencontrent, dans la rue, au café, échangent des paroles. Les mots prennent vie et indépendance; ils s'autonomisent au regard des locuteurs et de ceux qui les reçoivent. Ils viennent se ficher dans un coin de leur cerveau, déclenchant des réactions inattendues.
L'effet est saisissant, les personnages s'estompant derrière les mots.
Avec une démarche quasi scientifique, l'autrice dissèque les mécanismes de la conversation, les silences, les relances, les attentes à l'égard de l'interlocuteur, les méprises, les déceptions, et c'est là qu'elle fait le lien entre les tropismes et le langage, par l'intermédiaire de ce qu'on pourrait dénommer psychologie.
Et soudain la conversation dérape, les mots sont vides de sens, ou bien comme elle le dit, ils n'ont plus de terrain d'atterrissage.
Parfois, les paroles ont des espaces vides en elles, des espaces vides qui ont plus de poids que n'en ont les paroles.
Les mots peuvent être porteurs de halo de lumière ; ils transcendent les êtres qu'ils touchent, comme le mot amour. Ils servent de révélateurs, et comme sur une image photographique, ils font apparaître l'autre. N'est-ce pas le travail de l'écrivain qui est décrit de cette manière ?
Hormis le premier texte consacré aux derniers mots de Tchekhov sur son lit de mort, Ich sterbe, "je meurs" en allemand, la tonalité générale est plutôt alerte, légère, ludique. Nous sommes dans le registre des jeux de mots que Nathalie Sarraute souhaite partager avec ses lecteurs. Elles les interpellent, les associent, les intègrent au raisonnement.
Dix petits bijoux littéraires à lire et relire, pour en retirer toute la sève et l'intelligence. Un cinq étoiles bien mérité.
Les souvenirs d'enfance à la sauce Sarraute sont plus des réminiscences constamment interrogées, examinées sous tous les angles, qu'un récit reconstitué après coup et un peu édifiant. C'est tout l'intérêt de ce livre passionnant sans jamais être ennuyeux, dont le parti pris très analytique renouvelle ce genre littéraire bien encombré, sans jamais effacer l'émotion et la poésie qui irriguent ses ouvrages les plus réussis. Une douce porte d'entrée dans le "nouveau roman", réputé difficile d'accès.
Une autre expérience de lecture très étrange, surtout parce que je m’y suis lancé sans aucune préparation. Sarraute propose 24 pièces courtes, des vignettes, souvent seulement quelques pages, et qui ne semblent reliées par aucune intrigue, existent simplement séparément. J'ai tout de suite remarqué à quel point son style littéraire est mélodieux, cela m'a fait passer spontanément à la lecture à voix haute, et puis il me semblait que les sons avaient une vie propre, séparée du contenu. Parce que ce contenu a nécessité quelques recherches et réflexions. Ce n'est qu'à la seconde lecture que j'ai remarqué que Sarraut presque toujours part d'un constat : de choses, de personnes (non citées nommément), de situations, qu'elle semble décrire de manière impartiale, objective, neutre. Elle le relie immédiatement à une certaine réaction provoquée par ce qui a été décrit, et qu'elle analyse ensuite. Et puis émerge un monde très complexe d'actions et de réactions, des actions liées à des émotions (parfois très intenses) et vice versa, mais toujours considérées comme une sorte d'automatismes, et les personnes impliquées presque comme des automates. Intriguant, mais très froid, comme si l'on observait les mouvements incessants d'une fourmilière ou d'un nid d'abeille. Ce livre est certainement intriguant, mais je dois honnêtement admettre qu'il ne m'a pas réchauffé. Ce genre de littérature « déshumanisée » est bien sûr le fruit des évolutions inhumaines du XXe siècle (il est apparu pour la première fois en 1939, mais n'a percé qu'après l’édition de 1957), mais il suscite spontanément en moi des résistances. Peut-être ai-je, à tort, fermé les yeux sur le caractère inanimé de nombre de nos actions, fruits d’automatismes (inconscients), et chéris-je trop l’illusion d’une interaction humaniste. Mais il est bon que Sarraute garde à l’esprit un autre mode de voir cette réalité.
C'est avec son style habituel tissé de soliloques que Nathalie Sarraute nous transmet cette étrange autobiographie construite en un dialogue entre elle... et elle même, fait en outre de monologues intérieurs , de questions et réponses pour elle-même...
On y retrouve cette même vision inquisitrice du non dit. Cependant cette inquisition n'est pas tant à l'encontre de son être, ses contacts avec sa famille, ses choix et ses souvenirs qu'envers le langage qui les traduit.
Reconstruire le passé en évitant les souvenirs véridiques, en les transposant en un échange sincère mais critique, voilà l'enfance que l'écrivaine nous offre, non pas celle qu'elle a vécue mais son enfance littéraire, langagière plus que romanesque et romancée.
On y retrouve cette même vision inquisitrice du non dit. Cependant cette inquisition n'est pas tant à l'encontre de son être, ses contacts avec sa famille, ses choix et ses souvenirs qu'envers le langage qui les traduit.
Reconstruire le passé en évitant les souvenirs véridiques, en les transposant en un échange sincère mais critique, voilà l'enfance que l'écrivaine nous offre, non pas celle qu'elle a vécue mais son enfance littéraire, langagière plus que romanesque et romancée.
Pour quelles raisons n'ai-je pas fait la connaissance des Tropismes de Nathalie Sarraute plus tôt ? Ils m'ont tellement déconcertée à la première lecture, que je les ai immédiatement relus.
Les tropismes sont pour Nathalie Sarraute «les mouvements subtils, à peine perceptibles, fugitifs contradictoires, évanescents, de faibles tremblements, des ébauches d’appels timides et des reculs, des ombres légères qui glissent, et dont le jeu incessant constitue la trame invisible de tous les rapports humains et la substance même de notre vie.» Ils se situent à la limite de la conscience.
Les tropismes qu'elle a théorisés en littérature ont marqué toute son oeuvre et en ont fait l'une des précurseurs du Nouveau Roman.
Ce sont ici vingt-quatre très courts textes, sortes de petits contes de trois-quatre pages maximum, qu'aucune progression ou fil narratif ne relient. Indépendants, ils peuvent être lus et agencés selon la convenance du lecteur. Ils composent un chapelet de lambeaux de rêve, de bulles poétiques, de saynètes, à l'atmosphère étrange, où apparaissent des personnages anonymes, vagues silhouettes désincarnées.
Les protagonistes se rencontrent, bavardent, répondent à des convenances sociales, mais les discussions tournent à vide, et ils se trouvent rapidement enfermés dans des attitudes stéréotypées, plus particulièrement les femmes. Figures caricaturales, elles prennent le thé, tricotent, arpentent les magasins en quête d'un improbable tailleur en gros tweed à dessins. Elles sont souvent empêchées, en marge de l'action, en proie à des sentiments de peur, en position d'attente, car le temps est suspendu.
Les enfants sont également très présents, inscrits dans des relations énigmatiques avec les parents ou grands-parents qui exercent une supériorité, un pouvoir à leur égard, au travers de gestes envahissants ou violents.
On peut se demander si toutes ces situations ne sont pas vues à hauteur d'enfants, au travers d'une perception déformée de la réalité dans laquelle les adultes sont indistincts, où les objets et les meubles s'animent, et où des menaces diffuses planent.
Revenons aux tropismes : ils se situent pour l'autrice en amont du langage, et pourtant, c'est bien par le langage qu'elle parvient à en laisser une trace sur la page, un langage qu'elle peaufine puisqu'il lui aura fallu cinq ans pour les écrire.
Souvenirs, réminiscences, fragments surgis de l'inconscient ou d'on ne sait où ?
Deux niveaux de lecture nous sont proposés : celui des scènes de la vie de tous les jours, un peu vaine, absurde, et celui d'une matière brute faite de sensations, d'une intériorité qui se déverse et qui serait à l'origine des comportements humains.
Où Nathalie Sarraute situe-t-elle l'articulation entre les deux ? De quoi parle-t-elle exactement ?
Une lecture passionnante, déstabilisante et marquante qui aura soulevé chez moi de nombreuses interrogations et qui me pousse à aller plus loin dans sa bibliographie.
Les tropismes sont pour Nathalie Sarraute «les mouvements subtils, à peine perceptibles, fugitifs contradictoires, évanescents, de faibles tremblements, des ébauches d’appels timides et des reculs, des ombres légères qui glissent, et dont le jeu incessant constitue la trame invisible de tous les rapports humains et la substance même de notre vie.» Ils se situent à la limite de la conscience.
Les tropismes qu'elle a théorisés en littérature ont marqué toute son oeuvre et en ont fait l'une des précurseurs du Nouveau Roman.
Ce sont ici vingt-quatre très courts textes, sortes de petits contes de trois-quatre pages maximum, qu'aucune progression ou fil narratif ne relient. Indépendants, ils peuvent être lus et agencés selon la convenance du lecteur. Ils composent un chapelet de lambeaux de rêve, de bulles poétiques, de saynètes, à l'atmosphère étrange, où apparaissent des personnages anonymes, vagues silhouettes désincarnées.
Les protagonistes se rencontrent, bavardent, répondent à des convenances sociales, mais les discussions tournent à vide, et ils se trouvent rapidement enfermés dans des attitudes stéréotypées, plus particulièrement les femmes. Figures caricaturales, elles prennent le thé, tricotent, arpentent les magasins en quête d'un improbable tailleur en gros tweed à dessins. Elles sont souvent empêchées, en marge de l'action, en proie à des sentiments de peur, en position d'attente, car le temps est suspendu.
Les enfants sont également très présents, inscrits dans des relations énigmatiques avec les parents ou grands-parents qui exercent une supériorité, un pouvoir à leur égard, au travers de gestes envahissants ou violents.
On peut se demander si toutes ces situations ne sont pas vues à hauteur d'enfants, au travers d'une perception déformée de la réalité dans laquelle les adultes sont indistincts, où les objets et les meubles s'animent, et où des menaces diffuses planent.
Revenons aux tropismes : ils se situent pour l'autrice en amont du langage, et pourtant, c'est bien par le langage qu'elle parvient à en laisser une trace sur la page, un langage qu'elle peaufine puisqu'il lui aura fallu cinq ans pour les écrire.
Souvenirs, réminiscences, fragments surgis de l'inconscient ou d'on ne sait où ?
Deux niveaux de lecture nous sont proposés : celui des scènes de la vie de tous les jours, un peu vaine, absurde, et celui d'une matière brute faite de sensations, d'une intériorité qui se déverse et qui serait à l'origine des comportements humains.
Où Nathalie Sarraute situe-t-elle l'articulation entre les deux ? De quoi parle-t-elle exactement ?
Une lecture passionnante, déstabilisante et marquante qui aura soulevé chez moi de nombreuses interrogations et qui me pousse à aller plus loin dans sa bibliographie.
Sommes-nous des planètes qui tournons l'une autour de l'autre dans un ballet confidentiel et mal agencé, dérangé par les discours de nos semblables autant que par nos ressentiments ?
Sommes-nous ces cocons ivres de la vie des autres, de leurs paroles aussi gluantes que le liquide amniotique ambiant censé nous protéger mais qui nous étouffe.
Étouffant. Voilà le mot. L'écriture de Nathalie Sarraute est d'une telle densité, une telle proximité non seulement avec le discours mais avec le vécu, le ressenti, le peu conscient, le refoulé que l'air y circule peu. Dans sa prose à nulle autre comparable, mêlant dialogues, monologues intérieurs, reliquats de pensée, de non-pensée, d'orgueilleux soubresauts de l'âme et de verbeux hoquets de dégoût, l'auteure (ou l'autrice, je ne me suis pas encore décidé) tisse sa toile littéraire, nous enveloppe de tous les sucs sociaux et psychologiques que le langage a pu produire. Les personnages s'y débattent tandis que le lecteur tente de surnager dans le réseau romanesque dans lequel il s'est lui-même jeté en ouvrant ce planétarium. Non ce n'est pas un livre que nous lisons mais une pelote, une jungle, un enchevêtrement d'être soyeux et collant .
C'est un amas de langage à la dynamique étourdissante où les relations interpersonnelles forment un agglomérat informe peu tangible même s'il dégouline de honte, de vanité, veulerie, rancœurs et faiblesses. Existent-ils autrement que par ces bouts de langage, les Guimier, ? Et Germaine Lemaire (Maine pour les intimes) est-elle autre chose que ce fantasme habillé d'on-dit ?
Telle l'araignée, notre esprit sinon notre corps vrombit à la moindre palpitation de l'une des cordes qui forme la toile de notre lecture, l'une des répliques dites ou pensées par n'importe lequel des personnages. Aussi entrons-nous d'emblée dans ce grand planétarium, dans cette immense toile filée par Nathalie Sarraute avec son roman à la forme bizarre, compacte et mouvante, grossissant sous nos yeux, même le livre refermé.
Des planètes peut-être le sommes-nous mais telles des boules de jongleurs, nous sommes entraînés par le moindre des mouvements de la constellation rayonnant autour de notre orbite - être vivants et personnages de romans compris . Et notre unicité nous ne la devons qu'au contact souvent douloureux et brûlant des corps célestes qui nous entourent.
Sommes-nous ces cocons ivres de la vie des autres, de leurs paroles aussi gluantes que le liquide amniotique ambiant censé nous protéger mais qui nous étouffe.
Étouffant. Voilà le mot. L'écriture de Nathalie Sarraute est d'une telle densité, une telle proximité non seulement avec le discours mais avec le vécu, le ressenti, le peu conscient, le refoulé que l'air y circule peu. Dans sa prose à nulle autre comparable, mêlant dialogues, monologues intérieurs, reliquats de pensée, de non-pensée, d'orgueilleux soubresauts de l'âme et de verbeux hoquets de dégoût, l'auteure (ou l'autrice, je ne me suis pas encore décidé) tisse sa toile littéraire, nous enveloppe de tous les sucs sociaux et psychologiques que le langage a pu produire. Les personnages s'y débattent tandis que le lecteur tente de surnager dans le réseau romanesque dans lequel il s'est lui-même jeté en ouvrant ce planétarium. Non ce n'est pas un livre que nous lisons mais une pelote, une jungle, un enchevêtrement d'être soyeux et collant .
C'est un amas de langage à la dynamique étourdissante où les relations interpersonnelles forment un agglomérat informe peu tangible même s'il dégouline de honte, de vanité, veulerie, rancœurs et faiblesses. Existent-ils autrement que par ces bouts de langage, les Guimier, ? Et Germaine Lemaire (Maine pour les intimes) est-elle autre chose que ce fantasme habillé d'on-dit ?
Telle l'araignée, notre esprit sinon notre corps vrombit à la moindre palpitation de l'une des cordes qui forme la toile de notre lecture, l'une des répliques dites ou pensées par n'importe lequel des personnages. Aussi entrons-nous d'emblée dans ce grand planétarium, dans cette immense toile filée par Nathalie Sarraute avec son roman à la forme bizarre, compacte et mouvante, grossissant sous nos yeux, même le livre refermé.
Des planètes peut-être le sommes-nous mais telles des boules de jongleurs, nous sommes entraînés par le moindre des mouvements de la constellation rayonnant autour de notre orbite - être vivants et personnages de romans compris . Et notre unicité nous ne la devons qu'au contact souvent douloureux et brûlant des corps célestes qui nous entourent.
C'est long à mourir, très globalement illisible, à rallonge et particulièrement casse-tête à décortiquer pour des informations finalement pas si compliquées que cela à dire. le nouveau roman aurait gagné à être vulgarisé et expliqué correctement : on a l'impression qu'il faut avoir un style compliqué pour bien montrer que la théorie du nouveau roman est vraiment une nouveauté, oui vraiment, et si c'est obscur c'est que vos êtes trop attaché à ce que vous connaissez. pas étonnant que le nouveau roman soit passé de mode.
Il n’est pas besoin d’être un grand philologue pour comprendre que Le Silence est un pur exercice de style, intellectualiste et universitarien, issu d’une époque qui finissait de confire en académisme d’iconoclastes où tout ce qui était estampillé « nouveau » s’inscrivait à plein au cœur de la vogue, et qui publiait quantité de livres faciles à écrire et à louer, et beaucoup plus d’essais anodins que de chefs-d’œuvre : on n’osait plus déclarer que c’était piètre et minéral, que ça ne tenait d’aucune envergure, que c’était de la littérature de poseur douceâtre après les justes insultes d’auteurs fin-de-siècle, on adulait encore Sartre pour ses lapalissades morales de lycéens. Or, je crois pouvoir expliquer la genèse de cette œuvre : c’est l’occasion où un auteur trouva ingénieux de définir le plus exhaustivement la notion de « silence en société » dans une pièce de théâtre, et judicieux de proposer un personnage dont le mutisme obstiné trouble autrui, ou choque, ou amuse, et pertinent de suggérer que cette « problématique » s’inscrit en un ordre forcément métaphysique et « politico-sociale », malgré beaucoup de surestime patente, ce qui constitue la marque des « grands écrivains » français entre 1945 et 1970 : ce sera par ailleurs l’occasion pour Sarraute de développer l’idée de « tropisme », son exclusivité savante « à elle » et sa fierté puérile, idée selon laquelle on admet un cheminement sentimental intérieur de crise pour la moindre variation d’humeur, que l’auteur explicite à l’excès comme si le personnage devait hurler en totale désespérance une banale envie d’uriner. Le Silence est un exercice de 45 pages écrites en gros caractères sur le maximum de significations psychologiques qu’on peut prêter à un silence qui intervient dans une conversation mondaine, pièce rédigée par un auteur qui, probablement incapable de distinguer ses bonnes de ses mauvaises inspirations, les livre toutes sans distinction à la faveur d’éditeurs complaisants.
Il est vrai que le problème du silence – entendre : le silence pris comme objet foncier de l’intrigue, comme sujet même et pas seulement comme accessoire dramaturgique – est, je crois, relativement inédit au théâtre ; ne tout de même pas considérer le paradoxe d’un acteur-qui-ne-dit-rien comme une innovation géniale : c’est une idée qui traverse l’esprit de tout dramaturge débutant quand il répartit des répliques et des rôles et en envisage des alternatives. Pour autant, beaucoup d’inédits artistiques se justifient aussi par leur absence d’intérêt : c’est selon moi où se situe cette pièce, qui demeure une sorte d’objet conceptuel – et à peu près tout ce que l’art a exposé de « conceptuel » repose sur une supercherie généralement sue –, s’agissant d’un silence auquel l’auteur ne prend même pas la peine, c’est-à-dire ne fait même pas l’effort, de constituer une valeur plausible, de l’introduire avec habileté dans un contexte, de le faire suggérer au lieu d’inciter les acteurs à crier et à trembler sur des présomptions immédiates et insensées – qu’on peut bien appeler « tropisme » si l’on veut, qui ne sont que façons d’hystérie qu’une convention théâtrale essaie de passer pour raisonnables et édifiantes. Ce n’est même pas un silence relevant d’une élaboration d’intrigue, par exemple d’un secret, d’une honte, d’un jugement, etc. mais ce sont toutes les hypothèses l’une après l’autre, avec un minimum de lien seulement pour que ça ne semble pas trop arbitraire et qu’on puisse en rédiger des notes. Si l’on doute de la facilité à fabriquer du théâtre-par-thèmes, c’est qu’on n’est pas écrivain, qu’on n’a pas seulement tenté de l’être ; qu’on s’y essaie une fois et l’on verra qu’en quelques minutes on peut concevoir l’originalité d’une œuvre littéraire… : sans dialogue, sans mouvement, sans sujet, sans esprit de conséquence, sans temporalité, ou, pourquoi pas, sans la lettre « i », etc. Ce fut largement le projet du Nouveau-roman de réaliser des textes que nul ne veut lire par tentatives exclusives de fabriquer des idées bizarres, ostensibles et « patrimoniales », et ce fut aussi largement son destin de connaître en tant qu’école une notoriété historique par défaut de concurrence et qui fut bien proportionnelle à son innocuité en tant que courant de pensée et qu’influence artistique.
C’est ennuyeux, invraisemblable, ampoulé et objectivement vide, sans une idée décisive et mâle, quoique indéniablement masculin en un style de recherche crâne et concerné. Ce désir de « faire viril », qui caractérise le style de beaucoup de femmes écrivains jusqu’à nos jours, se perçoit particulièrement dans la désignation des personnages qui, faute de disposer de prénoms, seront (sauf un d’eux) des H. (pour « homme ») et des F. (pour « femme »), suivis d’un numéro ; on a donc : « H. 1 », « F. 3 », etc. (dans la liste des personnages, les hommes (les « H. ») sont annoncés avant les femmes). Or, combien de possibilités élégantes étaient permises, au lieu de ces désignations de cobayes ! On pouvait écrire, en tragédie antique : « Premier homme », « Troisième femme », ou, si l’on craignait de suggérer une hiérarchie : « Homme numéro un », « Femme numéro trois ». Mais l’aspect d’objectivité froide d’une stricte numérotation avec initiale confère une stature scientifique et mâle qui est propre à ces auteurs féminines soucieuses d’insertions et de succès dans une communauté d’hommes. Je ne fais pas ici dans le symbole : il est évident, si l’on y songe comme auteur, que l’écriture de ces noms permettait beaucoup de variétés et que le choix de Sarraute s’est porté sur ce qui fait crânement masculin. L’intention est nette : « Je vais (une fois de plus dans l’histoire de la littérature) me départir de personnalité et m’associer à une neutralité d’hommes qui consiste elle-même en une dépersonnalisation de distance et pour l’honneur. » C’est lâche et ce n’est pas artiste ; c’est superficiel en révélant le désir d’une mondanité jusque dans la création.
Pourtant, comme pour tout ce qui manque de profondeur ou qui sur bien des points n’est pas « fini », on peut en échafauder à l’envi une multitude de « pistes-d’interprétation » chargées de parachever l’ouvrage à la place de l’auteur, et c’est pourquoi on en fit comme d’ordinaire un symbole et même un ensemble de symboles peut-être contradictoires, et c’est aussi pourquoi la pièce constitue cette année une œuvre-pour-agrégatifs. Mais même l’étudiant, pourvu qu’il soit sincère, trouvera qu’en comparaison des drames qu’il a pu lire, celui-ci rend un son creux, une sécheresse emphatique, verbosité prétentieuse qui n’intéresse guère malgré la recommandation de ses professeurs : il faut certainement un abondant renfort didactique et biographique pour parvenir à donner sur l’œuvre, à force de déformations du jugement critique, une impression favorable, par rebonds de tout ce qu’il y a de connexe à l’œuvre même – ça se lit, ça s’oublie, il n’en reste que des fiches thématiques ordonnées, des cours à répéter sans passion comme un devoir de professionnel. À vrai dire, je plains beaucoup les Agrégatifs de devoir apprendre cela, de s’efforcer d’en extraire une matière qui soit mieux qu’anecdotique et artificielle, notamment de s’abîmer l’esprit jusqu’à se persuader peut-être qu’une dizaine de citations à retenir vaudront une synthèse intéressante. Et comme ce n’est pas une mais deux œuvres de Sarraute qui tombent cette année, j’estime probable que des jurés proposent une question de littérature comparée aux candidats, notamment à l’oral, sur ces pièces. Et certes elles ne sont pas longues, mais si l’on y songe, on trouvera que c’est peut-être pire, parce que cela signifie qu’il va falloir « délirer » longtemps pour en dresser l’académique éloge ; ce sera tout à fait une manière de dévoiement du sens artistique pour les futurs enseignants…
Il y a pourtant quelque chose de comique dans ce livre – c’est une drôlerie qu’il est bien entendu défendu de remarquer à l’Agrégation –, c’est la façon dont le préfacier Rykner défend la pièce de Sarraute coûte que coûte, sans la moindre distance, selon la méthode obligatoire des enseignants érudits, sans personnalité pour jamais suggérer un défaut puisque c’est l’Auteur. J’écris « comique » et le pense vraiment, sans sarcasme : c’est un homme qui sent que la pièce ne vaut que comme illustration d’un courant littéraire et qui, pour le cacher, use d’emblée de la prétérition c’est-à-dire qu’il évacue le fardeau du prohibé pour le soulagement de l’avoir déjà écrit : « Replacer Le Silence dans le contexte de sa rédaction – le début des années soixante et l’apogée du « Nouveau Théâtre » – risquerait fort de nous entraîner à n’en faire qu’une anti-pièce de plus parmi la multitude de celles qui fleurirent alors » (page 9) ; et voici un guide qui pense tellement fort ce qu’il n’est pas censé dire qu’il l’exprime d’emblée pour s’en débarrasser. Puis, quand il dresse un court répertoire de critiques négatives d’époque sur la pièce, et qui me paraissent plus que mesurées puisqu’aucune n’éreinte (ce qui me semblerait, à moi, mesuré), il faut absolument qu’il en signale « l’injustice », mais de façon si maladroite qu’on se demande si un esprit intelligent et conséquent a pu écrire de telles contradictions : « On ne saurait montrer la mécompréhension avec laquelle la pièce fut reçue par certains… Laboratoire intellectuel, expérience littéraire sans réalité scénique, Le Silence serait tout sauf du théâtre. Et c’est vrai en un sens ! » (pages 79-80) Valait-il bien la peine pour Rykner de s’indigner de ce qu’il reconnaît immédiatement une vérité ? Il atteint le comble de la naïveté et de la mauvaise foi peu après : « Tous les journalistes cependant, tant s’en faut, n’ont pas affiché la même myopie – qu’il est, reconnaissons-le, toujours facile de dénoncer avec le recul. » (page 80) : c’est à ces citations qu’on décèle précisément le processus de sélection des œuvres par le critique opportuniste. Il faut bien la relire, c’est un cas élémentaire de psychologie et qui doit servir pour confondre un universitarien passablement maladroit : des journalistes ont donc été « myopes » faute d’avoir eu le « recul » de connaître le succès de Sarraute avant qu’il se produise, autrement dit comme ils ignoraient alors que ce théâtre aurait une certaine gloire, ils pouvaient se tromper en en disant du mal. On doit donc comprendre que, selon Rykner, c’est la notoriété qui permet d’orienter la critique vers le juste ou l’injuste : il ne s’agit que d’anticiper cette notoriété, et d’y correspondre. C’est, à bien y réfléchir, la méthode habituelle des professeurs : relever ce qui a plu et s’accorder avec ce triomphe en tâchant de trouver après coup les qualités du textes susceptibles d’y avoir contribué. Je ne crois sincèrement pas exagérer l’implicite du préfacier : ces journalistes ont eu tort de la dénigrer parce que Sarraute est devenue célèbre ; inversement : Sarraute fut connue et appréciée ergo c’est un auteur de talent ; nul doute que Rykner procède de la belle façon : quelle pauvre espèce d’esprit et de critique ! Il n’est pas difficile d’avoir bonne vue quand on dispose des lunettes correctrices – des loupes grossières ! – de ce que le siècle présente comme respectable ! Mais on reconnaît la vanité d’un tel homme à un attribut qu’il faut lui admettre, qui est plus rare qu’on ne pense et que je ne remarque si caractérisée que dans peu de dossiers, c’est, quand il disserte d’une œuvre, de pouvoir en faire des commentaires qui s’appliqueraient aussi bien à n’importe quelle œuvre du même genre général. Un exemple ? la conclusion même de ces notes ; mais procédons par test. Concevez, je vous prie, une œuvre théâtrale, n’importe quel titre, de n’importe quelle époque. Est-ce fait ? l’avez-vous bien en tête ? Parfait. Or, ne trouvez pas de cette pièce la vérité suivante, que : « ce langage dramatique, il nous appartient encore aujourd’hui de le découvrir dans toute sa richesse, en faisant abstraction de toute idée reçue et en prêtant l’oreille à ce monde intérieur en ébullition qui nous est donné à voir dans la violence et l’humour mêlés qui sont les siens. » ? (page 81) Je suppose que ça s’adapte à peu près.
Pour revenir à cette conclusion si « œcuménique », j’ignore – sauf à présumer comme ils font tous avec excès et perpétuellement en faveur des livres-du-patrimoine-français, c’est-à-dire de manière partiale, c’est-à-dire en adhésion avec les valeurs et les dogmes, et c’est-à-dire presque sans philologie scientifique – comme on peut avoir trouvé à Le Silence de l’humour : je mets au défi quiconque d’en citer un passage qui prête à sourire, à moins que ce ne soit par contraste avec la morne solennité incrédible de l’ensemble, évoquant l’inutilité bavarde d’un Huis-clos de Sartre. Je sais bien que, quand on va au théâtre à Paris, on voit parfois des salles entières qui rient avant que ce soit drôle, et non seulement cela mais avec une démesure très singulière et quelque peu inquiétante : il faut entendre qu’on rit parce qu’on a d’abord su que la pièce était comique et qu’on veut recevoir la détente pour l’argent qu’on a dépensé ; en somme, le contenu de l’œuvre dramatique n’a plus guère de rapport avec la réaction du spectateur, du lecteur ou du critique. Je veux bien, c’est tout à fait ce qu’il faut à des Agrégatifs : les émotions édifiantes qu’on leur dicte et qu’ils sont censés inclure en quantité stœchiométrique (et toujours un peu mystérieuse) dans leurs copies, feignant de les avoir remarquées eux-mêmes ou en s’en étant persuadés. Mais pour moi, il m’est venu une image personnelle et éloquente de presque tout ce que j’ai lu de Sarraute jusqu’à présent, et si une telle vision ne parlera pas à tous et ne doit point entrer dans la composition d’une dissertation-avec-introduction-en-tant-de-parties, elle me suffit à moi, et probablement à ceux qui convertissent les réalités qu’ils fréquentent en auras poétiques transposables en couleurs et en signes ; et voilà comme je visualise Sarraute, ce qui inclut son œuvre :
Une femme condamnée à être un peu trop sérieuse et qui, avec une fausse audace, sort en ville le soir, le mollet nu, dans un imperméable beige pour homme.
Il est vrai que le problème du silence – entendre : le silence pris comme objet foncier de l’intrigue, comme sujet même et pas seulement comme accessoire dramaturgique – est, je crois, relativement inédit au théâtre ; ne tout de même pas considérer le paradoxe d’un acteur-qui-ne-dit-rien comme une innovation géniale : c’est une idée qui traverse l’esprit de tout dramaturge débutant quand il répartit des répliques et des rôles et en envisage des alternatives. Pour autant, beaucoup d’inédits artistiques se justifient aussi par leur absence d’intérêt : c’est selon moi où se situe cette pièce, qui demeure une sorte d’objet conceptuel – et à peu près tout ce que l’art a exposé de « conceptuel » repose sur une supercherie généralement sue –, s’agissant d’un silence auquel l’auteur ne prend même pas la peine, c’est-à-dire ne fait même pas l’effort, de constituer une valeur plausible, de l’introduire avec habileté dans un contexte, de le faire suggérer au lieu d’inciter les acteurs à crier et à trembler sur des présomptions immédiates et insensées – qu’on peut bien appeler « tropisme » si l’on veut, qui ne sont que façons d’hystérie qu’une convention théâtrale essaie de passer pour raisonnables et édifiantes. Ce n’est même pas un silence relevant d’une élaboration d’intrigue, par exemple d’un secret, d’une honte, d’un jugement, etc. mais ce sont toutes les hypothèses l’une après l’autre, avec un minimum de lien seulement pour que ça ne semble pas trop arbitraire et qu’on puisse en rédiger des notes. Si l’on doute de la facilité à fabriquer du théâtre-par-thèmes, c’est qu’on n’est pas écrivain, qu’on n’a pas seulement tenté de l’être ; qu’on s’y essaie une fois et l’on verra qu’en quelques minutes on peut concevoir l’originalité d’une œuvre littéraire… : sans dialogue, sans mouvement, sans sujet, sans esprit de conséquence, sans temporalité, ou, pourquoi pas, sans la lettre « i », etc. Ce fut largement le projet du Nouveau-roman de réaliser des textes que nul ne veut lire par tentatives exclusives de fabriquer des idées bizarres, ostensibles et « patrimoniales », et ce fut aussi largement son destin de connaître en tant qu’école une notoriété historique par défaut de concurrence et qui fut bien proportionnelle à son innocuité en tant que courant de pensée et qu’influence artistique.
C’est ennuyeux, invraisemblable, ampoulé et objectivement vide, sans une idée décisive et mâle, quoique indéniablement masculin en un style de recherche crâne et concerné. Ce désir de « faire viril », qui caractérise le style de beaucoup de femmes écrivains jusqu’à nos jours, se perçoit particulièrement dans la désignation des personnages qui, faute de disposer de prénoms, seront (sauf un d’eux) des H. (pour « homme ») et des F. (pour « femme »), suivis d’un numéro ; on a donc : « H. 1 », « F. 3 », etc. (dans la liste des personnages, les hommes (les « H. ») sont annoncés avant les femmes). Or, combien de possibilités élégantes étaient permises, au lieu de ces désignations de cobayes ! On pouvait écrire, en tragédie antique : « Premier homme », « Troisième femme », ou, si l’on craignait de suggérer une hiérarchie : « Homme numéro un », « Femme numéro trois ». Mais l’aspect d’objectivité froide d’une stricte numérotation avec initiale confère une stature scientifique et mâle qui est propre à ces auteurs féminines soucieuses d’insertions et de succès dans une communauté d’hommes. Je ne fais pas ici dans le symbole : il est évident, si l’on y songe comme auteur, que l’écriture de ces noms permettait beaucoup de variétés et que le choix de Sarraute s’est porté sur ce qui fait crânement masculin. L’intention est nette : « Je vais (une fois de plus dans l’histoire de la littérature) me départir de personnalité et m’associer à une neutralité d’hommes qui consiste elle-même en une dépersonnalisation de distance et pour l’honneur. » C’est lâche et ce n’est pas artiste ; c’est superficiel en révélant le désir d’une mondanité jusque dans la création.
Pourtant, comme pour tout ce qui manque de profondeur ou qui sur bien des points n’est pas « fini », on peut en échafauder à l’envi une multitude de « pistes-d’interprétation » chargées de parachever l’ouvrage à la place de l’auteur, et c’est pourquoi on en fit comme d’ordinaire un symbole et même un ensemble de symboles peut-être contradictoires, et c’est aussi pourquoi la pièce constitue cette année une œuvre-pour-agrégatifs. Mais même l’étudiant, pourvu qu’il soit sincère, trouvera qu’en comparaison des drames qu’il a pu lire, celui-ci rend un son creux, une sécheresse emphatique, verbosité prétentieuse qui n’intéresse guère malgré la recommandation de ses professeurs : il faut certainement un abondant renfort didactique et biographique pour parvenir à donner sur l’œuvre, à force de déformations du jugement critique, une impression favorable, par rebonds de tout ce qu’il y a de connexe à l’œuvre même – ça se lit, ça s’oublie, il n’en reste que des fiches thématiques ordonnées, des cours à répéter sans passion comme un devoir de professionnel. À vrai dire, je plains beaucoup les Agrégatifs de devoir apprendre cela, de s’efforcer d’en extraire une matière qui soit mieux qu’anecdotique et artificielle, notamment de s’abîmer l’esprit jusqu’à se persuader peut-être qu’une dizaine de citations à retenir vaudront une synthèse intéressante. Et comme ce n’est pas une mais deux œuvres de Sarraute qui tombent cette année, j’estime probable que des jurés proposent une question de littérature comparée aux candidats, notamment à l’oral, sur ces pièces. Et certes elles ne sont pas longues, mais si l’on y songe, on trouvera que c’est peut-être pire, parce que cela signifie qu’il va falloir « délirer » longtemps pour en dresser l’académique éloge ; ce sera tout à fait une manière de dévoiement du sens artistique pour les futurs enseignants…
Il y a pourtant quelque chose de comique dans ce livre – c’est une drôlerie qu’il est bien entendu défendu de remarquer à l’Agrégation –, c’est la façon dont le préfacier Rykner défend la pièce de Sarraute coûte que coûte, sans la moindre distance, selon la méthode obligatoire des enseignants érudits, sans personnalité pour jamais suggérer un défaut puisque c’est l’Auteur. J’écris « comique » et le pense vraiment, sans sarcasme : c’est un homme qui sent que la pièce ne vaut que comme illustration d’un courant littéraire et qui, pour le cacher, use d’emblée de la prétérition c’est-à-dire qu’il évacue le fardeau du prohibé pour le soulagement de l’avoir déjà écrit : « Replacer Le Silence dans le contexte de sa rédaction – le début des années soixante et l’apogée du « Nouveau Théâtre » – risquerait fort de nous entraîner à n’en faire qu’une anti-pièce de plus parmi la multitude de celles qui fleurirent alors » (page 9) ; et voici un guide qui pense tellement fort ce qu’il n’est pas censé dire qu’il l’exprime d’emblée pour s’en débarrasser. Puis, quand il dresse un court répertoire de critiques négatives d’époque sur la pièce, et qui me paraissent plus que mesurées puisqu’aucune n’éreinte (ce qui me semblerait, à moi, mesuré), il faut absolument qu’il en signale « l’injustice », mais de façon si maladroite qu’on se demande si un esprit intelligent et conséquent a pu écrire de telles contradictions : « On ne saurait montrer la mécompréhension avec laquelle la pièce fut reçue par certains… Laboratoire intellectuel, expérience littéraire sans réalité scénique, Le Silence serait tout sauf du théâtre. Et c’est vrai en un sens ! » (pages 79-80) Valait-il bien la peine pour Rykner de s’indigner de ce qu’il reconnaît immédiatement une vérité ? Il atteint le comble de la naïveté et de la mauvaise foi peu après : « Tous les journalistes cependant, tant s’en faut, n’ont pas affiché la même myopie – qu’il est, reconnaissons-le, toujours facile de dénoncer avec le recul. » (page 80) : c’est à ces citations qu’on décèle précisément le processus de sélection des œuvres par le critique opportuniste. Il faut bien la relire, c’est un cas élémentaire de psychologie et qui doit servir pour confondre un universitarien passablement maladroit : des journalistes ont donc été « myopes » faute d’avoir eu le « recul » de connaître le succès de Sarraute avant qu’il se produise, autrement dit comme ils ignoraient alors que ce théâtre aurait une certaine gloire, ils pouvaient se tromper en en disant du mal. On doit donc comprendre que, selon Rykner, c’est la notoriété qui permet d’orienter la critique vers le juste ou l’injuste : il ne s’agit que d’anticiper cette notoriété, et d’y correspondre. C’est, à bien y réfléchir, la méthode habituelle des professeurs : relever ce qui a plu et s’accorder avec ce triomphe en tâchant de trouver après coup les qualités du textes susceptibles d’y avoir contribué. Je ne crois sincèrement pas exagérer l’implicite du préfacier : ces journalistes ont eu tort de la dénigrer parce que Sarraute est devenue célèbre ; inversement : Sarraute fut connue et appréciée ergo c’est un auteur de talent ; nul doute que Rykner procède de la belle façon : quelle pauvre espèce d’esprit et de critique ! Il n’est pas difficile d’avoir bonne vue quand on dispose des lunettes correctrices – des loupes grossières ! – de ce que le siècle présente comme respectable ! Mais on reconnaît la vanité d’un tel homme à un attribut qu’il faut lui admettre, qui est plus rare qu’on ne pense et que je ne remarque si caractérisée que dans peu de dossiers, c’est, quand il disserte d’une œuvre, de pouvoir en faire des commentaires qui s’appliqueraient aussi bien à n’importe quelle œuvre du même genre général. Un exemple ? la conclusion même de ces notes ; mais procédons par test. Concevez, je vous prie, une œuvre théâtrale, n’importe quel titre, de n’importe quelle époque. Est-ce fait ? l’avez-vous bien en tête ? Parfait. Or, ne trouvez pas de cette pièce la vérité suivante, que : « ce langage dramatique, il nous appartient encore aujourd’hui de le découvrir dans toute sa richesse, en faisant abstraction de toute idée reçue et en prêtant l’oreille à ce monde intérieur en ébullition qui nous est donné à voir dans la violence et l’humour mêlés qui sont les siens. » ? (page 81) Je suppose que ça s’adapte à peu près.
Pour revenir à cette conclusion si « œcuménique », j’ignore – sauf à présumer comme ils font tous avec excès et perpétuellement en faveur des livres-du-patrimoine-français, c’est-à-dire de manière partiale, c’est-à-dire en adhésion avec les valeurs et les dogmes, et c’est-à-dire presque sans philologie scientifique – comme on peut avoir trouvé à Le Silence de l’humour : je mets au défi quiconque d’en citer un passage qui prête à sourire, à moins que ce ne soit par contraste avec la morne solennité incrédible de l’ensemble, évoquant l’inutilité bavarde d’un Huis-clos de Sartre. Je sais bien que, quand on va au théâtre à Paris, on voit parfois des salles entières qui rient avant que ce soit drôle, et non seulement cela mais avec une démesure très singulière et quelque peu inquiétante : il faut entendre qu’on rit parce qu’on a d’abord su que la pièce était comique et qu’on veut recevoir la détente pour l’argent qu’on a dépensé ; en somme, le contenu de l’œuvre dramatique n’a plus guère de rapport avec la réaction du spectateur, du lecteur ou du critique. Je veux bien, c’est tout à fait ce qu’il faut à des Agrégatifs : les émotions édifiantes qu’on leur dicte et qu’ils sont censés inclure en quantité stœchiométrique (et toujours un peu mystérieuse) dans leurs copies, feignant de les avoir remarquées eux-mêmes ou en s’en étant persuadés. Mais pour moi, il m’est venu une image personnelle et éloquente de presque tout ce que j’ai lu de Sarraute jusqu’à présent, et si une telle vision ne parlera pas à tous et ne doit point entrer dans la composition d’une dissertation-avec-introduction-en-tant-de-parties, elle me suffit à moi, et probablement à ceux qui convertissent les réalités qu’ils fréquentent en auras poétiques transposables en couleurs et en signes ; et voilà comme je visualise Sarraute, ce qui inclut son œuvre :
Une femme condamnée à être un peu trop sérieuse et qui, avec une fausse audace, sort en ville le soir, le mollet nu, dans un imperméable beige pour homme.
France-culture a sélectionné ce roman dans son émission « les romans qui ont changé le monde » le 22 août dernier. Une opportunité de découvrir cette autobiographie, où l’auteure, Nathalie Sarraute, âgée alors de 81 ans, raconte les premières onze années de sa vie entre Moscou, Pétersbourg, Genève et Paris.
Sous une forme particulière avec « un dialogue avec un « je » imaginaire », qui tente d’exprimer les sensations le plus fidèlement possible, avec un souci d’observation précise des réactions instinctives à un signe extérieur : un regard, une parole, un mouvement…hors du champ de la volonté.
D’une enfant entre des parents divorcés, sa mère fascinante et absente, un père aimant, tendre et attentif et une belle-mère au comportement instable vis à vis d’elle.
Une narration linéaire sans intrigue, avec des fragments d’une enfance restituée comme tels, dans un enchaînement qui peut sembler lié au hasard et rend compte de la remontée des souvenirs au fil de l’introspection, en donne une forme moderne, toujours moderne à ce jour, qui reste logique.
Un excellent moment de lecture avec des moments d’émotion, qui ont résonné en moi.
Sous une forme particulière avec « un dialogue avec un « je » imaginaire », qui tente d’exprimer les sensations le plus fidèlement possible, avec un souci d’observation précise des réactions instinctives à un signe extérieur : un regard, une parole, un mouvement…hors du champ de la volonté.
D’une enfant entre des parents divorcés, sa mère fascinante et absente, un père aimant, tendre et attentif et une belle-mère au comportement instable vis à vis d’elle.
Une narration linéaire sans intrigue, avec des fragments d’une enfance restituée comme tels, dans un enchaînement qui peut sembler lié au hasard et rend compte de la remontée des souvenirs au fil de l’introspection, en donne une forme moderne, toujours moderne à ce jour, qui reste logique.
Un excellent moment de lecture avec des moments d’émotion, qui ont résonné en moi.
Par le biais d'un dialogue entre elle, la narratrice, et son double qui la questionne, la corrige, Nathalie Sarraute exhume son enfance, partagée entre la Russie et la France, entre sa mère et son père, séparés depuis qu'elle a deux ans seulement. On parle des années 1900.
Il n'y a aucun fait extraordinaire dans cette autobiographie des limbes. Aucun personnage hors du commun. Et pourtant, rien n'est anodin pour la fillette qu'elle fut. Dans une langue travaillée où les mots sont ajustés comme les lames d'un parquet, Nathalie Sarraute nous dévoile ses peurs, ses joies, ses traumatismes. Sans jamais juger ses parents, sa belle-mère ni aucun des êtres qui peuplèrent son enfance, elle dévoile avec intelligence, tact et talent ses souvenirs, en leur mêlant les interrogations qu'ils suscitent encore chez la vieille dame (ce récit est publié alors qu'elle a 83 ans).
Il n'y a aucun fait extraordinaire dans cette autobiographie des limbes. Aucun personnage hors du commun. Et pourtant, rien n'est anodin pour la fillette qu'elle fut. Dans une langue travaillée où les mots sont ajustés comme les lames d'un parquet, Nathalie Sarraute nous dévoile ses peurs, ses joies, ses traumatismes. Sans jamais juger ses parents, sa belle-mère ni aucun des êtres qui peuplèrent son enfance, elle dévoile avec intelligence, tact et talent ses souvenirs, en leur mêlant les interrogations qu'ils suscitent encore chez la vieille dame (ce récit est publié alors qu'elle a 83 ans).
Lecture si émouvante. Ce dispositif à deux voix nous immerge très facilement dans la mémoire de Nathalie Sarraute, mémoire qu’elle semble très peu réécrire. Tout est dans le sensible. Comment expliquer ces souvenirs cotonneux et fondateurs, douloureux ou heureux…
Une des dernières phrases sublime sur la relation père-fille :
« C’est ainsi qu’il m’appelle parfois (…) Plus jamais Tachok, mais ma fille, ma petite fille, mon enfant… et ce que je sens dans ces mots, sans jamais me le dire clairement, c’est comme l’affirmation un peu douloureuse d’un lien à part qui nous unit… comme l’assurance de son constant soutien, et aussi un peu comme un défi… »
Je me demande quel est le lien entre Nathalie Sarraute et Annie Ernaux - j’y vois quelques ressemblances.
Une des dernières phrases sublime sur la relation père-fille :
« C’est ainsi qu’il m’appelle parfois (…) Plus jamais Tachok, mais ma fille, ma petite fille, mon enfant… et ce que je sens dans ces mots, sans jamais me le dire clairement, c’est comme l’affirmation un peu douloureuse d’un lien à part qui nous unit… comme l’assurance de son constant soutien, et aussi un peu comme un défi… »
Je me demande quel est le lien entre Nathalie Sarraute et Annie Ernaux - j’y vois quelques ressemblances.
Enfance /Nathalie Sarraute
Nathalie Sarraute, de son vrai nom Natalia (ou aussi Natacha) Tcherniak est née à Ivanovo en Russie en 1900 et morte à Paris en 1999. Elle devint l’une des figures du Nouveau Roman avec la publication en 1956 de son roman « L’ère du soupçon ».
Présentement, il s’agit d’un récit autobiographique concernant son enfance mouvementée. Née au sein d’une famille de la bourgeoisie juive assimilée, famille bientôt déchirée par un divorce quand elle a deux ans, elle est ballottée entre sa mère en Suisse puis en France et en Russie et son père à Paris, chacun ayant refait sa vie, sa mère à Saint - Pétersbourg et son père à Paris. La vie chez son père avec Véra sa belle-mère est très mal vécue par l’enfant entre 1909 et 1917 et constitue l’essentiel de ce récit écrit sous la forme originale d’un dialogue entre Nathalie et son double, sa conscience en somme, qui la met souvent en garde et exprime des scrupules, s’interroge sur la conduite à adopter dans les situations difficile qui ne manquent pas. Une voix assume la conduite du récit et l’autre est la conscience critique.
L’absence de sa mère notamment la fait souffrir et quand elle se remémore plus tard tous ces souvenirs, sa mère n’apparaît jamais. Nathalie s’interroge sur la vraie nature de sa mère qui est froide et distante avec elle, et qui finira par l’abandonner à son père quand elle a neuf ans. Et puis elle évoque cette petite Lili, sa demie sœur qu’elle qualifie de petit être criard, hagard, insensible, malfaisant, un diable, un démon…dont elle est jalouse, couvée qu’elle est par sa mère, Véra.
Ce n’est que bien plus tard qu’elle renouera avec sa mère.
Publiée en 1983, cette autobiographie écrite dans un style fluide et vivant se lit très facilement et couvre les onze premières années de la vie de Nathalie. C’était l’époque où à l’école on apprenait par cœur les départements français avec leur préfecture et sous préfectures, les capitales des états, les règles de grammaire, les fables de La Fontaine, les dates des grandes batailles de l’Histoire (Poitiers, Marignan, Austerlitz… etc. Époque qui a duré jusque dans le années 60 et que j’ai bien connue.
Un témoignage émouvant de cette enfance tourmentée qui voit déjà naître une vocation d’écrivain pour la jeune Natalia qui en a conscience, passionnée par la rédaction de ses devoirs de français pour lesquels elle ne vise que la meilleure note et par la lecture de tous les livres qui lui tombent sous la main. Partagée entre son âme russe et son cœur français, elle est une enfant sensible et son imagination n’a pas de limite. Joies et déceptions se succèdent souvent au gré des paroles des adultes qui peuvent réjouir ou blesser.
Pour elle son enfance cesse le jour où elle entre au lycée Fénelon.
Une très belle autobiographie d’une enfance subtilement évoquée avec nuances et élégance.
Nathalie Sarraute, de son vrai nom Natalia (ou aussi Natacha) Tcherniak est née à Ivanovo en Russie en 1900 et morte à Paris en 1999. Elle devint l’une des figures du Nouveau Roman avec la publication en 1956 de son roman « L’ère du soupçon ».
Présentement, il s’agit d’un récit autobiographique concernant son enfance mouvementée. Née au sein d’une famille de la bourgeoisie juive assimilée, famille bientôt déchirée par un divorce quand elle a deux ans, elle est ballottée entre sa mère en Suisse puis en France et en Russie et son père à Paris, chacun ayant refait sa vie, sa mère à Saint - Pétersbourg et son père à Paris. La vie chez son père avec Véra sa belle-mère est très mal vécue par l’enfant entre 1909 et 1917 et constitue l’essentiel de ce récit écrit sous la forme originale d’un dialogue entre Nathalie et son double, sa conscience en somme, qui la met souvent en garde et exprime des scrupules, s’interroge sur la conduite à adopter dans les situations difficile qui ne manquent pas. Une voix assume la conduite du récit et l’autre est la conscience critique.
L’absence de sa mère notamment la fait souffrir et quand elle se remémore plus tard tous ces souvenirs, sa mère n’apparaît jamais. Nathalie s’interroge sur la vraie nature de sa mère qui est froide et distante avec elle, et qui finira par l’abandonner à son père quand elle a neuf ans. Et puis elle évoque cette petite Lili, sa demie sœur qu’elle qualifie de petit être criard, hagard, insensible, malfaisant, un diable, un démon…dont elle est jalouse, couvée qu’elle est par sa mère, Véra.
Ce n’est que bien plus tard qu’elle renouera avec sa mère.
Publiée en 1983, cette autobiographie écrite dans un style fluide et vivant se lit très facilement et couvre les onze premières années de la vie de Nathalie. C’était l’époque où à l’école on apprenait par cœur les départements français avec leur préfecture et sous préfectures, les capitales des états, les règles de grammaire, les fables de La Fontaine, les dates des grandes batailles de l’Histoire (Poitiers, Marignan, Austerlitz… etc. Époque qui a duré jusque dans le années 60 et que j’ai bien connue.
Un témoignage émouvant de cette enfance tourmentée qui voit déjà naître une vocation d’écrivain pour la jeune Natalia qui en a conscience, passionnée par la rédaction de ses devoirs de français pour lesquels elle ne vise que la meilleure note et par la lecture de tous les livres qui lui tombent sous la main. Partagée entre son âme russe et son cœur français, elle est une enfant sensible et son imagination n’a pas de limite. Joies et déceptions se succèdent souvent au gré des paroles des adultes qui peuvent réjouir ou blesser.
Pour elle son enfance cesse le jour où elle entre au lycée Fénelon.
Une très belle autobiographie d’une enfance subtilement évoquée avec nuances et élégance.
Madame Nathalie.
L'Héréso n'a plus rien d'hérétique lorsqu'il défend Nathalie Sarraute. Elle n'est point attaquée mais, thanksfully, il nous remémore l'existence de cette écrivaine polyglotte. Son importance. Ma journée débute, éclairée par un ample article biographique du Monde retranscrit par un internaute inspiré, auteur et metteur-enscène.
Et je me remémore le choc d'Enfance, livre bien-nommé, découvert à trente ans. L'humour de la quatrième de couverture des Fruits d'Or, avec ce personnage indéfini mais si puissant dans sa manière d'exister — comme toujours chez la dame au regard vif, à l'obstination obsessionnelle et truculente — cet homme qui démolit en quatre lignes son propre ouvrage : Les Fruits d'Or, c'est très mauvais... Osé !
Naturellement, on plonge avec délice dans cette satire mordante du milieu littéraire.
Les Fruits d'or, c'est très bon et ça lui vaudra un prix. Je pense avoir tout dévoré de Nathalie Sarraute, de sa vie, de sa correspondance.
L'auteure, le style, l'audace, l'intelligence, le sourire m'ont toujours fasciné. Et puis, on ressentait cette impression d'écrire dans un désert. D'écrire comme personne.
Pour personne au début, ensuite elle fut fêtée.
Sarraute, toujours. Les Fruits d'or — prêté à une actrice qui ne me l'a jamais rendu, tant mieux pour elle, à l'époque où je faisais du prosélytisme — Enfance, le Planétarium…lorsque je replonge dans ces volumes de temps à autre, il est bien question d'un océan vertigineux dans lequel on s'abandonne, tout demeure, tout me revient, je me souviens.
Ouvrez ! — son dernier opus — vivace, malicieux, profond, empli d'humour comme toute son oeuvre.
Indispensable.
Une séquence marquante : elle cherche le nom d'Arcimboldo qui ne lui revient pas. N'arrivent que des fruits, des légumes et ce mot ”audace” — qui lui va tant. Elle nous parle de la mémoire, de sa perte à quatre-vingt-dix-huit ans lorsqu'elle écrit cet ouvrage, lentement dit-elle, très lentement comme elle a toujours écrit. On entend presque : laborieusement. Puis l'anglais bold (audacieux) s'impose et d'un coup, elle retrouve le nom du peintre espéré. Un chapitre haletant sur cette aventure dans laquelle chacun se voit. Sarraute partage et creuse humblement.
Aura passé sa vie à ouvrir des portes interdites avec les poignées du Planétarium, celles qui empêchaient la tante Berthe de dormir parce qu'elle ne les trouvait pas à son goût.
Et le lecteur se retrouve, trouve et relit, inlassablement.
Amoureuse de Proust, bien sûr.
Sarraute, un phare sans fard.
L'Héréso n'a plus rien d'hérétique lorsqu'il défend Nathalie Sarraute. Elle n'est point attaquée mais, thanksfully, il nous remémore l'existence de cette écrivaine polyglotte. Son importance. Ma journée débute, éclairée par un ample article biographique du Monde retranscrit par un internaute inspiré, auteur et metteur-enscène.
Et je me remémore le choc d'Enfance, livre bien-nommé, découvert à trente ans. L'humour de la quatrième de couverture des Fruits d'Or, avec ce personnage indéfini mais si puissant dans sa manière d'exister — comme toujours chez la dame au regard vif, à l'obstination obsessionnelle et truculente — cet homme qui démolit en quatre lignes son propre ouvrage : Les Fruits d'Or, c'est très mauvais... Osé !
Naturellement, on plonge avec délice dans cette satire mordante du milieu littéraire.
Les Fruits d'or, c'est très bon et ça lui vaudra un prix. Je pense avoir tout dévoré de Nathalie Sarraute, de sa vie, de sa correspondance.
L'auteure, le style, l'audace, l'intelligence, le sourire m'ont toujours fasciné. Et puis, on ressentait cette impression d'écrire dans un désert. D'écrire comme personne.
Pour personne au début, ensuite elle fut fêtée.
Sarraute, toujours. Les Fruits d'or — prêté à une actrice qui ne me l'a jamais rendu, tant mieux pour elle, à l'époque où je faisais du prosélytisme — Enfance, le Planétarium…lorsque je replonge dans ces volumes de temps à autre, il est bien question d'un océan vertigineux dans lequel on s'abandonne, tout demeure, tout me revient, je me souviens.
Ouvrez ! — son dernier opus — vivace, malicieux, profond, empli d'humour comme toute son oeuvre.
Indispensable.
Une séquence marquante : elle cherche le nom d'Arcimboldo qui ne lui revient pas. N'arrivent que des fruits, des légumes et ce mot ”audace” — qui lui va tant. Elle nous parle de la mémoire, de sa perte à quatre-vingt-dix-huit ans lorsqu'elle écrit cet ouvrage, lentement dit-elle, très lentement comme elle a toujours écrit. On entend presque : laborieusement. Puis l'anglais bold (audacieux) s'impose et d'un coup, elle retrouve le nom du peintre espéré. Un chapitre haletant sur cette aventure dans laquelle chacun se voit. Sarraute partage et creuse humblement.
Aura passé sa vie à ouvrir des portes interdites avec les poignées du Planétarium, celles qui empêchaient la tante Berthe de dormir parce qu'elle ne les trouvait pas à son goût.
Et le lecteur se retrouve, trouve et relit, inlassablement.
Amoureuse de Proust, bien sûr.
Sarraute, un phare sans fard.
Difficile d'entrer dans ce livre fait de bribes, sans personnages ni intrigue si ce n'est : que pensez-vous du livre Les Fruits d'or ?
On se retrouve dans les milieux autorisés à la Coluche, pour ce livre admirable qui n'a pas été surpassé au cours des 15 dernières années.
Penser le contraire équivaut à une excommunication, au mieux de la condescendance.
Jusqu'à ce que finalement oui c'est un navet, il est plat, mais qu'est-ce que ça peut bien faire ?
On se retrouve dans les milieux autorisés à la Coluche, pour ce livre admirable qui n'a pas été surpassé au cours des 15 dernières années.
Penser le contraire équivaut à une excommunication, au mieux de la condescendance.
Jusqu'à ce que finalement oui c'est un navet, il est plat, mais qu'est-ce que ça peut bien faire ?
Lecture obligatoire pour les cours. Aucune envie de lire ce livre.
Après lecture et analyse du texte, coup de cœur pour cette autobiographie touchante. L'auteure a su livrer son enfance dans un cadre simple et intimiste.
Je recommande fortement ce livre.
Après lecture et analyse du texte, coup de cœur pour cette autobiographie touchante. L'auteure a su livrer son enfance dans un cadre simple et intimiste.
Je recommande fortement ce livre.
Nathalie Sarraute égrène ses souvenirs d'enfance, dans une narration qui n'est pas linéaire, mais faite de petites scènes isolées dans le temps comme le sont tous nos souvenirs d'enfance : un départ en voyage, une sortie, une phrase marquante entendue un jour…
Face à elle, son double avec qui elle dialogue, qui l'oblige à réfléchir sur le sens de ces souvenirs : pourquoi celui-ci ? Que signifie vraiment celui-là ? Comprend-elle maintenant ce que ça voulait dire ?
C'est donc un récit très introspectif. Quand Annie Ernaux tente de donner à ses propres souvenirs d'enfance une dimension sociologique, historique presque, Nathalie Sarraute se penche surtout sur son ressenti d'enfant.
Une enfant ballottée entre deux parents, deux pays - la Russie et la France -, deux langues… Une enfant qui admire sa mère fantasque, qui chérit son père et craint un peu sa belle-mère.
Une enfant solitaire, qui aime lire :
"Je me souviens d'un livre de Mayne Reid, que mon père m'avait donné. Il l'avait aimé quand il était petit… mais il ne m'amusait pas beaucoup… peut-être étais-je trop jeune… huit ans et demi… je m'évadais des longues descriptions de prairies vers les tirets libérateurs, ouvrant sur les dialogues."
J'aime beaucoup l'image saisissante de ces "tirets libérateurs" qui me rappelle à moi aussi des lectures un peu trop ardues pour mon âge.
Et puis une enfant qui aime écrire, inventant la mort d'un petit chien pour une rédaction, apportant un soin maniaque à la belle écriture, au mot juste, à l'orthographe parfaite. Ambition qui apporte une sérénité à cette petite fille tiraillée entre deux foyers :
"La maîtresse nous prend nos copies. Elle va les examiner, indiquer les fautes à l'encre rouge dans les marges, puis les compter et mettre une note. Rien ne peut égaler la justesse de ce signe qu'elle va écrire sous mon nom. Il est la justice même, il est l'équité."
Une ambition que l'on retrouve magnifiée dans ce très beau récit.
LC thématique juillet-août 2023 : "Un.e auteur.e français.e"
Challenge gourmand (Divorcé)
Face à elle, son double avec qui elle dialogue, qui l'oblige à réfléchir sur le sens de ces souvenirs : pourquoi celui-ci ? Que signifie vraiment celui-là ? Comprend-elle maintenant ce que ça voulait dire ?
C'est donc un récit très introspectif. Quand Annie Ernaux tente de donner à ses propres souvenirs d'enfance une dimension sociologique, historique presque, Nathalie Sarraute se penche surtout sur son ressenti d'enfant.
Une enfant ballottée entre deux parents, deux pays - la Russie et la France -, deux langues… Une enfant qui admire sa mère fantasque, qui chérit son père et craint un peu sa belle-mère.
Une enfant solitaire, qui aime lire :
"Je me souviens d'un livre de Mayne Reid, que mon père m'avait donné. Il l'avait aimé quand il était petit… mais il ne m'amusait pas beaucoup… peut-être étais-je trop jeune… huit ans et demi… je m'évadais des longues descriptions de prairies vers les tirets libérateurs, ouvrant sur les dialogues."
J'aime beaucoup l'image saisissante de ces "tirets libérateurs" qui me rappelle à moi aussi des lectures un peu trop ardues pour mon âge.
Et puis une enfant qui aime écrire, inventant la mort d'un petit chien pour une rédaction, apportant un soin maniaque à la belle écriture, au mot juste, à l'orthographe parfaite. Ambition qui apporte une sérénité à cette petite fille tiraillée entre deux foyers :
"La maîtresse nous prend nos copies. Elle va les examiner, indiquer les fautes à l'encre rouge dans les marges, puis les compter et mettre une note. Rien ne peut égaler la justesse de ce signe qu'elle va écrire sous mon nom. Il est la justice même, il est l'équité."
Une ambition que l'on retrouve magnifiée dans ce très beau récit.
LC thématique juillet-août 2023 : "Un.e auteur.e français.e"
Challenge gourmand (Divorcé)
Ma bibliothèque regorge de titres classiques, lus pendant mes études de lettres, il y a trente ans, et jamais réouverts depuis. Nathalie Sarraute a été une découverte très forte de ces années. J’avais été scotchée par l’originalité de l’ovni qu’est Le planétarium. Parmi les folios jaunis que je possède d’elle, il y avait ce Martereau… Dans ce roman de 1953, Nathalie Sarraute nous plonge dans l’intimité d’une famille bourgeoise parisienne, nous plaçant principalement dans les pensées d’un narrateur, un jeune homme, un neveu maladif et fragile, qui a été recueilli par son oncle, sa tante et sa cousine. Ce neveu est assez mal à l’aise, attentif à chaque imperceptible signe qui ponctue les conversations, mouvements du visage, reculs, pauses, ton. Il présente à la famille son ami Martereau, un être plus naïf, plus sincère dans ses propos, dont tout le monde finit par faire grand cas. L’oncle est tellement séduit qu’il n’hésite pas à confier de l’argent à cet homme afin qu’il achète pour lui une petite maison de campagne. Martereau accepte. Aucun reçu n’est délivré et le comportement de Martereau peut tout à coup amener à douter de sa probité. A-t-on bêtement fait confiance ? Je n’avais gardé aucun souvenir de ce récit, un brin exigeant par sa façon d’être seulement situé dans les pensées des personnages. Il faut s’accrocher pour en suivre le flux, mais ce fut en réalité au final un régal. J’ai pensé à Proust pour l’écriture, mais également à la nouvelle du Collier de Maupassant pour l’histoire. Ce texte est d’une force inouïe, d’une grande ironie et d’une grande classe. J’ai aimé son regard acéré. Lit-on assez Nathalie Sarraute de nos jours ?
Lien : https://leslecturesdantigone..
Lien : https://leslecturesdantigone..
J'adore l'idée de tenter de mettre ses souvenirs sur papier, mais ici j'avoue qu'au bout d'un moment le temps m'a paru long. Se souvenir ok, mais finalement à toi lecteur un peu lambda, (à moins d'être fan de l'autrice) , ça va pas te servir à grand chose. Il ne se passe pas grand chose sinon qu'un bout de vie éphémère. L'exercice est intéressant mais vite le tout devient assez répétitif et un peu ennuyeux.
11/20
Note pour moi :
commencé le 21 avril
fini le 25 avril
265 pages - Petit format
Emprunté à la médiathèque
11/20
Note pour moi :
commencé le 21 avril
fini le 25 avril
265 pages - Petit format
Emprunté à la médiathèque
Nathalie Sarraute entre dans sa pièce en deux répliques : « j’aurais voulu rentrer sous terre. » « Moi aussi, je ne savais plus où me mettre ». Pierre avait fait remarquer à Madeleine, qui se faisait passer pour une prolétaire, qu’elle était l’héritière d’une grande fortune. Aurait-il dû se taire ?
S’en suit une discussion sur le mensonge : faut-il l’ignorer ou faire éclater la vérité ? L'admettre ou confondre le menteur ?
Pierre s’interroge alors sur une phrase que vient juste de proférer Simone. Il lui semblait pourtant qu’un jour, elle avait dit autre chose …
J’ai adoré cette ambiance, ce malaise que Nathalie Sarraute instaure avec finesse. Entre le bien-se-tenir social et la volonté de savoir la vérité, quelle est l’attitude à adopter ? Certains veulent fermer les oreilles, continuer la discussion, faire diversion, mais Pierre insiste. Par une remarque, une affirmation, il dévie la conversation, il revient sur le propos tenu.
On ressent la tension qui s’installe, qui grossit, le trouble est tellement palpable qu’on est embarrassé à la place des personnages. D’incommode, la situation devient embarrassante et le malaise prend au fil des pages une telle place qu’à la fin de la pièce, on est soulagé tant on craignait que le psychodrame explose à chaque instant. Une tension maintenue sur le fil du rasoir jusqu'au bout.
PS : Le Mensonge est la deuxième oeuvre théâtrale de Nathalie Sarraute.
S’en suit une discussion sur le mensonge : faut-il l’ignorer ou faire éclater la vérité ? L'admettre ou confondre le menteur ?
Pierre s’interroge alors sur une phrase que vient juste de proférer Simone. Il lui semblait pourtant qu’un jour, elle avait dit autre chose …
J’ai adoré cette ambiance, ce malaise que Nathalie Sarraute instaure avec finesse. Entre le bien-se-tenir social et la volonté de savoir la vérité, quelle est l’attitude à adopter ? Certains veulent fermer les oreilles, continuer la discussion, faire diversion, mais Pierre insiste. Par une remarque, une affirmation, il dévie la conversation, il revient sur le propos tenu.
On ressent la tension qui s’installe, qui grossit, le trouble est tellement palpable qu’on est embarrassé à la place des personnages. D’incommode, la situation devient embarrassante et le malaise prend au fil des pages une telle place qu’à la fin de la pièce, on est soulagé tant on craignait que le psychodrame explose à chaque instant. Une tension maintenue sur le fil du rasoir jusqu'au bout.
PS : Le Mensonge est la deuxième oeuvre théâtrale de Nathalie Sarraute.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur
Auteurs proches de Nathalie Sarraute
Quiz
Voir plus
Nathalie Sarraute et son œuvre
Dans quel pays est née Nathalie Sarraute ?
France
Royaume-Uni
Pologne
Russie
10 questions
41 lecteurs ont répondu
Thème :
Nathalie SarrauteCréer un quiz sur cet auteur41 lecteurs ont répondu