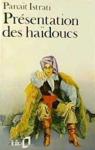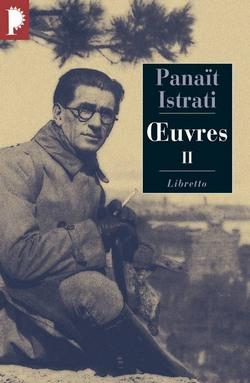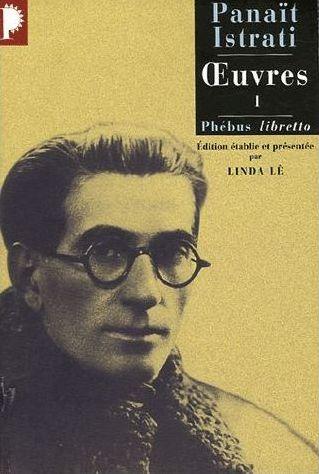Citations de Panaït Istrati (341)
LE train omnibus déposa Adrien à Bucarest un soir d'avril 1904. C'était un train de pauvres, composé uniquement de troisièmes et de wagons de marchandises. Depuis Braïla, il avait mis plus de huit heures à faire les 230 kilomètres environ qui séparent cette ville de Bucarest, traversant une interminable plaine noirâtre et semblant ne plus vouloir repartir après chaque arrêt dans les haltes soli- taires de la steppe du Baragàn. Pauvre train. Adrien, passant près de la locomotive ahanante, suintante, toute rafistolée, lui jeta un regard de commisération :
« Ces machines, pensa-t-il, on dirait qu'elles ont une âme. Lorsqu'on les fatigue trop, elles gémissent comme des êtFes animés. »
Il se serait complu à poursuivre cette idée de la machine — bête de trait, mais, dans la bousculade de la sortie, le visage tourmenté d'une paysanne lui rappela sa mère et il s'attrista aussitôt. Encore une fois elle l'avait gourmande et s'était opposée à son départ. Il avait passé outre comme de coutume, néanmoins les paroles de la mère l'agaçaient :
— Tu pars, tu reviens... Tu pars vêtu, tu rentres dégue- nillé. Combien de temps cela va durer ?. Tu as vingt ans et point de profession définie. Tu fais tous les métiers, mais aucun convenablement. Autant dire, tu ne fais rien, quoil Vagabond !
Adrien savait que, selon sa mère et selon tout le quartier, n'était convenable qu'une vie pareille à celle de la locomotive — bête de trait. Bien pis, lui, il devait encore se marier, user ses os entre une famille misérable et un infâme atelier.
Non. Pas ça ! Plutôt le vagabondage ! Plutôt le mépris universel ! N'était-il pas maître de son existence ? Pourquoi lui imposer la charge d'une famille et le bagne d'un atelier ? Non, non ! Il aimait courir la terre, connaître, contempler. Voilà la vie qu'il aimait, au prix même de tous les sacrifices, de toutes les souffrances.
« Ces machines, pensa-t-il, on dirait qu'elles ont une âme. Lorsqu'on les fatigue trop, elles gémissent comme des êtFes animés. »
Il se serait complu à poursuivre cette idée de la machine — bête de trait, mais, dans la bousculade de la sortie, le visage tourmenté d'une paysanne lui rappela sa mère et il s'attrista aussitôt. Encore une fois elle l'avait gourmande et s'était opposée à son départ. Il avait passé outre comme de coutume, néanmoins les paroles de la mère l'agaçaient :
— Tu pars, tu reviens... Tu pars vêtu, tu rentres dégue- nillé. Combien de temps cela va durer ?. Tu as vingt ans et point de profession définie. Tu fais tous les métiers, mais aucun convenablement. Autant dire, tu ne fais rien, quoil Vagabond !
Adrien savait que, selon sa mère et selon tout le quartier, n'était convenable qu'une vie pareille à celle de la locomotive — bête de trait. Bien pis, lui, il devait encore se marier, user ses os entre une famille misérable et un infâme atelier.
Non. Pas ça ! Plutôt le vagabondage ! Plutôt le mépris universel ! N'était-il pas maître de son existence ? Pourquoi lui imposer la charge d'une famille et le bagne d'un atelier ? Non, non ! Il aimait courir la terre, connaître, contempler. Voilà la vie qu'il aimait, au prix même de tous les sacrifices, de toutes les souffrances.
Toutefois, le voyant sortir du siège du « Syndicat mixte », il ne put résister au plaisir de lui décocher une méchanceté Tiens ! fit-il, étonné. Tu es, toi aussi, mêlé à cette marmelade mixte? Je ne l’aurais pas cru ! A quand donc votre candidature de député socialiste, M. Adrien Zograffi? Adrien vit son aspect minable et ne releva pas l’ironie. Le prenant par le bras, il l’entraîna avec lui
Allons prendre le thé ensemble. Il y a longtemps, qu’on ne s’est vu.
Rizou fut touché. Il savait qu’Adrien, à l’exemple de tant d’autres, aurait pu facilement répondre à son sarcasme en plaisantant sa chimie et son anarchie, toutes deux réduites à la fabrication de feux d’artifice. Aussi, il fut heureux de l’avoir échappé belle, car rien ne lui était plus pénible que les allu- sions désobligeantes, parfois cruelles, à ces deux passions de sa vie ses idées anarchistes et la chimie qu’il avait espéré illus- trer un jour du haut de la chaire universitaire.
Ils firent tout le chemin sans plus échanger un mot. A la maison de thé, bondée de pêcheurs russes barbus qui puaient l’alcool et le poisson, Rizou dit à Adrien, dès qu’ils furent installés dans leur coin
Tu me pardonnes ma méchanceté de tout à l’heure? Mais je sais bien que tu n’es pas méchant.
Oh, si ! je le suis. Que veux-tu, la vie n’est plus pour moi qu’un fardeau. Alors? On me frappe. Je frappe. Ou, plutôt, je mords, comme un paria impuissant.
Adrien regardait son visage marqué par l’impitoyable maladie et le trouvait sympathique, avec ses yeux noirs, brûlant de passions contenues.
– Dis-moi, Jean pourquoi ne veux-tu pas qu’on se voie plus souvent? Tu vis trop seul.
Il voulut lui prendre une main. L’autre la retira
Il ne faut pas être trop affectueux avec moi. Je n’y tiens pas. Je m’en suis déshabitué et je ne sais pour quelle raison j’en reprendrais l’habitude. On est affectueux pour la vie ou on ne l’est pas. Il n’est guère possible d’aimer un homme et de haïr tous les autres. Or, maintenant, c’est la haine qui me nourrit. Je déteste jusqu’à mes idoles. Regarde un Elisée Reclus. Au fond, même ce grand type n’a pas pu résister jusqu’à la fin au plaisir de s’asseoir confortablement sur les gros revenus de ses bouquins. Tant pis pour les disciples qui se sont fait casser la figure, poussés par la beauté des écrits du maître. Non. J’aime mieux Georges Sorel. Il est bien plus conséquent avec lui-même.
Allons prendre le thé ensemble. Il y a longtemps, qu’on ne s’est vu.
Rizou fut touché. Il savait qu’Adrien, à l’exemple de tant d’autres, aurait pu facilement répondre à son sarcasme en plaisantant sa chimie et son anarchie, toutes deux réduites à la fabrication de feux d’artifice. Aussi, il fut heureux de l’avoir échappé belle, car rien ne lui était plus pénible que les allu- sions désobligeantes, parfois cruelles, à ces deux passions de sa vie ses idées anarchistes et la chimie qu’il avait espéré illus- trer un jour du haut de la chaire universitaire.
Ils firent tout le chemin sans plus échanger un mot. A la maison de thé, bondée de pêcheurs russes barbus qui puaient l’alcool et le poisson, Rizou dit à Adrien, dès qu’ils furent installés dans leur coin
Tu me pardonnes ma méchanceté de tout à l’heure? Mais je sais bien que tu n’es pas méchant.
Oh, si ! je le suis. Que veux-tu, la vie n’est plus pour moi qu’un fardeau. Alors? On me frappe. Je frappe. Ou, plutôt, je mords, comme un paria impuissant.
Adrien regardait son visage marqué par l’impitoyable maladie et le trouvait sympathique, avec ses yeux noirs, brûlant de passions contenues.
– Dis-moi, Jean pourquoi ne veux-tu pas qu’on se voie plus souvent? Tu vis trop seul.
Il voulut lui prendre une main. L’autre la retira
Il ne faut pas être trop affectueux avec moi. Je n’y tiens pas. Je m’en suis déshabitué et je ne sais pour quelle raison j’en reprendrais l’habitude. On est affectueux pour la vie ou on ne l’est pas. Il n’est guère possible d’aimer un homme et de haïr tous les autres. Or, maintenant, c’est la haine qui me nourrit. Je déteste jusqu’à mes idoles. Regarde un Elisée Reclus. Au fond, même ce grand type n’a pas pu résister jusqu’à la fin au plaisir de s’asseoir confortablement sur les gros revenus de ses bouquins. Tant pis pour les disciples qui se sont fait casser la figure, poussés par la beauté des écrits du maître. Non. J’aime mieux Georges Sorel. Il est bien plus conséquent avec lui-même.
Habituellement, se levant à cinq heures, il achevait ce travail au bout de deux heures d’efforts soutenus ; et il le fallait bien, car, à sept heures, madame Thüringer se levait et il devait aussitôt l’accompagner au marché. Maintenant, il était quatre heures du matin. Il décida de commencer par la salle à manger, afin de ne pas être, par hasard, surpris à cette besogne qui n’entrait pas dans ses attributions. On lui eût tout de suite demandé pour quelle raison il faisait le travail de Julie, et il eût été bien embarrassé pour répondre. Les belles pièces étaient toutes parquetées. Adrien examina le parquet de la salle à manger et le trouva assez encrassé. Jl n’en voulut pas à Julie, au contraire, il la plaignit de n’avoir pas pu faire mieux son devoir. Il était, ce matin-là, plus généreux que jamais. Sans plus réfléchir au peu de temps qu’il avait devant lui, il se jeta sur la paille de fer. Une activité furieuse lui stimulait la nuque, à l’idée de la tête que ferait Julie quand elle verrait son parquet tout propre. Au demeurant, Anna pouvait apprendre toute la vérité. Était-il coupable de quelque trahison ? Nullement. Anna continuait à rester, pour lui, la grâce qu’on n’emeure que du bout des lèvres, comme on fait avec les images saintes. Entre elle et Julie il y avait un abîme. L’une ne pouvait remplacer l’autre. Anna était un rêve. Julie, une surprenante réalité. Il s’agissait de,deux bonheurs absolument différents. Adrien savait maintenant ce qu’était une Julie une violente joie qui vous rendait plus lucide, plus fort ; il lui en était immensément reconnaissant. Jusqu’à cet événement, il voyait les choses comme à travers un léger brouillard. Quelque part, il ne savait pas où, dans -son organisme, une pièce, qui ne fonctionnait pas, l’empêchait de voir la vie avec les yeux de tout le monde. Il devinait son infériorité dans le regard d’autrui. Le dernier imbécile pouvait, là-dessus, le confondre. Comment le confondre? Sans même qu’il en fût question. Se trouvant à côté d’un homme et regardant avec lui, disons, un chien, Adrien savait que l’autre ne voyait qu’un chien. Mais si, à la place du chien, il y avait une femme, Adrien ne savait plus ce que l’autre voyait.
Eh bien, depuis ce matin, le voile était tombé. Toutes les femmes qui passaient dans la rue étaient des Julie. Et lui, un homme comme tous les autres. Cet Éclaircissement, il le devait à la généreuse Hongroise. Il lui devait, en plus, la joie violente dont il venait de faire la découverte et qu’il se promettait de mieux apprécier le soir suivant, car la jeune femme lui avait dit, en s’endormant sur son bras :
Eh bien, depuis ce matin, le voile était tombé. Toutes les femmes qui passaient dans la rue étaient des Julie. Et lui, un homme comme tous les autres. Cet Éclaircissement, il le devait à la généreuse Hongroise. Il lui devait, en plus, la joie violente dont il venait de faire la découverte et qu’il se promettait de mieux apprécier le soir suivant, car la jeune femme lui avait dit, en s’endormant sur son bras :
Ramassé en boule, sur un tabouret bas, dans un coin de cette énorme cuisine de grosse maison bourgeoise, le jeune Adrien se tenait coi et semblait prêter l’oreille à quelque chose qui se serait passé dans sa poitrine. Il en-était tout préoccupé, depuis une heure qu’il était là. Sa mère l’avait fait venir, afin de le placer comme « garçon de courses », et, malgré l’heure trop matinale, la pauvre femme commençait à s’inquiéter de l’attitude, à son avis, peu convenable, que son fils adoptait au moment même où il allait être présenté aux patrons.
Dieu, qu’il est bourru ! – pensait-elle, se tenant debout, pour éviter toute surprise désagréable. Ce garçon n’arrivera jamais à rien.
Blanchisseuse dans la maison Thüringer, depuis des années, la mère Zoïtza savait que, d’un moment à l’autre, madame Anna, femme de M. Max Thüringer, allait faire irruption dans la cuisine, le fer à friser à la main. Elle s’installerait, comme d’habitude, devant la portière du fourneau, assise sur ce même tabouret bas qu’Adrien avait pris sans demander permission à personne. Là, jacassante ou morose, selon son humeur, madame Anna passait une petite demi-heure à faire trois choses à la fois friser ses cheveux, prendre son café et établir, d’accord avec sa mère, cuisinière de la maison, les menus de la journée. Puis, jolie, pimpante, elle allait faire le marché, accompagnée d’un domestique.
Adrien ne savait rien de tout cela, mais il sentait, de temps à autre, que sa mère n’était pas contente de lui. Il ne la regardait pas. Il fixait constamment le sol, à ses pieds, et mille souvenirs, mille sentiments, divers, contradictoires, tantôt gais, tantôt tristes, défilaient sous ses yeux. Il apercevait cependant, parfois, les pieds de sa mère qui changeaient de place, impatients.
Elle voudrait que j’attende debout, comme elle, se dit-il. Pour le respect de qui ? Les patrons, les deux frères Thüringer, ne peuvent pas venir à la cuisine. Ce sont de trop gros messieurs, et « rigides comme tous les Allemands Serait-ce pour le respect de madame Charlotte, mère de madame Anna? Ou pour madame elle-même ? Ou, encore, pour Mitzi, la jeune sœur de celle-ci ? Allons donc ! Ces trois femmes, aujourd’hui maîtresses de grande maison et bien braves, du reste, il ne les connaissait que trop, les ayant connues autrefois, et non comme « grandes dames ?. Six années auparavant, alors qu’il était âgé de treize ans, il avait habité la même maison qu’elles, sise place du Marché- Pauvre. A cette époque-là madame Charlotte venait de perdre son mari, M. Müller, mécanicien allemand débarqué en Rou- manie au temps des premiers chemins de fer, pensionné depuis longtemps et paralytique. Adrien avait beaucoup admiré la gravité de ce vieillard qui, cloué dans son fauteuil, lisait jour et nuit le Ber/Mer Tageblatt et la Frankfurter Zeitung. La misère régnait alors, dans cette famille, mais Adrien avait remarqué déjà que,, chez les Allemands, la misère pouvait être digne. Point de vêtements déchirés, ni sales, comme on en voyait chez « les nôtres ». Et les raccommodages, toujours savants, presque invisibles. Quant à la popote, c’était avec des sommes dérisoires que madame Charlotte parvenait à fabriquer des plats savoureux et même des gâteaux.
Toutefois, la misère harcelait de plus en plus la veuve et ses quatre enfants, trois filles et un garçon, dont aucun encore ne gagnait. On s’endettait. On emprunta de l’argent même à la mère d’Adrien, la plus pauvre des veuves. Puis les créditeurs devinrent agressifs. On dut vendre du mobilier. Enfin, toute honte bue, la puînée, Anna, alla se placer comme servante chez les frères Max et Bernard Thüringer, grands exportateurs de céréales, à Braila, ville où se déroule notre chronique et second port danubien de la Roumanie, alors bouillant d’activité.
Dieu, qu’il est bourru ! – pensait-elle, se tenant debout, pour éviter toute surprise désagréable. Ce garçon n’arrivera jamais à rien.
Blanchisseuse dans la maison Thüringer, depuis des années, la mère Zoïtza savait que, d’un moment à l’autre, madame Anna, femme de M. Max Thüringer, allait faire irruption dans la cuisine, le fer à friser à la main. Elle s’installerait, comme d’habitude, devant la portière du fourneau, assise sur ce même tabouret bas qu’Adrien avait pris sans demander permission à personne. Là, jacassante ou morose, selon son humeur, madame Anna passait une petite demi-heure à faire trois choses à la fois friser ses cheveux, prendre son café et établir, d’accord avec sa mère, cuisinière de la maison, les menus de la journée. Puis, jolie, pimpante, elle allait faire le marché, accompagnée d’un domestique.
Adrien ne savait rien de tout cela, mais il sentait, de temps à autre, que sa mère n’était pas contente de lui. Il ne la regardait pas. Il fixait constamment le sol, à ses pieds, et mille souvenirs, mille sentiments, divers, contradictoires, tantôt gais, tantôt tristes, défilaient sous ses yeux. Il apercevait cependant, parfois, les pieds de sa mère qui changeaient de place, impatients.
Elle voudrait que j’attende debout, comme elle, se dit-il. Pour le respect de qui ? Les patrons, les deux frères Thüringer, ne peuvent pas venir à la cuisine. Ce sont de trop gros messieurs, et « rigides comme tous les Allemands Serait-ce pour le respect de madame Charlotte, mère de madame Anna? Ou pour madame elle-même ? Ou, encore, pour Mitzi, la jeune sœur de celle-ci ? Allons donc ! Ces trois femmes, aujourd’hui maîtresses de grande maison et bien braves, du reste, il ne les connaissait que trop, les ayant connues autrefois, et non comme « grandes dames ?. Six années auparavant, alors qu’il était âgé de treize ans, il avait habité la même maison qu’elles, sise place du Marché- Pauvre. A cette époque-là madame Charlotte venait de perdre son mari, M. Müller, mécanicien allemand débarqué en Rou- manie au temps des premiers chemins de fer, pensionné depuis longtemps et paralytique. Adrien avait beaucoup admiré la gravité de ce vieillard qui, cloué dans son fauteuil, lisait jour et nuit le Ber/Mer Tageblatt et la Frankfurter Zeitung. La misère régnait alors, dans cette famille, mais Adrien avait remarqué déjà que,, chez les Allemands, la misère pouvait être digne. Point de vêtements déchirés, ni sales, comme on en voyait chez « les nôtres ». Et les raccommodages, toujours savants, presque invisibles. Quant à la popote, c’était avec des sommes dérisoires que madame Charlotte parvenait à fabriquer des plats savoureux et même des gâteaux.
Toutefois, la misère harcelait de plus en plus la veuve et ses quatre enfants, trois filles et un garçon, dont aucun encore ne gagnait. On s’endettait. On emprunta de l’argent même à la mère d’Adrien, la plus pauvre des veuves. Puis les créditeurs devinrent agressifs. On dut vendre du mobilier. Enfin, toute honte bue, la puînée, Anna, alla se placer comme servante chez les frères Max et Bernard Thüringer, grands exportateurs de céréales, à Braila, ville où se déroule notre chronique et second port danubien de la Roumanie, alors bouillant d’activité.
S’il tue, c’est parce que la cruauté de ses ennemis l’y oblige.
Le haïdouc, c’est l’homme né bon, et seule la bonté nous distingue de l’animalité : elle est l’unique distinction de la vie humaine.
En gagnant la forêt et en se mettant hors la loi, tout vrai haïdouc reste bon, point rancuneux, indulgent à l’erreur. Il n’oublie pas que ce qui fait la grandeur d’un chef, c’est surtout la compréhension. Sans quoi les gospodars (Note de bas de page : Les seigneurs) sauraient commander, eux aussi. Il n’oublie pas non plus qu’il est un révolté généreux : pour lui, le meurtre et le pillage ne sont pas un but.
Le haïdouc n’est pas un bandit.
Tout homme doit être haïdouc pour que le monde devienne meilleur. »
Le haïdouc, c’est l’homme né bon, et seule la bonté nous distingue de l’animalité : elle est l’unique distinction de la vie humaine.
En gagnant la forêt et en se mettant hors la loi, tout vrai haïdouc reste bon, point rancuneux, indulgent à l’erreur. Il n’oublie pas que ce qui fait la grandeur d’un chef, c’est surtout la compréhension. Sans quoi les gospodars (Note de bas de page : Les seigneurs) sauraient commander, eux aussi. Il n’oublie pas non plus qu’il est un révolté généreux : pour lui, le meurtre et le pillage ne sont pas un but.
Le haïdouc n’est pas un bandit.
Tout homme doit être haïdouc pour que le monde devienne meilleur. »
Chanson haïdouque
Le printemps, cette année-là, quoique précoce et doux, se montra fort pluvieux. Aussi fut-il possible à notre troupe de quitter sa retraite d’hiver un peu plus tôt que les haïdoucs n’en ont l’habitude ; mais, pour ce qui était d’aborder la plaine, il fallait y renoncer pour le moment ; les routes étaient défoncées, impraticables, désertes de charretiers. C’était sous des déguisements de charretiers que Floarea Codrilor, notre capitaine, avait décidé de nous faire faire les grands déplacements. Elle nous disait avec raison que les potéras (Note de bas de page : Armées de mercenaires) nous recherchaient sur les sentiers montagneux plutôt que dans les villes, ou en rase campagne. Nous devions abandonner les pratiques par trop « éventées », qui reléguaient naguère le haïdouc sur les confins de la terre où gémissait son frère le paysan. Il fallait maintenant nous rapprocher de cet homme, abruti par quatre siècles de spoliation, et lui faire comprendre que les haïdoucs seraient impuissants à le délivrer du joug aussi longtemps qu’il croupirait dans l’animalité. C’est pourquoi les révoltés allaient se muer en braves charretiers, se joindre aux interminables convois de voitures qui sillonnent les principautés danubiennes en long et en large, transporter de vraies, de fausses marchandises, boire, rire, bavarder avec leurs camarades, au besoin se laisser fouetter comme eux, mais toujours prêts à secouer, à réveiller de son triste sommeil la bête parlante, celle qui dépasse le bœuf en endurance et le lapin en fécondité. Et s’il restait bien entendu que, tout en poursuivant cette tentative de soulèvement, nous ne nous abstiendrions pas de piller et châtier, d’aventure, certains gros coupables, nous n’en devions pas moins considérer ces actes comme secondaires, bons à tenir le peuple en éveil et à satisfaire la soif de vengeance d’une haïdoucie primitive et bornée.
Le printemps, cette année-là, quoique précoce et doux, se montra fort pluvieux. Aussi fut-il possible à notre troupe de quitter sa retraite d’hiver un peu plus tôt que les haïdoucs n’en ont l’habitude ; mais, pour ce qui était d’aborder la plaine, il fallait y renoncer pour le moment ; les routes étaient défoncées, impraticables, désertes de charretiers. C’était sous des déguisements de charretiers que Floarea Codrilor, notre capitaine, avait décidé de nous faire faire les grands déplacements. Elle nous disait avec raison que les potéras (Note de bas de page : Armées de mercenaires) nous recherchaient sur les sentiers montagneux plutôt que dans les villes, ou en rase campagne. Nous devions abandonner les pratiques par trop « éventées », qui reléguaient naguère le haïdouc sur les confins de la terre où gémissait son frère le paysan. Il fallait maintenant nous rapprocher de cet homme, abruti par quatre siècles de spoliation, et lui faire comprendre que les haïdoucs seraient impuissants à le délivrer du joug aussi longtemps qu’il croupirait dans l’animalité. C’est pourquoi les révoltés allaient se muer en braves charretiers, se joindre aux interminables convois de voitures qui sillonnent les principautés danubiennes en long et en large, transporter de vraies, de fausses marchandises, boire, rire, bavarder avec leurs camarades, au besoin se laisser fouetter comme eux, mais toujours prêts à secouer, à réveiller de son triste sommeil la bête parlante, celle qui dépasse le bœuf en endurance et le lapin en fécondité. Et s’il restait bien entendu que, tout en poursuivant cette tentative de soulèvement, nous ne nous abstiendrions pas de piller et châtier, d’aventure, certains gros coupables, nous n’en devions pas moins considérer ces actes comme secondaires, bons à tenir le peuple en éveil et à satisfaire la soif de vengeance d’une haïdoucie primitive et bornée.
Stavro
Adrien traversa, étourdi, le court boulevard de la Mère-de-Dieu, qui à Braïla, conduit de l’église du même nom au Jardin public. Arrivé à l’entrée du jardin, il s’arrêta, confus et dépité.
– Tout de même ! s’exclama-t-il à haute voix. Je ne suis plus un enfant !... Et je crois bien avoir le droit de comprendre la vie comme je la sens.
Il était six heures du soir. Jour de travail. Les allées du jardin étaient presque désertes vers les deux portes principales, et le soleil crépusculaire dorait le sable, pendant que les bosquets de lilas plongeaient dans l’ombre nocturne. Des chauves-souris voltigeaient en tous sens, comme désemparées. Les bancs alignés sur les chaussées étaient presque tous libres, sauf dans certaines encoignures discrètes du jardin où de jeunes couples se tenaient serrés et devenaient sérieux au passage des importuns. Adrien ne fit attention à aucun être humain qu’il croisa en chemin. Il aspirait, avide, l’air pur qui se levait du sable fraîchement arrosé, le mélange embaumé du parfum des fleurs et pensait à ce qu’il ne pouvait pas comprendre.
Adrien traversa, étourdi, le court boulevard de la Mère-de-Dieu, qui à Braïla, conduit de l’église du même nom au Jardin public. Arrivé à l’entrée du jardin, il s’arrêta, confus et dépité.
– Tout de même ! s’exclama-t-il à haute voix. Je ne suis plus un enfant !... Et je crois bien avoir le droit de comprendre la vie comme je la sens.
Il était six heures du soir. Jour de travail. Les allées du jardin étaient presque désertes vers les deux portes principales, et le soleil crépusculaire dorait le sable, pendant que les bosquets de lilas plongeaient dans l’ombre nocturne. Des chauves-souris voltigeaient en tous sens, comme désemparées. Les bancs alignés sur les chaussées étaient presque tous libres, sauf dans certaines encoignures discrètes du jardin où de jeunes couples se tenaient serrés et devenaient sérieux au passage des importuns. Adrien ne fit attention à aucun être humain qu’il croisa en chemin. Il aspirait, avide, l’air pur qui se levait du sable fraîchement arrosé, le mélange embaumé du parfum des fleurs et pensait à ce qu’il ne pouvait pas comprendre.
Missiraș
Sînt la Iași,
Sau la Ieși.
Dacă ieși
De la slujbă,
Vin'la Cujbă.
Al matale,
Caragiale.
(pagina 65-66)
Sînt la Iași,
Sau la Ieși.
Dacă ieși
De la slujbă,
Vin'la Cujbă.
Al matale,
Caragiale.
(pagina 65-66)
Ciudat destin mi-a mai fost hărăzit și mie!
(Scrisoare deschisă oricui, 1932)
pagina 95
(Scrisoare deschisă oricui, 1932)
pagina 95
Tous les débats patriotiques sur la Transylvanie se résument à cette phrase qui a jadis échappée au « grand Brătianu », le père de l'actuel, et qui disait : « Va pour la Transylvanie, mais sans les transylvains ! ».
[Toate discuțiile patriotice pe seama Transilvaniei le putem rezuma la fraza care i-a scăpat altădată "marelui Ion Bratianu", tatăl celui actual, care a zis: "Vreau Transilvania, dar fără transilvăneni!"
(p. 10)
[Toate discuțiile patriotice pe seama Transilvaniei le putem rezuma la fraza care i-a scăpat altădată "marelui Ion Bratianu", tatăl celui actual, care a zis: "Vreau Transilvania, dar fără transilvăneni!"
(p. 10)
Je n’ai nullement envie de faire en ce moment de l’exécrable littérature. Je raconte ma vie, qui est sacrée. J’ai vécu toutes mes découvertes, comme toutes les séparations, les payant toujours très cher, les unes et les autres. Il le fallait bien. Autour de moi, ignorance et oppression se donnaient la main pour rendre l’homme ignoble et la terre inutile. Car l’homme n’est pas ignoble : on le rend ignoble lorsqu’on lui enlève la liberté et qu’on le cloue à une glèbe qui ne le nourrit pas. Et la terre ne devient inutile que si l’on vous empêche de l’aimer, en vous empêchant de la connaître.
C’est cela, le spectacle du monde sur lequel j’ouvrais mes yeux. Je m’en révoltai, tout seul, en partant, mais une prompte punition, qui devait durer vingt ans, commença à me tourmenter le cœur : c’est la souffrance que je causai à ma mère par mon refus d’obéir à un ordre qui enlaidissait sa vie. Impossible de s’entendre. Langages plus différents que ceux qui s’échangent entre une lionne et un aigle.
C’est cela, le spectacle du monde sur lequel j’ouvrais mes yeux. Je m’en révoltai, tout seul, en partant, mais une prompte punition, qui devait durer vingt ans, commença à me tourmenter le cœur : c’est la souffrance que je causai à ma mère par mon refus d’obéir à un ordre qui enlaidissait sa vie. Impossible de s’entendre. Langages plus différents que ceux qui s’échangent entre une lionne et un aigle.
Je crois bien que c’est cela : Klein aime par-dessus tout faire le patriarche, avoir sa petite cour, des gens qui le flattent.
Partager son bien avec des parents qui ne sont que des parents, ou se dépouiller pour une femme qui n’est qu’une femme, dites-moi : quel est le lien de sang que j’ai, moi, avec ces gens qui se font l’aumône ? Non ! Le seul être qui aurait droit à ma vie, ce serait celui auquel je me livrerais et qui se livrerait à moi, par amitié. Tout le reste est digne d’une brute. (« Mikhaïl », page 710)
Adrien Zograffi n’est, pour le moment, qu’un jeune homme qui aime l’Orient. C’est un autodidacte qui trouve la Sorbonne où il peut. Il vit, il rêve, il désire bien des choses. Plus tard, il osera dire que bien des choses sont mal faites par les hommes et par le Créateur.
(Avant-propos de l’auteur)
(Avant-propos de l’auteur)
On voudra bien se souvenir que l’homme qui a écrit ces pages si alertes a appris seul le français, il y a sept ans, en lisant nos classiques.
(Préface de Romain Rolland)
(Préface de Romain Rolland)
Ces textes ont été écrits comme on met un fer au feu. Istrati brûle, se consume dans son art, et nous brûlons avec lui, à la lumière de ses livres qui ont le pouvoir du rêve. Le vagabond de l’Orient, qui voyageait en clandestin, a laissé une œuvre à multiples facettes, solaire et ténébreuse, un viatique pour tous les amoureux d’une littérature écrite à l’encre des songes et de la fantaisie.
(Préface de LINDA LÊ)
(Préface de LINDA LÊ)
Un homme et un artiste! En voit-on souvent dans la vie, de ces animaux-là?
D'abord il est si difficile de rester bon et honnête au milieu d'un monde où tout est corruption. Je le dis sans haine. Je sais que personne ne peut sauter plus haut que le bord de son chapeau.
Ensuite, qu'est-ce qu'un artiste ? C'est le favorisé du hasard, qui le fit naître doué du pouvoir d'extérioriser ses sentiments, comme le rossignol qui sort du nid pour aller chanter sur la branche. Je ne vois là aucun mérite. Le mérite, ce serait de faire, de ses propres mains et sans en avoir jamais vu faire, une paire de bottines aussi parfaites que celles qui sortent des mains d'un bon bottier après trente ans d'expérience.
Non ; nous sommes tous de pauvres diables plus ou moins vains.
Mais là où nous commençons à être des hommes et des artistes, c'est quand nous souffrons de toute la souffrance humaine, quand nous l'exprimons selon nos moyens et combattons le mal causé au monde par notre égoïsme : l'Art, c'est une guerre à notre imperfection.
Et il y a là, pour notre cœur, un baume qui dépasse toutes les joies terrestres, car rien ne fait supporter la vie mieux que la générosité.
Hélas! Là encore, il faut être venu au monde ainsi, car nos capacités nous permettant aujourd'hui d'accaparer la terre, seule la Bonté peut réfréner notre violence, jusqu'au jour où la Justice la réfrénera, elle, mieux et définitivement.
D'abord il est si difficile de rester bon et honnête au milieu d'un monde où tout est corruption. Je le dis sans haine. Je sais que personne ne peut sauter plus haut que le bord de son chapeau.
Ensuite, qu'est-ce qu'un artiste ? C'est le favorisé du hasard, qui le fit naître doué du pouvoir d'extérioriser ses sentiments, comme le rossignol qui sort du nid pour aller chanter sur la branche. Je ne vois là aucun mérite. Le mérite, ce serait de faire, de ses propres mains et sans en avoir jamais vu faire, une paire de bottines aussi parfaites que celles qui sortent des mains d'un bon bottier après trente ans d'expérience.
Non ; nous sommes tous de pauvres diables plus ou moins vains.
Mais là où nous commençons à être des hommes et des artistes, c'est quand nous souffrons de toute la souffrance humaine, quand nous l'exprimons selon nos moyens et combattons le mal causé au monde par notre égoïsme : l'Art, c'est une guerre à notre imperfection.
Et il y a là, pour notre cœur, un baume qui dépasse toutes les joies terrestres, car rien ne fait supporter la vie mieux que la générosité.
Hélas! Là encore, il faut être venu au monde ainsi, car nos capacités nous permettant aujourd'hui d'accaparer la terre, seule la Bonté peut réfréner notre violence, jusqu'au jour où la Justice la réfrénera, elle, mieux et définitivement.
Le paysan fait le blé et l'apporte à la ville, qui le dévore sans lui laisser dans les mains de quoi s'acheter une chemise. Or la ville, c'est l'ouvrier. C'est donc lui qui doit être le responsable, la conscience qui régularise la vie de tout le pays. (p.40)
Je suis né de ces paysans-là et j'ai passé mon enfance au milieu d'eux, voilà d'où vient que je n'aime pas la légèreté de l'ouvrier des villes. Celui qui est né sans ciel et a grandi sans espace, à moins d'avoir de l'hérédité, ne peut approfondir l'abîme de l'existence. (p.39)
Certes, le matérialisme humain fournit autant de côtés à notre définition, mais, tout compte fait, je crois que l'homme naît idéaliste. Où l'ignominie l'emporte, c'est quand toutes les forces du "progrès social" s'appliquent à tuer dans l'oeuf ce ressort fragile qui est notre élan vers le sublime, au lieu d'aider à son développement. (p.28)
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur
Auteurs proches de Panaït Istrati
Lecteurs de Panaït Istrati (548)Voir plus
Quiz
Voir plus
Quiz mou (méfiez-vous des contrefaçons :-) et brûlant
Qu'est-ce qui s'enflamme à 232,8 degrés Celsius ?
Les scorpions (Pekinpah nous voilà)
Les livres (Bradbury nous voici)
1 questions
31 lecteurs ont répondu
Thèmes :
tribuCréer un quiz sur cet auteur31 lecteurs ont répondu