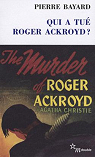Critiques de Pierre Bayard (303)
N°668– Août 2013.
AURAIS-JE ETE RESISTANT OU BOURREAU ? – Pierre Bayard - Les Éditions de Minuit.
Pour les gens de ma génération qui n'ont pas fait la guerre mais qui en ont entendu parler [beaucoup par ceux qui l'ont connue de loin, peu par ceux qui ont été d'authentiques héros], je me suis souvent demandé quel aurait été mon comportement pendant cette période troublée. Sauf bouleversement dans ma vie, je n'aurais certes pas été un délateur mais sûrement pas non plus un résistant héroïque, tout juste un tiède, comme la plupart des Français de l'époque. Mais le destin nous joue parfois de ces tours ! Je me suis dit que ce livre pouvait peut-être m’aider à clarifier mon propre questionnement.
L'auteur, né en 1954, tente de répondre à cette question en remontant le temps et en imaginant fictivement qu'il se trouve dans la situation de son père à la même époque parce qu'il a avec lui une similitude culturelle, des aspirations et un parcours communs. Il imagine donc une uchronie et se demande quelle aurait été son action dans ce contexte historique. Il a donc, fictivement, 18 ans en 1940, et élève d’hypokhâgne fuyant Paris se retrouve dans le sud de la France. Pour l'aider dans sa démarche d'analyse et de création, il convoque Louis Malle et Patrick Modiano pour le film « Lacombe Lucien », Daniel Cordier pour son engagement de Résistant, Stanley Milgram pour son expérience, Romain Gary pour ses romans et bien d'autres figures qui ont brillé par leur exemple...
C'est un texte dense, documenté, logique aussi dans son raisonnement, écrit par un universitaire et un psychanalyste qu'est Pierre Bayard et qui alterne entre fiction et démonstration. L'auteur y démonte les mécanismes qui amènent chaque homme face à une crise, soit à l'ignorer par peur, soit à s'engager pour y faire échec, soit à aider ceux qui en pâtissent. Il dissèque la « personnalité potentielle » que nous portons tous en nous et qui nous révèle, dans un tel contexte exceptionnel, tels que nous sommes réellement,même si l'image que nous donnons de nous-mêmes est peu flatteuse, fait la part du hasard, prend en compte les contraintes intérieures qui poussent les êtres à agir ou au contraire à s'abstenir, depuis les désaccords idéologiques et politiques jusqu'à l'indignation et l'empathie en passant par la soumission à l'autorité, le devoir d’obéissance aux ordres ou au contraire le devoir moral de refuser de les exécuter, le risque encouru par ceux qui osent sortir du rang et, au nom de leur conscience, de se singulariser. Il remet en cause au passage bien des idées reçues sur l'engagement personnel et sur les actions qui en découlent, détaille la nature de l'intervention du « bourreau » dans la « solution finale », le génocide rwandais ou la dictature sanguinaire de Pol Pot, analyse finement ce qu'il appelle « la personnalité altruiste ».
Quand il choisit de revenir à la fiction et de se mettre en situation de choisir entre De Gaulle et Pétain, il note son dégoût du régime de Vichy, son indignation face à ses agissements, sa sympathie pour les juifs mais aussi son incapacité à agir dans l'instant par peur de la dénonciation, de la torture et de la mort. Il est en effet peu indulgent avec lui, estimant que s'il avait vécu à cette époque, il aurait tenté de survivre dans la tourmente politique du régime de Vichy et aurait poursuivi ses études pour assurer son avenir en refusant l'action de résistance. Il se trouve quand même des excuses que le lecteur voudra bien admettre au nom de la peur ressentie. Les élèves de l’École Normale avaient pour ordre à l'époque de se tenir en dehors de toute action politique, même si en tant qu'institution, cet établissement ne partageait pas les idées du Maréchal. S'ils le faisaient c'était l'exclusion c'est à dire pour lui l'anéantissement d'années d'effort, l'effondrement d'un rêve familial, l'impossibilité d'entrer dans la Fonction Publique et donc de gagner sa vie, de fonder une famille comme il le souhaitait. Tout cela allait à l'encontre de l'exemple donné par de Sousa Mendes, ce consul du Portugal qui, en dépit d'une interdiction formelle de son pays, délivra, en juin 1940, plus de 30 000 visas à des juifs leur permettant ainsi de sauver leur vie, c'est à dire qu'il accepta délibérément de sortir du cadre existant pour n'agir que selon sa conscience. C'est, au sens de l'auteur, faire prévaloir la liberté simplement parce qu'on accepte de s'abstraire des contraintes mentales imposées, c'est aussi une manière de créativité puisqu'on invente ainsi une forme d'action qui est sans modèle préétabli. Ce n'est plus seulement un acte de résistance, c'est l'exploration d'une voie nouvelle qui met en évidence le concept de liberté, une véritable réinvention de soi. En ce qui le concerne, il avoue qu'il n'a pas ce courage et voit ici la raison de son défaut d'action. Il avoue quand même, malgré tout ce qu'il a dit auparavant et qui est de nature philosophique et altruiste que pour nombre de jeunes leur entrée personnelle en Résistance n'a pas été motivée par les rafles de juifs mais par l'institution du STO en février 1943 ! Pour lui c'est une véritable bifurcation qui le détermine grâce à des certificats médicaux à se faire affecter à la bibliothèque de l’École et attendre ainsi la Libération. Il parvient quand même à se dire que c'est là une forme de désobéissance et qu'il peut ainsi aider ceux qui ont fait le choix de la Résistance alors que son père n'a pu échapper au travail obligatoire en Allemagne.
Parmi tous ceux qu'il énumère et qui sont entrés en résistance, beaucoup sont croyants et s'estiment inspirés par Dieu. L'auteur qui, à l'inverse de son père, avoue être agnostique, ne peut justifier sa forme d'engagement, si faible soit-elle, par sa foi. Pour autant il admet que la démarche de ceux qui se sont engagés à résister, est de l'ordre du mystère et qu'il y a en nous un autre « moi ».
C'est donc un livre passionnant, agréable à lire, une fiction croisée avec un témoignage authentique qui donne l'occasion d'une réflexion sur l'éthique, d'un questionnement intime et peut-être d'une remise en cause personnelle.
© Hervé GAUTIER - Août 2013 - http://hervegautier.e-monsite.com
Lien : http://hervegautier.e-monsit..
L'auteur tente de se mettre dans la peau d'un jeune homme qui aurait eu l'âge de son père en 1940 et d'imaginer la trajectoire qu'il aurait choisie, quels événements fortuits ou déclics auraient pu orienter son choix. Pour illustrer son propos, il s'appuie sur des exemples (film, expériences, témoignages, résistants, prisonniers) dans différentes guerres ou régimes sanguinaires,, des hommes ou des femmes qui ont été capables de surmonter la peur, la terreur, et qui, en raison peut-être de leur groupe social, d'une rencontre déterminante, d'une éthique, de leur foi, de leur capacité d'empathie, ont réussi à passer à l'acte, à s'engager activement. Une belle réflexion qui incite à faire sa propre introspection, à réfléchir à nos choix.
Pourquoi faire un livre sur l'apologie de la non-lecture ?
L'auteur semble considérer avoir totalement raison, ce qui agace rapidement le lecteur. Doit-on se considérer comme inférieurs, nous les vrais lecteurs, qui lisent les livres de la couverture à l'achevé d'imprimer ?
En somme, un essai qui tourne globalement en rond, mais a le mérite de proposer quelques exemples intéressants.
L'auteur semble considérer avoir totalement raison, ce qui agace rapidement le lecteur. Doit-on se considérer comme inférieurs, nous les vrais lecteurs, qui lisent les livres de la couverture à l'achevé d'imprimer ?
En somme, un essai qui tourne globalement en rond, mais a le mérite de proposer quelques exemples intéressants.
Souvent provoquant, cet essai aborde un tabou de notre culture : celui de la non-lecture. Au delà d'un pseudo-guide pratique de conversation autour des livres que l'ont a pas lus (mais aussi de ceux que l'on a oubliés...), l'auteur propose une nouvelle théorie de la lecture autour de concepts tels que livres-écrans, bibliothèque intérieure, livres-fantômes...
Le tout est accompagné dans les notes de bas de pages d'un nouveau type de citations bibliogrpahiques, assez décapantes!
Le tout est accompagné dans les notes de bas de pages d'un nouveau type de citations bibliogrpahiques, assez décapantes!
C’est bien écrit, l’auteur développe une théorie sur la construction et les clés qui font des polars des succès ou non. C’est intéressant pour qui se passionne pour ce genre. Enfin, il reprend le cas de Roger Ackroyd pour proposer, à partir des éléments que nous donne Agatha Christie, un autre coupable, un autre mobile. L’exercice est intéressant et amusant si l’on s’intéresse à ce genre, bien sûr. J’avoue avoir survolé les 168 pages (188 - 20), ce qui dépassait le temps que j’étais disposé à consacrer à ce jeu.
Attention spoiler alert ! Le titre de ce nouvel essai (2022) de Pierre BAYARD est une supercherie. Si vous vouliez tout savoir sur les Beatles et les raisons de leur renommée analysées au rayon X, vous voilà refaits ! En effet, seulement un chapitre et à peine 10 pages sont consacrés aux fameux Scarabées de Liverpool et à celui qui les fit découvrir au monde entier en octobre 1961 : Brian EPSTEIN. En revanche, si vous n’êtes pas rancuniers et que vous décidez d’aller au bout de ce documentaire, vous allez en apprendre de belles tout en vous amusant follement, comme souvent chez Pierre BAYARD.
BAYARD est l’un de ces types que la version rationnelle de l’Histoire ne satisfait pas, et qui cherche à comprendre par ses propres moyens. Alors il va fourrer son nez dans une écriture parallèle. Ainsi, dans cet essai comme toujours consacré en partie à la littérature, il va à nouveau déconstruire des pensées, des certitudes. Rien de mieux que de convoquer des œuvres célèbres pour alimenter et documenter son raisonnement.
L’auteur nous entretient sur l’éclipse historique, en gros (ne pas) être au bon endroit (pas) au bon moment. Il en va pour la plupart des exemples réunis dans cet essai. Il est question des destins de Camille CLAUDEL, de Ben JONSON, ami et rival de SHAKESPEARE, par ailleurs auteur de « Volpone et le renard », œuvre redécouverte des siècles après sa mort et qui fait aujourd’hui autorité dans le théâtre.
BAYARD imagine un monde « sans » : sans MARX par exemple (et c’est PROUDHON qui aurait vraisemblablement tiré les marrons du feu), sans FREUD et les personnalités multiples, sans KAFKA, sans PROUST (quasiment ignoré avant d’être adulé dans des circonstances que rappelle l’auteur), sans Simone de BEAUVOIR et tant d’autres. Ou un monde sans « Le docteur Jivago » de PASTERNAK car, une fois de plus, la réalité historique la plus tordue qui soit nous vient de Russie (d’U.R.S.S. pour être précis), pays ignorant parfaitement le roman fleuve de PASTERNAK à sa sortie (censure oblige), alors que ce sont les Etats-Unis qui seront à la manœuvre pour justement le faire connaître en Occident et ainsi décrédibiliser le régime soviétique.
Ecrit ainsi, cela peut paraître superficiel. Mon propos ne se risquera pas à entrer dans les détails, ceux concernant les biais cognitifs ou encore les univers parallèles, mais en résumant succinctement, on peut noter que BAYARD emprunte des figures ou des œuvres passées, les recontextualise et les imagine telles que leur écho aurait pu advenir ou non dans un autre monde, à une autre époque, sans les mêmes « concurrents » par exemple, sans les mêmes tenants ni les mêmes aboutissants. Sans vous en dévoiler plus, il faut lire le chapitre dédié à Louise LABÉ afin de bien comprendre la démarche de l’auteur : comment nous créons et modelons un mythe, ici littéraire.
Mais cet ouvrage est aussi celui d’un psychanalyste érudit qui se plaît à glisser des uchronies dans ses propos pour en montrer la force. Il emploie souvent le terme « paradigme » pour situer une œuvre ou une célébrité dans un espace défini du temps à un moment donné, puis la faire glisser ailleurs, sans oublier « l’influence rétrospective », passionnante, qui dépeint un événement servant à la compréhension du passé et non pas du futur.
L’éclipse prend une place non négligeable dans les réflexions de l’auteur, qui là aussi prend des modèles documentés, montrant que telle œuvre oubliée, est réapparue plus tard, en quelque sorte dans un autre monde, pour être prise en exemple sans pourtant avoir traité exactement des sujets énoncés ensuite par les spécialistes.
Méticuleusement, BAYARD déroule ses idées et en vient au cas spécifique du féminisme, où des femmes ont été oubliées de l’Histoire (souvent écrite par des hommes - dominants), puis ont fini par ressurgir grâce à une conjoncture plus favorable. Je n’en dévoilerai pas plus, et même si ce livre est parfois un peu ardu, il vaut le coup par son originalité, ses pieds de nez à l’Histoire et ses réhabilitations (ou ses condamnations, là aussi a posteriori), un essai qui nous rend curieux car délivrant de nombreuses références. Comme la plupart des ouvrages de l’auteur, il est sorti dans la prestigieuse collection paradoxe des éditions de Minuit.
https://deslivresrances.blogspot.com/
Lien : https://deslivresrances.blog..
BAYARD est l’un de ces types que la version rationnelle de l’Histoire ne satisfait pas, et qui cherche à comprendre par ses propres moyens. Alors il va fourrer son nez dans une écriture parallèle. Ainsi, dans cet essai comme toujours consacré en partie à la littérature, il va à nouveau déconstruire des pensées, des certitudes. Rien de mieux que de convoquer des œuvres célèbres pour alimenter et documenter son raisonnement.
L’auteur nous entretient sur l’éclipse historique, en gros (ne pas) être au bon endroit (pas) au bon moment. Il en va pour la plupart des exemples réunis dans cet essai. Il est question des destins de Camille CLAUDEL, de Ben JONSON, ami et rival de SHAKESPEARE, par ailleurs auteur de « Volpone et le renard », œuvre redécouverte des siècles après sa mort et qui fait aujourd’hui autorité dans le théâtre.
BAYARD imagine un monde « sans » : sans MARX par exemple (et c’est PROUDHON qui aurait vraisemblablement tiré les marrons du feu), sans FREUD et les personnalités multiples, sans KAFKA, sans PROUST (quasiment ignoré avant d’être adulé dans des circonstances que rappelle l’auteur), sans Simone de BEAUVOIR et tant d’autres. Ou un monde sans « Le docteur Jivago » de PASTERNAK car, une fois de plus, la réalité historique la plus tordue qui soit nous vient de Russie (d’U.R.S.S. pour être précis), pays ignorant parfaitement le roman fleuve de PASTERNAK à sa sortie (censure oblige), alors que ce sont les Etats-Unis qui seront à la manœuvre pour justement le faire connaître en Occident et ainsi décrédibiliser le régime soviétique.
Ecrit ainsi, cela peut paraître superficiel. Mon propos ne se risquera pas à entrer dans les détails, ceux concernant les biais cognitifs ou encore les univers parallèles, mais en résumant succinctement, on peut noter que BAYARD emprunte des figures ou des œuvres passées, les recontextualise et les imagine telles que leur écho aurait pu advenir ou non dans un autre monde, à une autre époque, sans les mêmes « concurrents » par exemple, sans les mêmes tenants ni les mêmes aboutissants. Sans vous en dévoiler plus, il faut lire le chapitre dédié à Louise LABÉ afin de bien comprendre la démarche de l’auteur : comment nous créons et modelons un mythe, ici littéraire.
Mais cet ouvrage est aussi celui d’un psychanalyste érudit qui se plaît à glisser des uchronies dans ses propos pour en montrer la force. Il emploie souvent le terme « paradigme » pour situer une œuvre ou une célébrité dans un espace défini du temps à un moment donné, puis la faire glisser ailleurs, sans oublier « l’influence rétrospective », passionnante, qui dépeint un événement servant à la compréhension du passé et non pas du futur.
L’éclipse prend une place non négligeable dans les réflexions de l’auteur, qui là aussi prend des modèles documentés, montrant que telle œuvre oubliée, est réapparue plus tard, en quelque sorte dans un autre monde, pour être prise en exemple sans pourtant avoir traité exactement des sujets énoncés ensuite par les spécialistes.
Méticuleusement, BAYARD déroule ses idées et en vient au cas spécifique du féminisme, où des femmes ont été oubliées de l’Histoire (souvent écrite par des hommes - dominants), puis ont fini par ressurgir grâce à une conjoncture plus favorable. Je n’en dévoilerai pas plus, et même si ce livre est parfois un peu ardu, il vaut le coup par son originalité, ses pieds de nez à l’Histoire et ses réhabilitations (ou ses condamnations, là aussi a posteriori), un essai qui nous rend curieux car délivrant de nombreuses références. Comme la plupart des ouvrages de l’auteur, il est sorti dans la prestigieuse collection paradoxe des éditions de Minuit.
https://deslivresrances.blogspot.com/
Lien : https://deslivresrances.blog..
Voici une trilogie que j'ai acheté dans cet ordre, les 2 premiers il y a plus de dix ans , j'avais lu 30 pages du premier. Le 3eme vient de sortir et je l'ai lu tout de suite. C'est d'abord de la lecture, surtout les 3 de suite mais c'est avant tout une expérience. Si vous aimez entendre parler des livres, incunables, ceux comme aime savoir dans l'étagère, ceux vers qui on revient, ceux qu'on a et qu'on ne lira jamais , ceux qu'on a plus et qu'on a jamais lu, si vous avez envie de savoir pourquoi on les collectionne, pourquoi nous en parlons de façon mondaine ou sérieuse, alors je vous invite à vous plonger dans cette odyssée. C'est instructif, plein d'érudition, bien écrit et drôle. Vraiment plus qu'une lecture, le sentiment d'être adouber par des maîtres
Dans cet essai, on trouve une réflexion sur les bifurcations de la vie conduisant à (ne pas) s'engager dans l'action pour devenir un Juste ou un héros, dans des circonstances extrêmes.
L'auteur s'appuie sur quelques grands exemples empruntés à l'expérience des hommes et racontés ou rapportés dans des témoignages, des autobiographies, des essais ou des comptes rendus d'expérience.
Dans de courts chapitres très abordables, on croise ainsi, dans l'ordre, Lacombe Lucien (Malle et Modiano), Stanley Milgram puis Christopher Browning, Daniel Cordier, Romain Gary, André et Martha Trocmé, Hans et Sophie Scholl, Sousa Mendes, Milena Jesenska (et Kafka), Vann Nath, Jevan Divjak et cinq Justes rwandais.
Plus original, Pierre Bayard examine aussi les conditions dans lesquelles (ne) se serait (pas) révélée sa propre "personnalité potentielle" confrontée, une génération avant la sienne, aux tragiques événements des années 40.
On trouve enfin, devant Hannah Arendt effacée, des références assez fréquentes à quelques chercheurs et intellectuels qui se sont déjà saisis de ces questions : entre autres,
- Bayard lui-même à propos de l'image de soi déterminante dans l'engagement de R. Gary (Il était deux fois Romain Gary, 1990) ;
- Tzvetan Todorov pour sa distinction entre le Juste et le héros ou sa réflexion sur la responsabilité (Face à l'extrême, 2003) ;
- Samuel et Pearl Oliver, dans un titre programmatique : The altruitic Personality - Rescuers of Jews in Nazi Europa, 1988 ;
- Stéphane Israël à propos de l'évolution de l'ENS pendant la guerre : Les Normaliens dans la tourmente (1939-1945), 2005 ;
- José-Alain Fralon étudiant le Juste de Bordeaux (1988).
Et, plus largement sans doute :
- Harold Walzer qui propose notamment les notions de "cadre de référence" et de "marges de manoeuvre" : les Exécuteurs. Des hommes normaux aux meurtriers de masse, 2007 ;
- Michel Terestchenko dans Un si fragile vernis d'humanité. Banalité du mal, banalité du bien, 2005, pour la "présence à soi" plus substantielle qu'un "moi" relationnel fondant "cette identité d'emprunt, cette identité vide, qu'est l'image sociale de soi" (op.cit. page 290) : on a envie de poursuivre là sa lecture.
Aurais-je été résistant ou bourreau ? Un livre intéressant - une belle collection de notices commentées - qui ne parvient cependant pas toujours à dépasser les généralités échangées dans la conversation de personnes qui "posséd[ent] l'intelligence" (page 171).
L'auteur s'appuie sur quelques grands exemples empruntés à l'expérience des hommes et racontés ou rapportés dans des témoignages, des autobiographies, des essais ou des comptes rendus d'expérience.
Dans de courts chapitres très abordables, on croise ainsi, dans l'ordre, Lacombe Lucien (Malle et Modiano), Stanley Milgram puis Christopher Browning, Daniel Cordier, Romain Gary, André et Martha Trocmé, Hans et Sophie Scholl, Sousa Mendes, Milena Jesenska (et Kafka), Vann Nath, Jevan Divjak et cinq Justes rwandais.
Plus original, Pierre Bayard examine aussi les conditions dans lesquelles (ne) se serait (pas) révélée sa propre "personnalité potentielle" confrontée, une génération avant la sienne, aux tragiques événements des années 40.
On trouve enfin, devant Hannah Arendt effacée, des références assez fréquentes à quelques chercheurs et intellectuels qui se sont déjà saisis de ces questions : entre autres,
- Bayard lui-même à propos de l'image de soi déterminante dans l'engagement de R. Gary (Il était deux fois Romain Gary, 1990) ;
- Tzvetan Todorov pour sa distinction entre le Juste et le héros ou sa réflexion sur la responsabilité (Face à l'extrême, 2003) ;
- Samuel et Pearl Oliver, dans un titre programmatique : The altruitic Personality - Rescuers of Jews in Nazi Europa, 1988 ;
- Stéphane Israël à propos de l'évolution de l'ENS pendant la guerre : Les Normaliens dans la tourmente (1939-1945), 2005 ;
- José-Alain Fralon étudiant le Juste de Bordeaux (1988).
Et, plus largement sans doute :
- Harold Walzer qui propose notamment les notions de "cadre de référence" et de "marges de manoeuvre" : les Exécuteurs. Des hommes normaux aux meurtriers de masse, 2007 ;
- Michel Terestchenko dans Un si fragile vernis d'humanité. Banalité du mal, banalité du bien, 2005, pour la "présence à soi" plus substantielle qu'un "moi" relationnel fondant "cette identité d'emprunt, cette identité vide, qu'est l'image sociale de soi" (op.cit. page 290) : on a envie de poursuivre là sa lecture.
Aurais-je été résistant ou bourreau ? Un livre intéressant - une belle collection de notices commentées - qui ne parvient cependant pas toujours à dépasser les généralités échangées dans la conversation de personnes qui "posséd[ent] l'intelligence" (page 171).
Ce polar de référence n’a pas pris une ride ! Huis-clos sur une île, 10 personnages disparaissent les uns après les autres en semblant suivre les propos d’une comptine sadiquement affichée dans chacune des chambres. Le coupable est forcément sur l'île.
Le charme désuet fonctionne toujours et la tension, la suspicion, les retournements de situations n’ont rien perdu de leur efficacité.
•
Face à tant de maîtrise, j’étais ravie de m’intéresser à l’essai de Pierre Bayard qui, confiant, annonce immédiatement la couleur : “ce livre explique ce qui s’est réellement passé et pourquoi Agatha Christie s’est trompée.”
Le procédé m’a amusée : le narrateur prétend être le vrai coupable et avoir laissé un faux témoignage pour détourner l’attention. Agatha Christie serait tombée dans le piège et aurait malheureusement utilisé ce témoignage pour résoudre son enquête et ainsi, faire endosser les crimes commis sur l’île du Soldat au mauvais coupable.
•
L’ambition était réelle et la réussite n’est, à mes yeux, que partielle. Si la façon dont il est prouvé que le dénouement de l’enquête proposé par Agatha Christie est convaincante, la solution avancée à la place n’est pas plus irréfutable. A trop vouloir me faire douter de ce que le texte original avançait, j’ai douté de tout et ai appliqué aux propositions de Bayard les méthodes de déconstruction qu’il s’applique tant à nous transmettre. J’ai d’ailleurs déjà oublié la solution de remplacement qu’il avance !
En fait, je n’ai pas bien compris la manœuvre. Une grande partie de son essai vise à nous démontrer qu’Agatha Christie a recours à certains procédés d’illusionniste pour mener à bien son intrigue : l’omission volontaire, l’interprétation, le détournement d’attention… Mais n’est-ce pas le propre de tout roman policier de semer des indices subtiles pour pouvoir dire à la fin à son lecteur : “Ah ah ! mais c’était sous ton nez depuis le début” ? Sans eux, on trouve le dénouement abracadabrantesque mais s’ils sont trop nombreux et trop peu fins on est frustré et déçu de s’en douter trop vite.
•
Bref, cher Pierre Bayard, retenez que “la critique est aisée, mais l'art est difficile” comme disait l’autre.
Lien : https://www.instagram.com/p/..
Le charme désuet fonctionne toujours et la tension, la suspicion, les retournements de situations n’ont rien perdu de leur efficacité.
•
Face à tant de maîtrise, j’étais ravie de m’intéresser à l’essai de Pierre Bayard qui, confiant, annonce immédiatement la couleur : “ce livre explique ce qui s’est réellement passé et pourquoi Agatha Christie s’est trompée.”
Le procédé m’a amusée : le narrateur prétend être le vrai coupable et avoir laissé un faux témoignage pour détourner l’attention. Agatha Christie serait tombée dans le piège et aurait malheureusement utilisé ce témoignage pour résoudre son enquête et ainsi, faire endosser les crimes commis sur l’île du Soldat au mauvais coupable.
•
L’ambition était réelle et la réussite n’est, à mes yeux, que partielle. Si la façon dont il est prouvé que le dénouement de l’enquête proposé par Agatha Christie est convaincante, la solution avancée à la place n’est pas plus irréfutable. A trop vouloir me faire douter de ce que le texte original avançait, j’ai douté de tout et ai appliqué aux propositions de Bayard les méthodes de déconstruction qu’il s’applique tant à nous transmettre. J’ai d’ailleurs déjà oublié la solution de remplacement qu’il avance !
En fait, je n’ai pas bien compris la manœuvre. Une grande partie de son essai vise à nous démontrer qu’Agatha Christie a recours à certains procédés d’illusionniste pour mener à bien son intrigue : l’omission volontaire, l’interprétation, le détournement d’attention… Mais n’est-ce pas le propre de tout roman policier de semer des indices subtiles pour pouvoir dire à la fin à son lecteur : “Ah ah ! mais c’était sous ton nez depuis le début” ? Sans eux, on trouve le dénouement abracadabrantesque mais s’ils sont trop nombreux et trop peu fins on est frustré et déçu de s’en douter trop vite.
•
Bref, cher Pierre Bayard, retenez que “la critique est aisée, mais l'art est difficile” comme disait l’autre.
Lien : https://www.instagram.com/p/..
"Agatha Christie se serait-elle trompée ? Telle est l’affirmation de Pierre Bayard dans cet essai dédié au chef-d’œuvre de la romancière anglaise, ""Ils étaient dix"". Après ""Qui a tué Roger Ackroyd ?"" et ""L’Affaire du chien des Baskerville"", l’auteur consacre une nouvelle contre-enquête à l’une des plus célèbres affaires criminelles de la littérature : l’assassinat de dix personnes – meurtrier compris – sur une île isolée par la tempête. Sans jamais trahir le texte original, il relève les incohérences et les biais cognitifs ayant conduit des générations de lecteurs à accepter, sans sourciller, l’explication invraisemblable proposée par le roman, pour nous guider vers la seule conclusion logique et vers l’identité du véritable assassin.
Pierre Bayard développe ainsi une réflexion sur la position du lecteur, sur la liberté des personnages de fiction, et sur les codes du roman policier, en particulier des énigmes de chambre close. On en ressort aussi admiratif de cette nouvelle démonstration que de l’œuvre originale d’Agatha Christie, que l’auteur décortique pour mieux lui rendre hommage."
Pierre Bayard développe ainsi une réflexion sur la position du lecteur, sur la liberté des personnages de fiction, et sur les codes du roman policier, en particulier des énigmes de chambre close. On en ressort aussi admiratif de cette nouvelle démonstration que de l’œuvre originale d’Agatha Christie, que l’auteur décortique pour mieux lui rendre hommage."
Pierre Bayard offre, à travers un dilemme impossible et vraisemblable, un moyen de nous interroger sur notre place en tant que sujet – un sujet fragile, incertain, mais impliqué.
Lien : https://www.lemonde.fr/livre..
Lien : https://www.lemonde.fr/livre..
Plus qu'un roman policier comme il est classé dans ma médiathèque, je dirais que c'est un livre d'analyse critique de l'ouvrage d'Agatha Christie : "Ils étaient 10" (ex "Les dix petits nègres").
Après 2 parties consacrées à d'abord à un rappel des personnages de l'histoire et des causes de leur présence sur l'île, puis à la reprise de l'enquête, la suite est une confession du "véritable assassin" qui va expliquer pourquoi Agatha Christie s'est trompée. Pour appuyer ses dires et nous convaincre, il s'appuie sur des études psychologiques qui ont été faites sur des groupes et aussi sur tout ce qui concerne la focalisation de l'attention sur un point pour détourner l'esprit de ce qui se passe en réalité. C'est brillant et très intéressant.
Au fur et à mesure du développement, je me suis surprise à croire de plus en plus à cette version des faits qui est finalement plus crédible que la mise en scène du suicide du juge.
Une lecture que je recommande à tous les amoureux du grand classique d'Agatha Christie.
Après 2 parties consacrées à d'abord à un rappel des personnages de l'histoire et des causes de leur présence sur l'île, puis à la reprise de l'enquête, la suite est une confession du "véritable assassin" qui va expliquer pourquoi Agatha Christie s'est trompée. Pour appuyer ses dires et nous convaincre, il s'appuie sur des études psychologiques qui ont été faites sur des groupes et aussi sur tout ce qui concerne la focalisation de l'attention sur un point pour détourner l'esprit de ce qui se passe en réalité. C'est brillant et très intéressant.
Au fur et à mesure du développement, je me suis surprise à croire de plus en plus à cette version des faits qui est finalement plus crédible que la mise en scène du suicide du juge.
Une lecture que je recommande à tous les amoureux du grand classique d'Agatha Christie.
impossible de résister à une analyse et une fin alternative de Ils étaient dix (10 petits negres) d'Agatha Christie.
Le narrateur est ici le personnage du roman d origine qui prétend nous révéler la vérité sur ce qui s'est passé sur l'île des Soldats.
on débute par un rappel des personnages et de l œuvre de la reine du crime.
on présente l enquête puis la contre enquête à l'appui d arguments psychologiques et factuels, pertinents.
puis la révélation.
j avoue ne pas savoir quelle fin je préfère ni si en tant que lectrice je me suis fait abusée, mais j ai aimé mes 2 lectures : l'original et la contre enquête.
je crois M. Bayard que je vais lire d autres analyses de votre part car j'ai aimé le fond et la forme
Le narrateur est ici le personnage du roman d origine qui prétend nous révéler la vérité sur ce qui s'est passé sur l'île des Soldats.
on débute par un rappel des personnages et de l œuvre de la reine du crime.
on présente l enquête puis la contre enquête à l'appui d arguments psychologiques et factuels, pertinents.
puis la révélation.
j avoue ne pas savoir quelle fin je préfère ni si en tant que lectrice je me suis fait abusée, mais j ai aimé mes 2 lectures : l'original et la contre enquête.
je crois M. Bayard que je vais lire d autres analyses de votre part car j'ai aimé le fond et la forme
Il s'agit ici surtout de "branlette intellectuelle". J'aurais préférer me passer de cette lecture dont l'apport au débat oscille entre le "pas grand chose" et le "rien du tout".
Mais quel débat en fait ? Qui est vraiment le coupable ? Je ne vois pas vraiment l'intérêt de tenter de démontrer que l'auteur s'est trompé.
Mais quel débat en fait ? Qui est vraiment le coupable ? Je ne vois pas vraiment l'intérêt de tenter de démontrer que l'auteur s'est trompé.
Suivant l'esprit de Comment parler des livres que l'on n'a pas lus?, Pierre Bayard s'attaque ici aux lieux. Évidemment, Bayard étant fidèle à sa mission, il s'agit des lieux principalement présents dans la littérature. Voici donc « différentes manières de ne pas voyager » à l'usage de celles et ceux que Bayard nomme les voyageurs casaniers. On aura droit à des autobiographies d'auteurs qui n'ont pas eu l'heur de visiter les lieux qu'ils décrivent, à des essais écrits par des gens qui ne se sont pas rendus aux emplacements qui font l'objet de leur texte, à des écrivains mythomanes et à divers cas où la littérature a créé des univers fictionnels au grand plaisir, souvent, des lecteurs que nous sommes. De Marco Polo à Emmanuel Kant, de Chateaubriand à Édouard Glissant qui décrit l'île de Pâques, Bayard nous transporte et nous trimballe en nous chavirant et nous emballant. Il a encore frappé juste avec cette incursion dans le monde du voyage sans déplacement.
Lien : http://rivesderives.blogspot..
Lien : http://rivesderives.blogspot..
J’aime les analyses de Pierre Bayard sur des grandes oeuvres du roman policier (Dix petits nègres, Roger Ackroyd). Évidement, j’ai commencé par lire les plus récents.
J’ai donc été un peu déçue par cette analyse plus ancienne (2008) dans laquelle il explique encore une fois la différence entre intégrationnistes et ségrégationnistes.
Et cette explication prend beaucoup de place dans le livre, la théorie sur le véritable meurtrier ne venant que rapidement dans les toutes dernières pages. Et c’est bien dommage.
J’ai tout de même bien cru, au fil de ma lecture, que Pierre Bayard allait m’annoncer que Watson était lé véritable coupable. Mais non.
J’ai été surprise de découvrir que Sherlock n’avait pas résolu toutes ses enquêtes malgré sa méthode d’analyse scientifique.
J’ai découvert les autres écrits de Conan Doyle dont il pensait que ces séries-là le mèneraient à la postérité.
Bon, j’ai tout de même appris des choses lors de cette lecture, mais il m’a manqué une analyse du roman de Conan Doyle auquel l’auteur m’avait habitué.
Lien : https://alexmotamots.fr/laff..
J’ai donc été un peu déçue par cette analyse plus ancienne (2008) dans laquelle il explique encore une fois la différence entre intégrationnistes et ségrégationnistes.
Et cette explication prend beaucoup de place dans le livre, la théorie sur le véritable meurtrier ne venant que rapidement dans les toutes dernières pages. Et c’est bien dommage.
J’ai tout de même bien cru, au fil de ma lecture, que Pierre Bayard allait m’annoncer que Watson était lé véritable coupable. Mais non.
J’ai été surprise de découvrir que Sherlock n’avait pas résolu toutes ses enquêtes malgré sa méthode d’analyse scientifique.
J’ai découvert les autres écrits de Conan Doyle dont il pensait que ces séries-là le mèneraient à la postérité.
Bon, j’ai tout de même appris des choses lors de cette lecture, mais il m’a manqué une analyse du roman de Conan Doyle auquel l’auteur m’avait habitué.
Lien : https://alexmotamots.fr/laff..
Encore une fois très adroit et incroyablement sûr dans sa démonstration, Pierre Bayard met ses bonnes idées et son impertinence au service de l'Histoire de la littérature. Ainsi, s'il s'interroge sur la "conception linéaire de la temporalité" et s'amuse à perturber l'ordre des choses à base de "causes postérieures" et de "conséquences antérieures", il offre surtout au lecteur un cours magistral, au sens propre comme au sens figuré, et l'invite à à remettre en question sa lecture des oeuvres.
L'article complet sur Touchez mon blog, Monseigneur...
Lien : https://touchezmonblog.blogs..
L'article complet sur Touchez mon blog, Monseigneur...
Lien : https://touchezmonblog.blogs..
L'assassin n'est pas celui qu'on croit.
Me serais-je trompée?
Non. Impossible.
Je connais les lieux, je les ai créés.
Je connais les personnages, je leur ai donné vie.
Je connais l'intrigue, je l'ai imaginée.
Pensez-vous vraiment que je me sois trompée à ce point, moi la Reine du roman policier?
Aurais-je été trompée?
Mais par qui? Un de mes personnages ?
Moi qui les ai créés de toute pièce, comment auraient-ils pu me faire ça?
Je dois admettre que #pierrebayard l'explique bien. Il me faut le reconnaître, les personnages possèdent une certaine autonomie. Ils peuvent tout à fait prendre des directions différentes de la mienne.
Bon, de là à "réclamer un statut du personnage littéraire", n'exagérons pas, tout de même...
Il semblerait même que la structure littéraire de mon texte leur ait donné davantage d'indépendance.
Alors, aurais-je été trompée par l'un des miens?
C'est bien ce que revendique le narrateur, un de mes personnages donc, un comble, exploitant toutes les théories littéraires expliquées par Bayard à son avantage.
Pense-t-il réellement que je me sois laissé berner?
Impossible.
Pas moi.
Vous aurais-je trompés?
Pierre Bayard l'explique parfaitement.
N'en déplaise au narrateur, je suis la seule responsable de votre aveuglement, orchestré par la constitution de mon récit.
L'exploitation des différents biais cognitifs, notamment narratifs, vous a tous conduits à la mauvaise solution.
J'ai pourtant semé des indices grossiers, que personne n'aura relevés jusqu'à Bayard.
La négation du réel, toujours.
Dans deux autres romans également.
Qu'étonnamment personne n'a vus.
Aveuglement quand tu nous tiens... Alors, relisez mon roman, je vous offre une dernière chance d'identifier le coupable.
Et sinon, plongez-vous dans celui de Pierre Bayard.
Didactique, clair et documenté, il vous apportera la solution à l'énigme en plus d'une réflexion riche et passionnante sur les procédés littéraires , notamment en matière d'aveuglement et de détournement d'attention.
Littérairement vôtre,
Agatha
Lien : https://www.instagram.com/p/..
Me serais-je trompée?
Non. Impossible.
Je connais les lieux, je les ai créés.
Je connais les personnages, je leur ai donné vie.
Je connais l'intrigue, je l'ai imaginée.
Pensez-vous vraiment que je me sois trompée à ce point, moi la Reine du roman policier?
Aurais-je été trompée?
Mais par qui? Un de mes personnages ?
Moi qui les ai créés de toute pièce, comment auraient-ils pu me faire ça?
Je dois admettre que #pierrebayard l'explique bien. Il me faut le reconnaître, les personnages possèdent une certaine autonomie. Ils peuvent tout à fait prendre des directions différentes de la mienne.
Bon, de là à "réclamer un statut du personnage littéraire", n'exagérons pas, tout de même...
Il semblerait même que la structure littéraire de mon texte leur ait donné davantage d'indépendance.
Alors, aurais-je été trompée par l'un des miens?
C'est bien ce que revendique le narrateur, un de mes personnages donc, un comble, exploitant toutes les théories littéraires expliquées par Bayard à son avantage.
Pense-t-il réellement que je me sois laissé berner?
Impossible.
Pas moi.
Vous aurais-je trompés?
Pierre Bayard l'explique parfaitement.
N'en déplaise au narrateur, je suis la seule responsable de votre aveuglement, orchestré par la constitution de mon récit.
L'exploitation des différents biais cognitifs, notamment narratifs, vous a tous conduits à la mauvaise solution.
J'ai pourtant semé des indices grossiers, que personne n'aura relevés jusqu'à Bayard.
La négation du réel, toujours.
Dans deux autres romans également.
Qu'étonnamment personne n'a vus.
Aveuglement quand tu nous tiens... Alors, relisez mon roman, je vous offre une dernière chance d'identifier le coupable.
Et sinon, plongez-vous dans celui de Pierre Bayard.
Didactique, clair et documenté, il vous apportera la solution à l'énigme en plus d'une réflexion riche et passionnante sur les procédés littéraires , notamment en matière d'aveuglement et de détournement d'attention.
Littérairement vôtre,
Agatha
Lien : https://www.instagram.com/p/..
Dans la vérité sur les dix petits nègres, Pierre Bayard explique à ses lecteurs comment la conclusion des Dix petits nègres aurait dû être toute autre. Pour ce faire, il va proposer une explication sur la littérature portant sur les meurtres en piece close ou en lieu isolé. Puis il explique comment le lecteur a pu avoir son attention détournée. Et enfin, il propose une autre version pour la fin des Dix petits nègres.
C'est très intéressant et assez bluffant, même si la fin qu'il propose peut également souffrir d'une même analyse.
C'est très intéressant et assez bluffant, même si la fin qu'il propose peut également souffrir d'une même analyse.
Pierre Bayard qui nous avait offert Comment parler des livres que l'on a pas lus?, Pierre Bayard qui s'insinue dans le monde du livre et de la littérature en empruntant diverses portes, en choisissant divers parcours, en traitant le sujet selon des angles toujours plus originaux, nous entraîne ici, par cet essai littéraire, sur le terrain assurément mystérieux des univers parallèles. Il suscite notre curiosité, notre désir d'en savoir plus, de comprendre, si cela était imaginable, l'impact de la théorie des univers parallèles et les traces qu'elle aurait pu laisser sur la littérature, sur nos lectures et donc sur notre vie. Se situant à l'une des frontières multiples entre la science et la science-fiction, il nous convie à une exploration de cette hypothèse, maintenant partagée par plusieurs physiciens, pour y découvrir une possible solution à diverses énigmes que nous a laissées la littérature. Allant des paradoxes des voyages dans le temps au sentiment partagé de déjà-vu, du chat de Schrödinger à la théorie des passages et des glissements entre des univers partageant une grande part de réalité comme dans 1Q84 de Murakami, des écritures inspirées de vies parallèles au plagiat par anticipation, Bayard nous amène par cet exercice ludique de réflexion à saisir que nos lectures sont en quelque sorte des regards sur des univers issus de bifurcations et que souvent les auteurs font office de passeurs.
J'aurai vécu un très beau moment de lecture dans l'étrange univers de Bayard.
Lien : http://rivesderives.blogspot..
J'aurai vécu un très beau moment de lecture dans l'étrange univers de Bayard.
Lien : http://rivesderives.blogspot..
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur
Auteurs proches de Pierre Bayard
Lecteurs de Pierre Bayard (1247)Voir plus
Quiz
Voir plus
Comment parler des livres que l'on n'a pas lus ?
Un des chapitres débute avec la phrase : « L’idéal, pour séduire quelqu’un en parlant des livres qu’il aime, sans les avoir lus nous-mêmes, serait d’arrêter le temps ». Pierre Bayard étaie cette hypothèse en évoquant le film …
Massacre à la tronçonneuse (The Texas Chain Saw Massacre)
Un jour sans fin (Groundhog Day)
7 questions
167 lecteurs ont répondu
Thème : Comment parler des livres que l'on n'a pas lus ? de
Pierre BayardCréer un quiz sur cet auteur167 lecteurs ont répondu