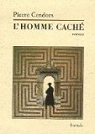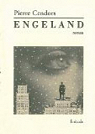Critiques de Pierre Cendors (88)
Journal de voyage et d'écriture, prélude ou spin off des Archives du vent joliment publié par les bien nommées éditions Isolato au printemps 2015, L'Invisible dehors, carnets islandais d'un voyage intérieur, raconte l'expédition menée par Pierre Cendors dans le cadre des Archives. Or, sitôt parvenu à destination, le voilà qui cesse d'écrire, oublie ce pour quoi il est venu...La suite ici : http://ericdarsan.blogspot.fr/2015/10/archives-du-vent-linvisible-dehors.html
Lien : http://ericdarsan.blogspot.f..
Lien : http://ericdarsan.blogspot.f..
Labyrinthique, onirique et méditative, chamanique et médiumnique, évanescente et granitique : telle est l'oeuvre de Pierre Cendors que l'on découvre à travers ces Archives du vent, jeu de solitaire mouvant et émouvant, étrange et fascinant, de casse-tête et de patience, sorti au Tripode le 17 septembre. La suite ici : http://ericdarsan.blogspot.fr/2015/10/archives-du-vent-linvisible-dehors.html
Lien : http://ericdarsan.blogspot.f..
Lien : http://ericdarsan.blogspot.f..
Expliquer en quoi Archives du vent est selon moi un très bon livre est singulièrement difficile. J’ai l’impression que c’est un peu le genre de roman qui te piège dans son propre univers, ses propres références, sa propre logique… avant de te le laisser sortir un peu hébété, ravi mais pas forcément capable de lui rendre justice… Tu es alors sorti de son système de référence, des repères qu’il a savamment posés un à un, et si tu as le malheur de sortir certains de ses préceptes hors contextes, ils n’ont plus l’air de rien, alors que placés où ils étaient, dits de cette façon, ils décoiffaient. Je vais essayer tout de même, parce que bon, sinon, il n’y aurait pas de chronique, et ce serait dommage que je passe des heures à vous parler des livres qui ne m’ont pas totalement convaincue pour ne pas poster sur ceux qui m’ont vraiment emportée comme jamais… Mais sachez-le, c’est bien plus difficile !
On découvre au début du roman le personnage d’Egon Storm, réalisateur de génie qui a inventé le Movicône : un procédé révolutionnaire qui à partir des images dont on dispose d’acteurs et personnalités disparus permet de reconstituer toute une palette afin de leur faire jouer de nouveaux rôles. Il réalise trois films à l’aide de cette technique : Nebula, La Septième Solitude et Le Rapport Usher, qui sortent tous à cinq ans d’intervalle. Cinq ans plus tard après le dernier, il fait parvenir à son projectionniste un ensemble de confidences où il évoque l’existence d’un quatrième et dernier film, Erland Solness…
Archives du vent, c’est toute l’histoire qui court, sinueuse, autour de ce film mystérieux, que le spectateur du roman ne découvrira peut-être un jour que par le plus heureux des hasard. Entre deux chapitres-fondus au noir, on découvre de nouveaux personnages : Egon Storm, qui nous semblait si lointain au début, alors qu’on ne le percevait que par ses confidences de réalisateur, nous apparaît plus touchant, plus familier, alors qu’on le côtoie plus directement ensuite ; Erland Solness, compagnon d’infortune et ami d’adolescence, se révèle pour Storm une source d’inspiration, plus profonde et inépuisable qu’en apparence… enfin, ses descendants aux multiples visages, oscillant tour à tour entre le réel et le fictionnel, à la fois obstacles et adjuvants dans la création d’Erland Solness, l’oeuvre. C’est difficile de bien décrire, parce que le livre est compliqué. Rien n’y est moins clair que les frontières entre le monde réel et l’autre-monde, bastion de l’imagination, et parfois reflet déformé, agrandi, amélioré de ce qui a déjà eu lieu. Mais ce n’est pas grave, parce que ça ne m’a jamais semblé inutilement compliqué. Le flou artistique qui entoure certains passages, leur poésie diffuse, les décrochages de sens, les bonds de la logique et de la perception, tout semble avoir sa place dans ce roman.
(La suite sur le blog)
Lien : https://gnossiennes.wordpres..
On découvre au début du roman le personnage d’Egon Storm, réalisateur de génie qui a inventé le Movicône : un procédé révolutionnaire qui à partir des images dont on dispose d’acteurs et personnalités disparus permet de reconstituer toute une palette afin de leur faire jouer de nouveaux rôles. Il réalise trois films à l’aide de cette technique : Nebula, La Septième Solitude et Le Rapport Usher, qui sortent tous à cinq ans d’intervalle. Cinq ans plus tard après le dernier, il fait parvenir à son projectionniste un ensemble de confidences où il évoque l’existence d’un quatrième et dernier film, Erland Solness…
Archives du vent, c’est toute l’histoire qui court, sinueuse, autour de ce film mystérieux, que le spectateur du roman ne découvrira peut-être un jour que par le plus heureux des hasard. Entre deux chapitres-fondus au noir, on découvre de nouveaux personnages : Egon Storm, qui nous semblait si lointain au début, alors qu’on ne le percevait que par ses confidences de réalisateur, nous apparaît plus touchant, plus familier, alors qu’on le côtoie plus directement ensuite ; Erland Solness, compagnon d’infortune et ami d’adolescence, se révèle pour Storm une source d’inspiration, plus profonde et inépuisable qu’en apparence… enfin, ses descendants aux multiples visages, oscillant tour à tour entre le réel et le fictionnel, à la fois obstacles et adjuvants dans la création d’Erland Solness, l’oeuvre. C’est difficile de bien décrire, parce que le livre est compliqué. Rien n’y est moins clair que les frontières entre le monde réel et l’autre-monde, bastion de l’imagination, et parfois reflet déformé, agrandi, amélioré de ce qui a déjà eu lieu. Mais ce n’est pas grave, parce que ça ne m’a jamais semblé inutilement compliqué. Le flou artistique qui entoure certains passages, leur poésie diffuse, les décrochages de sens, les bonds de la logique et de la perception, tout semble avoir sa place dans ce roman.
(La suite sur le blog)
Lien : https://gnossiennes.wordpres..
Nebula, La septième solitude et Le Rapport Usher : trois films du mouvement cinématographique tout nouveau, le Movicône (mélange de film et d'images d'archives), inventé par Egon Storm, cinéaste mystérieux, qui utilisent des images de Louise Brooks, Marlon Brandon et Adolf Hitler en leur faisant jouer des rôles qu'ils n'ont jamais tenus, Le procédé va avoir un succès mondial qui rendra son auteur célèbre et riche,
Au bord de la faillite, le ciné-club le Lunaire se voit sauvé par l'envoi de Nebula film devenu culte envoyé par son réalisateur, suivi d'un deuxième puis d'un troisième tous les cinq ans,
Lors de son ultime interview, Egon Storm semble annoncer son dernier film Solness et s'adresser, sans qu'on sache de qui il s'agit, à un certain Erland, : Er -land, Solness : le pays sans soleil ? Envoyé au Lunaire ? Réalisé par un Storm ? L'auteur joue avec nous,,,
Mais qui est cet Erland ? Depuis la Bavière où il vit, Erland Solness, âgé de vingt ans, se voit envoyé dans un cabaret par une sorte de devin, cabaret où il va entendre parler de cet interview, Erland Solness, c'est aussi le nom de son père qui lui a laissé une lettre mystérieuse, à lire le jour de ses 20 ans,
Une enquête quasi policière débute,
Les images , les époques et les lieux se répondent, en une trame fine et savante comme un fondu-enchaîné où nous verrions se faire et se défaire toutes les nuances des nuages, Islande, Écosse, Bavière, Norvège, Années 30, années 50, cinéma muet, images en noir et blanc, apparitions de Buffalo Bill dans son Wild West Show, regard perçant et scrutateur de Louise Brooks, Hitler devenu poète, Dali roulant les rrr à la catalane : un tourbillon d'images et d'évocations nous donnent le vertige, encore bien plus quand on découvre que la réalité n 'est là que pour faire émerger l'imaginaire, que la vie réelle et la vie rêvée se mêlent et se superposent,
Il est difficile de rendre compte d'un vertige, d'une plongée dans l'inconscient, à la frontière du surnaturel, La langue de Cendors, cinématographique, belle, toutes en volutes, nous hypnotise et nous retient, même quand on se dit que, tout de même, l'histoire est par moments confuse, Une lecture exigeante, hypnotique, qui permet de s'arracher à un réel en ce moment fait de sauvagerie (nous sommes le 18 novembre : 130 morts à Paris),
Au bord de la faillite, le ciné-club le Lunaire se voit sauvé par l'envoi de Nebula film devenu culte envoyé par son réalisateur, suivi d'un deuxième puis d'un troisième tous les cinq ans,
Lors de son ultime interview, Egon Storm semble annoncer son dernier film Solness et s'adresser, sans qu'on sache de qui il s'agit, à un certain Erland, : Er -land, Solness : le pays sans soleil ? Envoyé au Lunaire ? Réalisé par un Storm ? L'auteur joue avec nous,,,
Mais qui est cet Erland ? Depuis la Bavière où il vit, Erland Solness, âgé de vingt ans, se voit envoyé dans un cabaret par une sorte de devin, cabaret où il va entendre parler de cet interview, Erland Solness, c'est aussi le nom de son père qui lui a laissé une lettre mystérieuse, à lire le jour de ses 20 ans,
Une enquête quasi policière débute,
Les images , les époques et les lieux se répondent, en une trame fine et savante comme un fondu-enchaîné où nous verrions se faire et se défaire toutes les nuances des nuages, Islande, Écosse, Bavière, Norvège, Années 30, années 50, cinéma muet, images en noir et blanc, apparitions de Buffalo Bill dans son Wild West Show, regard perçant et scrutateur de Louise Brooks, Hitler devenu poète, Dali roulant les rrr à la catalane : un tourbillon d'images et d'évocations nous donnent le vertige, encore bien plus quand on découvre que la réalité n 'est là que pour faire émerger l'imaginaire, que la vie réelle et la vie rêvée se mêlent et se superposent,
Il est difficile de rendre compte d'un vertige, d'une plongée dans l'inconscient, à la frontière du surnaturel, La langue de Cendors, cinématographique, belle, toutes en volutes, nous hypnotise et nous retient, même quand on se dit que, tout de même, l'histoire est par moments confuse, Une lecture exigeante, hypnotique, qui permet de s'arracher à un réel en ce moment fait de sauvagerie (nous sommes le 18 novembre : 130 morts à Paris),
Dans la série « les-titres-qui-vous-envoûtent », j’ai craqué pour Archives du vent. C’était avant même de le voir en librairie : un post sur Internet qui présentait une sélection de romans pour l’un des innombrables prix qui fleurissent à la rentrée. Et puis je suis tombée dessus. Une superbe couverture, avec le regard insolent de Louise Brooks qui accroche immédiatement le vôtre. Je l’ai pris en main. Un objet splendide : un papier épais ; des marges confortables ; une typo élégante (Perpetua, un caractère créé en 1929, nous est-il précisé en fin d’ouvrage). Bref, un sacré beau livre qui avait fait l’objet de soins attentifs de la part d’un éditeur amoureux de son métier. Cela méritait de s’y attarder.
La quatrième de couverture était assez laconique ; seul l’un des rabats reprenait une citation du livre, qui éclairait sur la démarche volontiers ésotérique de l’auteur et le caractère ténébreux du texte.
"Mon histoire n’est pas un roman. Il ne s’agit pas plus d’un testament que d’une confession. C’est une formule talismanique pour sortir du monde sans en sortir, un blanc chamanique de la parole, quelque chose comme une aire de hors jeu dans le grand jeu cosmique où se joue notre existence."
Pas vraiment mon univers, mais pourquoi pas. Il est intéressant parfois de sortir de sa zone de confort pour explorer des horizons nouveaux et, peut-être, faire de réjouissantes découvertes...
... J’ai eu le plaisir de lire une écriture élégante, travaillée, très soignée.
Quant au récit lui-même, l’auteur sait incontestablement installer une atmosphère, quelque chose de surnaturel et d’assez poétique.
Mais, pour être franche, même si j’ai lu ce roman sans déplaisir, on ne peut pas dire que j’aie été franchement conquise. L’idée de départ était pourtant originale : un réalisateur de génie crée des films à l’aide d’un procédé révolutionnaire. En numérisant des œuvres cinématographiques ou des documents filmés, il peut, en assemblant ensuite les images à son gré, recréer des films de toute pièce, en faisant jouer aux acteurs des rôles entièrement nouveaux. Les conditions de projection de ces films obéissent à des exigences particulières de leur auteur, les entourant d’une aura de mystère supplémentaire...
S’il est amusant d’imaginer Brando en éditeur en vogue ou Louise Brooks en jeune chanteuse juive - des rôles qu’ils n’ont jamais tenus-, je n’ai pas bien saisi l’intérêt de faire d’Hitler un poète méconnu de grand talent (qui tombe amoureux de la chanteuse en question). Je ne me suis cependant pas arrêtée à ce détail...
J’ai poursuivi cette histoire nimbée de mystère en espérant qu’elle me mènerait vers des rivages inattendus. On évolue peu à peu vers une histoire de doubles dont l’un ferait le récit cinématographique de la vie de l’autre. Les frontières entre fiction et réalité semblaient se brouiller : de quoi me titiller !
Mais le fil du récit m’a paru un peu confus dans son déroulé comme dans son propos, et je suis finalement restée sur le bord du chemin... Dommage, car ce texte ne manquait pourtant pas de qualités. Au final, je ne regrette pas cette lecture, mais elle n’aura pas été le déclic d’une envolée vers de nouveaux horizons littéraires !
La quatrième de couverture était assez laconique ; seul l’un des rabats reprenait une citation du livre, qui éclairait sur la démarche volontiers ésotérique de l’auteur et le caractère ténébreux du texte.
"Mon histoire n’est pas un roman. Il ne s’agit pas plus d’un testament que d’une confession. C’est une formule talismanique pour sortir du monde sans en sortir, un blanc chamanique de la parole, quelque chose comme une aire de hors jeu dans le grand jeu cosmique où se joue notre existence."
Pas vraiment mon univers, mais pourquoi pas. Il est intéressant parfois de sortir de sa zone de confort pour explorer des horizons nouveaux et, peut-être, faire de réjouissantes découvertes...
... J’ai eu le plaisir de lire une écriture élégante, travaillée, très soignée.
Quant au récit lui-même, l’auteur sait incontestablement installer une atmosphère, quelque chose de surnaturel et d’assez poétique.
Mais, pour être franche, même si j’ai lu ce roman sans déplaisir, on ne peut pas dire que j’aie été franchement conquise. L’idée de départ était pourtant originale : un réalisateur de génie crée des films à l’aide d’un procédé révolutionnaire. En numérisant des œuvres cinématographiques ou des documents filmés, il peut, en assemblant ensuite les images à son gré, recréer des films de toute pièce, en faisant jouer aux acteurs des rôles entièrement nouveaux. Les conditions de projection de ces films obéissent à des exigences particulières de leur auteur, les entourant d’une aura de mystère supplémentaire...
S’il est amusant d’imaginer Brando en éditeur en vogue ou Louise Brooks en jeune chanteuse juive - des rôles qu’ils n’ont jamais tenus-, je n’ai pas bien saisi l’intérêt de faire d’Hitler un poète méconnu de grand talent (qui tombe amoureux de la chanteuse en question). Je ne me suis cependant pas arrêtée à ce détail...
J’ai poursuivi cette histoire nimbée de mystère en espérant qu’elle me mènerait vers des rivages inattendus. On évolue peu à peu vers une histoire de doubles dont l’un ferait le récit cinématographique de la vie de l’autre. Les frontières entre fiction et réalité semblaient se brouiller : de quoi me titiller !
Mais le fil du récit m’a paru un peu confus dans son déroulé comme dans son propos, et je suis finalement restée sur le bord du chemin... Dommage, car ce texte ne manquait pourtant pas de qualités. Au final, je ne regrette pas cette lecture, mais elle n’aura pas été le déclic d’une envolée vers de nouveaux horizons littéraires !
Un roman insulaire.
Lien : http://rss.feedsportal.com/c..
Lien : http://rss.feedsportal.com/c..
La poésie chamanique du cinéma réinventant le labyrinthe de la vie.
Sur mon blog : http://charybde2.wordpress.com/2015/10/02/note-de-lecture-bis-archives-du-vent-pierre-cendors/
Lien : http://charybde2.wordpress.c..
Sur mon blog : http://charybde2.wordpress.com/2015/10/02/note-de-lecture-bis-archives-du-vent-pierre-cendors/
Lien : http://charybde2.wordpress.c..
Entrée dans le labyrinthe fascinant de Pierre Cendors.
«Si nous cherchons quelque chose, le labyrinthe est l’endroit le plus favorable à la recherche.» Orson Welles, en exergue.
L’impression d’irréalité et de fascination qui nimbe toute l’œuvre de Pierre Cendors happe le lecteur dès ce premier roman, paru en 2006 aux éditions Finitude, une biographie ébauchée au travers de quatre nouvelles du poète pragois Endsen, poète secret ayant évolué durant son existence «dans un cercle d’invisibilité», et dont l’œuvre est devenue légendaire.
«Peu ont connu Endsen de son vivant.
Ceux qui l’ont fréquenté, morts aujourd’hui, ont conservé le silence jusqu’au bout. Le poète avait depuis toujours échappé à l’attention des biographes.»
Ecrivain aux identités fluctuantes, homme traqué, dissident clandestin du régime tchèque impliqué dans un procès politique qui plonge le lecteur dans un univers kafkaïen, Endsen apparaît comme un homme à l’identité fragmentée, dont on a perdu la trace depuis l’invasion de la Tchécoslovaquie, le 21 août 1968.
Sa disparition mystérieuse, dont la date et les circonstances elles aussi fluctuent, prend à chaque récit l’allure d’un recommencement, dans un au-delà qui est sans doute celui de la fiction.
«Tout porte à croire que j’ai été son seul confident. Pendant plus de trente ans, ses lettres me sont parvenues à la même adresse. Les périodes de silence alternaient avec des missives de plusieurs pages. La plupart provenaient de l’étranger, certaines de pays qui n’existent plus aujourd’hui.
Elles constituent un témoignage unique pour qui veut comprendre quel homme était réellement Endsen : «L’homme caché», comme on l’avait surnommé d’après le titre de son premier roman ou le poète visionnaire de L’eau-de-là ?
Là n’est pas l’essentiel. Ses premières lettres datent de son entrée au pensionnat. J’ai reçu le dernier document écrit de sa main en avril 1991, soit six ans après sa mort présumée, à Prague. Son contenu ne laisse plus de place au doute. Son séjour à Prague ne mit pas un point final à son cheminement. Bien au contraire, il lui ouvrit le passage vers un nouveau départ, une nouvelle vie, une nouvelle destination. Si de nombreux chercheurs nous ont restitué dans le détail l’errance de Rimbaud à Aden, la quête mystique d’Artaud en Irlande, aucun pourtant n’a jamais percé l’énigme de l’ultime destination d’Endsen. L’a-t-il voulu ainsi ? Personne ne discute plus aujourd’hui son droit à l’anonymat. Pas d’interviews, pas de photos ; tous les deux ans environ, une nouvelle publication, un événement publicitaire auquel il ne participerait naturellement pas : Endsen avait choisi sa vie.
Son œuvre a été sa vie.
C’est pourtant de ses derniers pas dont j’aimerais parler. Avant que tout ne disparaisse.
Avant que le temps de le suivre dans son dernier voyage ne vienne.»
Effets d’échos entre les quatre récits, incertitudes subtilement entretenues, contamination du réel et de la fiction, le pouvoir de fascination pour Endsen et son œuvre semble refléter en abyme le vertige qu’on éprouve en découvrant l’œuvre de Pierre Cendors, un œuvre qui fait monde, au cœur puissant et insaisissable.
Pierre Cendors sera l’invité de la librairie Charybde (129 rue de Charenton, 75012 Paris) le 1er octobre 2015 à 19h30.
Retrouvez cette note de lecture sur mon blog ici :
https://charybde2.wordpress.com/2015/09/29/note-de-lecture-lhomme-cache-pierre-cendors/
«Si nous cherchons quelque chose, le labyrinthe est l’endroit le plus favorable à la recherche.» Orson Welles, en exergue.
L’impression d’irréalité et de fascination qui nimbe toute l’œuvre de Pierre Cendors happe le lecteur dès ce premier roman, paru en 2006 aux éditions Finitude, une biographie ébauchée au travers de quatre nouvelles du poète pragois Endsen, poète secret ayant évolué durant son existence «dans un cercle d’invisibilité», et dont l’œuvre est devenue légendaire.
«Peu ont connu Endsen de son vivant.
Ceux qui l’ont fréquenté, morts aujourd’hui, ont conservé le silence jusqu’au bout. Le poète avait depuis toujours échappé à l’attention des biographes.»
Ecrivain aux identités fluctuantes, homme traqué, dissident clandestin du régime tchèque impliqué dans un procès politique qui plonge le lecteur dans un univers kafkaïen, Endsen apparaît comme un homme à l’identité fragmentée, dont on a perdu la trace depuis l’invasion de la Tchécoslovaquie, le 21 août 1968.
Sa disparition mystérieuse, dont la date et les circonstances elles aussi fluctuent, prend à chaque récit l’allure d’un recommencement, dans un au-delà qui est sans doute celui de la fiction.
«Tout porte à croire que j’ai été son seul confident. Pendant plus de trente ans, ses lettres me sont parvenues à la même adresse. Les périodes de silence alternaient avec des missives de plusieurs pages. La plupart provenaient de l’étranger, certaines de pays qui n’existent plus aujourd’hui.
Elles constituent un témoignage unique pour qui veut comprendre quel homme était réellement Endsen : «L’homme caché», comme on l’avait surnommé d’après le titre de son premier roman ou le poète visionnaire de L’eau-de-là ?
Là n’est pas l’essentiel. Ses premières lettres datent de son entrée au pensionnat. J’ai reçu le dernier document écrit de sa main en avril 1991, soit six ans après sa mort présumée, à Prague. Son contenu ne laisse plus de place au doute. Son séjour à Prague ne mit pas un point final à son cheminement. Bien au contraire, il lui ouvrit le passage vers un nouveau départ, une nouvelle vie, une nouvelle destination. Si de nombreux chercheurs nous ont restitué dans le détail l’errance de Rimbaud à Aden, la quête mystique d’Artaud en Irlande, aucun pourtant n’a jamais percé l’énigme de l’ultime destination d’Endsen. L’a-t-il voulu ainsi ? Personne ne discute plus aujourd’hui son droit à l’anonymat. Pas d’interviews, pas de photos ; tous les deux ans environ, une nouvelle publication, un événement publicitaire auquel il ne participerait naturellement pas : Endsen avait choisi sa vie.
Son œuvre a été sa vie.
C’est pourtant de ses derniers pas dont j’aimerais parler. Avant que tout ne disparaisse.
Avant que le temps de le suivre dans son dernier voyage ne vienne.»
Effets d’échos entre les quatre récits, incertitudes subtilement entretenues, contamination du réel et de la fiction, le pouvoir de fascination pour Endsen et son œuvre semble refléter en abyme le vertige qu’on éprouve en découvrant l’œuvre de Pierre Cendors, un œuvre qui fait monde, au cœur puissant et insaisissable.
Pierre Cendors sera l’invité de la librairie Charybde (129 rue de Charenton, 75012 Paris) le 1er octobre 2015 à 19h30.
Retrouvez cette note de lecture sur mon blog ici :
https://charybde2.wordpress.com/2015/09/29/note-de-lecture-lhomme-cache-pierre-cendors/
J'ai dévoré ce livre, après avoir fait la rencontre de son auteur au premier salon littéraire de France, et j'ai pu échanger avec lui lors d'une conversation d'on ne peut plus agréable avec Pierre Cendors.
Et ce fut avec le même charme que j'ai pu me plonger dans ce roman, qui m'a conquise totalement !
Il faut bien se l'avouer, dans la majorité des romans de nos jours, on retrouve des personnages pleins de bons sentiments, des écritures par certains égards bâclées et des références qui ,à mes yeux, devraient gentiment être glissées sous le tapis de l'ignorance humaine...
Cependant, c'est tout l'inverse dans Archive du vent, et c'est cela qui me rend si enthousiaste ! La plume est légère et fine, les mots bien tournés les références tout à fait variées !
Sans compter que l'histoire n'est pas une de ces vulgaires soupes de regrets et bonne conscience qui tente tout au long de son déroulement à nous soutirer quelques larmes..
Non, l'histoire est semblable à une douce mélodie qui vous accompagne ou vous berce...
C'est en lisant ce type de romans que je sais que la littérature a encore de beaux jours devant elle, et cela messieurs dames, ça n'a pas de prix !
Et ce fut avec le même charme que j'ai pu me plonger dans ce roman, qui m'a conquise totalement !
Il faut bien se l'avouer, dans la majorité des romans de nos jours, on retrouve des personnages pleins de bons sentiments, des écritures par certains égards bâclées et des références qui ,à mes yeux, devraient gentiment être glissées sous le tapis de l'ignorance humaine...
Cependant, c'est tout l'inverse dans Archive du vent, et c'est cela qui me rend si enthousiaste ! La plume est légère et fine, les mots bien tournés les références tout à fait variées !
Sans compter que l'histoire n'est pas une de ces vulgaires soupes de regrets et bonne conscience qui tente tout au long de son déroulement à nous soutirer quelques larmes..
Non, l'histoire est semblable à une douce mélodie qui vous accompagne ou vous berce...
C'est en lisant ce type de romans que je sais que la littérature a encore de beaux jours devant elle, et cela messieurs dames, ça n'a pas de prix !
"Mettre en lumière le langage de l'obscur".
Faire naître de l'invisible et des ombres une autre réalité que celle du monde où nous vivons.
Renouer avec l'autre partie de nous-mêmes bien plus révélatrice de qui nous sommes mais ensevelie sous la sédimentation du quotidien.
Pierre Cendors nous offre cet instant dans un texte hypnotique et sublime comme le regard magnétique et profond de l'actrice Louise Brooks, l'ange noir, qui semble sonder notre âme.
"Archives du vent", la seule lecture du titre est déjà prometteur du charme terrible de ce livre : saisir l'impalpable.
" Dans ce monde devenu tout à coup immobile, je crus entrevoir l'essence de la beauté. Elle était là, devant moi : fragile banquise d'un instant, pure flottaison de l'âme sur les hauts-fonds d'un mystère. La contempler ainsi dans sa nudité assouvissait un désir de sacré, qui dans le même temps, se révélait inextinguible".
"Le marcheur du vide", " ouverture au noir", "le cabaret du néant" sont des exemples de titres de chapitres qui sont révélateurs de l'emprise très forte d'emmener le lecteur vers une frontière de plus en plus floue entre la réalité et un autre réel possible, vers une autre dimension où le vrai et le faux s'éteignent.
L'écriture et le cinéma des années 30 et 50 s'imbriquent naturellement dans ce roman très singulier à la fois métaphysique et réaliste construit autour d'une énigme qui s'apparente à une enquête policière.
Egon Storm est un réalisateur islandais reconnu mondialement par son invention technologique révolutionnaire, le Movicône : faire jouer ensemble des acteurs disparus dans des films qu'ils n'ont jamais tournés.
Rattrapé par sa célébrité, cet homme solitaire et adepte de chamanisme se réfugie dans les terres les plus éloignées d'Islande, là où le ciel rejoint la mer.
Dans une cavité rocheuse seulement recouverte à marée haute, Egon Storm y puise l'inspiration. Il a aussi de puissantes visions qui le ramènent à un homme mystérieux, Solness.
Je ne dévoilerai pas plus l'intrigue car tout réside entre les lignes des feuilles blanches et les séquences en noir et blanc du cinéma muet.
J'ai lu le livre, j'ai vu un film , c'est un pur plaisir.
Je ne peux que répéter mon enthousiasme à lire "archives du vent".
J'ai été surprise par la tournure des évènements et complétement envoûtée par son imaginaire très séduisant.
Faire naître de l'invisible et des ombres une autre réalité que celle du monde où nous vivons.
Renouer avec l'autre partie de nous-mêmes bien plus révélatrice de qui nous sommes mais ensevelie sous la sédimentation du quotidien.
Pierre Cendors nous offre cet instant dans un texte hypnotique et sublime comme le regard magnétique et profond de l'actrice Louise Brooks, l'ange noir, qui semble sonder notre âme.
"Archives du vent", la seule lecture du titre est déjà prometteur du charme terrible de ce livre : saisir l'impalpable.
" Dans ce monde devenu tout à coup immobile, je crus entrevoir l'essence de la beauté. Elle était là, devant moi : fragile banquise d'un instant, pure flottaison de l'âme sur les hauts-fonds d'un mystère. La contempler ainsi dans sa nudité assouvissait un désir de sacré, qui dans le même temps, se révélait inextinguible".
"Le marcheur du vide", " ouverture au noir", "le cabaret du néant" sont des exemples de titres de chapitres qui sont révélateurs de l'emprise très forte d'emmener le lecteur vers une frontière de plus en plus floue entre la réalité et un autre réel possible, vers une autre dimension où le vrai et le faux s'éteignent.
L'écriture et le cinéma des années 30 et 50 s'imbriquent naturellement dans ce roman très singulier à la fois métaphysique et réaliste construit autour d'une énigme qui s'apparente à une enquête policière.
Egon Storm est un réalisateur islandais reconnu mondialement par son invention technologique révolutionnaire, le Movicône : faire jouer ensemble des acteurs disparus dans des films qu'ils n'ont jamais tournés.
Rattrapé par sa célébrité, cet homme solitaire et adepte de chamanisme se réfugie dans les terres les plus éloignées d'Islande, là où le ciel rejoint la mer.
Dans une cavité rocheuse seulement recouverte à marée haute, Egon Storm y puise l'inspiration. Il a aussi de puissantes visions qui le ramènent à un homme mystérieux, Solness.
Je ne dévoilerai pas plus l'intrigue car tout réside entre les lignes des feuilles blanches et les séquences en noir et blanc du cinéma muet.
J'ai lu le livre, j'ai vu un film , c'est un pur plaisir.
Je ne peux que répéter mon enthousiasme à lire "archives du vent".
J'ai été surprise par la tournure des évènements et complétement envoûtée par son imaginaire très séduisant.
Dans les premières convulsions de l’Allemagne nazie, le parcours de la photographe Fausta K., ou l’absence au monde comme clé de la construction d’une oeuvre.
Biographie d’artiste, extraits du catalogue d’exposition, rétrospective des œuvres de la photographe Fausta Kinsel, roman poétique avec une intrigue fascinante, «Engeland», paru en 2010 aux éditions Finitude, semble se situer en un territoire énigmatique, en lisière du fantastique, et l’on ressort de cette lecture comme d’une séance d’hypnose, sans se souvenir de tout mais fasciné.
Séparée d’avec son ami d’enfance Houdini, qui vit reclus dans une pièce depuis l’accident brutal dans un chantier de Berlin qui l’a privé de l’usage de ses jambes, et qui n’a plus avec Fausta qu’un contact épistolaire, la photographe Fausta Kinsel (1898 – 1996) parcourra le sombre vingtième siècle, habitée par l’ombre de son ami et par une solitude essentielle à son œuvre.
Quelques années après la disparition d’Houdini, Fausta, dans le milieu artistique berlinois des années 1930, est ramenée sur les traces de celui-ci en découvrant son portrait, signé d’un certain Engel. Elle recherche l’identité de ce mystérieux peintre, toujours dans l’ombre de cette âme sœur disparue.
«Plus tard, critiques et biographes expliqueront cette distance un peu solitaire qui, selon eux, annonce un artiste en devenir. L’amitié d’Houdini en serait l’origine. Pas un jour ne se passe sans que l’un ne se dédouble en pensée dans l’autre. La réalité brutale de l’accident n’y change rien. La correspondance qu’ils échangent l’affirme d’une manière surprenante : si tout désormais sépare Fausta d’Houdini, rien ne peut les désunir. Cette absence qui les éloigne d’autrui les rend âprement présents l’un à l’autre.
Bâillonnez le visible et l’invisible se met à crier à pleine voix. Cet hiver-là, au milieu d’une leçon, Fausta éprouve la violence d’un appel.»
Témoin des sombres palpitations de l’Histoire, tandis qu’en Allemagne «une grande partie de l’industrie se reconvertit dans l’armement», Fausta K. ne fait que côtoyer ces événements, et avance, solitaire, sur le chemin de sa quête intérieure, vers un vide désencombré de l’artifice au cœur de l’univers, pour dévoiler dans son œuvre ce qui ne se voit pas.
«… lorsque dans l’œil du photographe le visible ne montre que lui-même, on assiste à une sorte de déréalisation du réel ; regardez les couvertures des magazines, les images d’actualité, toutes ces photos sans issues… La réalité n’est pas le visible qu’on enregistre à l’aide d’une technique, avec cette efficacité vide, cette vitesse privée de vision, que l’on voit aujourd’hui sur les écrans.
Le réel, commentait-elle ailleurs, c’est la sensation vaste du fleuve, l’exultation calme qui s’empare de vous quand, en marchant longtemps dans le vent, une sorte de lumineux anonymat descend sur vos pas.»
Dans les ombres discrètes de Prague et d’un écrivain aux initiales similaires, F.K., ce superbe roman, avec lequel «Archives du vent» (éditions Le Tripode, septembre 2015) entrera en résonance très particulière, est habité de secrètes correspondances, comme cette coïncidence entre la disparition d’Engel et celle du magicien Harry Houdini, et des thèmes qui traversent l’œuvre de Pierre Cendors, du double et de la gémellité, du silence et du détachement de la réalité visible essentiels à la création artistique, thème central de «L’invisible dehors».
«Le chasseur des steppes et le photographe nomade parcourent un territoire identique. Ils savent que tout chemin entrave la vraie progression, que la pensée d’un but à atteindre abolit la vision. Il n’y a ni chemin, ni but ni pensées. Rien.
Mes photographies sont des raccourcis vers ce rien.»
Retrouvez cette note de lecture, et toutes celles de Charybde 2 et 7 sur leur blog ici :
https://charybde2.wordpress.com/2015/08/04/note-de-lecture-engeland-pierre-cendors/
Biographie d’artiste, extraits du catalogue d’exposition, rétrospective des œuvres de la photographe Fausta Kinsel, roman poétique avec une intrigue fascinante, «Engeland», paru en 2010 aux éditions Finitude, semble se situer en un territoire énigmatique, en lisière du fantastique, et l’on ressort de cette lecture comme d’une séance d’hypnose, sans se souvenir de tout mais fasciné.
Séparée d’avec son ami d’enfance Houdini, qui vit reclus dans une pièce depuis l’accident brutal dans un chantier de Berlin qui l’a privé de l’usage de ses jambes, et qui n’a plus avec Fausta qu’un contact épistolaire, la photographe Fausta Kinsel (1898 – 1996) parcourra le sombre vingtième siècle, habitée par l’ombre de son ami et par une solitude essentielle à son œuvre.
Quelques années après la disparition d’Houdini, Fausta, dans le milieu artistique berlinois des années 1930, est ramenée sur les traces de celui-ci en découvrant son portrait, signé d’un certain Engel. Elle recherche l’identité de ce mystérieux peintre, toujours dans l’ombre de cette âme sœur disparue.
«Plus tard, critiques et biographes expliqueront cette distance un peu solitaire qui, selon eux, annonce un artiste en devenir. L’amitié d’Houdini en serait l’origine. Pas un jour ne se passe sans que l’un ne se dédouble en pensée dans l’autre. La réalité brutale de l’accident n’y change rien. La correspondance qu’ils échangent l’affirme d’une manière surprenante : si tout désormais sépare Fausta d’Houdini, rien ne peut les désunir. Cette absence qui les éloigne d’autrui les rend âprement présents l’un à l’autre.
Bâillonnez le visible et l’invisible se met à crier à pleine voix. Cet hiver-là, au milieu d’une leçon, Fausta éprouve la violence d’un appel.»
Témoin des sombres palpitations de l’Histoire, tandis qu’en Allemagne «une grande partie de l’industrie se reconvertit dans l’armement», Fausta K. ne fait que côtoyer ces événements, et avance, solitaire, sur le chemin de sa quête intérieure, vers un vide désencombré de l’artifice au cœur de l’univers, pour dévoiler dans son œuvre ce qui ne se voit pas.
«… lorsque dans l’œil du photographe le visible ne montre que lui-même, on assiste à une sorte de déréalisation du réel ; regardez les couvertures des magazines, les images d’actualité, toutes ces photos sans issues… La réalité n’est pas le visible qu’on enregistre à l’aide d’une technique, avec cette efficacité vide, cette vitesse privée de vision, que l’on voit aujourd’hui sur les écrans.
Le réel, commentait-elle ailleurs, c’est la sensation vaste du fleuve, l’exultation calme qui s’empare de vous quand, en marchant longtemps dans le vent, une sorte de lumineux anonymat descend sur vos pas.»
Dans les ombres discrètes de Prague et d’un écrivain aux initiales similaires, F.K., ce superbe roman, avec lequel «Archives du vent» (éditions Le Tripode, septembre 2015) entrera en résonance très particulière, est habité de secrètes correspondances, comme cette coïncidence entre la disparition d’Engel et celle du magicien Harry Houdini, et des thèmes qui traversent l’œuvre de Pierre Cendors, du double et de la gémellité, du silence et du détachement de la réalité visible essentiels à la création artistique, thème central de «L’invisible dehors».
«Le chasseur des steppes et le photographe nomade parcourent un territoire identique. Ils savent que tout chemin entrave la vraie progression, que la pensée d’un but à atteindre abolit la vision. Il n’y a ni chemin, ni but ni pensées. Rien.
Mes photographies sont des raccourcis vers ce rien.»
Retrouvez cette note de lecture, et toutes celles de Charybde 2 et 7 sur leur blog ici :
https://charybde2.wordpress.com/2015/08/04/note-de-lecture-engeland-pierre-cendors/
L’énigme du quatrième film d’Egon Storm, ou l’éclatant labyrinthe littéraire de Pierre Cendors.
«Les lectures nous mènent au fond du monde plus loin que les voyages.»
Ce treizième livre et cinquième roman de Pierre Cendors, qui paraîtra en septembre 2015 aux éditions Le Tripode, forme une pièce maîtresse du puzzle de son œuvre, de cet univers cohérent et fascinant qui pullule de correspondances.
Inventeur d’une nouvelle forme cinématographique qui deviendra mythique, Egon Storm, cinéaste islandais visionnaire, vit retiré du monde. Depuis sa retraite, il a cédé les droits exclusifs d’exploitation de ses films à son ancien camarade d’études Karl Oska, faisant entrer son ciné-club menacé de faillite dans la légende future du cinéaste.
Dès la projection de Nebula, le premier film d’une œuvre annoncée comme une unique trilogie, le cinéma d’Egon Storm, «ovni cinématographique et prouesse technologique phénoménale», est devenu mythique.
«Artiste au sens où l’entendait la Renaissance, Storm, bientôt surnommé l’apprenti sorcier du cinéma islandais, devint ainsi le poète phare et le savant ouvrier d’une libération de l’image qui, dans la seconde moitié du XXIe siècle, bouleversa l’industrie cinématographique.»
Recevant le troisième et dernier long-métrage de cette trilogie, Oska découvre en écoutant l’enregistrement adressé par Storm l’existence inattendue d’un quatrième film, ayant pour personnage central un certain Erland Solness, énigmatique camarade de jeunesse du réalisateur.
Ainsi s’ouvre ce jeu de pistes borgésien, roman émaillé d’échos et d’indices dont l’aspect se transforme, de l’ombre à la lumière, au fur et à mesure de l’avancée du récit et du dénouement de l’intrigue.
Ayant pris contact avec Oska bien des années après, le fils d’Erland part dans un périple solitaire au bord de l’océan – confrontation avec le silence pour faire surgir ce qui est au-delà du visible, en écho au récit précédent de Pierre Cendors «L’invisible dehors» -, sur les traces de son père méconnu et du lien inexpliqué et visiblement ancien qui relie les deux hommes, Erland et Storm, suivant la piste de ce mystérieux et quatrième film.
«C’est là que je suis né une deuxième fois.
C’était en hiver, une fin d’après-midi. L’esprit vacant, je progressais à l’intérieur d’une ravine abritée de la bourrasque lorsque cela se produisit. L’océan était à portée de regard. Je ralentis, puis je m’arrêtai comme l’eût fait un cerf humant une présence dans le vent. Je ne parle pas d’un paysage, ni du ressac, ni même d’une lumière dans le ciel. Il n’y avait rien à voir. Rien de visible. Pourtant, mon regard était aussi alerte que si j’eusse eu, devant moi, le spectacle d’un incendie immobile, immense, un aperçu immatériel de l’âme du monde, la sensation puissante de ses harmoniques secrets.»
Dans ce roman où les œuvres littéraires et cinématographiques se répondent, où les niveaux de récit s’enchâssent et s’entrecroisent, l’histoire se noue comme un thriller, se penchant sur les correspondances entre imaginaire et réel, entre invention et miroir, formant un labyrinthe fascinant qui conserve sa part d’ombre même après son achèvement, comme le superbe «Lanark» d’Alasdair Gray, quête énigmatique qui s’organise autour du silence et de l’ombre, rappelant «Le soleil» de Jean-Hubert Gailliot.
Dédiée au plus haut comme celle de Pierre Michon, l’œuvre de Pierre Cendors semble poussée par une nécessité obscure, qui permet de révéler l’intériorité, qui révèle le sens caché du «poème sauvage d’une vie», le savoir inconscient à l’intérieur d’une expérience humaine «dans l’arrière-pays de la non-pensée, quelque part sous les astres de la volonté inconsciente, parmi les puissances oraculaires et les femmes-esprits aux paupières peintes de nuit ».
«Que sont les mots, madame, sinon des réservoirs d’énergie ? Des viviers assoupis qui, à la manière de ces flaques croupissant sur le lit caillouteux d’un torrent asséché, l’été, et pour peu que vous incliniez doucement votre ombre au-dessus d’elles, soudain révèlent une vie d’inertie frémissante ?»
Retrouvez cette note de lecture, et toutes celles de Charybde 2 et 7 sur leur blog ici :
https://charybde2.wordpress.com/2015/07/30/note-de-lecture-archives-du-vent-pierre-cendors/
Et vous pourrez rencontrer Pierre Cendors pour une soirée à la librairie Charybde le 1er octobre 2015.
«Les lectures nous mènent au fond du monde plus loin que les voyages.»
Ce treizième livre et cinquième roman de Pierre Cendors, qui paraîtra en septembre 2015 aux éditions Le Tripode, forme une pièce maîtresse du puzzle de son œuvre, de cet univers cohérent et fascinant qui pullule de correspondances.
Inventeur d’une nouvelle forme cinématographique qui deviendra mythique, Egon Storm, cinéaste islandais visionnaire, vit retiré du monde. Depuis sa retraite, il a cédé les droits exclusifs d’exploitation de ses films à son ancien camarade d’études Karl Oska, faisant entrer son ciné-club menacé de faillite dans la légende future du cinéaste.
Dès la projection de Nebula, le premier film d’une œuvre annoncée comme une unique trilogie, le cinéma d’Egon Storm, «ovni cinématographique et prouesse technologique phénoménale», est devenu mythique.
«Artiste au sens où l’entendait la Renaissance, Storm, bientôt surnommé l’apprenti sorcier du cinéma islandais, devint ainsi le poète phare et le savant ouvrier d’une libération de l’image qui, dans la seconde moitié du XXIe siècle, bouleversa l’industrie cinématographique.»
Recevant le troisième et dernier long-métrage de cette trilogie, Oska découvre en écoutant l’enregistrement adressé par Storm l’existence inattendue d’un quatrième film, ayant pour personnage central un certain Erland Solness, énigmatique camarade de jeunesse du réalisateur.
Ainsi s’ouvre ce jeu de pistes borgésien, roman émaillé d’échos et d’indices dont l’aspect se transforme, de l’ombre à la lumière, au fur et à mesure de l’avancée du récit et du dénouement de l’intrigue.
Ayant pris contact avec Oska bien des années après, le fils d’Erland part dans un périple solitaire au bord de l’océan – confrontation avec le silence pour faire surgir ce qui est au-delà du visible, en écho au récit précédent de Pierre Cendors «L’invisible dehors» -, sur les traces de son père méconnu et du lien inexpliqué et visiblement ancien qui relie les deux hommes, Erland et Storm, suivant la piste de ce mystérieux et quatrième film.
«C’est là que je suis né une deuxième fois.
C’était en hiver, une fin d’après-midi. L’esprit vacant, je progressais à l’intérieur d’une ravine abritée de la bourrasque lorsque cela se produisit. L’océan était à portée de regard. Je ralentis, puis je m’arrêtai comme l’eût fait un cerf humant une présence dans le vent. Je ne parle pas d’un paysage, ni du ressac, ni même d’une lumière dans le ciel. Il n’y avait rien à voir. Rien de visible. Pourtant, mon regard était aussi alerte que si j’eusse eu, devant moi, le spectacle d’un incendie immobile, immense, un aperçu immatériel de l’âme du monde, la sensation puissante de ses harmoniques secrets.»
Dans ce roman où les œuvres littéraires et cinématographiques se répondent, où les niveaux de récit s’enchâssent et s’entrecroisent, l’histoire se noue comme un thriller, se penchant sur les correspondances entre imaginaire et réel, entre invention et miroir, formant un labyrinthe fascinant qui conserve sa part d’ombre même après son achèvement, comme le superbe «Lanark» d’Alasdair Gray, quête énigmatique qui s’organise autour du silence et de l’ombre, rappelant «Le soleil» de Jean-Hubert Gailliot.
Dédiée au plus haut comme celle de Pierre Michon, l’œuvre de Pierre Cendors semble poussée par une nécessité obscure, qui permet de révéler l’intériorité, qui révèle le sens caché du «poème sauvage d’une vie», le savoir inconscient à l’intérieur d’une expérience humaine «dans l’arrière-pays de la non-pensée, quelque part sous les astres de la volonté inconsciente, parmi les puissances oraculaires et les femmes-esprits aux paupières peintes de nuit ».
«Que sont les mots, madame, sinon des réservoirs d’énergie ? Des viviers assoupis qui, à la manière de ces flaques croupissant sur le lit caillouteux d’un torrent asséché, l’été, et pour peu que vous incliniez doucement votre ombre au-dessus d’elles, soudain révèlent une vie d’inertie frémissante ?»
Retrouvez cette note de lecture, et toutes celles de Charybde 2 et 7 sur leur blog ici :
https://charybde2.wordpress.com/2015/07/30/note-de-lecture-archives-du-vent-pierre-cendors/
Et vous pourrez rencontrer Pierre Cendors pour une soirée à la librairie Charybde le 1er octobre 2015.
Voyage au nord de l’Islande dans la solitude et le silence, «pour rompre avec d’anciennes formes».
Dans ce livre sous titré «Carnet islandais d’un voyage intérieur», et paru en 2014 aux éditions Isolato, Pierre Cendors raconte, avec une langue poétique somptueuse, un voyage entrepris au printemps 2011, une confrontation avec les paysages élémentaires du grand nord islandais pour donner corps à un projet romanesque encore vague.
«Depuis mon retour du Septentrion, je me répète souvent ces paroles de Magnús Morland, les rares dont je me souvienne :
Je ne viens pas en Islande pour voir, au pied d’un glacier, un désert de lave, des geysers ou un volcan, car alors je perdrais l’écho de ce qui m’appelle ici. Je ne viens pas non plus contempler les aurores boréales. Je viens pour rejoindre l’autre côté d’une vision qui m’habite depuis de longues années, une vision dont je ne sais presque rien, sinon que le paysage archaïque, aux reliefs ruiniformes, de cette île qui a surgi de l’Atlantique Nord, il y a de cela 25 millions d’années, lui ressemble.»
Le voyage démarre à Hornstrandir, «un territoire dont le règne sauvage, à cette latitude et si éloigné de l’affairisme amnésique de nos sociétés, n’a rien d’un simulacre.» Pour cet écrivain marcheur, la solitude et la matière brute doivent nourrir la page blanche, dialogue intérieur face au vide entre le mouvement des pas et celui de l’imagination.
Prenant des accents d’une profondeur mystiques, Pierre Cendors dit l’éloignement du monde, le détachement d’une société utilitaire qui mutile, pour entrer dans la beauté puissante et muette et le temps distendu de ce paysage minéral, et renouveler ainsi la pensée et la forme.
«L’homme n’est peut-être qu’un épisode de l’évolution. À quelques kilomètres de Reykjavík, des rangées pimpantes de résidences-casernes, aussi déplacées dans ces étendues désertiques qu’une femme fardée, parfumée, permanentée au milieu du Sahara, soulignent brutalement l’évidence : la civilisation, toute civilisation, est une divinité clandestine déchue.»
Voyage au milieu de nulle part et au cœur de la matière, ce face-à-face avec le vide prend une direction inattendue, devant cette «nature affranchie de toute mainmise» humaine, ces distances et ces durées si vastes qu’elles font disparaître le but et imposent le silence, puis avec le choc de la découverte des toiles du peintre islandais Georg Gudni.
«Hvarfnúpur.
Laekjarfjall.
Látrafjall
Sphinx ruiniformes dont seuls demeurent le train arrière et les puissantes pattes antérieures, scellées à leur socle d’immobilité.
Straumnessfjall.
Skálafell.
Montagnes-enclumes sillonnées de crevées où s’agrège la dernière neige, où ruisselle l’eau de fonte. Montagnes, tours et corniches larvaires aux torsions calcinées, aux cernes de refroidissement moulurés et réguliers.
Pierres sombres, lugubres dévaloirs à avalanches face auxquels, sous la poitrine du promeneur, un vertige s’écœure en silence.
Falaise-cargos dont l’étrave noirâtre partage la baie mouvante et agglomère les nuées sifflantes dans ses hauteurs démâtées.»
Dédié à Georg Gudni, «L’invisible dehors» est un récit d’une beauté intense, tendu vers une forme d’absolu, plus tellurique que céleste, qui évoque les fulgurances d’Emmanuel Ruben et son évocation de l’œuvre du peintre danois Per Kirkeby dans «Icecolor».
«On écrit pour donner voix à ce qui, autrement, demeurerait muet, enseveli sous le piétinement des paroles. On écrit pour quitter l’insomnie des conversations, ces longs repas du langage.»
Retrouvez cette note de lecture, et toutes celles de Charybde 2 et 7 sur leur blog ici :
https://charybde2.wordpress.com/2015/07/05/note-de-lecture-linvisible-dehors-pierre-cendors/
Dans ce livre sous titré «Carnet islandais d’un voyage intérieur», et paru en 2014 aux éditions Isolato, Pierre Cendors raconte, avec une langue poétique somptueuse, un voyage entrepris au printemps 2011, une confrontation avec les paysages élémentaires du grand nord islandais pour donner corps à un projet romanesque encore vague.
«Depuis mon retour du Septentrion, je me répète souvent ces paroles de Magnús Morland, les rares dont je me souvienne :
Je ne viens pas en Islande pour voir, au pied d’un glacier, un désert de lave, des geysers ou un volcan, car alors je perdrais l’écho de ce qui m’appelle ici. Je ne viens pas non plus contempler les aurores boréales. Je viens pour rejoindre l’autre côté d’une vision qui m’habite depuis de longues années, une vision dont je ne sais presque rien, sinon que le paysage archaïque, aux reliefs ruiniformes, de cette île qui a surgi de l’Atlantique Nord, il y a de cela 25 millions d’années, lui ressemble.»
Le voyage démarre à Hornstrandir, «un territoire dont le règne sauvage, à cette latitude et si éloigné de l’affairisme amnésique de nos sociétés, n’a rien d’un simulacre.» Pour cet écrivain marcheur, la solitude et la matière brute doivent nourrir la page blanche, dialogue intérieur face au vide entre le mouvement des pas et celui de l’imagination.
Prenant des accents d’une profondeur mystiques, Pierre Cendors dit l’éloignement du monde, le détachement d’une société utilitaire qui mutile, pour entrer dans la beauté puissante et muette et le temps distendu de ce paysage minéral, et renouveler ainsi la pensée et la forme.
«L’homme n’est peut-être qu’un épisode de l’évolution. À quelques kilomètres de Reykjavík, des rangées pimpantes de résidences-casernes, aussi déplacées dans ces étendues désertiques qu’une femme fardée, parfumée, permanentée au milieu du Sahara, soulignent brutalement l’évidence : la civilisation, toute civilisation, est une divinité clandestine déchue.»
Voyage au milieu de nulle part et au cœur de la matière, ce face-à-face avec le vide prend une direction inattendue, devant cette «nature affranchie de toute mainmise» humaine, ces distances et ces durées si vastes qu’elles font disparaître le but et imposent le silence, puis avec le choc de la découverte des toiles du peintre islandais Georg Gudni.
«Hvarfnúpur.
Laekjarfjall.
Látrafjall
Sphinx ruiniformes dont seuls demeurent le train arrière et les puissantes pattes antérieures, scellées à leur socle d’immobilité.
Straumnessfjall.
Skálafell.
Montagnes-enclumes sillonnées de crevées où s’agrège la dernière neige, où ruisselle l’eau de fonte. Montagnes, tours et corniches larvaires aux torsions calcinées, aux cernes de refroidissement moulurés et réguliers.
Pierres sombres, lugubres dévaloirs à avalanches face auxquels, sous la poitrine du promeneur, un vertige s’écœure en silence.
Falaise-cargos dont l’étrave noirâtre partage la baie mouvante et agglomère les nuées sifflantes dans ses hauteurs démâtées.»
Dédié à Georg Gudni, «L’invisible dehors» est un récit d’une beauté intense, tendu vers une forme d’absolu, plus tellurique que céleste, qui évoque les fulgurances d’Emmanuel Ruben et son évocation de l’œuvre du peintre danois Per Kirkeby dans «Icecolor».
«On écrit pour donner voix à ce qui, autrement, demeurerait muet, enseveli sous le piétinement des paroles. On écrit pour quitter l’insomnie des conversations, ces longs repas du langage.»
Retrouvez cette note de lecture, et toutes celles de Charybde 2 et 7 sur leur blog ici :
https://charybde2.wordpress.com/2015/07/05/note-de-lecture-linvisible-dehors-pierre-cendors/
Un homme sort du coma avec pour seul indice de son identité un livre qu'il était en train d'écrire sur un poète et cinéaste célèbre mais disparu. Afin de retrouver la mémoire, il lit sa thèse et reprend l'enquête là où il l'avait laissée avant sa chute et son amnésie. Il se rend à la bibliothèque où il rencontre une jeune femme qui va le mettre sur une nouvelle piste grâce à u livre. Pendant son enquête, le chercheur va rencontrer les femmes qui ont partagé la vie de l'artiste disparu. On a parfois du mal à suivre l'auteur et son héros, l'histoire est labyrinthique.
« Pour ceux qu’elle aura choisis, c’est peu de visiter la Bretagne. Il faut la quitter en souhaitant d’y vivre, l’oreille collée contre ce profond coquillage en rumeur. Et son appel est celui d’un cloître au mur défoncé vers le large : la mer, le vent, la terre nue et rien. C’est ici une province de l’âme. “Les Celtes, écrit Flaubert dans Salammbô, regrettaient trois pierres brutes, sous un ciel toujours pluvieux, au fond d’un golfe rempli d’îlots. »
Julien Gracq, Lettrines, Ed. Corti, 1967
La partie en gras de la citation est l’incipit du recueil de poèmes de Pierre Cendors : Chant runique du vide.
Le recueil place le prélude de son chant dans un contexte — et un intertexte — qui se tient à l’aplomb du large, au-dessus du grand vide, de ce dénuement qui emprunte l’épaisseur aux seuls éléments ; l’horizon et le livre ouverts.
Trois parties (“Chant runique du vide”, “L’errance du vide”, “L’intime du large”, les textes ont parus antérieurement dans plusieurs revues) jalonnent ce qu’il faut déjà entrevoir comme un voyage initiatique, une quête d’un lieu ou d’un état originel qui demande de se désabriter (pour reprendre un thème qui m’est cher), de se déposséder des strates, des habits que nous arborons pour singulariser notre personnalité, que sont le langage, “ce fouissement verbeux”, les leçons apprises (“Un peu d’ignorance pour que la connaissance devienne adulte”), le “déracinement visuel” des villes…
Chant runique
Il faut d’abord faire une halte. Ne pas précipiter la lecture migratoire et faire résonner le titre. Chant runique : cette expression, dans un premier élan de réflexion, me paraissait être la rencontre paradoxale et conflictuelle entre ce qui est de l’ordre du phonatoire, le chant, cette vibration en présence et ce qui ne sont que des unités d’écriture, ces minuscules cosses vides de signifié et imprononçables que les lettres alphabétiques, les runes. La rencontre de ces deux oppositions me semblait énoncer l’aporie essentielle de la poésie : l’impossibilité de faire chanter la lettre écrite car poésie est chant, est vocable (pour reprendre un terme cher à Jabès), est vibration de la glotte autant que de l’air. Mais aussi : est silence entre le chant et le champ de vision, est rythme, rythmicité (terme que j’emprunte à Deleuze et qui dit cette façon de nier et d’épouser le rythme tout à la fois). Mais encore : l’expression oppose l’unique au multiple, le rassemblé au disséminé, l’arrangement syntagmatique aux éléments d’une combinatoire possible mais non advenue. Mais ça, c’était avant que je ne rentre dans l’univers, ô combien vaste, des runes et de la mythologie nordique qui l’accompagne.
Car les runes ne sont pas que des graphèmes, à l’image de l’alphabet latin, les noms des lettres ont un sens singulier interne. En un sens, les runes gardent le souvenir de leur origine pictogrammique quand l’écriture latine en a coupé les ponts. Les runes sont les gardiens de secrets ancestraux (rūn en vieux nordique et en islandais signifie secret, mot que l’on retrouve dans le verbe allemand raunen : chuchoter, murmurer) et leurs origines mythologiques leur octroient non pas des pouvoirs occultes (les odinistes récusent ce mot, il est vrai galvaudé dans la littérature occultiste) mais des propriétés ésotériques, doucement magiques qu’il convient de réveiller, de convoquer, par le chant. Pour comprendre ces origines il faut aller fouiller parmi un des textes fondateurs de la mythologie nordique : le poème Hávamál (Les Dits du Très Haut), et plus précisément la deuxième partie de ce poème : le Rúnatal dans lequel Odin raconte la façon dont il découvrit le secret des runes :
"Je sais que je pendis
A l’arbre battu des vents
Neuf nuits pleines,
Navré d’une lance
Et donné à Ódinn,
Moi-même à moi-même donné,
A cet arbre
Dont nul ne sait
D’où proviennent les racines.
Point de pain ne me remirent
Ni de corne ;
Je scrutai en dessous,
je ramassai les runes,
Hurlant les ramassai,
De là, retombai.
Neuf chants suprêmes
J’appris du fils renommé
De Bölthorn, père de Bestla,
Et je pus boire
Du précieux hydromel
Puisé dans Ódrerir."
Bien sûr comme tout texte fondateur d’une cosmogonie, les interprétations sont autant légions qu’il y a de mots dans le texte, mais ce qu’il faut noter : c’est la part sacrificielle de celui qui part en quête (là encore), le nécessaire abandon de soi-même à soi-même donné, et l’attachement quasi-obstiné à l’arbre dont les racines sont perdues. Déracinement de soi-même à soi-même, abandon de soi dans la faim et la soif. Hurlement et chute. C’est un des chemins qu’emprunte le chaman pour accéder aux secrets que nos yeux ne peuvent pas voir… En poésie, d’Odin à Rimbaud (ou à Cendors), il n’y a qu’un pas.
« Maam Unst Iona »
« Maam Unst Iona » sont trois mots qui apparaissent et reparaissent dans le recueil comme la scansion psalmodiée d’un chant runique. Trois mots aux consonances et aux correspondances étranges, “comme des rocs scellés dans leur chute”. Trois mots mystérieux comme trois gouttes de sang dans la neige. Pourtant derrière ces phonèmes se cache une réalité géographique : ces noms désignent trois lieux parsemant le Royaume Uni, d’Irlande en Ecosse : Maam Cross est un carrefour, la rencontre de plusieurs routes traversant le Connemara, desservi par une gare. Unst est la dernière île peuplée, mais néanmoins sauvage, et la plus septentrionale de l’archipel des Shetland. Iona est une petite île d’Ecosse de 120 âmes qui est véritablement le berceau du Christianisme en Ecosse. Qu’ont en commun ces trois lieux, hormis leur isolement, leur éloignement certain de la civilisation ? Aussi curieux que cela puisse paraître, lorsque l’on relie ces trois lieux (voir la carte sur le blog) on obtient une ligne parfaitement droite. Le choix de ces rune n’est pas uniquement sonore, il révèle un mystère de la géographie, il trace un chemin, une correspondance entre le lieu de tous les chemins (le carrefour Maam), le lieu de l’extrémité (la finisterre Unst) et le lieu détaché de tout (l’île Iona). Le chant runique du vide est un chant d’itinéraire autant que d’initiation qui apprend méthodiquement à se dépouiller de soi pour atteindre “ce grand vide qui n’est pas le néant — Lao Tseu”. Il y a autant de bizarreries dans le langage que dans les lieux que nous créons : l’homme écrit à la surface du globe comme un scribe géographe (et on a déjà parlé ici du rapport étroit qu’entretient Pierre Cendors à la géographie, sujet qui pourrait à lui-seul nourrir une thèse), il trace des lignes, lisse des courbes, inscrit des runes spatiaux sans même le savoir, tout comme Monsieur Jourdain. Ce sont des hasards sans importance, dont le sens, s’il y en a un, nous échappe totalement. Mais on peut suivre ces hasards, emprunter ces itinéraires qui disent une part du secret dans l’intime, ces hasards qui nous font oublier peu à peu d’où l’on vient et qui floute l’idée même de destination. L’être au monde n’est pas au carrefour, ni à l’extrémité des terres, ni encerclé par la mer. Ce n’est pas non plus la ligne qui les relierait tous. L’être au monde c’est :
« En ce lieu sans chemins
Seul d’aventure
L’exilé l’affamé
en quête d’un pas
premier
qui en l’homme dépasse
l’homme
Peu viennent ici »
Il faut aussi insister sur le parcours emprunté par la langue dans ce cheminement car la langue dans ce recueil est un obstacle qu’il faut franchir, des entraves dont il faut se délier : “Encore trop de mots | pour dire | ce vide lucide.” La langue aussi doit se sacrifier, s’emmarginer, rejoindre “le silence mental | des corbeaux”. Se dépouiller au point de perdre tout verbe actant : du départ qui nécessite l’action, du remuement de soi dans le voyage jusqu’à la contemplation ultime de cette “Image temple” qui clôt le recueil, la langue tarit doucement, en “un grave et lent mûrissement de ces jours”. Cette recherche du silence ne s’inscrit pas dans un mouvement menant au mutisme, à l’aphasie mais, comme dans la philosophie taoïste dont il est fait mention, elle figure, elle reproduit le mouvement qui consiste à aller cherche ce qui s’inscrit dans le vide, plutôt que dans le plein, à mettre en relief ce qui, en creux, n’offre aucune aspérité à la réalité…
Ce Chant runique du vide, m’a ému profondément autant qu’il a agi en moi (“reste ici | pour te quitter | attends d’être agi”) et fait mûrir de secrètes envies d’évasions intérieures.
Lien : http://www.labyrinthiques.ne..
Julien Gracq, Lettrines, Ed. Corti, 1967
La partie en gras de la citation est l’incipit du recueil de poèmes de Pierre Cendors : Chant runique du vide.
Le recueil place le prélude de son chant dans un contexte — et un intertexte — qui se tient à l’aplomb du large, au-dessus du grand vide, de ce dénuement qui emprunte l’épaisseur aux seuls éléments ; l’horizon et le livre ouverts.
Trois parties (“Chant runique du vide”, “L’errance du vide”, “L’intime du large”, les textes ont parus antérieurement dans plusieurs revues) jalonnent ce qu’il faut déjà entrevoir comme un voyage initiatique, une quête d’un lieu ou d’un état originel qui demande de se désabriter (pour reprendre un thème qui m’est cher), de se déposséder des strates, des habits que nous arborons pour singulariser notre personnalité, que sont le langage, “ce fouissement verbeux”, les leçons apprises (“Un peu d’ignorance pour que la connaissance devienne adulte”), le “déracinement visuel” des villes…
Chant runique
Il faut d’abord faire une halte. Ne pas précipiter la lecture migratoire et faire résonner le titre. Chant runique : cette expression, dans un premier élan de réflexion, me paraissait être la rencontre paradoxale et conflictuelle entre ce qui est de l’ordre du phonatoire, le chant, cette vibration en présence et ce qui ne sont que des unités d’écriture, ces minuscules cosses vides de signifié et imprononçables que les lettres alphabétiques, les runes. La rencontre de ces deux oppositions me semblait énoncer l’aporie essentielle de la poésie : l’impossibilité de faire chanter la lettre écrite car poésie est chant, est vocable (pour reprendre un terme cher à Jabès), est vibration de la glotte autant que de l’air. Mais aussi : est silence entre le chant et le champ de vision, est rythme, rythmicité (terme que j’emprunte à Deleuze et qui dit cette façon de nier et d’épouser le rythme tout à la fois). Mais encore : l’expression oppose l’unique au multiple, le rassemblé au disséminé, l’arrangement syntagmatique aux éléments d’une combinatoire possible mais non advenue. Mais ça, c’était avant que je ne rentre dans l’univers, ô combien vaste, des runes et de la mythologie nordique qui l’accompagne.
Car les runes ne sont pas que des graphèmes, à l’image de l’alphabet latin, les noms des lettres ont un sens singulier interne. En un sens, les runes gardent le souvenir de leur origine pictogrammique quand l’écriture latine en a coupé les ponts. Les runes sont les gardiens de secrets ancestraux (rūn en vieux nordique et en islandais signifie secret, mot que l’on retrouve dans le verbe allemand raunen : chuchoter, murmurer) et leurs origines mythologiques leur octroient non pas des pouvoirs occultes (les odinistes récusent ce mot, il est vrai galvaudé dans la littérature occultiste) mais des propriétés ésotériques, doucement magiques qu’il convient de réveiller, de convoquer, par le chant. Pour comprendre ces origines il faut aller fouiller parmi un des textes fondateurs de la mythologie nordique : le poème Hávamál (Les Dits du Très Haut), et plus précisément la deuxième partie de ce poème : le Rúnatal dans lequel Odin raconte la façon dont il découvrit le secret des runes :
"Je sais que je pendis
A l’arbre battu des vents
Neuf nuits pleines,
Navré d’une lance
Et donné à Ódinn,
Moi-même à moi-même donné,
A cet arbre
Dont nul ne sait
D’où proviennent les racines.
Point de pain ne me remirent
Ni de corne ;
Je scrutai en dessous,
je ramassai les runes,
Hurlant les ramassai,
De là, retombai.
Neuf chants suprêmes
J’appris du fils renommé
De Bölthorn, père de Bestla,
Et je pus boire
Du précieux hydromel
Puisé dans Ódrerir."
Bien sûr comme tout texte fondateur d’une cosmogonie, les interprétations sont autant légions qu’il y a de mots dans le texte, mais ce qu’il faut noter : c’est la part sacrificielle de celui qui part en quête (là encore), le nécessaire abandon de soi-même à soi-même donné, et l’attachement quasi-obstiné à l’arbre dont les racines sont perdues. Déracinement de soi-même à soi-même, abandon de soi dans la faim et la soif. Hurlement et chute. C’est un des chemins qu’emprunte le chaman pour accéder aux secrets que nos yeux ne peuvent pas voir… En poésie, d’Odin à Rimbaud (ou à Cendors), il n’y a qu’un pas.
« Maam Unst Iona »
« Maam Unst Iona » sont trois mots qui apparaissent et reparaissent dans le recueil comme la scansion psalmodiée d’un chant runique. Trois mots aux consonances et aux correspondances étranges, “comme des rocs scellés dans leur chute”. Trois mots mystérieux comme trois gouttes de sang dans la neige. Pourtant derrière ces phonèmes se cache une réalité géographique : ces noms désignent trois lieux parsemant le Royaume Uni, d’Irlande en Ecosse : Maam Cross est un carrefour, la rencontre de plusieurs routes traversant le Connemara, desservi par une gare. Unst est la dernière île peuplée, mais néanmoins sauvage, et la plus septentrionale de l’archipel des Shetland. Iona est une petite île d’Ecosse de 120 âmes qui est véritablement le berceau du Christianisme en Ecosse. Qu’ont en commun ces trois lieux, hormis leur isolement, leur éloignement certain de la civilisation ? Aussi curieux que cela puisse paraître, lorsque l’on relie ces trois lieux (voir la carte sur le blog) on obtient une ligne parfaitement droite. Le choix de ces rune n’est pas uniquement sonore, il révèle un mystère de la géographie, il trace un chemin, une correspondance entre le lieu de tous les chemins (le carrefour Maam), le lieu de l’extrémité (la finisterre Unst) et le lieu détaché de tout (l’île Iona). Le chant runique du vide est un chant d’itinéraire autant que d’initiation qui apprend méthodiquement à se dépouiller de soi pour atteindre “ce grand vide qui n’est pas le néant — Lao Tseu”. Il y a autant de bizarreries dans le langage que dans les lieux que nous créons : l’homme écrit à la surface du globe comme un scribe géographe (et on a déjà parlé ici du rapport étroit qu’entretient Pierre Cendors à la géographie, sujet qui pourrait à lui-seul nourrir une thèse), il trace des lignes, lisse des courbes, inscrit des runes spatiaux sans même le savoir, tout comme Monsieur Jourdain. Ce sont des hasards sans importance, dont le sens, s’il y en a un, nous échappe totalement. Mais on peut suivre ces hasards, emprunter ces itinéraires qui disent une part du secret dans l’intime, ces hasards qui nous font oublier peu à peu d’où l’on vient et qui floute l’idée même de destination. L’être au monde n’est pas au carrefour, ni à l’extrémité des terres, ni encerclé par la mer. Ce n’est pas non plus la ligne qui les relierait tous. L’être au monde c’est :
« En ce lieu sans chemins
Seul d’aventure
L’exilé l’affamé
en quête d’un pas
premier
qui en l’homme dépasse
l’homme
Peu viennent ici »
Il faut aussi insister sur le parcours emprunté par la langue dans ce cheminement car la langue dans ce recueil est un obstacle qu’il faut franchir, des entraves dont il faut se délier : “Encore trop de mots | pour dire | ce vide lucide.” La langue aussi doit se sacrifier, s’emmarginer, rejoindre “le silence mental | des corbeaux”. Se dépouiller au point de perdre tout verbe actant : du départ qui nécessite l’action, du remuement de soi dans le voyage jusqu’à la contemplation ultime de cette “Image temple” qui clôt le recueil, la langue tarit doucement, en “un grave et lent mûrissement de ces jours”. Cette recherche du silence ne s’inscrit pas dans un mouvement menant au mutisme, à l’aphasie mais, comme dans la philosophie taoïste dont il est fait mention, elle figure, elle reproduit le mouvement qui consiste à aller cherche ce qui s’inscrit dans le vide, plutôt que dans le plein, à mettre en relief ce qui, en creux, n’offre aucune aspérité à la réalité…
Ce Chant runique du vide, m’a ému profondément autant qu’il a agi en moi (“reste ici | pour te quitter | attends d’être agi”) et fait mûrir de secrètes envies d’évasions intérieures.
Lien : http://www.labyrinthiques.ne..
Suite à un accident, l’écrivain Paul Fauster a perdu la mémoire. Pour remonter la trame de son passé, il reprend celle de l’ouvrage fragmentaire qu’il composait : une biographie mythopoétique d’Endsen, le Rimbaud des pays de l’Est.
Mais comment écrit-on la vie d’un éternel disparu, qui semble se dissoudre dans la matière même du XXe siècle ? Comment écrire autour d’une identité qui se transmet ? Comment reconstituer l’Histoire, quand celle-ci n’est qu’une longue de suite de purges ou d’oscillations fantastiques ? Comment marcher dans les pas de quelqu’un qui déréalise jusqu’aux lieux qu’il parcourt, qui brouille les identités de ceux qu’il croise, et qui, s’inscrivant dans le temps du mythe, paraît être fiction vivante, écriture en marche ?
Dès la couverture, Cendors nous avertit : ce roman est un nouveau puzzle qu’il ajoute à son univers-labyrinthe, une nouvelle pièce fragmentaire de son œuvre, véritable hymne au dispar-être. Il s’agit moins, ici, de bâtir un livre de plus, que de tisser un prolongement, commencement et/ou fin, à la spirale littéraire dans laquelle il nous entraîne depuis L’Homme Caché.
La suite par ici : http://www.delitteris.com/au-fil-des-pages/les-fragments-solander/
Lien : http://www.delitteris.com/au..
Mais comment écrit-on la vie d’un éternel disparu, qui semble se dissoudre dans la matière même du XXe siècle ? Comment écrire autour d’une identité qui se transmet ? Comment reconstituer l’Histoire, quand celle-ci n’est qu’une longue de suite de purges ou d’oscillations fantastiques ? Comment marcher dans les pas de quelqu’un qui déréalise jusqu’aux lieux qu’il parcourt, qui brouille les identités de ceux qu’il croise, et qui, s’inscrivant dans le temps du mythe, paraît être fiction vivante, écriture en marche ?
Dès la couverture, Cendors nous avertit : ce roman est un nouveau puzzle qu’il ajoute à son univers-labyrinthe, une nouvelle pièce fragmentaire de son œuvre, véritable hymne au dispar-être. Il s’agit moins, ici, de bâtir un livre de plus, que de tisser un prolongement, commencement et/ou fin, à la spirale littéraire dans laquelle il nous entraîne depuis L’Homme Caché.
La suite par ici : http://www.delitteris.com/au-fil-des-pages/les-fragments-solander/
Lien : http://www.delitteris.com/au..
C’est un livre qu’on lit comme une traversée, celle du silence d’un homme qui n’écrit plus, qui « sans voix » devient « sans lieu » et s’adonne à l’errance éveillée, à la marche anonyme, posant son attention partout et nulle part.
C’est un homme qui s’appelle Aden, dans lequel on veut lire la disparition de Rimbaud, et qui oscille, baudelairien, dans les forêts de symboles à travers lesquelles il chemine, dans cette « promenade absolue » où il foule le visible et l’invisible, et qui cherche à atteindre, mallarméen, l’azur.
Son nomadisme s’entrecoupe d’une autre voix, italique, cherchant à dire l’indicible, s’efforçant, Orphée composant des livres d’Hadès, de « trouver un langage pour dire ce que les livres ne disent pas ».
C’est un poète psychogéographe, qui devient ce qu’il cherche, la « cartographie sensorielle » d’une âme qui se découvre, « paysage inaccessible », aux fulgurances qui éclaboussent poétiquement ceux qui croisent son chemin, tel ce passant, « hiéroglyphe perdue dans la multitude »,qui, captivé par le regard d’Aden, plonge dans cet éden de « l’invisible coeur du connu ».
C’est un livre où l’é-moi se fracture, se fissure pour laisser éclater, « flamboyance silencieuse », le recueillement d’une vie qui choisit de « s’originer » en poésie, au risque du silence, de l’errance et de la transe.
C’est un livre de Pierre Cendors : un autre labyrinthe où les noms s’effacent pour laisser éclater, lumineuse évidence, la pureté d’un style dont les déambulations me hantent et m’offrent, dans un même mouvement, le plaisir de la perte et de la trouvaille féconde.
Lien : http://www.delitteris.com/no..
C’est un homme qui s’appelle Aden, dans lequel on veut lire la disparition de Rimbaud, et qui oscille, baudelairien, dans les forêts de symboles à travers lesquelles il chemine, dans cette « promenade absolue » où il foule le visible et l’invisible, et qui cherche à atteindre, mallarméen, l’azur.
Son nomadisme s’entrecoupe d’une autre voix, italique, cherchant à dire l’indicible, s’efforçant, Orphée composant des livres d’Hadès, de « trouver un langage pour dire ce que les livres ne disent pas ».
C’est un poète psychogéographe, qui devient ce qu’il cherche, la « cartographie sensorielle » d’une âme qui se découvre, « paysage inaccessible », aux fulgurances qui éclaboussent poétiquement ceux qui croisent son chemin, tel ce passant, « hiéroglyphe perdue dans la multitude »,qui, captivé par le regard d’Aden, plonge dans cet éden de « l’invisible coeur du connu ».
C’est un livre où l’é-moi se fracture, se fissure pour laisser éclater, « flamboyance silencieuse », le recueillement d’une vie qui choisit de « s’originer » en poésie, au risque du silence, de l’errance et de la transe.
C’est un livre de Pierre Cendors : un autre labyrinthe où les noms s’effacent pour laisser éclater, lumineuse évidence, la pureté d’un style dont les déambulations me hantent et m’offrent, dans un même mouvement, le plaisir de la perte et de la trouvaille féconde.
Lien : http://www.delitteris.com/no..
Trois séries de poèmes (chant runique du vide, l’errance du vide, l’intime du large) rythment ces minces pages au goût de vent filant à travers une nuit sans étoile.
L’écriture procède par éclats, orchestrant des silences et de brusques « passage[s] vers/ nos territoires profonds ». En surgissent, dans la « fonte des lumières », des élans convulsés, des figures déjà brouillées par la « vitesse noire » de l’écriture (qu’elles soient celle d’un enfant ou d’un « homme qui passe »), des paysages dépeuplés, parfois pages planes réduites à un trait par un train au « grand rythme élémentaire », parfois trouées obscures, « hauts-fonds », vertiges ravinés, à moins qu’on ne nous invite à passer à travers des forêts au silence-monastère déchiré de corbeaux. A chaque poème ses chemins-visages tracés à l’encre lumineuse.
Pierre Cendors, en prenant « pour langage / le tumulte blanc », s’improvise nouveau Taliesin – comment ne pas penser à cette figure essentielle du barde métamorphe en découvrant ces « noms frappés à même la forge qui/ dans la pierre millénaire / a scellé le galop du cerf / la force leste du saumon / l’éclair du faucon » ?-, scandant des runes (« maan unst iona ») pour faire surgir, du vide ouvert, l’immensité des provinces de l’âme.
Il s’enfouit dans l’obscure clarté du verbe pour mieux dire, « phénix souterrain », son « désir d’élémentaire », sa « solitude incisive » et le « lieu austère vital » où se forge, dans le « vide lucide », la poésie, cet « ensoleillement / des profondeurs » de l’être, ce baume fondateur, natif, s’arc-boutant au silence pour en faire jaillir la forme du chant.
Reléguant le « je » au rôle d’appendice poétique, Cendors chante l’invisible « paysage du vent », l’«éternité passagère », et le chemin sans fin, constellé de divers seuils, que le poète et son lecteur empruntent pour découvrir, sur les larges rivages de l’indicible, l’arborescente beauté de l’être-monde & du vif poème en devenir.
Lien : http://www.delitteris.com/no..
L’écriture procède par éclats, orchestrant des silences et de brusques « passage[s] vers/ nos territoires profonds ». En surgissent, dans la « fonte des lumières », des élans convulsés, des figures déjà brouillées par la « vitesse noire » de l’écriture (qu’elles soient celle d’un enfant ou d’un « homme qui passe »), des paysages dépeuplés, parfois pages planes réduites à un trait par un train au « grand rythme élémentaire », parfois trouées obscures, « hauts-fonds », vertiges ravinés, à moins qu’on ne nous invite à passer à travers des forêts au silence-monastère déchiré de corbeaux. A chaque poème ses chemins-visages tracés à l’encre lumineuse.
Pierre Cendors, en prenant « pour langage / le tumulte blanc », s’improvise nouveau Taliesin – comment ne pas penser à cette figure essentielle du barde métamorphe en découvrant ces « noms frappés à même la forge qui/ dans la pierre millénaire / a scellé le galop du cerf / la force leste du saumon / l’éclair du faucon » ?-, scandant des runes (« maan unst iona ») pour faire surgir, du vide ouvert, l’immensité des provinces de l’âme.
Il s’enfouit dans l’obscure clarté du verbe pour mieux dire, « phénix souterrain », son « désir d’élémentaire », sa « solitude incisive » et le « lieu austère vital » où se forge, dans le « vide lucide », la poésie, cet « ensoleillement / des profondeurs » de l’être, ce baume fondateur, natif, s’arc-boutant au silence pour en faire jaillir la forme du chant.
Reléguant le « je » au rôle d’appendice poétique, Cendors chante l’invisible « paysage du vent », l’«éternité passagère », et le chemin sans fin, constellé de divers seuils, que le poète et son lecteur empruntent pour découvrir, sur les larges rivages de l’indicible, l’arborescente beauté de l’être-monde & du vif poème en devenir.
Lien : http://www.delitteris.com/no..
Arrivé à Venise, une nuit sans lune, Innocenzo, dit Inno, espère trouver, dans les vapeurs perpétuelles des fêtes sérénissimes, l’Unique, l’amante jusque là invisible qui saura répondre, symphonie, à ses chimères. Il se heurtera, dans sa quête, à la figure-némésis de l’astronome Ricorni, et croisera les silhouettes superbes de la courtisane Fulvia, au nom jaune fauve terni par sa profession, et Auria, l’oiseau-lyre à la voix d’or pur. Qui sera, de cet Amour(eux), la Psyché ? Dans cette ville, « sphinx d’eau » où les rêves respirent, qui saura faire revivre le(s) mythe(s) ?
Pierre Cendors tisse ici un roman en trois actes, dans un décor théâtral – Venise au nom tressé d’imaginaires (le labyrinthe, le masque, la fête perpétuelle, l’eau miroitante, la beauté hors-temps à valeur de mythe), Venise et ses palazzos détrempés de brume, aux cours dentelées de coulisses secrètes- propre à accueillir les tromperies sophistiquées animant les personnages. Les jeux d’identité et de filiation s’entrecroisent, les mensonges, les jalousies et les révélations finales éclatent comme autant de coups de théâtre servis par des acteurs inconscients de leur rôle archétypal (l’amoureux et son valet fidèle– Guido au nom si symbolique-, le vieux barbon, la courtisane et l’orpheline).
Tout ne semble ici que double, reflet, masque, jeux de miroirs...
La suite par ici : http://www.delitteris.com/au-fil-des-pages/adieu-a-ce-qui-vient/
Lien : http://www.delitteris.com/au..
Pierre Cendors tisse ici un roman en trois actes, dans un décor théâtral – Venise au nom tressé d’imaginaires (le labyrinthe, le masque, la fête perpétuelle, l’eau miroitante, la beauté hors-temps à valeur de mythe), Venise et ses palazzos détrempés de brume, aux cours dentelées de coulisses secrètes- propre à accueillir les tromperies sophistiquées animant les personnages. Les jeux d’identité et de filiation s’entrecroisent, les mensonges, les jalousies et les révélations finales éclatent comme autant de coups de théâtre servis par des acteurs inconscients de leur rôle archétypal (l’amoureux et son valet fidèle– Guido au nom si symbolique-, le vieux barbon, la courtisane et l’orpheline).
Tout ne semble ici que double, reflet, masque, jeux de miroirs...
La suite par ici : http://www.delitteris.com/au-fil-des-pages/adieu-a-ce-qui-vient/
Lien : http://www.delitteris.com/au..
Une nouvelle pierre au labyrinthe-Cendors, sous forme de livre-accordéon.
Une voix, qui glisse de « tu » en « je », épaisse de mystères (qui est ce tu, qui est ce je : des enfants enfermés dans quelque banal pensionnat, remué de quelconques bruits nocturnes, ou autre chose, comme le suggère la fin du texte ?), tressée de contradictions, d’oscillations, luttant contre l’ordinaire pour le métamorphoser, comme savent le faire les enfants avant que le sommeil les emporte, défigurant les ombres sous leurs paupières, regardant sans voir, lisant sans lire, « avant que cela ne commence » – le sommeil, les chimères.
Le texte organise peu à peu sa bascule, déformant les maigres bornes qu’il offre (à quand correspond ce « maintenant » ? A un présent onirique, à un temps détrempé d’encre ? Où se situe-t-on ? Dans un souvenir, une illusion, un lieu palpable, un entre-deux ?), transformant un ascenseur en véhicule de songes (« il te semble que quelque chose, tu ne sais quoi, va surgir d’une terre profonde, un torse, des épaules, un cou. L’haleine animale d’une joie sauvage »), montant et descendant dans l’imaginaire, le subconscient poétique du lecteur – à moins qu’il ne traverse réellement les douze étages menant de ce « je », qui cherche à traduire les ombres du texte, jusqu’au lecteur, qui hésite à s’embarquer dans cet attelage de mots au souffle trouble, et finit par s’y engager, confiant en la force interne du style-Cendors.
On se laisse emporter par cet étrange enchevêtrement textuel, en se demandant si l’on a assisté à une rêverie nocturne d’enfance perdue, ou à l’intuition fulgurante de ce qu’est le processus d’écriture fantastique, où les diverses trames du temps se confondent, étirées dans les ascensions du texte et ses déclivités étranges, et où les sens se troublent et n’offrent plus de repères stables.
Au texte répondent des collages tout aussi énigmatiques, au travers desquels chemine une bille-bulle-ballon, reflets incertains, guide fragile pour des enfants aux allures désuètes, se détachant sur des imaginaires riches de symboles (vague déchaînée, phare qui n’éclaire rien, pluie d’étoiles filantes, cheval de manège emballé, lune et branches démesurées, villes-poupées, statuaire carrollienne).
Etrange fil directeur visuel, que cette forme qui fuit au gré des vents, comme les certitudes du lecteur s’égarent au fil de cette poignée de pages qui réinventent l’errance éveillée.
Un fascinant micro-labyrinthe à la belle facture (papier luxueux, accordéon-dédale abrité par une belle couverture à rabats & impression de qualité), que j’imaginerais volontiers réalisé par David Lynch, tant il y a dans cette dense écriture visuelle quelque chose qui joue avec notre inconscient, dansant sur nos capacités de compréhension et d’intuition
Lien : http://www.delitteris.com/au..
Une voix, qui glisse de « tu » en « je », épaisse de mystères (qui est ce tu, qui est ce je : des enfants enfermés dans quelque banal pensionnat, remué de quelconques bruits nocturnes, ou autre chose, comme le suggère la fin du texte ?), tressée de contradictions, d’oscillations, luttant contre l’ordinaire pour le métamorphoser, comme savent le faire les enfants avant que le sommeil les emporte, défigurant les ombres sous leurs paupières, regardant sans voir, lisant sans lire, « avant que cela ne commence » – le sommeil, les chimères.
Le texte organise peu à peu sa bascule, déformant les maigres bornes qu’il offre (à quand correspond ce « maintenant » ? A un présent onirique, à un temps détrempé d’encre ? Où se situe-t-on ? Dans un souvenir, une illusion, un lieu palpable, un entre-deux ?), transformant un ascenseur en véhicule de songes (« il te semble que quelque chose, tu ne sais quoi, va surgir d’une terre profonde, un torse, des épaules, un cou. L’haleine animale d’une joie sauvage »), montant et descendant dans l’imaginaire, le subconscient poétique du lecteur – à moins qu’il ne traverse réellement les douze étages menant de ce « je », qui cherche à traduire les ombres du texte, jusqu’au lecteur, qui hésite à s’embarquer dans cet attelage de mots au souffle trouble, et finit par s’y engager, confiant en la force interne du style-Cendors.
On se laisse emporter par cet étrange enchevêtrement textuel, en se demandant si l’on a assisté à une rêverie nocturne d’enfance perdue, ou à l’intuition fulgurante de ce qu’est le processus d’écriture fantastique, où les diverses trames du temps se confondent, étirées dans les ascensions du texte et ses déclivités étranges, et où les sens se troublent et n’offrent plus de repères stables.
Au texte répondent des collages tout aussi énigmatiques, au travers desquels chemine une bille-bulle-ballon, reflets incertains, guide fragile pour des enfants aux allures désuètes, se détachant sur des imaginaires riches de symboles (vague déchaînée, phare qui n’éclaire rien, pluie d’étoiles filantes, cheval de manège emballé, lune et branches démesurées, villes-poupées, statuaire carrollienne).
Etrange fil directeur visuel, que cette forme qui fuit au gré des vents, comme les certitudes du lecteur s’égarent au fil de cette poignée de pages qui réinventent l’errance éveillée.
Un fascinant micro-labyrinthe à la belle facture (papier luxueux, accordéon-dédale abrité par une belle couverture à rabats & impression de qualité), que j’imaginerais volontiers réalisé par David Lynch, tant il y a dans cette dense écriture visuelle quelque chose qui joue avec notre inconscient, dansant sur nos capacités de compréhension et d’intuition
Lien : http://www.delitteris.com/au..
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur
Auteurs proches de Pierre Cendors
Lecteurs de Pierre Cendors (219)Voir plus
Quiz
Voir plus
La pluie comme on l'aime
Quel auteur attend "La pluie avant qu'elle tombe"?
Olivier Norek
Jonathan Coe
10 questions
204 lecteurs ont répondu
Créer un quiz sur cet auteur204 lecteurs ont répondu