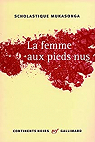Critiques de Scholastique Mukasonga (326)
Un hommage très touchant de l’auteure a sa mère. Une mère courageuse, extraordinaire, aimante, protectrice. Et au-travers elle, l’auteure témoigne de la vie obligée des Tutsis déportés. Une vie ou plus rien ils ne leur restent. Une vie faite de crainte, de douleurs, d’obligations envers des militaires qui frappent, qui dont régner la terreur. Mais la mère de l’auteure a tout fait pour rendre ‘’normale’’ la vie de ses enfants en leur offrant un foyer bienveillant, un petit cocon sécuritaire, en leur mettant tous les jours de la nourriture dans l’assiette. Bref, une lecture courte, mais qui touche. Une lecture poignante, vibrante, sincère. Une lecture pleine d’amour qui gagne sur l’horreur. Une très belle lecture.
Hommage rendu à sa mère et à toutes les mères courage.
A lire, aussi pour apprendre/connaître les us et coutumes d'un pays.
A lire, aussi pour apprendre/connaître les us et coutumes d'un pays.
Ce livre est un hommage à Stefania et à travers elle, à toutes les femmes rwandaises qui survivaient pour sauver leurs enfants d'une mort quasi-imminente. Dans cette courte autobiographie, Scholastique Mukasonga
nous plongé dans la vie des déportés Tutsi à Nyamata. Comment étaient conçues les maisons, comment étaient réparties les tâches dans la famille. Elle raconte l'éducation, les relations de voisinage, la médecine, les mariages, la beauté rwandaise, le pain, l'agriculture tel un art...
Elle évoque également la place de la colonisation : l'école, la messe, les prêtres, les prénoms chrétiens, le "progrès", ceux qu'on appelle les "évolués". Elle évoque également, les incursions et les exactions des soldats Hutus...
C'est vraiment très beau. Je recommande cette lecture si on souhaite lire sur le Rwanda d'avant 1994.
Lien : https://www.instagram.com/p/..
nous plongé dans la vie des déportés Tutsi à Nyamata. Comment étaient conçues les maisons, comment étaient réparties les tâches dans la famille. Elle raconte l'éducation, les relations de voisinage, la médecine, les mariages, la beauté rwandaise, le pain, l'agriculture tel un art...
Elle évoque également la place de la colonisation : l'école, la messe, les prêtres, les prénoms chrétiens, le "progrès", ceux qu'on appelle les "évolués". Elle évoque également, les incursions et les exactions des soldats Hutus...
C'est vraiment très beau. Je recommande cette lecture si on souhaite lire sur le Rwanda d'avant 1994.
Lien : https://www.instagram.com/p/..
Vingt-sept membres de la famille de l'écrivaine ont été massacrés pendant le génocide rwandais. Stefania, sa mère tutsie, était des victimes et ce livre rend un hommage magnifique à cette femme africaine contrainte à l'exil avec sa famille à Nyamata, sous la perpétuelle menace des soldats hutus du camp Gako. Nous sommes dans la région inhospitalière du Bugesera, là où sont déportés les tutsis du nord depuis les massacres ethniques qui les ravagèrent en vagues successives depuis 1959.
"Ma mère n'avait qu'une idée en tête, le même projet pour chaque jour, qu'une seule raison de survivre : sauver ses enfants. Pour cela elle élaborait toutes les stratégies, expérimentait toutes les tactiques."
Le livre raconte comment Stefania préserva et éleva ses enfants, cultiva la terre, fit des projets pour eux comme le font les mères rwandaises, selon leurs coutumes, selon leur pauvreté, attentives aux présages du ciel, des corbeaux, des plantes et des eaux du lac. La description du mode de vie et des codes de cette famille est une source d'information sociologique et ethnographique étonnante. Malgré l'épée de Damoclès — un piétinement de bottes sur la piste, une fusillade dans la nuit, l'arrestation d'un voisin —, subsiste une volonté de vivre dignement comme elle l'a fait autrefois sur les pentes des collines, sous le couvert des bananiers. L'époque racontée doit remonter aux années septante, un peu plus tôt peut-être, alors que Scholastique était adolescente (l'auteure est née en 1956).
Stefania n'aime pas l'habitation de torchis et de tôle, "vide d'Esprits", où logent les déportés. Elle veut sa case, l'inzu, la maison de paille, roseau et papyrus, tressée comme une vannerie. L'eau pour le poisson, l'air pour les hommes, l'inzu à Stefania, une maison où elle pourra vivre une vraie vie de famille, où on entend moudre les grains de sorgho sur la pierre, le clapotis des cruches où fermente la bière, le rire des enfants et le bavardage insouciant des jeunes filles. Elle connut le grand bonheur de voir son fils fonder une famille de neuf enfants, dont sept garçons. La famille se perpétuerait donc si quelques-uns survivaient. Elle se trompait.
"Ma raison de vivre est de représenter ce peuple massacré comme des "cafards", de redonner une identité à ces personnes, de faire admettre qu’il avait droit au premier des droits de l’homme, le droit de vivre." Voilà comment s'exprime Scholastique dans une interview à La Libre Belgique.
Le génocide n'est pas l'objet du livre mais il est partout présent. Dès les premières pages, des responsables sont désignés, à savoir les autorités hutu, placées par les Belges et l'Église à la tête du Rwanda nouvellement indépendant.
Plus loin, il est question d'histoires qu'on racontait qui n'étaient pas celles des tutsis: "Les Blancs avaient déchaîné sur les Tutsis les monstres insatiables de leurs mauvais rêves. [...]. Ils prétendaient mieux savoir que nous qui nous étions, d'où nous venions." L'auteur veut parler du mythe hamitique construit par l'explorateur John Hanning Speke : le peuple tutsi serait une minorité raciale supérieure aux Hutus car il n'est pas originaire du Rwanda mais d'Éthiopie. Ce mythe a été utilisé par les extrémistes hutus pour mobiliser les citoyens ordinaires contre les tutsis «envahisseurs» lors du génocide de 1994.
Le journaliste Jean Hatzfeld dans Une saison de machettes (2003) a interrogé des génocidaires de la région rwandaise. Il explique dans un entretien (Afrik.com) pourquoi il a voulu s'adresser aux tueurs et ce qu'il en a retenu.
On constate que derrière ce livre simple, authentique, d'une grande sobriété, subsistent des blessures irréparables et l'immense question des responsabilités, à laquelle ce modeste billet ne saurait répondre.
La femme aux pieds nus a obtenu le Prix Seligmann.
Lien : http://www.christianwery.be/..
"Ma mère n'avait qu'une idée en tête, le même projet pour chaque jour, qu'une seule raison de survivre : sauver ses enfants. Pour cela elle élaborait toutes les stratégies, expérimentait toutes les tactiques."
Le livre raconte comment Stefania préserva et éleva ses enfants, cultiva la terre, fit des projets pour eux comme le font les mères rwandaises, selon leurs coutumes, selon leur pauvreté, attentives aux présages du ciel, des corbeaux, des plantes et des eaux du lac. La description du mode de vie et des codes de cette famille est une source d'information sociologique et ethnographique étonnante. Malgré l'épée de Damoclès — un piétinement de bottes sur la piste, une fusillade dans la nuit, l'arrestation d'un voisin —, subsiste une volonté de vivre dignement comme elle l'a fait autrefois sur les pentes des collines, sous le couvert des bananiers. L'époque racontée doit remonter aux années septante, un peu plus tôt peut-être, alors que Scholastique était adolescente (l'auteure est née en 1956).
Stefania n'aime pas l'habitation de torchis et de tôle, "vide d'Esprits", où logent les déportés. Elle veut sa case, l'inzu, la maison de paille, roseau et papyrus, tressée comme une vannerie. L'eau pour le poisson, l'air pour les hommes, l'inzu à Stefania, une maison où elle pourra vivre une vraie vie de famille, où on entend moudre les grains de sorgho sur la pierre, le clapotis des cruches où fermente la bière, le rire des enfants et le bavardage insouciant des jeunes filles. Elle connut le grand bonheur de voir son fils fonder une famille de neuf enfants, dont sept garçons. La famille se perpétuerait donc si quelques-uns survivaient. Elle se trompait.
"Ma raison de vivre est de représenter ce peuple massacré comme des "cafards", de redonner une identité à ces personnes, de faire admettre qu’il avait droit au premier des droits de l’homme, le droit de vivre." Voilà comment s'exprime Scholastique dans une interview à La Libre Belgique.
Le génocide n'est pas l'objet du livre mais il est partout présent. Dès les premières pages, des responsables sont désignés, à savoir les autorités hutu, placées par les Belges et l'Église à la tête du Rwanda nouvellement indépendant.
Plus loin, il est question d'histoires qu'on racontait qui n'étaient pas celles des tutsis: "Les Blancs avaient déchaîné sur les Tutsis les monstres insatiables de leurs mauvais rêves. [...]. Ils prétendaient mieux savoir que nous qui nous étions, d'où nous venions." L'auteur veut parler du mythe hamitique construit par l'explorateur John Hanning Speke : le peuple tutsi serait une minorité raciale supérieure aux Hutus car il n'est pas originaire du Rwanda mais d'Éthiopie. Ce mythe a été utilisé par les extrémistes hutus pour mobiliser les citoyens ordinaires contre les tutsis «envahisseurs» lors du génocide de 1994.
Le journaliste Jean Hatzfeld dans Une saison de machettes (2003) a interrogé des génocidaires de la région rwandaise. Il explique dans un entretien (Afrik.com) pourquoi il a voulu s'adresser aux tueurs et ce qu'il en a retenu.
On constate que derrière ce livre simple, authentique, d'une grande sobriété, subsistent des blessures irréparables et l'immense question des responsabilités, à laquelle ce modeste billet ne saurait répondre.
La femme aux pieds nus a obtenu le Prix Seligmann.
Lien : http://www.christianwery.be/..
Un livre d'amour né dans la violence.
La femme aux pieds nus n'est autre que Stéfania, la mère de l'auteur, massacrée comme tant d'autres lors du génocide rwandais de 1994. Le génocide n'est pas le thème central de ce livre, mais il est sous-jacent à chaque page, la présence des militaires et des jeunes hutus est menaçante et fait vivre la famille dans une tension constante.
Stéfania et les siens avaient déjà été chassés de leurs terres et déplacés dans la région du Bugasera, terre aride et inhospitalière où les mères s'efforcent de maintenir les traditions avec dignité et courage. C'est ce que décrit l'auteur en évoquant son enfance parmi ses nombreux frères et soeurs. En une dizaine de chapitres, elle dresse un portrait de la vie quotidienne, saison après saison, la récolte du sorgho, la construction d'une case traditionnelle "l'inzu". De nombreuses traditions régissent la conduite à tenir, que ce soit sur la beauté des femmes, la manière de se soigner et de lire les présages, ou les codes à respecter entre voisines.
Lien : http://legoutdeslivres.canal..
Stéfania et les siens avaient déjà été chassés de leurs terres et déplacés dans la région du Bugasera, terre aride et inhospitalière où les mères s'efforcent de maintenir les traditions avec dignité et courage. C'est ce que décrit l'auteur en évoquant son enfance parmi ses nombreux frères et soeurs. En une dizaine de chapitres, elle dresse un portrait de la vie quotidienne, saison après saison, la récolte du sorgho, la construction d'une case traditionnelle "l'inzu". De nombreuses traditions régissent la conduite à tenir, que ce soit sur la beauté des femmes, la manière de se soigner et de lire les présages, ou les codes à respecter entre voisines.
Lien : http://legoutdeslivres.canal..
J'ai l'impression qu'il me manque un bout de cette histoire... J'aurais dû commencer la bibliographie de cette auteure en commençant par son premier roman...
La femme aux pieds nus est son deuxième roman et on sent que beaucoup de choses graves vont arriver aux personnages super attachants de son histoire 😫😫
On est au Rwanda, à la veille du génocide et finalement la femme aux pieds nus est un hommage à toutes les femmes fortes qui ont élevées les enfants du village (dont l'auteure) en pleine période tendue.
La femme aux pieds nus est son deuxième roman et on sent que beaucoup de choses graves vont arriver aux personnages super attachants de son histoire 😫😫
On est au Rwanda, à la veille du génocide et finalement la femme aux pieds nus est un hommage à toutes les femmes fortes qui ont élevées les enfants du village (dont l'auteure) en pleine période tendue.
La femme aux pieds nus est un hommage écrit par l'auteure à sa mère ; pour nous lecteurs, c'est un aperçu de la vie à la campagne au Rwanda et des traditions de ce pays. L'auteure raconte son quotidien, les travaux des champs, la scolarité, les relations de voisinage, les règles de la vie amoureuse au village et les efforts de sa mère pour assurer la sécurité de ses enfants.
Car l'action du livre se passe à la fin des années 1960, bien avant le génocide de 1994, mais la terreur est présente tout au long du livre. Sa famille est tutsi, elle a déjà connu les premiers massacres de 1963, elle y a échappé, mais a été expulsée avec les autres tutsis dans ce village. Son bétail, la richesse de toute famille tutsie, a été volé ou abattu. Les militaires patrouillent parfois, et chaque descente se termine par des humiliations, des dégradations, des coups, tout ce qui convient pour rabaisser les Tutsis et leur rappeler qu'ils sont à la merci de leurs vainqueurs. L'auteure parle de sa crainte de faire une mauvaise rencontre, "un serpent, un léopard, un militaire" : le militaire est l'égal du serpent car il est aussi dangereux. La mère se prépare tous les jours à la fuite qu'il faudra prendre un jour ; le baluchon des enfants est toujours prêt, des réserves de nourriture sont stockées dans les champs derrière la maison, et les enfants eux-mêmes sont conditionnés à réagir lorsque inévitablement arrivera le drame. Elle est prête à se sacrifier, mais veut sauver ses enfants.
Malgré ce climat de peur, l'auteure raconte une enfance difficile mais heureuse. Ses parents sont pauvres, mais respectés dans le village, l'entente avec les voisins est excellente, chacun partageant les mêmes valeurs. Qu'importe si un jour il y a peu à manger, la famille reste soudée dans toutes les circonstances de la vie.
Car l'action du livre se passe à la fin des années 1960, bien avant le génocide de 1994, mais la terreur est présente tout au long du livre. Sa famille est tutsi, elle a déjà connu les premiers massacres de 1963, elle y a échappé, mais a été expulsée avec les autres tutsis dans ce village. Son bétail, la richesse de toute famille tutsie, a été volé ou abattu. Les militaires patrouillent parfois, et chaque descente se termine par des humiliations, des dégradations, des coups, tout ce qui convient pour rabaisser les Tutsis et leur rappeler qu'ils sont à la merci de leurs vainqueurs. L'auteure parle de sa crainte de faire une mauvaise rencontre, "un serpent, un léopard, un militaire" : le militaire est l'égal du serpent car il est aussi dangereux. La mère se prépare tous les jours à la fuite qu'il faudra prendre un jour ; le baluchon des enfants est toujours prêt, des réserves de nourriture sont stockées dans les champs derrière la maison, et les enfants eux-mêmes sont conditionnés à réagir lorsque inévitablement arrivera le drame. Elle est prête à se sacrifier, mais veut sauver ses enfants.
Malgré ce climat de peur, l'auteure raconte une enfance difficile mais heureuse. Ses parents sont pauvres, mais respectés dans le village, l'entente avec les voisins est excellente, chacun partageant les mêmes valeurs. Qu'importe si un jour il y a peu à manger, la famille reste soudée dans toutes les circonstances de la vie.
Le tendre hymne à la maternité et à la communauté de Scholastique Mukasonga explore l'exil qui prive les gens de leurs traditions et de leur identité.
Née au Rwanda en 1956, Mukasonga a connu très tôt le conflit ethnique qui a marqué son pays. En 1960, sa famille tutsi est exilée dans la « plaine sèche et poussiéreuse du Bugesera », près de la frontière burundaise. Ils ont laissé derrière eux leurs montagnes bien-aimées et les vaches qu'ils avaient autrefois fièrement gardées, forcés de vivre de la culture du sorgho, des haricots et des légumes.
Mukasonga rend hommage à sa mère, Stefania, et aux femmes des villages de réfugiés qui les ont tous « nourris, protégés, conseillés et consolés ». L'auteur se souvient des rituels qui ont façonné ses années de formation et nourri sa famille. L'arrangement des mariages, la consommation de bière de sorgho, la récompense du pain et l'amour des femmes pour la pipe, tout cela est magnifiquement représenté. Tout comme la menace d'une violence soudaine de la part des soldats hutus, omniprésente.
Malheureusement, Mukasonga a dû quitter son école à Butare et fuir au Burundi. Elle s'est installée en France en 1992, deux ans avant le génocide des Tutsi ; 37 membres de sa famille ont été massacrés.
Ce bain de sang hante et propulse le récit. Au début, Mukasonga écrit : "Maman, je n'étais pas là pour couvrir ton corps et il ne me reste que des mots... encore et encore, mes phrases tissent un linceul pour ton corps disparu."
Dans sa conclusion déchirante, elle décrit le cauchemar de ceux qu'elle a laissés derrière elle. L'ombre de son amie Candida lui demande sans cesse: "As-tu un pagne assez grand pour les couvrir tous, chacun d'eux... chacun... chacun ?"
Ce livre, comme tous ceux de Scholastique sont des hommage hors du commun à cette Mère Courage ,
aussi un rappel bouleversant des dégâts de la guerres.
Souvenons-nous que pendant que les Tutsis se faisaient découper à la machette, les chefs d'états et les casques bleus, à quelques kilomètres du lieu des massacres, regardaient...
Paisiblement ?
Ou quelques remords sont-ils venus tourmenter leurs nuits douillettes?
Lien : http://holophernes.over-blog..
Née au Rwanda en 1956, Mukasonga a connu très tôt le conflit ethnique qui a marqué son pays. En 1960, sa famille tutsi est exilée dans la « plaine sèche et poussiéreuse du Bugesera », près de la frontière burundaise. Ils ont laissé derrière eux leurs montagnes bien-aimées et les vaches qu'ils avaient autrefois fièrement gardées, forcés de vivre de la culture du sorgho, des haricots et des légumes.
Mukasonga rend hommage à sa mère, Stefania, et aux femmes des villages de réfugiés qui les ont tous « nourris, protégés, conseillés et consolés ». L'auteur se souvient des rituels qui ont façonné ses années de formation et nourri sa famille. L'arrangement des mariages, la consommation de bière de sorgho, la récompense du pain et l'amour des femmes pour la pipe, tout cela est magnifiquement représenté. Tout comme la menace d'une violence soudaine de la part des soldats hutus, omniprésente.
Malheureusement, Mukasonga a dû quitter son école à Butare et fuir au Burundi. Elle s'est installée en France en 1992, deux ans avant le génocide des Tutsi ; 37 membres de sa famille ont été massacrés.
Ce bain de sang hante et propulse le récit. Au début, Mukasonga écrit : "Maman, je n'étais pas là pour couvrir ton corps et il ne me reste que des mots... encore et encore, mes phrases tissent un linceul pour ton corps disparu."
Dans sa conclusion déchirante, elle décrit le cauchemar de ceux qu'elle a laissés derrière elle. L'ombre de son amie Candida lui demande sans cesse: "As-tu un pagne assez grand pour les couvrir tous, chacun d'eux... chacun... chacun ?"
Ce livre, comme tous ceux de Scholastique sont des hommage hors du commun à cette Mère Courage ,
aussi un rappel bouleversant des dégâts de la guerres.
Souvenons-nous que pendant que les Tutsis se faisaient découper à la machette, les chefs d'états et les casques bleus, à quelques kilomètres du lieu des massacres, regardaient...
Paisiblement ?
Ou quelques remords sont-ils venus tourmenter leurs nuits douillettes?
Lien : http://holophernes.over-blog..
L'auteur rend hommage à sa mère, Stefania, une paysanne rwandaise à qui elle avait promis de recouvrir son corps d'un pagne à sa mort. Elle n'a pu le faire, sa mère étant victime du génocide tutsi en 1994 avec nombre de membres de sa famille. Elle lui dédie ce récit dans lequel elle conte son enfance.
Les massacres des Tutsi par les Hutu ne datent pas des années 1990. Dès l'indépendance, les Belges ont laissé aux commandes des Hutu. Les Tutsi de la famille de l'auteur ont été déplacés dans la région défavorisée et malsaine du Bugesera. en 1963, fuyant les massacres perpétrés plus au nord.
L'auteur décrit les traditions de la société rurale rwandaise que sa mère s'évertue à maintenir : la maison traditionnelle (inzu), les contes, le sorgho, les mariages, les contes, les femmes, gardiennes des traditions. Stefania ne vit que pour nourrir ses cinq enfants, les protéger des exactions, brimadesn, arrestations, saccages, viols...
Un témoignage terrible dans lequel l'humour n'est pas absent ( les mariages).
Il manque un lexique à la fin du livre qui reprendrait les nombreux termes traditionnels.
Les massacres des Tutsi par les Hutu ne datent pas des années 1990. Dès l'indépendance, les Belges ont laissé aux commandes des Hutu. Les Tutsi de la famille de l'auteur ont été déplacés dans la région défavorisée et malsaine du Bugesera. en 1963, fuyant les massacres perpétrés plus au nord.
L'auteur décrit les traditions de la société rurale rwandaise que sa mère s'évertue à maintenir : la maison traditionnelle (inzu), les contes, le sorgho, les mariages, les contes, les femmes, gardiennes des traditions. Stefania ne vit que pour nourrir ses cinq enfants, les protéger des exactions, brimadesn, arrestations, saccages, viols...
Un témoignage terrible dans lequel l'humour n'est pas absent ( les mariages).
Il manque un lexique à la fin du livre qui reprendrait les nombreux termes traditionnels.
Un vibrant hommage à une mère courage écrit à la perfection, mon second roman de Schoslatisque Mukasonga.
Ce livre m'a beaucoup plu car il est à la fois émouvant mais aussi très simple, il est compréhensible et c'est ce qui en fait un livre entraînant. A travers son récit l'auteur nous permet découvrir le Rwanda. Durant la lecture nous voyageons sans jamais quitter notre position, c'est une vraie découverte avec : les traditions, les fruits et légumes typiquement Africain, mais aussi le vocabulaire Rwandais, le voyage est prolifique. Connaissant les origines de l'auteur, lexique est assez curieux car ce livre est de fait adressé au Rwandais. Mais malgré ses quelques problèmes de lexique le rythme et la construction des phrases restent tout à fait lisible.
L'une de mes phrase fétiche : "Ouvre les Yeux et, désormais, que tu saches quel est ton chemin.
L'une de mes phrase fétiche : "Ouvre les Yeux et, désormais, que tu saches quel est ton chemin.
J’ai lu il y a peu de temps « j’ai cru qu’il enlevaient toute trace de toi » ♥️. Il aborde le génocide des Tutsi au Rwanda en 1994.
Mais ici, dans - La femme aux pieds nus - nous ne sommes pas face à un roman, à une fiction. Nous faisons frontalement face à la réalité.
« 𝘑𝘦 𝘯’𝘢𝘪 𝘱𝘢𝘴 𝘳𝘦𝘤𝘰𝘶𝘷𝘦𝘳𝘵 𝘥𝘦 𝘴𝘰𝘯 𝘱𝘢𝘨𝘯𝘦 𝘭𝘦 𝘤𝘰𝘳𝘱𝘴 𝘥𝘦 𝘮𝘢 𝘮è𝘳𝘦. 𝘗𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘯𝘦 𝘯’é𝘵𝘢𝘪𝘵 𝘭à 𝘱𝘰𝘶𝘳 𝘭𝘦 𝘳𝘦𝘤𝘰𝘶𝘷𝘳𝘪𝘳. 𝘓𝘦𝘴 𝘢𝘴𝘴𝘢𝘴𝘴𝘪𝘯𝘴 𝘰𝘯𝘵 𝘱𝘶 𝘴’𝘢𝘵𝘵𝘢𝘳𝘥𝘦𝘳 𝘥𝘦𝘷𝘢𝘯𝘵 𝘭𝘦 𝘤𝘢𝘥𝘢𝘷𝘳𝘦 𝘲𝘶𝘦 𝘭𝘦𝘶𝘳𝘴 𝘮𝘢𝘤𝘩𝘦𝘵𝘵𝘦𝘴 𝘢𝘷𝘢𝘪𝘦𝘯𝘵 𝘥é𝘮𝘦𝘮𝘣𝘳é ».
Le ton est donné. Je passe de la découverte du génocide rwandais avec un roman/fiction, à une plongée même au cœur de l’horreur véritable.
Mukasonga a une écriture sans nul doute magnifique. Comment l’imaginer après de telles horreurs ? Ce récit est un hommage à sa mère, à ses racines, à son pays : « 𝘔𝘢𝘮𝘢𝘯, 𝘫𝘦 𝘯’é𝘵𝘢𝘪𝘴 𝘱𝘢𝘴 𝘭à 𝘱𝘰𝘶𝘳 𝘳𝘦𝘤𝘰𝘶𝘷𝘳𝘪𝘳 𝘵𝘰𝘯 𝘤𝘰𝘳𝘱𝘴 𝘦𝘵 𝘫𝘦 𝘯’𝘢𝘪 𝘱𝘢𝘴 𝘱𝘭𝘶𝘴 𝘲𝘶𝘦 𝘥𝘦𝘴 𝘮𝘰𝘵𝘴 - 𝘥𝘦𝘴 𝘮𝘰𝘵𝘴 𝘥’𝘶𝘯𝘦 𝘭𝘢𝘯𝘨𝘶𝘦 𝘲𝘶𝘦 𝘵𝘶 𝘯𝘦 𝘤𝘰𝘮𝘱𝘳𝘦𝘯𝘢𝘪𝘴 𝘱𝘢𝘴 - 𝘱𝘰𝘶𝘳 𝘢𝘤𝘤𝘰𝘮𝘱𝘭𝘪𝘳 𝘤𝘦 𝘲𝘶𝘦 𝘵𝘶 𝘢𝘴 𝘥𝘦𝘮𝘢𝘯𝘥é. 𝘌𝘵 𝘫𝘦 𝘴𝘶𝘪𝘴 𝘴𝘦𝘶𝘭𝘦 𝘢𝘷𝘦𝘤 𝘮𝘦𝘴 𝘱𝘢𝘶𝘷𝘳𝘦𝘴 𝘮𝘰𝘵𝘴 𝘦𝘵 𝘮𝘦𝘴 𝘱𝘩𝘳𝘢𝘴𝘦𝘴, 𝘴𝘶𝘳 𝘭𝘢 𝘱𝘢𝘨𝘦 𝘥𝘶 𝘤𝘢𝘩𝘪𝘦𝘳, 𝘵𝘪𝘴𝘴𝘦𝘯𝘵 𝘦𝘵 𝘳𝘦𝘵𝘪𝘴𝘴𝘦𝘯𝘵 𝘭𝘦 𝘭𝘪𝘯𝘤𝘦𝘶𝘭 𝘥𝘦 𝘵𝘰𝘯 𝘤𝘰𝘳𝘱𝘴 𝘢𝘣𝘴𝘦𝘯𝘵 ».
Ce livre est une autobiographie, un témoignage nécessaire - pour que chacun prenne conscience des horreurs se déroulant dans le monde. Tout en douceur et en vérité, il nous livre un récit dur mais d’une infinie beauté.
Mais ici, dans - La femme aux pieds nus - nous ne sommes pas face à un roman, à une fiction. Nous faisons frontalement face à la réalité.
« 𝘑𝘦 𝘯’𝘢𝘪 𝘱𝘢𝘴 𝘳𝘦𝘤𝘰𝘶𝘷𝘦𝘳𝘵 𝘥𝘦 𝘴𝘰𝘯 𝘱𝘢𝘨𝘯𝘦 𝘭𝘦 𝘤𝘰𝘳𝘱𝘴 𝘥𝘦 𝘮𝘢 𝘮è𝘳𝘦. 𝘗𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘯𝘦 𝘯’é𝘵𝘢𝘪𝘵 𝘭à 𝘱𝘰𝘶𝘳 𝘭𝘦 𝘳𝘦𝘤𝘰𝘶𝘷𝘳𝘪𝘳. 𝘓𝘦𝘴 𝘢𝘴𝘴𝘢𝘴𝘴𝘪𝘯𝘴 𝘰𝘯𝘵 𝘱𝘶 𝘴’𝘢𝘵𝘵𝘢𝘳𝘥𝘦𝘳 𝘥𝘦𝘷𝘢𝘯𝘵 𝘭𝘦 𝘤𝘢𝘥𝘢𝘷𝘳𝘦 𝘲𝘶𝘦 𝘭𝘦𝘶𝘳𝘴 𝘮𝘢𝘤𝘩𝘦𝘵𝘵𝘦𝘴 𝘢𝘷𝘢𝘪𝘦𝘯𝘵 𝘥é𝘮𝘦𝘮𝘣𝘳é ».
Le ton est donné. Je passe de la découverte du génocide rwandais avec un roman/fiction, à une plongée même au cœur de l’horreur véritable.
Mukasonga a une écriture sans nul doute magnifique. Comment l’imaginer après de telles horreurs ? Ce récit est un hommage à sa mère, à ses racines, à son pays : « 𝘔𝘢𝘮𝘢𝘯, 𝘫𝘦 𝘯’é𝘵𝘢𝘪𝘴 𝘱𝘢𝘴 𝘭à 𝘱𝘰𝘶𝘳 𝘳𝘦𝘤𝘰𝘶𝘷𝘳𝘪𝘳 𝘵𝘰𝘯 𝘤𝘰𝘳𝘱𝘴 𝘦𝘵 𝘫𝘦 𝘯’𝘢𝘪 𝘱𝘢𝘴 𝘱𝘭𝘶𝘴 𝘲𝘶𝘦 𝘥𝘦𝘴 𝘮𝘰𝘵𝘴 - 𝘥𝘦𝘴 𝘮𝘰𝘵𝘴 𝘥’𝘶𝘯𝘦 𝘭𝘢𝘯𝘨𝘶𝘦 𝘲𝘶𝘦 𝘵𝘶 𝘯𝘦 𝘤𝘰𝘮𝘱𝘳𝘦𝘯𝘢𝘪𝘴 𝘱𝘢𝘴 - 𝘱𝘰𝘶𝘳 𝘢𝘤𝘤𝘰𝘮𝘱𝘭𝘪𝘳 𝘤𝘦 𝘲𝘶𝘦 𝘵𝘶 𝘢𝘴 𝘥𝘦𝘮𝘢𝘯𝘥é. 𝘌𝘵 𝘫𝘦 𝘴𝘶𝘪𝘴 𝘴𝘦𝘶𝘭𝘦 𝘢𝘷𝘦𝘤 𝘮𝘦𝘴 𝘱𝘢𝘶𝘷𝘳𝘦𝘴 𝘮𝘰𝘵𝘴 𝘦𝘵 𝘮𝘦𝘴 𝘱𝘩𝘳𝘢𝘴𝘦𝘴, 𝘴𝘶𝘳 𝘭𝘢 𝘱𝘢𝘨𝘦 𝘥𝘶 𝘤𝘢𝘩𝘪𝘦𝘳, 𝘵𝘪𝘴𝘴𝘦𝘯𝘵 𝘦𝘵 𝘳𝘦𝘵𝘪𝘴𝘴𝘦𝘯𝘵 𝘭𝘦 𝘭𝘪𝘯𝘤𝘦𝘶𝘭 𝘥𝘦 𝘵𝘰𝘯 𝘤𝘰𝘳𝘱𝘴 𝘢𝘣𝘴𝘦𝘯𝘵 ».
Ce livre est une autobiographie, un témoignage nécessaire - pour que chacun prenne conscience des horreurs se déroulant dans le monde. Tout en douceur et en vérité, il nous livre un récit dur mais d’une infinie beauté.
Dans un article paru dans le Monde (06.09.2019) j’ai appris l’origine de son nom : « Mukasonga. Votre prénom rwandais est devenu un nom de famille en France. Il vient Du cri de ras-le-bol poussé par mon père à ma naissance. Mukasonga est un prénom qui signifie en kinyarwanda : « Encore une fille ! »J’arrivais après deux filles, ce qui n’est pas la meilleure place dans une fratrie. Au Rwanda, avoir une fille est souhaité à deux places bien précises : au rang d’aînée, pour qu’elle aide la maman au quotidien, et comme petite dernière, car on espère qu’elle deviendra le bâton de vieillesse des parents. En kinyarwanda, « muka » signifie « femme de » et « songa » désigne le point culminant de la colline ».
Roman autobiographique, hommage à sa famille, en particulier à sa mère Stefania, aux disparus du Rwanda et tout particulièrement de Nyamata. C’est un devoir de mémoire si je puis dire. Dans ce livre elle nous parle de sa mère et de sa préoccupation première : tout faire pour protéger et cacher ses enfants en cas d’attaque, assurer la survie de ses enfants.
Dans ce roman elle nous décrit la vie dans les camps, les travaux des champs, la culture et les multiples utilisations du sorgho blanc ou rouge,( la bière, les montures de lunettes, les poupées,), le respect des traditions ancestrales, la peur des soldats, la perdurance des valeurs fondamentales, les plantes médicinales, les recettes et les formules pour soigner; l’importance des voisins et des voisines, la culture locale, les traditions relatives au mariage. L’importance donnée aux vaches, au pain.. La façon dont Stefania a construit son « inzu » pour vivre comme avant. Elle nous parle du rôle de la mère dans la famille traditionnelle, la façon de vivre, les coutumes, les croyances, la communication avec les esprits. Elle fait revivre le Rwanda d’avant le génocide, à une époque où la guerre entre les Tutsis et les Hutu était déclarée, ses souvenirs d’enfance. C’est aussi la transmission orale faite par sa mère à ses enfants, comme c’était la coutume. Elle souligne la qualité de conteuse, de passeuse d’histoire de sa mère. Sa mère étant une « marieuse réputée», elle explique aussi les traditions relatives au mariage et au choix de l’épouse ; les critères de beauté sont extrêmement intéressants (la vache est la référence) et j’ai aussi adoré le passage sur l’importance des pieds.
C’est aussi la description de la façon dont les blancs se conduisent ; si tu ne te convertis pas au catholicisme, pas de prénom chrétien et donc… pas d’école.
Malgré le thème dur et dramatique, c’est une vie familiale qui transpire l’amour que nous transmet une survivante. Superbe témoignage qui a de plus un caractère particulier car elle emploie les mots de là-bas et que cela crée toute l’ambiance... Acheter le kalifuma chez le magendu… (pour info : le kalifuma ou Mirabilis jalapa ou la Belle de nuit a des propriétés antispasmodiques anti-fongique, antibactérien, antimicrobien et anti-virale)
Lien : https://www.cathjack.ch/word..
Roman autobiographique, hommage à sa famille, en particulier à sa mère Stefania, aux disparus du Rwanda et tout particulièrement de Nyamata. C’est un devoir de mémoire si je puis dire. Dans ce livre elle nous parle de sa mère et de sa préoccupation première : tout faire pour protéger et cacher ses enfants en cas d’attaque, assurer la survie de ses enfants.
Dans ce roman elle nous décrit la vie dans les camps, les travaux des champs, la culture et les multiples utilisations du sorgho blanc ou rouge,( la bière, les montures de lunettes, les poupées,), le respect des traditions ancestrales, la peur des soldats, la perdurance des valeurs fondamentales, les plantes médicinales, les recettes et les formules pour soigner; l’importance des voisins et des voisines, la culture locale, les traditions relatives au mariage. L’importance donnée aux vaches, au pain.. La façon dont Stefania a construit son « inzu » pour vivre comme avant. Elle nous parle du rôle de la mère dans la famille traditionnelle, la façon de vivre, les coutumes, les croyances, la communication avec les esprits. Elle fait revivre le Rwanda d’avant le génocide, à une époque où la guerre entre les Tutsis et les Hutu était déclarée, ses souvenirs d’enfance. C’est aussi la transmission orale faite par sa mère à ses enfants, comme c’était la coutume. Elle souligne la qualité de conteuse, de passeuse d’histoire de sa mère. Sa mère étant une « marieuse réputée», elle explique aussi les traditions relatives au mariage et au choix de l’épouse ; les critères de beauté sont extrêmement intéressants (la vache est la référence) et j’ai aussi adoré le passage sur l’importance des pieds.
C’est aussi la description de la façon dont les blancs se conduisent ; si tu ne te convertis pas au catholicisme, pas de prénom chrétien et donc… pas d’école.
Malgré le thème dur et dramatique, c’est une vie familiale qui transpire l’amour que nous transmet une survivante. Superbe témoignage qui a de plus un caractère particulier car elle emploie les mots de là-bas et que cela crée toute l’ambiance... Acheter le kalifuma chez le magendu… (pour info : le kalifuma ou Mirabilis jalapa ou la Belle de nuit a des propriétés antispasmodiques anti-fongique, antibactérien, antimicrobien et anti-virale)
Lien : https://www.cathjack.ch/word..
Un hommage aux mères tutsies, et surtout Stefania, celle dont la fille a écrit ce livre. Des mères qui nourrissent, soignent, protègent, cultivent la terre, bâtissent les "inzus" (il ne faut pas dire "huttes"), arrangent les mariages, prient les dieux des ancêtres autant que la Vierge Marie. Les mères qui restent le pivot de ces populations tutsies, déportées par les hutus, l'ethnie dominante (des dominateurs qui deviendront, 30 ans plus tard, des assassins sans limites).
Le style est simple, descriptif, l'ensemble prend bien vite la forme d'un répertoire des traditions tutsies, ce qui est instructif en soi mais sans beaucoup d'émotion (à l'exception des rappels sur le destin tragique que connaîtront ces femmes et beaucoup de leurs enfants).
Un livre à lire pour découvrir un autre monde.
Le style est simple, descriptif, l'ensemble prend bien vite la forme d'un répertoire des traditions tutsies, ce qui est instructif en soi mais sans beaucoup d'émotion (à l'exception des rappels sur le destin tragique que connaîtront ces femmes et beaucoup de leurs enfants).
Un livre à lire pour découvrir un autre monde.
J'ai voulu approfondir mes lectures sur l'Afrique qui sont pauvres. Mais ce recueil m'a déçue. Peut-être le genre nouvelles me convient-il mal. Je n'ai pas adhéré aux deux premières, le style conte africain ne m'a pas emballée, je l'ai trouvé peu fluide. En revanche j'ai bien aimé la troisième, beaucoup plus réaliste. Malgré cette impression en demies teintes je pense retenter cet auteur avec son roman "Notre-Dame du Nil".
C'est par la petit porte de la nouvelle que Mukasonga nous fait entrer dans le Rwanda d'avant génocide. L'écriture est fluide, rapide, évocatrice. Les personnages sont palpables. Et le cadre raconté ne ressemble pas à ce qu'on a l'habitude de lire.
De ses trois très courtes nouvelles, que je ne raconterai pas, on aperçoit un pays en pleine mutation. Malgré le regard enfantin, quelque chose de sombre se dégage de ces contes envolés et presque féériques.
Autant dire qu'on a envie de découvrir toute son oeuvre après cette (si) brève rencontre.
De ses trois très courtes nouvelles, que je ne raconterai pas, on aperçoit un pays en pleine mutation. Malgré le regard enfantin, quelque chose de sombre se dégage de ces contes envolés et presque féériques.
Autant dire qu'on a envie de découvrir toute son oeuvre après cette (si) brève rencontre.
Scholastique Mukasonga, née en 1956, est une écrivaine rwandaise d'expression française. Elle connaît dès l’enfance la violence et les humiliations des conflits politiques qui agitent le Rwanda. En 1960, sa famille est déplacée dans une région insalubre du pays et en 1973 elle est chassée de l’école d’assistante sociale de Butare et doit s’exiler au Burundi avant de s’établir en France en 1992. En 1994, année du génocide des Tutsi, elle apprend que 27 membres de sa famille ont été massacrés, dont sa mère.
En 2014 parait, Ce que murmurent les collines, un recueil de six nouvelles. La présente édition de poche, nommée La Vache du roi Musinga, contient trois de ces textes et permet d’approcher l’univers de l’écrivain.
Bizarrement, c’est la nouvelle donnant son titre au bouquin qui m’a le moins plu. Très certainement n’en ai-je pas cerné la portée profonde mais les références à l’histoire du pays ou ses légendes me sont passées au-dessus de la tête et pour le dire plus crûment m’ont légèrement ennuyé. Par contre j’ai bien aimé les deux autres textes, Le Bois de la croix et Un Pygmée à l’école. Beaucoup plus simples à comprendre, ils mettent mieux en valeur l’écriture de Scholastique Mukasonga, légère et aérienne, alors qu’en fait tout n’est que tristesse ou émotion esquissées.
Dans Le Bois de la croix, il est question de religion, celle des Pères missionnaires et des croyances locales ancestrales avec des allusions discrètes à la sexualité interdite des religieux blancs, et la narratrice encore enfant, obtenant son diplôme scolaire puis partant à l’internat dans la grande ville, loin de sa famille et premiers pas vers l’exil à venir. Un Pygmée à l’école, comme le titre l’indique, est une courte fable sur le racisme – une attitude universellement partagée. Un gamin d’origine Pygmée, soutenu par un prêtre contre l’avis des enseignants ruandais accède à l’école. Mis à l’écart mais secret ami de la narratrice et de ses deux copines, il s’avérera le plus doué de la classe mais ce n’est qu’en s’exilant dans un autre pays africain qu’il connaitra devenu un homme, un brillant avenir.
Dans tous les textes, même si l’auteure ne le dénonce pas franchement, nous sommes dans une société africaine sous la coupe de l’homme Blanc, ses prêtres missionnaires ou ses autorités politiques. Les natifs, selon leur caractère ou la situation, adoptent des attitudes différentes vis-à-vis de la religion qu’on veut leur inculquer, soit la ruse « - Les Pères te racontent leurs histoires. Moi, je vais te raconter l’histoire de l’arbre géant et de sa forêt comme ma mère me l’a racontée. » Soit le pragmatisme, « Il faut que, toi aussi, tu acceptes comme les autres le Rwanda que nous fabriquent les Blancs. »
Un gentil petit recueil qui ne m’a pas déplu du tout mais qui ne m’a pas emballé plus que ça, non plus. Mais comme l’ouvrage est court et son prix plus que modique, le détour en vaut la chandelle ne serait-ce que pour découvrir Scholastique Mukasonga.
En 2014 parait, Ce que murmurent les collines, un recueil de six nouvelles. La présente édition de poche, nommée La Vache du roi Musinga, contient trois de ces textes et permet d’approcher l’univers de l’écrivain.
Bizarrement, c’est la nouvelle donnant son titre au bouquin qui m’a le moins plu. Très certainement n’en ai-je pas cerné la portée profonde mais les références à l’histoire du pays ou ses légendes me sont passées au-dessus de la tête et pour le dire plus crûment m’ont légèrement ennuyé. Par contre j’ai bien aimé les deux autres textes, Le Bois de la croix et Un Pygmée à l’école. Beaucoup plus simples à comprendre, ils mettent mieux en valeur l’écriture de Scholastique Mukasonga, légère et aérienne, alors qu’en fait tout n’est que tristesse ou émotion esquissées.
Dans Le Bois de la croix, il est question de religion, celle des Pères missionnaires et des croyances locales ancestrales avec des allusions discrètes à la sexualité interdite des religieux blancs, et la narratrice encore enfant, obtenant son diplôme scolaire puis partant à l’internat dans la grande ville, loin de sa famille et premiers pas vers l’exil à venir. Un Pygmée à l’école, comme le titre l’indique, est une courte fable sur le racisme – une attitude universellement partagée. Un gamin d’origine Pygmée, soutenu par un prêtre contre l’avis des enseignants ruandais accède à l’école. Mis à l’écart mais secret ami de la narratrice et de ses deux copines, il s’avérera le plus doué de la classe mais ce n’est qu’en s’exilant dans un autre pays africain qu’il connaitra devenu un homme, un brillant avenir.
Dans tous les textes, même si l’auteure ne le dénonce pas franchement, nous sommes dans une société africaine sous la coupe de l’homme Blanc, ses prêtres missionnaires ou ses autorités politiques. Les natifs, selon leur caractère ou la situation, adoptent des attitudes différentes vis-à-vis de la religion qu’on veut leur inculquer, soit la ruse « - Les Pères te racontent leurs histoires. Moi, je vais te raconter l’histoire de l’arbre géant et de sa forêt comme ma mère me l’a racontée. » Soit le pragmatisme, « Il faut que, toi aussi, tu acceptes comme les autres le Rwanda que nous fabriquent les Blancs. »
Un gentil petit recueil qui ne m’a pas déplu du tout mais qui ne m’a pas emballé plus que ça, non plus. Mais comme l’ouvrage est court et son prix plus que modique, le détour en vaut la chandelle ne serait-ce que pour découvrir Scholastique Mukasonga.
Ce recueil de nouvelles contient trois témoignages d'un Rwanda en pleine mutation : les colons débarquent jusque dans les villages, imposent le christianisme et combattent tout ce qui a un relent de paganisme. La population accepte le changement, par opportunisme ou par pragmatisme, mais derrière cette conversion de façade, les anciens tentent tout de même de transmettre leur culture à leurs enfants.
Voir de vieilles traditions qui ont plusieurs centaines d'années d'existence disparaître comme ça du jour au lendemain, en moins d'une génération, laisse toujours une drôle d'impression. Et quand on voit que ce qui l'a remplacé a pratiquement disparu quelques dizaines d'années plus tard, on peut se demander si ça valait bien la peine de tout bousculer.
Les nouvelles sont agréables à lire, mais le recueil est un peu court : on a à peine le temps de s'immerger dans l'ambiance du Rwanda de l'époque qu'il faut déjà le quitter.
Voir de vieilles traditions qui ont plusieurs centaines d'années d'existence disparaître comme ça du jour au lendemain, en moins d'une génération, laisse toujours une drôle d'impression. Et quand on voit que ce qui l'a remplacé a pratiquement disparu quelques dizaines d'années plus tard, on peut se demander si ça valait bien la peine de tout bousculer.
Les nouvelles sont agréables à lire, mais le recueil est un peu court : on a à peine le temps de s'immerger dans l'ambiance du Rwanda de l'époque qu'il faut déjà le quitter.
Ce court livre contient trois nouvelles Rwandaises, se lit très facilement et nous projette dans un monde onirique, entre les souvenirs de l'autrice et contes traditionnels, dans des aventures où les légendes côtoient la modernité, où la transmission de la culture reste un impératif, récit d'un pays en pleine mutation précédant le début de la guerre.
Lecture enrichissante et dépaysante.
Lecture enrichissante et dépaysante.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur
Auteurs proches de Scholastique Mukasonga
Lecteurs de Scholastique Mukasonga (1439)Voir plus
Quiz
Voir plus
Roman : les particules élémentaires
Qui est l'auteur du livre : Les particules élémentaires ?
Michel Bussi
Michel Houellebecq
Michel Rostain
10 questions
17 lecteurs ont répondu
Thème : Les particules élémentaires de
Michel HouellebecqCréer un quiz sur cet auteur17 lecteurs ont répondu