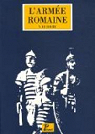Né(e) à : Carthage (Tunisie) , le 26/04/1943
Yann Le Bohec est un historien français. Il est spécialiste de l'Antiquité romaine, en particulier d'Afrique romaine et d'histoire militaire.
En 1982, sa thèse d'État porta sur le camp de la IIIe légion Auguste d'Afrique à Lambèse, soutenue à l’Université de Paris X-Nanterre, où il a ensuite été assistant (1972-1981) puis maître-assistant (1981-1985).
Il enseigna à Grenoble II de 1985 à 1989, puis à Lyon III (où il créa puis dirigea le DESS “Formation aux métiers de l’archéologie”) jusqu'en 2001, avant d'être nommé à Paris IV (Paris-Sorbonne), où il enseigne aujourd'hui en tant que Professeur des Universités.
En 2000, il a été élu vice-président de la section "Histoire et archéologie des civilisations antiques" du Comité des Travaux Historiques et Scientifiques. Il est aussi vice-Président du Conseil Scientifique du Centre d’Étude d’Histoire de la Défense.
D'autre part, il publie depuis 1986 une bibliographie annuelle sur l'Afrique romaine, et il dirige la collection "Antiquité/Synthèses" aux éditions Picard.
Yann Le Bohec s'est notamment vu confier la direction de The Encyclopedia of the Roman Army, monumental ouvrage décrit comme "un outil indispensable pour l'étude de l'histoire militaire antique" qui comble le manque jusque là d'"un livre de référence fiable qui rende hommage à l'importance du sujet".
Ajouter des informations
A l'occasion du 24e Rendez-vous de l'Histoire de Blois, Yann le Bohec vous présente son ouvrage "Les Juifs dans l'Afrique romaine" aux éditions Memoring. Retrouvez le livre : https://www.mollat.com/livres/2542461/yann-le-bohec-les-juifs-dans-l-afrique-romaine Note de musique : © mollat Sous-titres générés automatiquement en français par YouTube. Visitez le site : http://www.mollat.com/ Suivez la librairie mollat sur les réseaux sociaux : Instagram : https://instagram.com/librairie_mollat/ Facebook : https://www.facebook.com/Librairie.mollat?ref=ts Twitter : https://twitter.com/LibrairieMollat Linkedin : https://www.linkedin.com/in/votre-libraire-mollat/ Soundcloud: https://soundcloud.com/librairie-mollat Pinterest : https://www.pinterest.com/librairiemollat/ Vimeo : https://vimeo.com/mollat
Un des lieutenants de César, appelé Hirtius, reprit la rédaction du De Bello Gallico, abandonnée par le proconsul. Il dit clairement que l'année 51 vit encore une véritable guerre. […] La liste des peuples mentionnés par Hirtius et encore impliqués dans ces conflits est impressionnante. […] Il ne faut pourtant pas se laisser impressionner par Hirtius qui, comme César, et pour des raisons analogues, est un grand menteur : il ne veut pas diminuer les mérites de son armée, ses propres exploits et ceux de son supérieur. Pourtant non seulement les pertes en hommes de ses ennemis avaient atteint des chiffres considérables, sur lesquels nous reviendrons, mais encore l'effondrement du moral était patent. Les Gaulois, dans leur majorité, avaient compris qu'ils ne pourraient pas l'emporter sur les Romains, qu'ils ne devaient rien attendre d'un chef, providentiel ou non, et que l'union de 52 n'avait rien apporté de plus que les divisions antérieures.
La mort d'Auguste entraîna des désordres extraordinaires au sein de l'armée romaine. Les légions de Pannonie se mirent en grève ! Les causes profondes du malaise relèvent de la politique : les soldats espéraient une nouvelle façon de gouverner, qui ne privilégierait ni le Sénat, ni le pouvoir du prince. Les causes immédiates sont un catalogue de revendications qui a dû inspirer les syndicats français actuels : les légionnaires demandaient une hausse de salaire, un abaissement de l'âge de la retraite et de meilleures conditions de travail. En particulier, ils souhaitaient que les centurions les battent moins souvent et moins durement.
En attendant une réponse de leur employeur, l'empereur, et pour appuyer leurs revendications, ils cessèrent le travail : plus de tours de garde, plus d'exercice, plus de corvées, plus d'obéissance. La situation s'aggrava quand les légions de Germanie imitèrent leurs soeurs de Pannonie ; elles se conduisirent, pour les mêmes motifs, avec le même mode d'action.
Quoi qu'on en ait dit, Tibère mesura avec justesse la gravité de la situation et, devant l'incapacité de ses légats à rétablir l'ordre, il désigna deux princes impériaux pour suppléer ces médiocres. Il n'est pas sans intérêt de voir comment ils s'y sont pris. Dépêché en Pannonie, Drusus II fut aidé des dieux, qui lui envoyèrent une éclipse de lune. En homme cultivé, il savait que c'était un phénomène naturel. Mais les soldats l'ignoraient, et leurs esprits superstitieux y virent une expression de la colère divine, ce qui les ramena à l'obéissance. Quelques exécutions de meneurs, pour l'exemple, achevèrent de rétablir la discipline.
Sur les bords du Rhin, Germanicus eut moins de chance. Les dieux ne le favorisèrent pas, et il fut faire preuve de plus d'habileté, d'autant que les grévistes l'acclamèrent comme empereur à son arrivée, espérant lui faire plaisir. Il ne pouvait pas faire autrement que de proclamer son obéissance à Tibère. Puis il agit sur trois plans. Pour apaiser le plus grand nombre, il accorda quelques faveurs : des permissions et des gratifications. Pour donner mauvaise conscience aux révoltés, il éloigna sa femme et ses enfants, comme s'il les croyaient capables de s'en prendre à des êtres sans défense. Et il distribua quelques punitions.
Pages 393-394
L'après-bataille du côté des vaincus
Normalement, les barbares étaient vaincus et il en allait évidemment de même pour des Romains dans les guerres civiles. Arrivés à ce stade, les combattants barbares se comportaient comme faisaient les Romains dans les mêmes circonstances ; ils se partageaient entre la fuite, la reddition et le suicide (roi dace Décébale). Les civils, eux, étaient exposés à une tétralogie de l'horreur : vols, viols, meurtres et incendies. Personne, pourtant, ne songeait à s'en indigner, car tous se comportaient de la même manière. Aulu-Gelle et saint Augustin, théologien des plus rigoureux, ont d'ailleurs expliqué que ces comportements étaient normaux et conformes à la morale, car ils relevaient du droit de la guerre, ius belli.
La vigne vient facilement et se comporte comme un vrai chiendent ; elle ne demande que du soleil et, si l’on veut du bon vin, beaucoup de travail et d’intelligence (pentes du Vésuve et Étrurie en Italie, îles de Chio et Rhodes en Grèce). Le vin était très répandu, et en offrir une coupe était un geste de courtoisie, d’amitié, mais l’ivresse était mal vue ; jamais consommé pur, il était mélangé avec de l’eau, du miel, du plâtre… Les soldats buvaient parfois une piquette appelée posca.

Mafia cinema et serie
mcnulty83
89 livres
Adjectifs qui n'en font qu'à leur tête😋
Un bâtiment qui n'est plus une école
112 lecteurs ont répondu