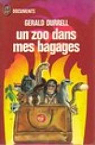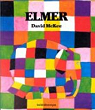Guy Cheminaud
Note moyenne : /5 (sur 0 notes)
Ajouter la description de l’éditeur
Vous pouvez également contribuer à la description collective rédigée par les membres de Babelio.
Contribuer à la description collective
EAN : 978B003WU0T06
Payot et Rivages (01/01/1939)
Payot et Rivages (01/01/1939)
Note moyenne : /5 (sur 0 notes)
Résumé :
Nous n’avons pas encore dans notre base la description de l’éditeur (quatrième de couverture)
Ajouter la description de l’éditeur
Vous pouvez également contribuer à la description collective rédigée par les membres de Babelio.
Contribuer à la description collective
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après Les betes sauvages de l'indochine, mes chasses au laosVoir plus
Citations et extraits (6)
Voir plus
Ajouter une citation
Dans quel but les Siamois et les Laotions chassaient-ils encore les rhinocéros avec tant d'ardeur à la fin du siècle dernier? C'était avant tout pour en décrocher la corne dont la valeur représentait une fortune.
Une belle corne de rhinocéros valait au moins 2;000 ticaux, ce qui représentait plus de 3000 francs-or. Et le prix de la vie d'un indigène était de 25 francs par mois au maximum.
La capture d'un jeune rhinocéros vivant pouvait quintupler cette somme. A ce butin, venait s'ajouter une venaison copieuse et de premier choix. Les chasseurs la découpaient, la fumaient sur place et l'emportaient avec la peau dont la valeur commerciale n'était pas à dédaigner.
Les acheteurs de cornes ne manquaient pas. Les Chinois, nombreux au Siam, les exportaient dans leur pays quand elles n'avaient pas été accaparées par la consommation locale. Cette consommation était d'ordre purement pharmaceutique. La poudre de corne râpée entre, en effet, dans une foule de préparations toutes plus merveilleuses les unes que les autres.
D'après les Annnales du SIam, les ambassadeurs du roi, qui vinrent à Versailles au XVIIè siècle offrirent à Louis XIV, de la part de leur souverain, cinq cornes de rhinocéros cerclées d'or. On ne dit pas, de notre côté, si Louis XIV usa de cette panacée.
Ces même Annales nous apprenent que l'on exportait 1000 cornes par an au XVIIè siècle; 500 au xviiiè et qu'en 1835, ce chiffre était tombé à 60 cornes et 100 peaux. Les statistiques sont muettes à la fin du siècle dernier. Sans doute les chasses suffisaient à peine à l'approvisionnement du pays.
Si on ajoute à cette exportation du Siam celle de la Birmanie qui était importante, et celle de la Cochinchine qui l'était moins, il n'est pas exagéré de supposer que l'on à tué, entre les XVIe et XIXe siècles, trente mille rhinocéros. C'est plus qu'il en faut pour anéantir une espèce déjà peu prolifique. N'oublions pas non plus que les rhinocéros n'ont pas toujours une corne. Il leur arrive parfois de la perdre et d'attendre philosophiquement qu'il leur en pousse une deuxième. D'autres, enfin, n'en ont pas du tout. On tuait donc plus de rhinocéros que l'on ne râpait de cornes.
Une belle corne de rhinocéros valait au moins 2;000 ticaux, ce qui représentait plus de 3000 francs-or. Et le prix de la vie d'un indigène était de 25 francs par mois au maximum.
La capture d'un jeune rhinocéros vivant pouvait quintupler cette somme. A ce butin, venait s'ajouter une venaison copieuse et de premier choix. Les chasseurs la découpaient, la fumaient sur place et l'emportaient avec la peau dont la valeur commerciale n'était pas à dédaigner.
Les acheteurs de cornes ne manquaient pas. Les Chinois, nombreux au Siam, les exportaient dans leur pays quand elles n'avaient pas été accaparées par la consommation locale. Cette consommation était d'ordre purement pharmaceutique. La poudre de corne râpée entre, en effet, dans une foule de préparations toutes plus merveilleuses les unes que les autres.
D'après les Annnales du SIam, les ambassadeurs du roi, qui vinrent à Versailles au XVIIè siècle offrirent à Louis XIV, de la part de leur souverain, cinq cornes de rhinocéros cerclées d'or. On ne dit pas, de notre côté, si Louis XIV usa de cette panacée.
Ces même Annales nous apprenent que l'on exportait 1000 cornes par an au XVIIè siècle; 500 au xviiiè et qu'en 1835, ce chiffre était tombé à 60 cornes et 100 peaux. Les statistiques sont muettes à la fin du siècle dernier. Sans doute les chasses suffisaient à peine à l'approvisionnement du pays.
Si on ajoute à cette exportation du Siam celle de la Birmanie qui était importante, et celle de la Cochinchine qui l'était moins, il n'est pas exagéré de supposer que l'on à tué, entre les XVIe et XIXe siècles, trente mille rhinocéros. C'est plus qu'il en faut pour anéantir une espèce déjà peu prolifique. N'oublions pas non plus que les rhinocéros n'ont pas toujours une corne. Il leur arrive parfois de la perdre et d'attendre philosophiquement qu'il leur en pousse une deuxième. D'autres, enfin, n'en ont pas du tout. On tuait donc plus de rhinocéros que l'on ne râpait de cornes.
Ce cornac était un brave type de Laotien métissé de Kha, qui avait la spécialité d'amuser mon personnel à la veillée avec ses facéties. Il était en outre particulièrement dévoué et respectueux à mon égard, mai beaucoup plus à la mode fruste des Khas qu'à la mode réservée des Laotiens. C'est ainsi qu'ayant appris un jour de la bouche de mon boy que le "patron" manquait pour le moment de papier hygiénique, il avait de propre mouvement taillé soigneusement des baguettes pour me les offrir en remplacement. Ce système est en usage en Extrême-Orient chez les gens de la brousse. Comme je le remerciais de sa délicate attention, en lui faisant toutefois remarquer que les Occidentaux ne savent pas se servir de baguettes, il me répondit non sans quelque à propos:
"C'est un tour de main à prendre!"
Je m'excuse auprès des lecteurs de ces détails quelque peu scatologiques, mais ils dépeignent bien les moeurs de ces homme qui luttent dans la jungle.
"C'est un tour de main à prendre!"
Je m'excuse auprès des lecteurs de ces détails quelque peu scatologiques, mais ils dépeignent bien les moeurs de ces homme qui luttent dans la jungle.
Je ne peux terminer ici cette courte étude d'un animal offrant, en somme, peu d'intérêt pour la chasse, sans parler de l'usage que l'on fait au Siam de la bouse du gayal, ainsi d'ailleurs que celle de l'éléphant. Recueillies à l'état frais et préparées suivant certaines méthodes, ces volumineuses bouses servent à fabriquer un ersatz d'opium à fumer. C'est cette matière... première que la Régie d'opium d'Indochine acheta, il y a quelques années pour les besoins de ses bouilleries. Il y en avait pour vingt-trois millions de francs seulement. On s’aperçut trop tard de l'escroquerie, et il fallut un décret du gouvernement général pour que le stock entier fût jeté à la mer.
Je me souviens avoir vu, en 1899, [sur le marché de Chodoc], un crocodile en vie, sur un étal, les pattes ramenées dans le dos, la gueule entravée, la queue maintenue droit au moyen d'un bâton. Cette queue était débitée par tranches à la demande successive des acheteurs. L'animal, à chaque amputaion, réagissait à peine.
La dernière tranche coupée, le crocodile fut porté au fleuve et jeté à l'eau avprès avoir été débarrassé de ses liens, car il est très mal élevé, dans ces pays, de tuer un animal quand cela n'est pas nécessaire.
Mourut-il par la suite? Voilà une question que je ne me charge pas à mon tour de trancher.
La dernière tranche coupée, le crocodile fut porté au fleuve et jeté à l'eau avprès avoir été débarrassé de ses liens, car il est très mal élevé, dans ces pays, de tuer un animal quand cela n'est pas nécessaire.
Mourut-il par la suite? Voilà une question que je ne me charge pas à mon tour de trancher.
Mon cuisinier excellait surtout dans la cuisson des gigots (qu'il rôtissait dans des fours à termitière1) (...).
1. On abat, avec une barre à mine, tout le cloisonnement intérieur d'une termitière de moyenne dimension et aussi régulière que possible, en décapitant le sommet. On perce ensuite une porte de four au ras du sol pour où l'on évacue les déblais. Le sommet rebouché et la porte fermée d'une tôle, on obtient un four parfait après un premier chauffage à blanc qui achève de d'anéantir tout ce qui peut rester de termites à l'intérieur et dans les galeries du sous-sol.
1. On abat, avec une barre à mine, tout le cloisonnement intérieur d'une termitière de moyenne dimension et aussi régulière que possible, en décapitant le sommet. On perce ensuite une porte de four au ras du sol pour où l'on évacue les déblais. Le sommet rebouché et la porte fermée d'une tôle, on obtient un four parfait après un premier chauffage à blanc qui achève de d'anéantir tout ce qui peut rester de termites à l'intérieur et dans les galeries du sous-sol.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Quiz
Voir plus
Les écrivains et le suicide
En 1941, cette immense écrivaine, pensant devenir folle, va se jeter dans une rivière les poches pleine de pierres. Avant de mourir, elle écrit à son mari une lettre où elle dit prendre la meilleure décision qui soit.
Virginia Woolf
Marguerite Duras
Sylvia Plath
Victoria Ocampo
8 questions
1754 lecteurs ont répondu
Thèmes :
suicide
, biographie
, littératureCréer un quiz sur ce livre1754 lecteurs ont répondu