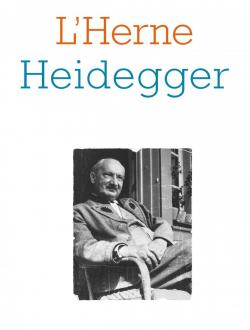Etienne Klein est physicien et philosophe. Il signe dans le "Cahier de l'Herne", consacré à André Comte-Sponville, un texte sur le temps et notre rapport à l'ennui, qui a toujours "une mauvaise réputation", mais qui peut aussi avoir des ressources, être un facteur créatif. le scientifique revient sur les définitions du vide et du néant, deux concepts bien différents qui intéressent les physiciens. Nous ne sommes pas égaux face à l'ennui, face au vide.
Retrouvez l'intégralité de l'interview ci-dessous :
https://www.france.tv/france-5/la-grande-librairie/la-grande-librairie-saison-12/1448617-a-quoi-sert-la-philosophie.html

Les Cahiers de l'Herne/5
5 notes
Résumé :
Cahier Heidegger
Martin Heidegger
Categorie : Cahiers de L'Herne
Parution : 11/05/2016
Pages : 312
Dirigé par Michel Haar.
Lire Heidegger, c’est relire autrement tout ce que nous lisons. Ce Cahier invite à mieux comprendre la pensée heideggérienne autours des thèmes principaux qu’il aborde.
Des essais, témoignages et lettres retracent l’impacte de sa pensée dans la culture moderne.
Martin Heidegger
Categorie : Cahiers de L'Herne
Parution : 11/05/2016
Pages : 312
Dirigé par Michel Haar.
Lire Heidegger, c’est relire autrement tout ce que nous lisons. Ce Cahier invite à mieux comprendre la pensée heideggérienne autours des thèmes principaux qu’il aborde.
Des essais, témoignages et lettres retracent l’impacte de sa pensée dans la culture moderne.
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après Martin Heidegger - Les cahiers de L'HerneVoir plus
Citations et extraits (11)
Voir plus
Ajouter une citation
II
Et aujourd’hui ? Les dieux anciens se sont enfuis. Hölderlin, qui a fait l’épreuve de cette disparition comme aucun autre poète avant lui ni après lui, et qui l’a portée de façon fondatrice à la parole, demande, dans son élégie Pain et vin [2], consacrée au dieu du vin Dionysos :
« Wo, wo leuchten sie denn, die fernhintreffende Sprüche ?
Delphi schlummert und wo tonet das grosse Geschick ? » (IV Str.)
« Où brillent-ils, les oracles qui portent loin ?
Delphes somnole — où retentit le grand destin ? »
Y a-t-il aujourd’hui, après deux millénaires et demi, un art qui se tienne sous la même exigence que le fit autrefois l’art en Grèce ? Et sinon, de quelle région provient l’exigence à laquelle l’art moderne, dans tous ses domaines, répond ? Ses œuvres ne jaillissent plus des limites fécondes d’un monde du populaire et du national. Elles appartiennent à l’universalité de la civilisation mondiale. Leur composition et leur organisation font partie de ce que la technique scientifique projette et produit. Celle-ci a décidé du mode et des possibilités du séjour de l’homme dans le monde. La constatation que nous vivons dans un monde scientifique, et que par l’appellation de « science », c’est la science de la nature, la physique mathématique, qui est entendue, met l’accent sur quelque chose qu’on ne connaît que trop.
En fonction d’elle on est facilement porté à expliquer que la région d’où provient l’exigence à laquelle l’art d’aujourd’hui a à répondre, n’est autre que le monde scientifique.
Nous hésitons à donner notre assentiment. Nous restons dans l’embarras. C’est pourquoi nous demandons : qu’est-ce que cela signifie — « le monde de la science » ? Nietzsche, à la fin de la neuvième décennie du siècle dernier, a déjà prononcé une parole qui peut aider à résoudre cette question. La voici :
« Ce n’est pas la victoire de la science, qui caractérise notre dix-neuvième siècle, mais la victoire de la méthode scientifique sur la science. » (Volonté de puissance, n. 466.)
La phrase de Nietzsche réclame un éclaircissement.
Que signifie ici « méthode » ? Que signifie « la victoire de la méthode » ? « Méthode » ne signifie pas ici l’instrument grâce auquel la recherche scientifique élabore le domaine, thématiquement établi, de ses objets. Méthode signifie bien plutôt la façon et la manière dont, dès l’abord, ce qui constitue à chaque fois le domaine des objets soumis à la recherche est délimité dans son objectivité. La méthode est le projet qui d’avance a prise sur le monde, et établit ce en quoi seulement il peut être soumis à la recherche. Et quel est ce projet ? Réponse : que soit en général soumis au calcul tout ce qui est accessible à l’expérimentation et contrôlable par elle. A ce projet d’un monde les sciences particulières demeurent assujetties dans leur démarche. C’est pourquoi la méthode ainsi comprise est la « victoire sur la science ». La victoire comporte en elle-même une décision. Elle affirme : ne vaut comme véritablement réel que ce qui est scientifiquement démontrable, c’est-à-dire calculable. Grâce à la calculabilité, le monde devient, toujours et partout, soumis à la maîtrise de l’homme. La méthode est la provocation victorieuse lancée au monde pour qu’il soit en général à la pleine disposition de l’homme. La victoire de la méthode sur la science a pris son départ au XVIIe siècle, grâce à Galilée et à Newton, en Europe — et nulle part ailleurs sur cette terre.
La victoire de la méthode se développe aujourd’hui dans ses possibilités les plus extrêmes comme cybernétique. Le mot grec κυ6ερνήτης est le nom de celui qui tient les commandes. Le monde scientifique devient monde cybernétique. Le projet cybernétique du monde suppose, dans sa saisie préalable, que la caractéristique fondamentale de tous les processus calculables du monde soit la commande. La commande d’un processus par un autre est rendue possible par la transmission d’une information. Dans la mesure où le processus commandé renvoie des messages à celui qui le commande et ainsi l’informe, la commande a le caractère de la rétroaction des informations.
La régulation dans les deux sens des processus en rapport mutuel s’accomplit donc en un mouvement circulaire. C’est pourquoi la circularité de la régulation est le caractère fondamental du monde que projette la cybernétique. Sur elle repose la possibilité de l’autorégulation, l’automatisation d’un système moteur. Dans la représentation du monde par la cybernétique, la différence entre les machines automatiques et les êtres vivants est abolie. Elle est neutralisée par le processus de l’information qui ne fait pas de différence. Le projet cybernétique du monde, la « victoire de la méthode sur la science » rend possible que le monde de l’inanimé et de l’animé soit soumis à un calcul généralement équivalent, et en ce sens universel — à un calcul, c’est-à-dire à une maîtrise. L’homme lui aussi a sa place assignée dans cette uniformité du monde cybernétique. A tel point que cette place de l’homme est toute particulière. En effet, dans l’horizon de la représentation cybernétique, l’homme a son lieu dans le circuit de régulation le plus large. Conformément à la représentation moderne de l’homme, celui-ci est en effet le sujet, qui se rapporte au monde comme au domaine des objets, en les travaillant. La transformation du monde qui est ainsi à chaque fois produite se donne en retour à connaître à l’homme. La relation sujet-objet est, pour la représentation cybernétique, l’échange réciproque des informations, la rétroaction au sein du circuit de régulation supérieur, qui peut être décrit par le titre « homme et monde ». La science cybernétique de l’homme cherche à présent les fondements d’une anthropologie scientifique là où le requisit principal de la méthode, le projet de tout soumettre au calcul, peut être satisfait de la façon la plus sûre dans l’expérimentation, à savoir dans la biochimie et la biophysique. C’est pourquoi ce qui dans la vie de l’homme est, d’après les normes de la méthode, le vivant normatif, ce sont les gamètes. Ils ne sont plus comme auparavant les miniatures de l’être vivant pleinement développé. La biochimie a découvert le plan de la vie dans les gènes des gamètes. Ce plan est la programmation inscrite et stockée dans les gènes, le programme de l’évolution. La science connaît déjà l’alphabet de ce programme. On parle d’« archives de l’information génétique ». Sur sa connaissance se fonde la perspective assurée d’obtenir un jour une prise sur la production et la sélection de l’homme par la technique scientifique. La pénétration de la structure génétique des gamètes humains par la biochimie et la fission de l’atome par la physique nucléaire se tiennent l’une et l’autre sur la même voie, celle de la victoire de la méthode sur la science.
Dans une note de l’année 1884, Nietzsche remarque : « L’homme est l’animal qui n’est pas encore établi. » (XIII, n. 667). Cette phrase contient deux pensées. D’une part, l’essence de l’homme n’est pas encore bien établie, pas encore reconnue. D’autre part, l’existence de l’homme n’est pas encore fermement établie, pas assurée. Certes, un chercheur américain explique aujourd’hui : « L’homme sera l’unique animal qui puisse diriger sa propre évolution. » Mais la cybernétique se voit par ailleurs forcée de reconnaître qu’une régulation générale de l’existence humaine n’est pas encore accomplie à l’heure actuelle. C’est pourquoi l’homme fait encore provisoirement fonction, dans le domaine universel de la science cybernétique, de « facteur de perturbation ». Les plans et les actions de l’homme, apparemment libres, agissent de façon perturbante.
Mais tout récemment la science a aussi pris possession de ce champ de l’existence humaine. Elle entreprend l’exploration et la planification, rigoureusement méthodiques, de l’avenir possible de l’homme agissant. Elle prend en compte les informations sur ce qui est planifiable de l’homme. Cette sorte d’avenir est le futur pour le Logos qui, en tant que futurologie, se subordonne à la victoire de la méthode sur la science. La parenté de cette très récente discipline scientifique avec la cybernétique est évidente.
Cependant nous ne mesurons toute la portée de la science cybernétique et futurologique de l’homme que si nous prenons garde à la présupposition sur laquelle elle se fonde. Cette présupposition consiste en ce que l’homme est déterminé comme l’être social. Mais société veut dire : société industrielle. Elle est le sujet auquel le monde des objets demeure rapporté. On pense certes que l’égoïté de l’homme serait surmontée par son être social. Mais cet être social ne fait en aucune façon que l’homme moderne sacrifie sa subjectivité. Bien plutôt, la société industrielle est l’égoïté, c’est-à-dire la subjectivité, portée à son élévation la plus extrême. En elle, l’homme ne s’en remet qu’à soi-même et aux domaines, par lui érigés en institutions, de son monde vécu. Certes, la société industrielle ne peut être ce qu’elle est que si elle se soumet aux règles de la science dominée par la cybernétique et de la technique scientifique. Mais l’autorité de la science s’appuie sur la victoire de la méthode, qui de son côté produit comme sa justification l’effet de la recherche qu’elle dirige. Ce titre de justification est tenu pour suffisant. L’autorité anonyme de la science est considérée comme intouchable.
Cependant vous n’avez dû cesser de vous demander : pourquoi ces considérations sur la cybernétique, la futurologie et la société industrielle ? ne nous sommes-nous pas beaucoup trop éloignés, ce faisant, de notre question sur la provenance de l’art ? Cela semble bien être le cas, et pourtant n’est pas juste.
Les renvois à l’existence de l’homme d’aujourd’hui nous ont bien plutôt préparés à poser de façon plus réfléchie notre question sur la provenance de l’art et la destination de la pensée.
Et aujourd’hui ? Les dieux anciens se sont enfuis. Hölderlin, qui a fait l’épreuve de cette disparition comme aucun autre poète avant lui ni après lui, et qui l’a portée de façon fondatrice à la parole, demande, dans son élégie Pain et vin [2], consacrée au dieu du vin Dionysos :
« Wo, wo leuchten sie denn, die fernhintreffende Sprüche ?
Delphi schlummert und wo tonet das grosse Geschick ? » (IV Str.)
« Où brillent-ils, les oracles qui portent loin ?
Delphes somnole — où retentit le grand destin ? »
Y a-t-il aujourd’hui, après deux millénaires et demi, un art qui se tienne sous la même exigence que le fit autrefois l’art en Grèce ? Et sinon, de quelle région provient l’exigence à laquelle l’art moderne, dans tous ses domaines, répond ? Ses œuvres ne jaillissent plus des limites fécondes d’un monde du populaire et du national. Elles appartiennent à l’universalité de la civilisation mondiale. Leur composition et leur organisation font partie de ce que la technique scientifique projette et produit. Celle-ci a décidé du mode et des possibilités du séjour de l’homme dans le monde. La constatation que nous vivons dans un monde scientifique, et que par l’appellation de « science », c’est la science de la nature, la physique mathématique, qui est entendue, met l’accent sur quelque chose qu’on ne connaît que trop.
En fonction d’elle on est facilement porté à expliquer que la région d’où provient l’exigence à laquelle l’art d’aujourd’hui a à répondre, n’est autre que le monde scientifique.
Nous hésitons à donner notre assentiment. Nous restons dans l’embarras. C’est pourquoi nous demandons : qu’est-ce que cela signifie — « le monde de la science » ? Nietzsche, à la fin de la neuvième décennie du siècle dernier, a déjà prononcé une parole qui peut aider à résoudre cette question. La voici :
« Ce n’est pas la victoire de la science, qui caractérise notre dix-neuvième siècle, mais la victoire de la méthode scientifique sur la science. » (Volonté de puissance, n. 466.)
La phrase de Nietzsche réclame un éclaircissement.
Que signifie ici « méthode » ? Que signifie « la victoire de la méthode » ? « Méthode » ne signifie pas ici l’instrument grâce auquel la recherche scientifique élabore le domaine, thématiquement établi, de ses objets. Méthode signifie bien plutôt la façon et la manière dont, dès l’abord, ce qui constitue à chaque fois le domaine des objets soumis à la recherche est délimité dans son objectivité. La méthode est le projet qui d’avance a prise sur le monde, et établit ce en quoi seulement il peut être soumis à la recherche. Et quel est ce projet ? Réponse : que soit en général soumis au calcul tout ce qui est accessible à l’expérimentation et contrôlable par elle. A ce projet d’un monde les sciences particulières demeurent assujetties dans leur démarche. C’est pourquoi la méthode ainsi comprise est la « victoire sur la science ». La victoire comporte en elle-même une décision. Elle affirme : ne vaut comme véritablement réel que ce qui est scientifiquement démontrable, c’est-à-dire calculable. Grâce à la calculabilité, le monde devient, toujours et partout, soumis à la maîtrise de l’homme. La méthode est la provocation victorieuse lancée au monde pour qu’il soit en général à la pleine disposition de l’homme. La victoire de la méthode sur la science a pris son départ au XVIIe siècle, grâce à Galilée et à Newton, en Europe — et nulle part ailleurs sur cette terre.
La victoire de la méthode se développe aujourd’hui dans ses possibilités les plus extrêmes comme cybernétique. Le mot grec κυ6ερνήτης est le nom de celui qui tient les commandes. Le monde scientifique devient monde cybernétique. Le projet cybernétique du monde suppose, dans sa saisie préalable, que la caractéristique fondamentale de tous les processus calculables du monde soit la commande. La commande d’un processus par un autre est rendue possible par la transmission d’une information. Dans la mesure où le processus commandé renvoie des messages à celui qui le commande et ainsi l’informe, la commande a le caractère de la rétroaction des informations.
La régulation dans les deux sens des processus en rapport mutuel s’accomplit donc en un mouvement circulaire. C’est pourquoi la circularité de la régulation est le caractère fondamental du monde que projette la cybernétique. Sur elle repose la possibilité de l’autorégulation, l’automatisation d’un système moteur. Dans la représentation du monde par la cybernétique, la différence entre les machines automatiques et les êtres vivants est abolie. Elle est neutralisée par le processus de l’information qui ne fait pas de différence. Le projet cybernétique du monde, la « victoire de la méthode sur la science » rend possible que le monde de l’inanimé et de l’animé soit soumis à un calcul généralement équivalent, et en ce sens universel — à un calcul, c’est-à-dire à une maîtrise. L’homme lui aussi a sa place assignée dans cette uniformité du monde cybernétique. A tel point que cette place de l’homme est toute particulière. En effet, dans l’horizon de la représentation cybernétique, l’homme a son lieu dans le circuit de régulation le plus large. Conformément à la représentation moderne de l’homme, celui-ci est en effet le sujet, qui se rapporte au monde comme au domaine des objets, en les travaillant. La transformation du monde qui est ainsi à chaque fois produite se donne en retour à connaître à l’homme. La relation sujet-objet est, pour la représentation cybernétique, l’échange réciproque des informations, la rétroaction au sein du circuit de régulation supérieur, qui peut être décrit par le titre « homme et monde ». La science cybernétique de l’homme cherche à présent les fondements d’une anthropologie scientifique là où le requisit principal de la méthode, le projet de tout soumettre au calcul, peut être satisfait de la façon la plus sûre dans l’expérimentation, à savoir dans la biochimie et la biophysique. C’est pourquoi ce qui dans la vie de l’homme est, d’après les normes de la méthode, le vivant normatif, ce sont les gamètes. Ils ne sont plus comme auparavant les miniatures de l’être vivant pleinement développé. La biochimie a découvert le plan de la vie dans les gènes des gamètes. Ce plan est la programmation inscrite et stockée dans les gènes, le programme de l’évolution. La science connaît déjà l’alphabet de ce programme. On parle d’« archives de l’information génétique ». Sur sa connaissance se fonde la perspective assurée d’obtenir un jour une prise sur la production et la sélection de l’homme par la technique scientifique. La pénétration de la structure génétique des gamètes humains par la biochimie et la fission de l’atome par la physique nucléaire se tiennent l’une et l’autre sur la même voie, celle de la victoire de la méthode sur la science.
Dans une note de l’année 1884, Nietzsche remarque : « L’homme est l’animal qui n’est pas encore établi. » (XIII, n. 667). Cette phrase contient deux pensées. D’une part, l’essence de l’homme n’est pas encore bien établie, pas encore reconnue. D’autre part, l’existence de l’homme n’est pas encore fermement établie, pas assurée. Certes, un chercheur américain explique aujourd’hui : « L’homme sera l’unique animal qui puisse diriger sa propre évolution. » Mais la cybernétique se voit par ailleurs forcée de reconnaître qu’une régulation générale de l’existence humaine n’est pas encore accomplie à l’heure actuelle. C’est pourquoi l’homme fait encore provisoirement fonction, dans le domaine universel de la science cybernétique, de « facteur de perturbation ». Les plans et les actions de l’homme, apparemment libres, agissent de façon perturbante.
Mais tout récemment la science a aussi pris possession de ce champ de l’existence humaine. Elle entreprend l’exploration et la planification, rigoureusement méthodiques, de l’avenir possible de l’homme agissant. Elle prend en compte les informations sur ce qui est planifiable de l’homme. Cette sorte d’avenir est le futur pour le Logos qui, en tant que futurologie, se subordonne à la victoire de la méthode sur la science. La parenté de cette très récente discipline scientifique avec la cybernétique est évidente.
Cependant nous ne mesurons toute la portée de la science cybernétique et futurologique de l’homme que si nous prenons garde à la présupposition sur laquelle elle se fonde. Cette présupposition consiste en ce que l’homme est déterminé comme l’être social. Mais société veut dire : société industrielle. Elle est le sujet auquel le monde des objets demeure rapporté. On pense certes que l’égoïté de l’homme serait surmontée par son être social. Mais cet être social ne fait en aucune façon que l’homme moderne sacrifie sa subjectivité. Bien plutôt, la société industrielle est l’égoïté, c’est-à-dire la subjectivité, portée à son élévation la plus extrême. En elle, l’homme ne s’en remet qu’à soi-même et aux domaines, par lui érigés en institutions, de son monde vécu. Certes, la société industrielle ne peut être ce qu’elle est que si elle se soumet aux règles de la science dominée par la cybernétique et de la technique scientifique. Mais l’autorité de la science s’appuie sur la victoire de la méthode, qui de son côté produit comme sa justification l’effet de la recherche qu’elle dirige. Ce titre de justification est tenu pour suffisant. L’autorité anonyme de la science est considérée comme intouchable.
Cependant vous n’avez dû cesser de vous demander : pourquoi ces considérations sur la cybernétique, la futurologie et la société industrielle ? ne nous sommes-nous pas beaucoup trop éloignés, ce faisant, de notre question sur la provenance de l’art ? Cela semble bien être le cas, et pourtant n’est pas juste.
Les renvois à l’existence de l’homme d’aujourd’hui nous ont bien plutôt préparés à poser de façon plus réfléchie notre question sur la provenance de l’art et la destination de la pensée.
La provenance de l’art et la destination de la pensée
Conférence tenue le 4 avril 1967 à l’Académie des sciences et des arts d’Athènes. Version prononcée et revue.
Monsieur le Président, mes chers collègues, mesdames et messieurs,
Que la première et l’unique parole d’un membre de l’Académie des Arts de Berlin soit une parole de reconnaissance pour l’accueil de Monsieur le professeur Theodorakopoulos, pour l’invitation du gouvernement grec et pour l’hospitalité de l’Académie des Sciences et des Arts.
Mais comment vous témoigner, à vous qui êtes nos hôtes à Athènes, la reconnaissance des invités ?
Notre reconnaissance est de tenter de penser avec vous. Penser — mais à quoi ? Nous qui sommes membre de l’Académie des Arts, nous trouvant ici, à Athènes, en présence de l’Académie des Sciences, à l’époque de la technique scientifique, que pouvons-nous méditer d’autre que ce monde qui jadis, pour que commencent les arts de l’Europe occidentale et les sciences, posa les fondements ?
Ce monde est certes, pour les historiens, chose du passé. Mais pour l’histoire, si nous l’éprouvons comme ce qui nous est destiné, il demeure toujours et il demeurera toujours un présent nouveau : quelque chose qui attend de nous que nous allions en pensant à sa rencontre, et que nous mettions par-là à l’épreuve notre propre pensée et notre propre création artistique. Car le commencement d’un destin est ce qu’il y a de plus grand. Il tient d’avance tout ce qui vient après lui sous sa puissance.
Nous méditons sur la provenance de l’art en Grèce. Nous tentons de jeter un regard dans ce domaine qui, avant tout art, exerce déjà sa puissance et qui seul accorde à l’art ce qui fait de lui ce qu’il est. Nous ne recherchons pas une définition formelle de l’art, pas plus qu’il ne nous revient de disserter en historien sur l’histoire de l’origine de l’art en Grèce.
Comme nous aimerions, dans nos considérations, éviter l’arbitraire de l’inspiration, nous demandons ici, à Athènes, conseil et assistance de l’antique protectrice de la cité et de la terre attique, de la déesse Athéna. Nous ne pouvons certes pas épuiser la plénitude de sa divinité. Nous ne faisons que reconnaître ce qu’Athéna nous dit de la provenance de l’art.
Telle est la première question qui nous conduit.
La seconde s’impose d’elle-même. La voici : qu’en est-il aujourd’hui de l’art au regard de son antique provenance ?
Enfin nous méditons en troisième lieu cette question : d’où la pensée qui reconsidère aujourd’hui la provenance de l’art reçoit-elle sa destination ?
I
Homère nomme Athéna πολύμητις, la conseillère aux multiples ressources [1]. Que signifie donner conseil ? Cela veut dire : préméditer quelque chose, y pourvoir d’avance et par là faire qu’elle réussisse. De ce fait Athéna règne partout où les hommes produisent quelque chose, mettent au jour quelque chose, la mènent à bonne fin, mettent en œuvre, agissent et font. C’est ainsi qu’Athéna est l’amie qui conseille et qui aide Hercule dans ses exploits. On voit apparaître la déesse sur la métope d’Atlas du temple de Zeus à Olympie : invisible encore dans sa toute proche assistance, et en même temps éloignée de toute la haute distance de sa divinité. Athéna dispense ses conseils tout particuliers aux hommes qui produisent des outils, des vases et des joyaux. Tout homme qui est habile à produire, qui connaît son affaire, qui maîtrise son métier est un τεχνηίτης. Nous comprenons ce terme dans un sens beaucoup trop étroit quand nous le traduisons par artisan. Même ceux qui érigent des monuments et font des sculptures s’appellent des technitaï. Ils s’appellent ainsi parce que leur action qui donne la mesure est dirigée par une compréhension qui porte le nom de τέχνη. Ce mot nomme une forme de savoir. Il ne signifie pas le travail et la fabrication. Mais savoir veut dire : avoir en vue dès l’abord ce qui est en jeu dans la production d’une image et d’une œuvre. L’œuvre peut être aussi bien une œuvre, de science ou de philosophie, de poésie ou d’éloquence. L’art est τέχνη, mais non pas technique. L’artiste est τεχνηίτης, mais pas plus technicien qu’artisan.
Parce que l’art, comme τέχνη, repose dans un savoir, parce qu’un tel savoir est un regard préalable dans ce qui montre la forme et donne la mesure, mais qui est encore l’invisible, et qui doit d’abord être porté dans la visibilité et la perceptibilité de l’œuvre, pour ces raisons un tel regard préalable dans ce qui jusqu’ici n’a pas encore été donné à voir requiert singulièrement la vision et la clarté.
Ce regard préalable qui porte l’art a besoin de l’illumination. D’où pourrait-elle être accordée à l’art, sinon de la part de la déesse qui, comme πολύμητις, comme la conseillère aux multiples ressources, est en même temps γλαυκηπις ? L’adjectif γλαυκός désigne l’éclat rayonnant de la mer, des astres, de la lune, mais aussi le chatoiement de l’olivier. L’œil d’Athéna est l’œil qui éclaire et resplendit. C’est pourquoi lui appartient, comme un signe de ce qu’elle est, la chouette, ή γλαύζ. Son œil n’a pas seulement l’ardeur de la braise, il traverse aussi la nuit et rend visible ce qui serait, autrement, l’invisible.
C’est pourquoi Pindare, dans la septième Olympique, qui célèbre l’île de Rhodes et ses habitants, dit :
« αύτα δέ σφισιν ώπασε τέχναν
πάσαν έπιχθονιων Γλακώπις άριστοπόνοις κρατείν » (Olympiques, VII, 50 sq.)
« Et la déesse même aux yeux clairs leur fit don
De passer en tout art ceux qui hantent la terre
Grâce à leurs mains qui sont au labeur sans égales »
Nous devons toutefois poser une question plus précise encore : ce regard de la déesse Athéna, ce regard qui porte conseil et illumine, vers quoi est-il dirigé ?
Pour trouver la réponse, rendons-nous présent le relief sacré du musée de l’Acropole. Sur lui Athéna apparaît comme la σκεπτομένη, celle qui médite. Vers quoi le regard méditatif de la déesse est-il tourné ? Vers la borne, vers la limite. La limite n’est certes pas seulement le contour et le cadre, n’est pas seulement le lieu où quelque chose s’arrête. La limite signifie ce par quoi quelque chose est rassemblée dans ce qu’elle a de propre, pour apparaître par là dans toute sa plénitude, pour venir à la présence. En méditant sur la limite, Athéna a déjà en vue ce vers quoi l’action humaine doit tout d’abord regarder pour pouvoir porter ce qu’elle y a vu dans la visibilité d’une œuvre. Plus encore : le regard méditatif de la déesse ne pénètre pas seulement la forme invisible des œuvres possibles des hommes. Le regard d’Athéna se pose avant tout déjà sur ce qui de soi-même laisse paraître dans le sceau de leur présence les choses qui n’ont pas à être produites par l’homme. Cela, les Grecs le nomment de toute antiquité la φύσις. La traduction romaine du mot φύσις par natura et enfin, à partir d’elle, le concept de la nature devenu dominant dans la pensée de l’Europe occidentale dissimulent complètement le sens de ce que φύσις désigne : ce qui paraît de soi-même dans la limite qui est à chaque fois la sienne, et qui a dans cette limite son séjour.
Ce que la φύσις a de mystérieux, nous pouvons aujourd’hui encore en faire l’épreuve en Grèce — et seulement ici, à cet instant où d’une façon à la fois bouleversante et retenue apparaissent une montagne, une île, une plage, un olivier. On entend dire que cela tient au caractère unique de la lumière. Cela n’est pas faux, mais reste seulement superficiel. On néglige de considérer d’où cette lumière exceptionnelle est donnée, à quoi elle appartient dans son être. Ce n’est qu’ici, en Grèce, où le tout du monde s’est adressé à l’homme en tant que φύσις et a jeté sur l’homme son dévolu, que la perception et l’action humaines pouvaient et devaient correspondre à un tel dévolu : l’homme était par là d’emblée forcé de porter lui-même, par son propre pouvoir, à la présence, ce qui devait comme œuvre laisser apparaître un monde jusque-là non encore apparu.
L’art répond à la φύσις, et n’est pourtant pas une copie ni une imitation de ce qui est déjà présent. C’est mystérieusement que φύσις et τέχνη s’appartiennent l’une à l’autre. Mais l’élément dans lequel φύσις et τέχνη s’appartiennent l’une à l’autre, et le domaine dans lequel l’art doit s’introduire pour pouvoir, en tant qu’art, devenir ce qu’il est, cet élément et ce domaine demeurent à couvert.
Dès l’aube de la Grèce, poètes et penseurs ont certes touché ce mystère. La clarté, qui à tout ce qui est présent fait don de sa présence, c’est dans l’éclair qu’elle montre sa maîtrise rassemblée en se faisant connaître tout soudain.
Héraclite dit : « τὰ δὲ πάντα οἰακίζει κεραυνός (B 64) », « c’est l’éclair qui gouverne tout ». Cela signifie : l’apparaître de ce qui de soi-même est présent dans son sceau, c’est l’éclair qui d’un seul coup le conduit et le gouverne.
Conférence tenue le 4 avril 1967 à l’Académie des sciences et des arts d’Athènes. Version prononcée et revue.
Monsieur le Président, mes chers collègues, mesdames et messieurs,
Que la première et l’unique parole d’un membre de l’Académie des Arts de Berlin soit une parole de reconnaissance pour l’accueil de Monsieur le professeur Theodorakopoulos, pour l’invitation du gouvernement grec et pour l’hospitalité de l’Académie des Sciences et des Arts.
Mais comment vous témoigner, à vous qui êtes nos hôtes à Athènes, la reconnaissance des invités ?
Notre reconnaissance est de tenter de penser avec vous. Penser — mais à quoi ? Nous qui sommes membre de l’Académie des Arts, nous trouvant ici, à Athènes, en présence de l’Académie des Sciences, à l’époque de la technique scientifique, que pouvons-nous méditer d’autre que ce monde qui jadis, pour que commencent les arts de l’Europe occidentale et les sciences, posa les fondements ?
Ce monde est certes, pour les historiens, chose du passé. Mais pour l’histoire, si nous l’éprouvons comme ce qui nous est destiné, il demeure toujours et il demeurera toujours un présent nouveau : quelque chose qui attend de nous que nous allions en pensant à sa rencontre, et que nous mettions par-là à l’épreuve notre propre pensée et notre propre création artistique. Car le commencement d’un destin est ce qu’il y a de plus grand. Il tient d’avance tout ce qui vient après lui sous sa puissance.
Nous méditons sur la provenance de l’art en Grèce. Nous tentons de jeter un regard dans ce domaine qui, avant tout art, exerce déjà sa puissance et qui seul accorde à l’art ce qui fait de lui ce qu’il est. Nous ne recherchons pas une définition formelle de l’art, pas plus qu’il ne nous revient de disserter en historien sur l’histoire de l’origine de l’art en Grèce.
Comme nous aimerions, dans nos considérations, éviter l’arbitraire de l’inspiration, nous demandons ici, à Athènes, conseil et assistance de l’antique protectrice de la cité et de la terre attique, de la déesse Athéna. Nous ne pouvons certes pas épuiser la plénitude de sa divinité. Nous ne faisons que reconnaître ce qu’Athéna nous dit de la provenance de l’art.
Telle est la première question qui nous conduit.
La seconde s’impose d’elle-même. La voici : qu’en est-il aujourd’hui de l’art au regard de son antique provenance ?
Enfin nous méditons en troisième lieu cette question : d’où la pensée qui reconsidère aujourd’hui la provenance de l’art reçoit-elle sa destination ?
I
Homère nomme Athéna πολύμητις, la conseillère aux multiples ressources [1]. Que signifie donner conseil ? Cela veut dire : préméditer quelque chose, y pourvoir d’avance et par là faire qu’elle réussisse. De ce fait Athéna règne partout où les hommes produisent quelque chose, mettent au jour quelque chose, la mènent à bonne fin, mettent en œuvre, agissent et font. C’est ainsi qu’Athéna est l’amie qui conseille et qui aide Hercule dans ses exploits. On voit apparaître la déesse sur la métope d’Atlas du temple de Zeus à Olympie : invisible encore dans sa toute proche assistance, et en même temps éloignée de toute la haute distance de sa divinité. Athéna dispense ses conseils tout particuliers aux hommes qui produisent des outils, des vases et des joyaux. Tout homme qui est habile à produire, qui connaît son affaire, qui maîtrise son métier est un τεχνηίτης. Nous comprenons ce terme dans un sens beaucoup trop étroit quand nous le traduisons par artisan. Même ceux qui érigent des monuments et font des sculptures s’appellent des technitaï. Ils s’appellent ainsi parce que leur action qui donne la mesure est dirigée par une compréhension qui porte le nom de τέχνη. Ce mot nomme une forme de savoir. Il ne signifie pas le travail et la fabrication. Mais savoir veut dire : avoir en vue dès l’abord ce qui est en jeu dans la production d’une image et d’une œuvre. L’œuvre peut être aussi bien une œuvre, de science ou de philosophie, de poésie ou d’éloquence. L’art est τέχνη, mais non pas technique. L’artiste est τεχνηίτης, mais pas plus technicien qu’artisan.
Parce que l’art, comme τέχνη, repose dans un savoir, parce qu’un tel savoir est un regard préalable dans ce qui montre la forme et donne la mesure, mais qui est encore l’invisible, et qui doit d’abord être porté dans la visibilité et la perceptibilité de l’œuvre, pour ces raisons un tel regard préalable dans ce qui jusqu’ici n’a pas encore été donné à voir requiert singulièrement la vision et la clarté.
Ce regard préalable qui porte l’art a besoin de l’illumination. D’où pourrait-elle être accordée à l’art, sinon de la part de la déesse qui, comme πολύμητις, comme la conseillère aux multiples ressources, est en même temps γλαυκηπις ? L’adjectif γλαυκός désigne l’éclat rayonnant de la mer, des astres, de la lune, mais aussi le chatoiement de l’olivier. L’œil d’Athéna est l’œil qui éclaire et resplendit. C’est pourquoi lui appartient, comme un signe de ce qu’elle est, la chouette, ή γλαύζ. Son œil n’a pas seulement l’ardeur de la braise, il traverse aussi la nuit et rend visible ce qui serait, autrement, l’invisible.
C’est pourquoi Pindare, dans la septième Olympique, qui célèbre l’île de Rhodes et ses habitants, dit :
« αύτα δέ σφισιν ώπασε τέχναν
πάσαν έπιχθονιων Γλακώπις άριστοπόνοις κρατείν » (Olympiques, VII, 50 sq.)
« Et la déesse même aux yeux clairs leur fit don
De passer en tout art ceux qui hantent la terre
Grâce à leurs mains qui sont au labeur sans égales »
Nous devons toutefois poser une question plus précise encore : ce regard de la déesse Athéna, ce regard qui porte conseil et illumine, vers quoi est-il dirigé ?
Pour trouver la réponse, rendons-nous présent le relief sacré du musée de l’Acropole. Sur lui Athéna apparaît comme la σκεπτομένη, celle qui médite. Vers quoi le regard méditatif de la déesse est-il tourné ? Vers la borne, vers la limite. La limite n’est certes pas seulement le contour et le cadre, n’est pas seulement le lieu où quelque chose s’arrête. La limite signifie ce par quoi quelque chose est rassemblée dans ce qu’elle a de propre, pour apparaître par là dans toute sa plénitude, pour venir à la présence. En méditant sur la limite, Athéna a déjà en vue ce vers quoi l’action humaine doit tout d’abord regarder pour pouvoir porter ce qu’elle y a vu dans la visibilité d’une œuvre. Plus encore : le regard méditatif de la déesse ne pénètre pas seulement la forme invisible des œuvres possibles des hommes. Le regard d’Athéna se pose avant tout déjà sur ce qui de soi-même laisse paraître dans le sceau de leur présence les choses qui n’ont pas à être produites par l’homme. Cela, les Grecs le nomment de toute antiquité la φύσις. La traduction romaine du mot φύσις par natura et enfin, à partir d’elle, le concept de la nature devenu dominant dans la pensée de l’Europe occidentale dissimulent complètement le sens de ce que φύσις désigne : ce qui paraît de soi-même dans la limite qui est à chaque fois la sienne, et qui a dans cette limite son séjour.
Ce que la φύσις a de mystérieux, nous pouvons aujourd’hui encore en faire l’épreuve en Grèce — et seulement ici, à cet instant où d’une façon à la fois bouleversante et retenue apparaissent une montagne, une île, une plage, un olivier. On entend dire que cela tient au caractère unique de la lumière. Cela n’est pas faux, mais reste seulement superficiel. On néglige de considérer d’où cette lumière exceptionnelle est donnée, à quoi elle appartient dans son être. Ce n’est qu’ici, en Grèce, où le tout du monde s’est adressé à l’homme en tant que φύσις et a jeté sur l’homme son dévolu, que la perception et l’action humaines pouvaient et devaient correspondre à un tel dévolu : l’homme était par là d’emblée forcé de porter lui-même, par son propre pouvoir, à la présence, ce qui devait comme œuvre laisser apparaître un monde jusque-là non encore apparu.
L’art répond à la φύσις, et n’est pourtant pas une copie ni une imitation de ce qui est déjà présent. C’est mystérieusement que φύσις et τέχνη s’appartiennent l’une à l’autre. Mais l’élément dans lequel φύσις et τέχνη s’appartiennent l’une à l’autre, et le domaine dans lequel l’art doit s’introduire pour pouvoir, en tant qu’art, devenir ce qu’il est, cet élément et ce domaine demeurent à couvert.
Dès l’aube de la Grèce, poètes et penseurs ont certes touché ce mystère. La clarté, qui à tout ce qui est présent fait don de sa présence, c’est dans l’éclair qu’elle montre sa maîtrise rassemblée en se faisant connaître tout soudain.
Héraclite dit : « τὰ δὲ πάντα οἰακίζει κεραυνός (B 64) », « c’est l’éclair qui gouverne tout ». Cela signifie : l’apparaître de ce qui de soi-même est présent dans son sceau, c’est l’éclair qui d’un seul coup le conduit et le gouverne.
III
Vers quoi notre question est-elle à présent dirigée ? Est-ce vers la région d’où provient pour l’art d’aujourd’hui l’exigence ? Cette région est-elle le monde cybernétique de la société industrielle qui se planifie par la futurologie ? Si ce monde de la civilisation mondiale doit être la région qui soumet l’art à son exigence, nous avons bien, par les indications qui précèdent, pris connaissance de cette région. Seulement cette prise de connaissance n’est pas encore une compréhension par la connaissance de ce qui domine de part en part ce monde comme tel. Nous devons repenser ce qui domine le monde moderne pour pouvoir jeter un regard dans cette région d’où l’art provient et que nous recherchons. Le caractère fondamental du projet cybernétique du monde est la circularité de la régulation, dans laquelle la rétroaction des informations a son cours. Le plus large circuit de régulation inclut le rapport mutuel de l’homme et du monde. Qu’est-ce qui règne dans une telle inclusion ? Les rapports de l’homme au monde, et, avec eux, la totalité de l’existence sociale de l’homme sont enclos dans le domaine où la science cybernétique exerce sa maîtrise.
Cette même inclusion, c’est-à-dire cette même captivité, se montre dans la futurologie. De quelle sorte est en effet l’avenir qui doit être exploré, d’une façon rigoureusement méthodique, par la futurologie ? L’avenir est représenté comme ce qui revient à l’homme. La teneur de ce qui revient à l’homme n’est certes pas épuisée nécessairement par ce qui est pris en compte du présent et pour le présent. L’avenir exploré par la futurologie n’est rien d’autre qu’un présent prolongé. L’homme reste enclos dans le cercle des possibilités calculées par lui et pour lui.
Et la société industrielle ? Elle est la subjectivité qui s’établit sur elle-même. C’est à ce sujet que tous les objets sont ordonnés. La société industrielle s’est enflée jusqu’à faire de soi la norme inconditionnée de toute objectivité. Il se découvre donc que la société industrielle existe sur le fondement de l’inclusion dans l’ensemble de ses propres puissances.
Qu’en est-il de l’art au sein de la société industrielle, dont le monde commence de devenir cybernétique ? Les énoncés de l’art deviennent-ils une sorte d’information dans ce monde et pour lui ? Ses productions seront-elles par là destinées à satisfaire au caractère de processus du circuit de régulation industriel, et à sa possibilité permanente d’accomplissement ? L’œuvre peut-elle, s’il en est ainsi, demeurer encore une œuvre ? Son sens moderne n’est-il pas que dès le départ elle soit déjà dépassée au profit de l’accomplissement progressif du procès de création, qui ne se règle qu’à partir de soi-même et ainsi demeure enclos en soi-même ? L’art moderne n’apparaît-il pas comme une rétroaction des informations dans le circuit de régulation de la société industrielle et du monde technico-scientifique ? A partir de là, les « affaires culturelles », dont on parle tant, ne reçoivent-elles pas leur légitime fondation ?
Ces questions, en tant que questions, nous obsèdent. Elles se rassemblent toutes en une question unique, qui est :
Qu’en est-il de l’inclusion de l’homme dans son monde technico-scientifique ? Dans cet être enclos, ne serait-ce pas une clôture qui règne, une fermeture de l’homme à ce qui d’abord adresse l’homme à la destination qui lui est propre, pour qu’il s’introduise dans l’adresse, au lieu de disposer par ses calculs, techniquement et scientifiquement, de lui-même et de son monde, de lui-même et de son autoproduction technique ? [L’espérance, si elle peut être en général un principe, n’est-elle pas l’égoïsme inconditionné de la subjectivité humaine ?]
Mais l’homme de la civilisation mondiale peut-il de lui-même faire une percée dans cette clôture qui le ferme au destin ? Certainement pas selon les voies et avec les moyens de sa planification et de sa production scientifique et technique. L’homme peut-il en effet se faire fort, en général, de vouloir briser cette clôture face au destin ? Ce serait de la démesure. Cette clôture ne peut jamais être brisée par l’homme. Mais elle ne peut non plus s’ouvrir sans la participation de l’homme. De quelle sorte est cette ouverture ? Que peut faire l’homme pour la préparer ? La première chose à faire est, présumons-le, de ne pas esquiver les questions énoncées. Nécessaire est de les reconsidérer par la pensée. Nécessaire est tout d’abord de penser cette clôture comme telle, c’est-à-dire de repenser ce qui règne en elle. Sans doute il ne s’agit pas, de ce fait, de percer la clôture. Nécessaire demeure l’intuition qu’une telle pensée n’est pas un simple prélude à l’action, mais constitue l’action décisive elle-même, par laquelle le rapport de l’homme au monde en général peut seulement commencer à se modifier. Nécessaire est que nous nous pensions en nous libérant d’une distinction entre théorie et pratique qui est depuis longtemps insuffisante. Nécessaire demeure l’intuition qu’une telle pensée n’est pas un acte que nous ne faisons que de notre propre chef ; bien loin de là, elle ne peut être osée que sur ce mode : que la pensée s’engage dans la région d’où la civilisation mondiale aujourd’hui devenue planétaire a pris son commencement.
Nécessaire est de faire le pas en arrière. En arrière, vers où ? En arrière vers le commencement qui s’annonçait à nous lorsque nous en référions à la déesse Athéna. Mais ce pas en arrière ne veut pas dire qu’il faudrait d’une façon ou d’une autre faire revivre le monde de la Grèce antique et que la pensée devrait chercher son refuge auprès des philosophes présocratiques.
Pas en arrière veut dire que la pensée recule devant la civilisation mondiale et, en prenant ses distances vis-à-vis d’elle, nullement en la niant, s’introduit dans ce qui devait demeurer encore impensé au commencement de la pensée occidentale, mais qui y est également déjà nommé, et ainsi dit par avance à notre pensée.
Plus encore — la méditation que nous venons de tenter avait déjà en vue cet impensé, sans l’expliquer en propre. Par le renvoi à Athéna, la conseillère aux multiples ressources, et qui de son clair regard médite la limite, nous avons été rendus attentifs aux montagnes, aux îles, aux formes et aux figures qui apparaissent à partir de leur délimitation, à l’appartenance mutuelle de la φύσις et de la τέχνη, à la présence unique des choses dans cette lumière fameuse.
Méditons encore ceci de façon plus réfléchie : la lumière ne peut éclairer ce qui est présent que si ce qui est présent est déjà éclos dans une ouverture et un dégagement, et de ce fait peut déjà s’étendre. Cette ouverture est certes éclairée par la lumière, mais en aucune façon elle n’est produite et formée par elle. Car même l’obscur a besoin de cette ouverture, sans quoi nous ne pourrions pas avancer à travers l’obscurité et nous frayer un chemin à travers elle.
Aucun espace ne pourrait donner aux choses l’espace de leur lieu et de leur ordonnance, aucun temps ne pourrait donner le temps de l’heure et de l’année au naître et au mourir, c’est-à-dire leur donner leur extension et leur durée, si n’était déjà accordée à l’espace et au temps, à leur mutuelle appartenance, l’ouverture qui les traverse de sa puissance.
La langue des Grecs nomme ce don de liberté qui seul accorde tout ce qui est ouvert 1’’A -λήθεια, l’être à découvert. Elle n’écarte pas l’être à couvert. Cela se produit si peu que la mise à découvert a sans cesse besoin de la mise à couvert.
Héraclite déjà se dirige vers ce rapport dans sa parole :
« Φύσις κρύπτεσθαι φιλεί » (B 123)
« A ce qui de soi-même paraît, il appartient en propre de se mettre à couvert ».
Le secret de la fameuse lumière grecque réside dans l’être à découvert, dans la dé-couverte qui règne en elle. Elle appartient au couvert et elle se met elle-même à couvert, mais de telle façon que, grâce à ce retrait de soi, elle laisse aux choses leur séjour, qui apparaît à partir de la délimitation. Et si régnait un lien à peine pressenti entre la fermeture vis-à-vis du destin et l’être à découvert qui est encore impensé, qui se retire encore ? La clôture devant le destin est-elle la réserve, qui dure depuis long- temps, de l’être à découvert ? Et si le signe qui nous introduit au secret de 1’’A -λήθεια encore impensée nous introduisait en même temps dans la région d’où provient l’art ? Est-ce de cette région que vient l’exigence de la production des œuvres ? L’oeuvre, en tant qu’oeuvre, ne doit-elle pas faire signe vers ce qui n’est pas disponible pour l’homme, vers ce qui se met à couvert, pour que l’œuvre ne dise pas seulement ce qu’on sait déjà, connaît déjà, pratique déjà ? Ne faut-il pas que l’œuvre de l’art fasse silence sur ce qui se met à couvert, sur ce qui, en tant que se couvrant, réveille en l’homme la pudeur devant ce qui ne se laisse ni planifier ni diriger, ni calculer ni faire ?
Sera-t-il encore donné en partage à l’homme de cette terre de trouver, demeurant en elle, un séjour au monde, c’est-à-dire un habiter, qui soit déterminé par la voix de l’être à découvert se couvrant ?
Nous ne le savons pas. Mais nous savons que 1’’A -λήθεια qui se met à couvert dans la lumière grecque et qui accorde d’emblée la lumière est plus ancienne, plus originelle, et par là plus durable que toute œuvre ou figure imaginée par l’homme et oeuvrée de main d’homme.
Mais nous savons aussi que l’être à découvert se couvrant demeure l’inapparent et le presque rien pour un monde où l’astronautique et la physique nucléaire établissent les normes courantes.
Vers quoi notre question est-elle à présent dirigée ? Est-ce vers la région d’où provient pour l’art d’aujourd’hui l’exigence ? Cette région est-elle le monde cybernétique de la société industrielle qui se planifie par la futurologie ? Si ce monde de la civilisation mondiale doit être la région qui soumet l’art à son exigence, nous avons bien, par les indications qui précèdent, pris connaissance de cette région. Seulement cette prise de connaissance n’est pas encore une compréhension par la connaissance de ce qui domine de part en part ce monde comme tel. Nous devons repenser ce qui domine le monde moderne pour pouvoir jeter un regard dans cette région d’où l’art provient et que nous recherchons. Le caractère fondamental du projet cybernétique du monde est la circularité de la régulation, dans laquelle la rétroaction des informations a son cours. Le plus large circuit de régulation inclut le rapport mutuel de l’homme et du monde. Qu’est-ce qui règne dans une telle inclusion ? Les rapports de l’homme au monde, et, avec eux, la totalité de l’existence sociale de l’homme sont enclos dans le domaine où la science cybernétique exerce sa maîtrise.
Cette même inclusion, c’est-à-dire cette même captivité, se montre dans la futurologie. De quelle sorte est en effet l’avenir qui doit être exploré, d’une façon rigoureusement méthodique, par la futurologie ? L’avenir est représenté comme ce qui revient à l’homme. La teneur de ce qui revient à l’homme n’est certes pas épuisée nécessairement par ce qui est pris en compte du présent et pour le présent. L’avenir exploré par la futurologie n’est rien d’autre qu’un présent prolongé. L’homme reste enclos dans le cercle des possibilités calculées par lui et pour lui.
Et la société industrielle ? Elle est la subjectivité qui s’établit sur elle-même. C’est à ce sujet que tous les objets sont ordonnés. La société industrielle s’est enflée jusqu’à faire de soi la norme inconditionnée de toute objectivité. Il se découvre donc que la société industrielle existe sur le fondement de l’inclusion dans l’ensemble de ses propres puissances.
Qu’en est-il de l’art au sein de la société industrielle, dont le monde commence de devenir cybernétique ? Les énoncés de l’art deviennent-ils une sorte d’information dans ce monde et pour lui ? Ses productions seront-elles par là destinées à satisfaire au caractère de processus du circuit de régulation industriel, et à sa possibilité permanente d’accomplissement ? L’œuvre peut-elle, s’il en est ainsi, demeurer encore une œuvre ? Son sens moderne n’est-il pas que dès le départ elle soit déjà dépassée au profit de l’accomplissement progressif du procès de création, qui ne se règle qu’à partir de soi-même et ainsi demeure enclos en soi-même ? L’art moderne n’apparaît-il pas comme une rétroaction des informations dans le circuit de régulation de la société industrielle et du monde technico-scientifique ? A partir de là, les « affaires culturelles », dont on parle tant, ne reçoivent-elles pas leur légitime fondation ?
Ces questions, en tant que questions, nous obsèdent. Elles se rassemblent toutes en une question unique, qui est :
Qu’en est-il de l’inclusion de l’homme dans son monde technico-scientifique ? Dans cet être enclos, ne serait-ce pas une clôture qui règne, une fermeture de l’homme à ce qui d’abord adresse l’homme à la destination qui lui est propre, pour qu’il s’introduise dans l’adresse, au lieu de disposer par ses calculs, techniquement et scientifiquement, de lui-même et de son monde, de lui-même et de son autoproduction technique ? [L’espérance, si elle peut être en général un principe, n’est-elle pas l’égoïsme inconditionné de la subjectivité humaine ?]
Mais l’homme de la civilisation mondiale peut-il de lui-même faire une percée dans cette clôture qui le ferme au destin ? Certainement pas selon les voies et avec les moyens de sa planification et de sa production scientifique et technique. L’homme peut-il en effet se faire fort, en général, de vouloir briser cette clôture face au destin ? Ce serait de la démesure. Cette clôture ne peut jamais être brisée par l’homme. Mais elle ne peut non plus s’ouvrir sans la participation de l’homme. De quelle sorte est cette ouverture ? Que peut faire l’homme pour la préparer ? La première chose à faire est, présumons-le, de ne pas esquiver les questions énoncées. Nécessaire est de les reconsidérer par la pensée. Nécessaire est tout d’abord de penser cette clôture comme telle, c’est-à-dire de repenser ce qui règne en elle. Sans doute il ne s’agit pas, de ce fait, de percer la clôture. Nécessaire demeure l’intuition qu’une telle pensée n’est pas un simple prélude à l’action, mais constitue l’action décisive elle-même, par laquelle le rapport de l’homme au monde en général peut seulement commencer à se modifier. Nécessaire est que nous nous pensions en nous libérant d’une distinction entre théorie et pratique qui est depuis longtemps insuffisante. Nécessaire demeure l’intuition qu’une telle pensée n’est pas un acte que nous ne faisons que de notre propre chef ; bien loin de là, elle ne peut être osée que sur ce mode : que la pensée s’engage dans la région d’où la civilisation mondiale aujourd’hui devenue planétaire a pris son commencement.
Nécessaire est de faire le pas en arrière. En arrière, vers où ? En arrière vers le commencement qui s’annonçait à nous lorsque nous en référions à la déesse Athéna. Mais ce pas en arrière ne veut pas dire qu’il faudrait d’une façon ou d’une autre faire revivre le monde de la Grèce antique et que la pensée devrait chercher son refuge auprès des philosophes présocratiques.
Pas en arrière veut dire que la pensée recule devant la civilisation mondiale et, en prenant ses distances vis-à-vis d’elle, nullement en la niant, s’introduit dans ce qui devait demeurer encore impensé au commencement de la pensée occidentale, mais qui y est également déjà nommé, et ainsi dit par avance à notre pensée.
Plus encore — la méditation que nous venons de tenter avait déjà en vue cet impensé, sans l’expliquer en propre. Par le renvoi à Athéna, la conseillère aux multiples ressources, et qui de son clair regard médite la limite, nous avons été rendus attentifs aux montagnes, aux îles, aux formes et aux figures qui apparaissent à partir de leur délimitation, à l’appartenance mutuelle de la φύσις et de la τέχνη, à la présence unique des choses dans cette lumière fameuse.
Méditons encore ceci de façon plus réfléchie : la lumière ne peut éclairer ce qui est présent que si ce qui est présent est déjà éclos dans une ouverture et un dégagement, et de ce fait peut déjà s’étendre. Cette ouverture est certes éclairée par la lumière, mais en aucune façon elle n’est produite et formée par elle. Car même l’obscur a besoin de cette ouverture, sans quoi nous ne pourrions pas avancer à travers l’obscurité et nous frayer un chemin à travers elle.
Aucun espace ne pourrait donner aux choses l’espace de leur lieu et de leur ordonnance, aucun temps ne pourrait donner le temps de l’heure et de l’année au naître et au mourir, c’est-à-dire leur donner leur extension et leur durée, si n’était déjà accordée à l’espace et au temps, à leur mutuelle appartenance, l’ouverture qui les traverse de sa puissance.
La langue des Grecs nomme ce don de liberté qui seul accorde tout ce qui est ouvert 1’’A -λήθεια, l’être à découvert. Elle n’écarte pas l’être à couvert. Cela se produit si peu que la mise à découvert a sans cesse besoin de la mise à couvert.
Héraclite déjà se dirige vers ce rapport dans sa parole :
« Φύσις κρύπτεσθαι φιλεί » (B 123)
« A ce qui de soi-même paraît, il appartient en propre de se mettre à couvert ».
Le secret de la fameuse lumière grecque réside dans l’être à découvert, dans la dé-couverte qui règne en elle. Elle appartient au couvert et elle se met elle-même à couvert, mais de telle façon que, grâce à ce retrait de soi, elle laisse aux choses leur séjour, qui apparaît à partir de la délimitation. Et si régnait un lien à peine pressenti entre la fermeture vis-à-vis du destin et l’être à découvert qui est encore impensé, qui se retire encore ? La clôture devant le destin est-elle la réserve, qui dure depuis long- temps, de l’être à découvert ? Et si le signe qui nous introduit au secret de 1’’A -λήθεια encore impensée nous introduisait en même temps dans la région d’où provient l’art ? Est-ce de cette région que vient l’exigence de la production des œuvres ? L’oeuvre, en tant qu’oeuvre, ne doit-elle pas faire signe vers ce qui n’est pas disponible pour l’homme, vers ce qui se met à couvert, pour que l’œuvre ne dise pas seulement ce qu’on sait déjà, connaît déjà, pratique déjà ? Ne faut-il pas que l’œuvre de l’art fasse silence sur ce qui se met à couvert, sur ce qui, en tant que se couvrant, réveille en l’homme la pudeur devant ce qui ne se laisse ni planifier ni diriger, ni calculer ni faire ?
Sera-t-il encore donné en partage à l’homme de cette terre de trouver, demeurant en elle, un séjour au monde, c’est-à-dire un habiter, qui soit déterminé par la voix de l’être à découvert se couvrant ?
Nous ne le savons pas. Mais nous savons que 1’’A -λήθεια qui se met à couvert dans la lumière grecque et qui accorde d’emblée la lumière est plus ancienne, plus originelle, et par là plus durable que toute œuvre ou figure imaginée par l’homme et oeuvrée de main d’homme.
Mais nous savons aussi que l’être à découvert se couvrant demeure l’inapparent et le presque rien pour un monde où l’astronautique et la physique nucléaire établissent les normes courantes.
Question : Trotsky avait parlé, lui, de « militarisation du travail », ce qui ne rend pas pour autant votre livre de 1932 acceptable pour un marxiste. Der Arbeiter a été violemment critiqué par Lukacs...
Ernst Jünger : Lukacs, que j’ai bien connu, a écrit ce qui correspondait aux vues de son idéologie et de son parti. Je ne suis pas antimarxiste. Au point de vue économique, Marx a mis en lumière des choses parfaitement exactes. Son analyse est une étape sur le chemin de mon « Travailleur ». En ce sens, Marx peut entrer dans mon propre système, mais moi je ne passe pas dans le sien, c’est toute la différence et elle est essentielle. Pour moi, Marx a mutilé Hegel en enfermant celui-ci, en le réduisant à une conception du monde trop rationnelle et économique... Et ce que j’ai voulu, au fond, réintroduire dans le Travailleur, c’est ce que Marx lui a enlevé, notamment ce que j’appellerai Weltgeist. Dans son époque, Marx n’est certes pas le seul à aller dans ce sens. Pensez à Darwin par exemple. Vous savez qu’il y a des botanistes tels que Fechner qui ont sur les plantes un regard quasiment mystique. Darwin, dans sa représentation de l’évolution, lui aussi, efface une dimension, retire, enlève quelque chose d’essentiel : il y a trop de temps dans sa conception. Il ne suffit pas d’introduire le temps, il faut aussi savoir l’extraire ! Et c’est sans doute pour éviter sur tous ces points de nombreux malentendus que j’ai toujours refusé de laisser rééditer ou traduire mon livre.
(...)
Question : La division systématique entre « droite » et « gauche » vous reste, disiez-vous, étrangère...
Ernst Jünger: Je ne l’accepte pas. Je pense que l’homme est un tout et lorsque quelqu’un me dit « je suis de droite » ou « je suis de gauche », j’ai l’impression qu’il se présente à moi comme une moitié d’homme ! Et c’est sans intérêt. Je travaille à la fois avec ma main droite et ma main gauche, mes deux hémisphères cérébraux, et il me paraît nécessaire que tout cela s’harmonise. On m’a parfois demandé ce que je pense de la démocratie... mais ce n’est qu’un mot : il y a cent démocraties !... Je me demande plutôt, dans tel ou tel cas, quel est l’homme qui la gouverne et comment il le fait. Lors d’un banquet des sept sages de la Grèce, l’un d’eux a dit : « La meilleure démocratie est celle qui ressemble le plus à la monarchie et la meilleure monarchie est celle qui se rapproche le plus de la démocratie. » Je crois même que c’est Solon qui a dit cela. Et, pour moi, il en va ainsi de la droite et de la gauche. Je trouve, par exemple, très positive l’action d’hommes de gauche arrivant au pouvoir et adoptant ensuite quelques idées conservatrices...
Pour finir, je vous dirai ceci : Heidegger, il est impossible de le situer « à droite » ou « à gauche ». Il faudrait plutôt le situer en termes de hauteur ou de profondeur !... (pp. 149-150)
Ernst Jünger : Lukacs, que j’ai bien connu, a écrit ce qui correspondait aux vues de son idéologie et de son parti. Je ne suis pas antimarxiste. Au point de vue économique, Marx a mis en lumière des choses parfaitement exactes. Son analyse est une étape sur le chemin de mon « Travailleur ». En ce sens, Marx peut entrer dans mon propre système, mais moi je ne passe pas dans le sien, c’est toute la différence et elle est essentielle. Pour moi, Marx a mutilé Hegel en enfermant celui-ci, en le réduisant à une conception du monde trop rationnelle et économique... Et ce que j’ai voulu, au fond, réintroduire dans le Travailleur, c’est ce que Marx lui a enlevé, notamment ce que j’appellerai Weltgeist. Dans son époque, Marx n’est certes pas le seul à aller dans ce sens. Pensez à Darwin par exemple. Vous savez qu’il y a des botanistes tels que Fechner qui ont sur les plantes un regard quasiment mystique. Darwin, dans sa représentation de l’évolution, lui aussi, efface une dimension, retire, enlève quelque chose d’essentiel : il y a trop de temps dans sa conception. Il ne suffit pas d’introduire le temps, il faut aussi savoir l’extraire ! Et c’est sans doute pour éviter sur tous ces points de nombreux malentendus que j’ai toujours refusé de laisser rééditer ou traduire mon livre.
(...)
Question : La division systématique entre « droite » et « gauche » vous reste, disiez-vous, étrangère...
Ernst Jünger: Je ne l’accepte pas. Je pense que l’homme est un tout et lorsque quelqu’un me dit « je suis de droite » ou « je suis de gauche », j’ai l’impression qu’il se présente à moi comme une moitié d’homme ! Et c’est sans intérêt. Je travaille à la fois avec ma main droite et ma main gauche, mes deux hémisphères cérébraux, et il me paraît nécessaire que tout cela s’harmonise. On m’a parfois demandé ce que je pense de la démocratie... mais ce n’est qu’un mot : il y a cent démocraties !... Je me demande plutôt, dans tel ou tel cas, quel est l’homme qui la gouverne et comment il le fait. Lors d’un banquet des sept sages de la Grèce, l’un d’eux a dit : « La meilleure démocratie est celle qui ressemble le plus à la monarchie et la meilleure monarchie est celle qui se rapproche le plus de la démocratie. » Je crois même que c’est Solon qui a dit cela. Et, pour moi, il en va ainsi de la droite et de la gauche. Je trouve, par exemple, très positive l’action d’hommes de gauche arrivant au pouvoir et adoptant ensuite quelques idées conservatrices...
Pour finir, je vous dirai ceci : Heidegger, il est impossible de le situer « à droite » ou « à gauche ». Il faudrait plutôt le situer en termes de hauteur ou de profondeur !... (pp. 149-150)
Question : Votre livre Der Arbeiter « Le Travailleur », publié en 1932, a été pour Martin Heidegger une stimulation décisive et l’a conduit à poser sa « Question de la Technique ». Vous avez échangé avec lui une correspondance encore inédite. Quelles impressions vous ont laissées vos rencontres avec Heidegger ? Et comment vous apparaît aujourd’hui son « chemin de pensée » ?
Ernst Jünger : J’ai été d’autant plus étonné, après la Deuxième Guerre mondiale, par l’intérêt que l’œuvre de Heidegger suscitait auprès de jeunes Français, que ses textes, même pour de jeunes Allemands, étaient extrêmement difficiles à comprendre...
J’ai dit un jour à Heidegger: « Il y a dans vos écrits quelque chose qui va plus loin, plus profond que le mot, et qui le ramène ensuite à la surface : c’est comme si une force magique permettait au lecteur de comprendre ce que les mots n’ont pas explicitement dit. » Une dame m’a raconté que, étant étudiante à Fribourg, elle avait assisté un jour, vers sept heures du matin, à un cours de Heidegger et qu’elle avait été complètement fascinée; elle avait eu l’impression de tout comprendre, tout s’éclairait !
« Mais, une fois sortie de l’université ajouta-t-elle, je ne savais plus par quel chemin j’étais passée. Les phrases s’étaient effacées, j’avais tout oublié ! C’était comme si, pendant le cours, un enchanteur m’avait ensorcelée. » Sans doute parce que ce qui avait été dit était à la fois inhabituel et d’une grande force spirituelle. Chez Heidegger, la philosophie, la pensée, remonte à nouveau de la connaissance au langage, et du langage jusqu’à sa source. Heidegger – qui joue volontiers avec les assonances – transporte le langage jusqu’à ses racines, son tréfonds. C’est en ce sens qu’il me fait penser au pouvoir d’un magicien qui, pour être compris, n’a pas besoin de faire appel à votre rationalité et qui, à la limite, pourrait se passer de mots pour se faire entendre! Cette impression singulière, je l’ai ressentie moi-même à Todtnauberg, dans la petite Hütte de Heidegger, lors de ma première visite. Et Frederic-Georg, mon frère poète qui, bien avant la Deuxième Guerre mondiale me parlait souvent de lui, la partageait, comme l’éditeur Klostermann et beaucoup d’autres personnes... Heidegger avait dans le regard une force, un rayonnement intense, presque insoutenable, que je n’ai vu que dans les yeux de Picasso. Il me faisait parfois penser, avec son petit chapeau, à un lutin malicieux surgi des profondeurs de la Forêt Noire. Rares sont les êtres en qui se conjuguent de tels pouvoirs, à la fois magiques et spirituels. Et comme il prenait le temps d’écouter les autres ! Il va sans dire que cet aspect n’est qu’une facette de son œuvre immense. Il faudra peut-être plus d’un siècle pour savoir vraiment ce qu’elle nous dit d’essentiel, ce qu’elle porte vraiment au langage... Quant à la dimension proprement poétique ou magique, il faudra du temps aussi pour en comprendre vraiment les secrets et le sens... (Ernst Jünger, "Le Travailleur planétaire", pp. 145-146)
Ernst Jünger : J’ai été d’autant plus étonné, après la Deuxième Guerre mondiale, par l’intérêt que l’œuvre de Heidegger suscitait auprès de jeunes Français, que ses textes, même pour de jeunes Allemands, étaient extrêmement difficiles à comprendre...
J’ai dit un jour à Heidegger: « Il y a dans vos écrits quelque chose qui va plus loin, plus profond que le mot, et qui le ramène ensuite à la surface : c’est comme si une force magique permettait au lecteur de comprendre ce que les mots n’ont pas explicitement dit. » Une dame m’a raconté que, étant étudiante à Fribourg, elle avait assisté un jour, vers sept heures du matin, à un cours de Heidegger et qu’elle avait été complètement fascinée; elle avait eu l’impression de tout comprendre, tout s’éclairait !
« Mais, une fois sortie de l’université ajouta-t-elle, je ne savais plus par quel chemin j’étais passée. Les phrases s’étaient effacées, j’avais tout oublié ! C’était comme si, pendant le cours, un enchanteur m’avait ensorcelée. » Sans doute parce que ce qui avait été dit était à la fois inhabituel et d’une grande force spirituelle. Chez Heidegger, la philosophie, la pensée, remonte à nouveau de la connaissance au langage, et du langage jusqu’à sa source. Heidegger – qui joue volontiers avec les assonances – transporte le langage jusqu’à ses racines, son tréfonds. C’est en ce sens qu’il me fait penser au pouvoir d’un magicien qui, pour être compris, n’a pas besoin de faire appel à votre rationalité et qui, à la limite, pourrait se passer de mots pour se faire entendre! Cette impression singulière, je l’ai ressentie moi-même à Todtnauberg, dans la petite Hütte de Heidegger, lors de ma première visite. Et Frederic-Georg, mon frère poète qui, bien avant la Deuxième Guerre mondiale me parlait souvent de lui, la partageait, comme l’éditeur Klostermann et beaucoup d’autres personnes... Heidegger avait dans le regard une force, un rayonnement intense, presque insoutenable, que je n’ai vu que dans les yeux de Picasso. Il me faisait parfois penser, avec son petit chapeau, à un lutin malicieux surgi des profondeurs de la Forêt Noire. Rares sont les êtres en qui se conjuguent de tels pouvoirs, à la fois magiques et spirituels. Et comme il prenait le temps d’écouter les autres ! Il va sans dire que cet aspect n’est qu’une facette de son œuvre immense. Il faudra peut-être plus d’un siècle pour savoir vraiment ce qu’elle nous dit d’essentiel, ce qu’elle porte vraiment au langage... Quant à la dimension proprement poétique ou magique, il faudra du temps aussi pour en comprendre vraiment les secrets et le sens... (Ernst Jünger, "Le Travailleur planétaire", pp. 145-146)
Videos de Les Cahiers de l'Herne (2)
Voir plusAjouter une vidéo
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Les Cahiers de l'Herne (54)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Philo pour tous
Jostein Gaarder fut au hit-parade des écrits philosophiques rendus accessibles au plus grand nombre avec un livre paru en 1995. Lequel?
Les Mystères de la patience
Le Monde de Sophie
Maya
Vita brevis
10 questions
440 lecteurs ont répondu
Thèmes :
spiritualité
, philosophieCréer un quiz sur ce livre440 lecteurs ont répondu