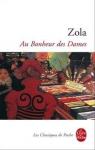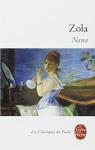Critiques filtrées sur 5 étoiles
Roman d'Émile Zola.
Veuve et nouvellement arrivée sur Paris, Hélène élève patiemment sa fille Jeanne, une enfant à la santé et à l'esprit fragiles. Amicalement accueillie et secourue par son voisin, le docteur Henri Deberle, Hélène s'éprend violemment de lui. le médecin répond à ses sentiments. Mais c'est compter sans Jeanne qui aime passionnement sa mère, au point de lui refuser tout contact avec un homme ou avec d'autres enfants. Maladivement jalouse et extraordinairement lucide, Jeanne, qui devient adolescente, ne supporte pas de voir sa mère lui échapper.
Ce tome de la série des Rougon-Macquart ne donne pas précisément envie de tomber amoureux, ni d'avoir des enfants... J'ai beaucoup aimé la scène où Hélène et Henri veillent l'enfant malade, dans le silence angoissé d'une nuit d'attente. Les crises de l'enfant m'ont passablement irritée, et les émois amoureux de la jeune maman n'ont pas davantage suscité ma bienveillance.
Ceci dit, le texte reste excellent. La narration est travaillée, la langue est riche. L'auteur m'enchante sur la forme, et tant pis pour le fond !
-----------------------------------------------------------------------------------------------
RELECTURE DE NOVEMBRE 2012
Hélène est veuve depuis quelques années et n'est occupée que du bonheur de sa fille Jeanne, une enfant à la santé et aux nerfs fragiles. « Veillez surtout à ce qu'elle mène une vie égale, heureuse, sans secousses. » (p. 22) Dans leur appartement de Passy, la mère et la fille vivent bienheureuses, sortant rarement et rencontrant peu de monde. Un soir de fièvre, Hélène fait appel à son voisin, le jeune docteur Henri Deberle. le trouble qui s'empare d'eux est d'abord timide et chaste, mais bien vite, Hélène et Henri ne peuvent plus contenir leurs sentiments. Pourtant, régulièrement reçue par Mme Deberle, Hélène prend la résolution de ne pas consommer cet amour.
« Certes, elle aimait son enfant. N'était-ce point assez, ce grand amour qui avait empli sa vie jusque-là ? Cet amour devait lui suffire, avec sa douceur et son calme, son éternité qu'aucune lassitude ne pouvait rompre. » (p. 75) Hélène, en mère dévouée, étouffe son amour adultère dans les soins qu'elle prodigue à son enfant. Mais Jeanne est à la fois la barrière et le lien entre la mère et le médecin. « Rien ne les séparait plus que cette enfant, secouée de leur passion. » (p. 185) Quand Hélène et Henri se penchent ensemble sur le lit de la petite malade, l'amour qu'ils portent à l'enfant travestit bien mal le feu qui brûle leurs deux coeurs. Et Jeanne ne s'y trompe pas : le bon ami devient un rival et l'enfant exprime une jalousie rageuse et sourde. Elle sent que sa mère lui échappe pour une passion bien différente de l'amour filial.
Le drame d'Hélène, c'est d'avoir vécu un veuvage trop calme, presque monacal. Quand le sentiment amoureux s'empare d'elle, son coeur est vierge comme celui d'une jeune fille, mais elle ne peut plus en disposer à sa guise sans blesser son enfant, si enragée d'elle. Et l'amour adulte se heurte à son devoir de mère. « Elle souffrait trop de cette lutte entre sa maternité et son amour. » (p. 187) le personnage de Jeanne me laisse perplexe. Autant la jalousie capricieuse de cette enfant choyée m'agace, autant je comprends le sentiment d'abandon qu'elle peut ressentir devant l'égoïsme amoureux de sa mère. Ce volume des Rougon-Macquart peut sembler moins violent, voire moins enlevé que d'autres, mais ici les ravages sont immenses et portent sur une enfance fragile en dévastant une innocence assoiffée d'amour.
Ce roman est le premier texte d'Émile Zola que j'ai lu, vers 13 ans, naïvement attirée par son titre. La page d'amour est belle, mais elle est cruelle et elle s'arrache par lambeaux. Ici, clairement, Zola fustige la brièveté de la passion et l'indifférence de la vie qui continue, quoi qu'il arrive.
Veuve et nouvellement arrivée sur Paris, Hélène élève patiemment sa fille Jeanne, une enfant à la santé et à l'esprit fragiles. Amicalement accueillie et secourue par son voisin, le docteur Henri Deberle, Hélène s'éprend violemment de lui. le médecin répond à ses sentiments. Mais c'est compter sans Jeanne qui aime passionnement sa mère, au point de lui refuser tout contact avec un homme ou avec d'autres enfants. Maladivement jalouse et extraordinairement lucide, Jeanne, qui devient adolescente, ne supporte pas de voir sa mère lui échapper.
Ce tome de la série des Rougon-Macquart ne donne pas précisément envie de tomber amoureux, ni d'avoir des enfants... J'ai beaucoup aimé la scène où Hélène et Henri veillent l'enfant malade, dans le silence angoissé d'une nuit d'attente. Les crises de l'enfant m'ont passablement irritée, et les émois amoureux de la jeune maman n'ont pas davantage suscité ma bienveillance.
Ceci dit, le texte reste excellent. La narration est travaillée, la langue est riche. L'auteur m'enchante sur la forme, et tant pis pour le fond !
-----------------------------------------------------------------------------------------------
RELECTURE DE NOVEMBRE 2012
Hélène est veuve depuis quelques années et n'est occupée que du bonheur de sa fille Jeanne, une enfant à la santé et aux nerfs fragiles. « Veillez surtout à ce qu'elle mène une vie égale, heureuse, sans secousses. » (p. 22) Dans leur appartement de Passy, la mère et la fille vivent bienheureuses, sortant rarement et rencontrant peu de monde. Un soir de fièvre, Hélène fait appel à son voisin, le jeune docteur Henri Deberle. le trouble qui s'empare d'eux est d'abord timide et chaste, mais bien vite, Hélène et Henri ne peuvent plus contenir leurs sentiments. Pourtant, régulièrement reçue par Mme Deberle, Hélène prend la résolution de ne pas consommer cet amour.
« Certes, elle aimait son enfant. N'était-ce point assez, ce grand amour qui avait empli sa vie jusque-là ? Cet amour devait lui suffire, avec sa douceur et son calme, son éternité qu'aucune lassitude ne pouvait rompre. » (p. 75) Hélène, en mère dévouée, étouffe son amour adultère dans les soins qu'elle prodigue à son enfant. Mais Jeanne est à la fois la barrière et le lien entre la mère et le médecin. « Rien ne les séparait plus que cette enfant, secouée de leur passion. » (p. 185) Quand Hélène et Henri se penchent ensemble sur le lit de la petite malade, l'amour qu'ils portent à l'enfant travestit bien mal le feu qui brûle leurs deux coeurs. Et Jeanne ne s'y trompe pas : le bon ami devient un rival et l'enfant exprime une jalousie rageuse et sourde. Elle sent que sa mère lui échappe pour une passion bien différente de l'amour filial.
Le drame d'Hélène, c'est d'avoir vécu un veuvage trop calme, presque monacal. Quand le sentiment amoureux s'empare d'elle, son coeur est vierge comme celui d'une jeune fille, mais elle ne peut plus en disposer à sa guise sans blesser son enfant, si enragée d'elle. Et l'amour adulte se heurte à son devoir de mère. « Elle souffrait trop de cette lutte entre sa maternité et son amour. » (p. 187) le personnage de Jeanne me laisse perplexe. Autant la jalousie capricieuse de cette enfant choyée m'agace, autant je comprends le sentiment d'abandon qu'elle peut ressentir devant l'égoïsme amoureux de sa mère. Ce volume des Rougon-Macquart peut sembler moins violent, voire moins enlevé que d'autres, mais ici les ravages sont immenses et portent sur une enfance fragile en dévastant une innocence assoiffée d'amour.
Ce roman est le premier texte d'Émile Zola que j'ai lu, vers 13 ans, naïvement attirée par son titre. La page d'amour est belle, mais elle est cruelle et elle s'arrache par lambeaux. Ici, clairement, Zola fustige la brièveté de la passion et l'indifférence de la vie qui continue, quoi qu'il arrive.
Après une petite interruption de quelques mois, je poursuis ma découverte/lecture dans l'ordre des Rougon-Macquart, et le plaisir est toujours aussi grand !
Après le lourd et magistral Assommoir, ici Zola nous offre une sorte de pause comme il l'indique dans sa préface, une pause dans laquelle j'ai aimé me plonger tel un nid douillet.
Dans Une page d'amour c'est la famille Mouret que l'on retrouve, Hélène plus précisément ; fille d'Ursule et du chapelier Mouret, soeur de Silvère et François, tante d'Octave et de Serge. Pour ceux qui ont vu mes critiques précédentes vous savez peut-être déjà que c'est une famille que j'aime particulièrement et qui m'émeut beaucoup, alors j'ai été ravie d'en découvrir une autre membre !
Hélène est veuve et mère de la petite Jeanne qu'elle élève seule, toutes deux habitent à Paris près de Passy et mènent une vie quasi paisible. Mais malheureusement la petite Jeanne a hérité de la Tante Dide ses crises et sa santé fragile... Un soir Hélène fait appel à un médecin de leur voisinage, le docteur Deberle, qui soignera la fillette. Une alchimie étrange opère entre les deux adultes et dès lors Hélène et sa fille sympathiseront avec la famille du médecin, son épouse et leur entourage. C'est donc le quotidien de ce petit groupe que l'on va suivre, un quotidien fait de discussions, de promenades dans les jardins, de petits diners intimes, etc.
Mais l'élément central qui rythme la vie d'Hélène et du groupe c'est Jeanne et sa santé précaire. Seulement Jeanne, en plus d'être malade est aussi extrêmement possessive envers sa mère, à un point où elle l'étouffe et l'empêche de vivre pleinement.
Je dois avouer que, malgré la compassion qu'elle suscité, Jeanne m'a aussi beaucoup agacé. Hélène porte un amour inconditionnel envers sa fille ce qui est bien sûr admirable et touchant, mais j'aurais aimé qu'elle s'affirme davantage, qu'elle se laisse moins dominer par l'intransigeance de sa fille. Hélène est une femme douce et bienveillante, à laquelle je me suis attachée, mais malheureusement, et c'est là un autre héritage de la tante Dide ; elle s'est souvent laissé porter par les évènement extérieurs par manque d'une volonté fixe. Néanmoins, et fort heureusement, au fil du temps (sans trop en dévoiler) elle réussira à vivre de plus en plus par elle même, malheureusement non sans conséquences...
Ce roman c'est aussi une plongée visuelle. Les cinq tableaux ponctuant la fin de chacun des cinq chapitres sont absolument grandioses. Une peinture de l'ouest parisien à différents moments climatiques, allant de pair avec les états-d'âmes de nos deux héroïnes, donnent à eux seuls une incroyable profondeur au roman.
Notre cher Emile réussit encore une fois à nous livrer une oeuvre unique et superbe. Ce tome est certes une parenthèse, il est, des mots de l'auteur, "bien pâle" surtout en comparaison des deux mastodontes qui le précèdent et le succèdent. Mais il ne déroge absolument pas, selon moi, aux standards des précédents. Et comme il l'a également signifié "je veux dans ma série toutes les notes", clairement Zola réussit encore à créer un univers nouveau, une atmosphère nouvelle. Celle l'ouest Parisien, d'une vie de lenteur, d'amour et d'oisiveté. Celle d'une relation mère/fille pour le moins singulière mais très forte et très vive. Bref, tout est réussi.
Encore une fois j'ai adoré !
Et maintenant j'ai hâte de retrouver la petite Nana devenue grande !
Après le lourd et magistral Assommoir, ici Zola nous offre une sorte de pause comme il l'indique dans sa préface, une pause dans laquelle j'ai aimé me plonger tel un nid douillet.
Dans Une page d'amour c'est la famille Mouret que l'on retrouve, Hélène plus précisément ; fille d'Ursule et du chapelier Mouret, soeur de Silvère et François, tante d'Octave et de Serge. Pour ceux qui ont vu mes critiques précédentes vous savez peut-être déjà que c'est une famille que j'aime particulièrement et qui m'émeut beaucoup, alors j'ai été ravie d'en découvrir une autre membre !
Hélène est veuve et mère de la petite Jeanne qu'elle élève seule, toutes deux habitent à Paris près de Passy et mènent une vie quasi paisible. Mais malheureusement la petite Jeanne a hérité de la Tante Dide ses crises et sa santé fragile... Un soir Hélène fait appel à un médecin de leur voisinage, le docteur Deberle, qui soignera la fillette. Une alchimie étrange opère entre les deux adultes et dès lors Hélène et sa fille sympathiseront avec la famille du médecin, son épouse et leur entourage. C'est donc le quotidien de ce petit groupe que l'on va suivre, un quotidien fait de discussions, de promenades dans les jardins, de petits diners intimes, etc.
Mais l'élément central qui rythme la vie d'Hélène et du groupe c'est Jeanne et sa santé précaire. Seulement Jeanne, en plus d'être malade est aussi extrêmement possessive envers sa mère, à un point où elle l'étouffe et l'empêche de vivre pleinement.
Je dois avouer que, malgré la compassion qu'elle suscité, Jeanne m'a aussi beaucoup agacé. Hélène porte un amour inconditionnel envers sa fille ce qui est bien sûr admirable et touchant, mais j'aurais aimé qu'elle s'affirme davantage, qu'elle se laisse moins dominer par l'intransigeance de sa fille. Hélène est une femme douce et bienveillante, à laquelle je me suis attachée, mais malheureusement, et c'est là un autre héritage de la tante Dide ; elle s'est souvent laissé porter par les évènement extérieurs par manque d'une volonté fixe. Néanmoins, et fort heureusement, au fil du temps (sans trop en dévoiler) elle réussira à vivre de plus en plus par elle même, malheureusement non sans conséquences...
Ce roman c'est aussi une plongée visuelle. Les cinq tableaux ponctuant la fin de chacun des cinq chapitres sont absolument grandioses. Une peinture de l'ouest parisien à différents moments climatiques, allant de pair avec les états-d'âmes de nos deux héroïnes, donnent à eux seuls une incroyable profondeur au roman.
Notre cher Emile réussit encore une fois à nous livrer une oeuvre unique et superbe. Ce tome est certes une parenthèse, il est, des mots de l'auteur, "bien pâle" surtout en comparaison des deux mastodontes qui le précèdent et le succèdent. Mais il ne déroge absolument pas, selon moi, aux standards des précédents. Et comme il l'a également signifié "je veux dans ma série toutes les notes", clairement Zola réussit encore à créer un univers nouveau, une atmosphère nouvelle. Celle l'ouest Parisien, d'une vie de lenteur, d'amour et d'oisiveté. Celle d'une relation mère/fille pour le moins singulière mais très forte et très vive. Bref, tout est réussi.
Encore une fois j'ai adoré !
Et maintenant j'ai hâte de retrouver la petite Nana devenue grande !
Une page d'amour est un voyage intemporel dans la complexité des sentiments et des relations humaines. L'écrivain décrit d'une manière simple, sensible et élégante les mécanismes comportementaux des individus, il analyse l'étendue du pouvoir tyrannique de l'enfant, la fugacité de la passion amoureuse, la profonde douleur de la mort et l'imparable violence des regrets et des remords.
En parallèle, l'auteur nous fait découvrir l'étendue des quartiers parisiens et la beauté de ses monuments, que le lecteur pourra admirer en se penchant à la fenêtre de l'appartement d'Hélène Grandjean, l'héroïne de son livre. Il dépeint le Paris du second Empire, d'un trait de plume coloré, il lui redonne vie à la façon d'un peintre faisant naître sous ses doigts des aquarelles aux tons chamarrés. La douce musicalité de ces tableaux vient rythmer le récit au fil des quatre saisons et adoucit un peu la tragédie des évènements de cette page d'amour derrière laquelle se cache un drame.
De la grande littérature, poétique et artistique, écrite par un romancier talentueux que l'on ne se lasse jamais de lire…
En parallèle, l'auteur nous fait découvrir l'étendue des quartiers parisiens et la beauté de ses monuments, que le lecteur pourra admirer en se penchant à la fenêtre de l'appartement d'Hélène Grandjean, l'héroïne de son livre. Il dépeint le Paris du second Empire, d'un trait de plume coloré, il lui redonne vie à la façon d'un peintre faisant naître sous ses doigts des aquarelles aux tons chamarrés. La douce musicalité de ces tableaux vient rythmer le récit au fil des quatre saisons et adoucit un peu la tragédie des évènements de cette page d'amour derrière laquelle se cache un drame.
De la grande littérature, poétique et artistique, écrite par un romancier talentueux que l'on ne se lasse jamais de lire…
Les histoires d‘a, les histoires d'a, les histoires d'amour finissent mal. Vous connaissez la chanson. Et ce n'est pas Zola qui va vous prouver le contraire. Chez lui, les histoires d'amour finissent plus souvent au cimetière au son de la marche funèbre, qu'à l'église au son de la marche nuptiale. le bonheur chez Zola, n'existe pas, ou alors il est éphémère ; comme chez Maupassant où il s'affiche pour une partie de campagne, claire, joyeuse et ensoleillée, mais qui n'a qu'un temps, mangé qu'il est au mieux par la routine, au pire par le malheur.
Pourtant ce n'est pas faute d'essayer : Avec « Une page d'amour » (1878), Zola entend constituer « une halte de tendresse et de douceur » après ce monument de douleur qu'est « L'Assommoir » et avant cet autre chantier pas plus gai, « Nana ».
L'héroïne de « Une page d'amour » est Hélène Mouret. Elle est la soeur de François Mouret (mari de Marthe Rougon) qu'on a vu dans « La Conquête de Plassans » et du petit Silvère mort dans « La Fortune des Rougon ». Hélène veuve d'un nommé Grandjean, vit seule avec sa fille Jeanne, maladive et caractérielle, victime de crises violentes. Lors d'une de ces crises, Hélène fait appel à son voisin le docteur Henri Deberle Un sentiment de plus en plus fort naît entre eux. Mais Jeanne entre autres dérèglements, est d'une possessivité extraordinaire, elle ne supporte pas que sa mère s'attache à quelqu'un d'autre qu'elle. Elle prend en haine le docteur, allant même jusqu'à s'exposer sous la pluie pour attraper une pneumonie ou pire la phtisie (ancien nom de la tuberculose). L'amour d'Hélène et Henri n'y résistera pas.
« Une page d'amour », du point de vue de l'écriture, essaye de se rapprocher un peu de l'impressionnisme pictural (ce que fait si bien Maupassant) qui, de plus convient bien au sujet du roman, notamment les émois amoureux timides au départ, et de plus en plus assurés d'Hélène et Henri. On notera entre autres cette touche « picturale » dans les descriptions de paysages, parisiens ou banlieusards, qui donnent un cadre parfait à cette idylle.
« Une page d'amour » est aussi un grand roman naturaliste, dans l'analyse de la personnalité de la petite Jeanne. Ici ce n'est pas tant l'influence du milieu qui est étudiée, mais celle de l'hérédité : elle hérite à la fois (la pauvrette) du dérèglement mental de son aïeule Adélaïde fouque, mais encore de la faiblesse de sa grand-mère Ursule Macquart (qui comme elle était phtisique). Ajoutez à cela les troubles d'une ado qui n'a plus de repères, vous obtenez un cocktail explosif.
En lisant ces lignes aujourd'hui, on est étonné de voir avec quelle acuité l'auteur sait examiner et décrire ces troubles de l'adolescences (bien moins connus et étudiés à l'époque qu'aujourd'hui). C'est bien la preuve que Zola n'est pas seulement un grand écrivain, il a également une âme de scientifique qui lui permet de mener à bien son grand projet. En y regardant bien, il faut bien reconnaître qu'il y a une faille dans sa théorie sur l'hérédité : des deux parents qu'a chaque personnage, il privilégie celui qui figure dans son arbre généalogique des caractéristiques héréditaires particulières, et il occulte l'autre parent. C'est la réflexion qui m'est venue avec la petite Jeanne : le rapport est tout de suite établi avec les ancêtres porteurs des mêmes tares ou des mêmes symptômes. Mais le père de Jeanne avait lui aussi une ascendance dont apparemment il n'a transmis aucun caractère à sa fille. Ce serait pour le moins bizarre que cette gamine ait tout pris de sa mère et rien de son père. Et ce constat on peut le faire sur bien des personnages. Un autre reproche, ce serait de constater que Zola n'a vu dans l'hérédité que des tares, des défauts ou des faiblesses : pas une seule qualité. Certes c'est un parti pris, et l'auteur a dû penser que s'il fallait mettre tout cela en roman (voire en romans), ce serait une entreprise surhumaine, d'autant que l'hérédité n'est qu'un détail parmi d'autres de l'étude naturaliste.
Ces quelques réflexions n'enlèvent rien à l'attention, à la curiosité, voire au plaisir qu'on a à lire Zola, qui sait à point nommer nous émouvoir, quitte à nous choquer, et à nous intéresser, toujours.
Pourtant ce n'est pas faute d'essayer : Avec « Une page d'amour » (1878), Zola entend constituer « une halte de tendresse et de douceur » après ce monument de douleur qu'est « L'Assommoir » et avant cet autre chantier pas plus gai, « Nana ».
L'héroïne de « Une page d'amour » est Hélène Mouret. Elle est la soeur de François Mouret (mari de Marthe Rougon) qu'on a vu dans « La Conquête de Plassans » et du petit Silvère mort dans « La Fortune des Rougon ». Hélène veuve d'un nommé Grandjean, vit seule avec sa fille Jeanne, maladive et caractérielle, victime de crises violentes. Lors d'une de ces crises, Hélène fait appel à son voisin le docteur Henri Deberle Un sentiment de plus en plus fort naît entre eux. Mais Jeanne entre autres dérèglements, est d'une possessivité extraordinaire, elle ne supporte pas que sa mère s'attache à quelqu'un d'autre qu'elle. Elle prend en haine le docteur, allant même jusqu'à s'exposer sous la pluie pour attraper une pneumonie ou pire la phtisie (ancien nom de la tuberculose). L'amour d'Hélène et Henri n'y résistera pas.
« Une page d'amour », du point de vue de l'écriture, essaye de se rapprocher un peu de l'impressionnisme pictural (ce que fait si bien Maupassant) qui, de plus convient bien au sujet du roman, notamment les émois amoureux timides au départ, et de plus en plus assurés d'Hélène et Henri. On notera entre autres cette touche « picturale » dans les descriptions de paysages, parisiens ou banlieusards, qui donnent un cadre parfait à cette idylle.
« Une page d'amour » est aussi un grand roman naturaliste, dans l'analyse de la personnalité de la petite Jeanne. Ici ce n'est pas tant l'influence du milieu qui est étudiée, mais celle de l'hérédité : elle hérite à la fois (la pauvrette) du dérèglement mental de son aïeule Adélaïde fouque, mais encore de la faiblesse de sa grand-mère Ursule Macquart (qui comme elle était phtisique). Ajoutez à cela les troubles d'une ado qui n'a plus de repères, vous obtenez un cocktail explosif.
En lisant ces lignes aujourd'hui, on est étonné de voir avec quelle acuité l'auteur sait examiner et décrire ces troubles de l'adolescences (bien moins connus et étudiés à l'époque qu'aujourd'hui). C'est bien la preuve que Zola n'est pas seulement un grand écrivain, il a également une âme de scientifique qui lui permet de mener à bien son grand projet. En y regardant bien, il faut bien reconnaître qu'il y a une faille dans sa théorie sur l'hérédité : des deux parents qu'a chaque personnage, il privilégie celui qui figure dans son arbre généalogique des caractéristiques héréditaires particulières, et il occulte l'autre parent. C'est la réflexion qui m'est venue avec la petite Jeanne : le rapport est tout de suite établi avec les ancêtres porteurs des mêmes tares ou des mêmes symptômes. Mais le père de Jeanne avait lui aussi une ascendance dont apparemment il n'a transmis aucun caractère à sa fille. Ce serait pour le moins bizarre que cette gamine ait tout pris de sa mère et rien de son père. Et ce constat on peut le faire sur bien des personnages. Un autre reproche, ce serait de constater que Zola n'a vu dans l'hérédité que des tares, des défauts ou des faiblesses : pas une seule qualité. Certes c'est un parti pris, et l'auteur a dû penser que s'il fallait mettre tout cela en roman (voire en romans), ce serait une entreprise surhumaine, d'autant que l'hérédité n'est qu'un détail parmi d'autres de l'étude naturaliste.
Ces quelques réflexions n'enlèvent rien à l'attention, à la curiosité, voire au plaisir qu'on a à lire Zola, qui sait à point nommer nous émouvoir, quitte à nous choquer, et à nous intéresser, toujours.
Agonie et extase des sens, passion brûlante et éphémère, intimisme dramatique, foi omniprésente, etc., quelle est donc cette page, tellement éloignée des trames bruyantes, et souvent sordides, lorsque les Rougon-Macquart fricotent avec Paris et ses environs ?
Une page d'amour, une seule, qui s'étire au-dessus de Paris, dont on n'apercevra que l'horizon, comme un mystère insondable au-dessus duquel passent les saisons au gré de l'humeur du personnage principal : Hélène, jeune et superbe veuve – « cette dame si belle et si blanche », pureté incarnée ayant mené jusqu'alors une « vie grise » – ; mère d'une enfant malingre – Jeanne – qui aime sa mère d'un amour tyrannique et exclusif.
Cela se passe sur la colline de Passy qui n'était, dans ces années 1850, pas encore intégrée à la capitale. Îlot à l'abri du tumulte parisien, mais qu'on croirait, à tort, paisible. Hélène y découvre le poison de l'amour, elle qui avait mené jusqu'alors une vie si vertueuse, du point des moeurs en vigueur.
Cet amour s'incarne en la personne d'un médecin bourgeois, chef de famille respecté. Dans cet univers cossu et feutré, la violence des sentiments va donc surgir avec fracas, en des tableaux parfois d'une violence inouïe, comme cette tempête rugissant aux oreilles de la petite Jeanne, définitivement convaincue que sa mère l'a abandonnée pour son amant, à qui celle-ci se donne au même moment dans quelques logis sordide. L'issue en sera fatale pour la petite, qui se rongera de jalousie jusqu'à en mourir, gardant sur son visage sans vie les traits du reproche, à la grande terreur de sa mère.
Particulièrement dans ce roman, décor et personnages sont à l'unisson. Ainsi, quand la passion étreint Hélène, voici que « Paris lui envoyait au visage son souffle puissant ». D'autre fois, plus calme, « l'inconnu de la grande ville, dans le calme d'un beau soir, l'avait bercée d'un rêve attendri ».
« Frissonnante à la crainte de perdre Henri par quelque imprudence », Hélène – qui avouera plus tard un incompréhensible « coup d'étrange folie, [un] mal abominable, aveugle comme la foudre » – perdra la chair de sa chair et s'en retournera à une vie rangée – car la vie continue, telle une fatalité incontournable –, songeant que son amant lui aura été aussi insondable que Paris.
Une page d'amour est donc un récit où il ne se passe presque rien sinon une succession de tableaux anodins avec des gens presque tous insignifiants, sauf une poignée qui portent en eux une tragédie ; tous cela, dans une sorte de huis-clos. Surtout, il s'y trouve une pudeur qu'on soupçonnerait difficilement, particulièrement après avoir lu L'Assommoir, qui précède justement cette histoire : « J'ai voulu donner une note absolument opposée à celle de l'Assommoir », écrira d'ailleurs Zola dans une lettre ; sans doute un besoin de quitter la fange pour des horizons plus propres, même si, çà et là, la souillure demeure – voir là mère Fétu, mendiante professionnelle par la bouche de laquelle Hélène découvrira que son amant se remet fort bien de leur séparation de corps et d'esprit.
Au passage, Zola en profite pour écorner la futilité de la bourgeoisie en la personne de madame Deberle, une riche écervelée qui occupe ses journées à combler son vide intérieur.
À propos de cette tendre et à la fois douloureuse page, le peintre Cézanne – ami de jeunesse de Zola –, aura ces mots justes : « Les lieux par leur peinture sont imprégnés de la passion qui agite les personnages, et, par là, font plus corps ensemble avec les acteurs et sont moins désintéressés dans le tout. Ils semblent s'animer pour ainsi dire et participer aux souffrances des êtres vivants. »
Enfin, ce roman est la preuve que Zola sait se faire poète…
Une page d'amour, une seule, qui s'étire au-dessus de Paris, dont on n'apercevra que l'horizon, comme un mystère insondable au-dessus duquel passent les saisons au gré de l'humeur du personnage principal : Hélène, jeune et superbe veuve – « cette dame si belle et si blanche », pureté incarnée ayant mené jusqu'alors une « vie grise » – ; mère d'une enfant malingre – Jeanne – qui aime sa mère d'un amour tyrannique et exclusif.
Cela se passe sur la colline de Passy qui n'était, dans ces années 1850, pas encore intégrée à la capitale. Îlot à l'abri du tumulte parisien, mais qu'on croirait, à tort, paisible. Hélène y découvre le poison de l'amour, elle qui avait mené jusqu'alors une vie si vertueuse, du point des moeurs en vigueur.
Cet amour s'incarne en la personne d'un médecin bourgeois, chef de famille respecté. Dans cet univers cossu et feutré, la violence des sentiments va donc surgir avec fracas, en des tableaux parfois d'une violence inouïe, comme cette tempête rugissant aux oreilles de la petite Jeanne, définitivement convaincue que sa mère l'a abandonnée pour son amant, à qui celle-ci se donne au même moment dans quelques logis sordide. L'issue en sera fatale pour la petite, qui se rongera de jalousie jusqu'à en mourir, gardant sur son visage sans vie les traits du reproche, à la grande terreur de sa mère.
Particulièrement dans ce roman, décor et personnages sont à l'unisson. Ainsi, quand la passion étreint Hélène, voici que « Paris lui envoyait au visage son souffle puissant ». D'autre fois, plus calme, « l'inconnu de la grande ville, dans le calme d'un beau soir, l'avait bercée d'un rêve attendri ».
« Frissonnante à la crainte de perdre Henri par quelque imprudence », Hélène – qui avouera plus tard un incompréhensible « coup d'étrange folie, [un] mal abominable, aveugle comme la foudre » – perdra la chair de sa chair et s'en retournera à une vie rangée – car la vie continue, telle une fatalité incontournable –, songeant que son amant lui aura été aussi insondable que Paris.
Une page d'amour est donc un récit où il ne se passe presque rien sinon une succession de tableaux anodins avec des gens presque tous insignifiants, sauf une poignée qui portent en eux une tragédie ; tous cela, dans une sorte de huis-clos. Surtout, il s'y trouve une pudeur qu'on soupçonnerait difficilement, particulièrement après avoir lu L'Assommoir, qui précède justement cette histoire : « J'ai voulu donner une note absolument opposée à celle de l'Assommoir », écrira d'ailleurs Zola dans une lettre ; sans doute un besoin de quitter la fange pour des horizons plus propres, même si, çà et là, la souillure demeure – voir là mère Fétu, mendiante professionnelle par la bouche de laquelle Hélène découvrira que son amant se remet fort bien de leur séparation de corps et d'esprit.
Au passage, Zola en profite pour écorner la futilité de la bourgeoisie en la personne de madame Deberle, une riche écervelée qui occupe ses journées à combler son vide intérieur.
À propos de cette tendre et à la fois douloureuse page, le peintre Cézanne – ami de jeunesse de Zola –, aura ces mots justes : « Les lieux par leur peinture sont imprégnés de la passion qui agite les personnages, et, par là, font plus corps ensemble avec les acteurs et sont moins désintéressés dans le tout. Ils semblent s'animer pour ainsi dire et participer aux souffrances des êtres vivants. »
Enfin, ce roman est la preuve que Zola sait se faire poète…
Huitième volume des Rougon Maquart, il se démarque cependant des sept premiers tomes.
Moins axé sur l'étude des moeurs de la société sous le Second Empire, nous suivons tout de même des membres de la famille éponyme.
Ici, Hélène, descendante d'Adélaïde Fouque, a transmis la tare de la famille à sa fille.
Celle ci est sujette à des crises nerveuses, que l'on pourrait comparer à des crises d'epilepsie.
Veuve, elle a perdu son mari lors de son arrivée à Paris, et se retrouve donc piégée dans son quotidien, elle ne sort pas ou peu, s'occupe de son enfant qu'elle doit ménager en toutes circonstances.
Et tout cela dans la plus grande solitude.
Viendront naturellement se présenter deux prétendants. L'un représentant la raison, l'autre la passion.
Une page d'amour sera donc ce combat sans fin entre la raison et l'envie. Qui transparaîtra à travers Hélène et sa fille.
Un portrait d'Hélène sera également mis en parallèle avec celui de Paris, nous permettant d'en savoir plus sur ses sentiments.
Une belle histoire, aussi bien dans le fond que dans la forme, d'un amour qui ne peut tourner qu'au drame avec la plume de l'auteur, et qui nous mettra face à la légitimité de nos choix, et de nos passions destructrices.
Moins axé sur l'étude des moeurs de la société sous le Second Empire, nous suivons tout de même des membres de la famille éponyme.
Ici, Hélène, descendante d'Adélaïde Fouque, a transmis la tare de la famille à sa fille.
Celle ci est sujette à des crises nerveuses, que l'on pourrait comparer à des crises d'epilepsie.
Veuve, elle a perdu son mari lors de son arrivée à Paris, et se retrouve donc piégée dans son quotidien, elle ne sort pas ou peu, s'occupe de son enfant qu'elle doit ménager en toutes circonstances.
Et tout cela dans la plus grande solitude.
Viendront naturellement se présenter deux prétendants. L'un représentant la raison, l'autre la passion.
Une page d'amour sera donc ce combat sans fin entre la raison et l'envie. Qui transparaîtra à travers Hélène et sa fille.
Un portrait d'Hélène sera également mis en parallèle avec celui de Paris, nous permettant d'en savoir plus sur ses sentiments.
Une belle histoire, aussi bien dans le fond que dans la forme, d'un amour qui ne peut tourner qu'au drame avec la plume de l'auteur, et qui nous mettra face à la légitimité de nos choix, et de nos passions destructrices.
Un des premiers volumes de la série fleuve des Rougon-Macquart. Une fois de plus chez Zola, la faute, la transgression sont au coeur du roman et viennent hanter les personnages. Une fois de plus, le bonheur semble se refuser à des êtres droits, mais faibles.
Hélène, veuve et mère d'un fillette, Jeanne, mène une vie rangée dans ce quartier de Passy où elle vient d'aménager. Jusqu'au jour où Jeanne tombe malade...
Hélène fait appel au docteur Deberle, son voisin, propriétaire de son logement. Dès le premier regard, Henri Deberle est troublé par la beauté de la jeune femme. Une "page d'amour" s'ouvre, se referme, puis se tourne définitivement , au rythme des rémissions et des rechutes de l'enfant.
En effet, par l'amour exclusif qu'elle exige de sa mère, Jeanne sape le bonheur secret dont rêvent Hélène et le docteur Deberle. C'est elle qui, inconsciemment sans doute, décide de l'avenir de cet amour naissant, et coupable (Deberle est marié à l'exubérante et frivole Juliette).
C'est elle enfin qui en précipite le dénouement .
Je retiens de ce roman de magnifiques descriptions de Paris : vivante, lumineuse, nimbée de brumes, ou torturée par la violence de l'orage, la ville se métamorphose au fil du roman, s'invite dans l'intrigue et devient personnage à part entière. Zola observe avec l'acuité du photographe et la sensibilité du peintre. Il tisse des liens très forts entre son personnage de chair et le tableau qu'elle contemple :
"Souvent aussi, dans les heures d'espoir, elle avait confié l'allégresse de son coeur aux lointains perdus des faubourgs. Il n'était plus un monument qui ne lui rappelât une émotion triste ou heureuse. Paris vivait de son existence. Mais jamais elle ne l'aimait davantage qu'au crépuscule, lorsque, la journée finie, il consentait à un quart d'heure d'apaisement, d'oubli et de songerie, en attendant que le gaz fût allumé. "
C'est cette dimension-là qui , selon moi, porte l'empreinte littéraire d'un grand Zola, et que l'on retrouve si souvent dans son oeuvre.
Un très beau roman, mais y a-t-il des romans médiocres chez Zola ?
Hélène, veuve et mère d'un fillette, Jeanne, mène une vie rangée dans ce quartier de Passy où elle vient d'aménager. Jusqu'au jour où Jeanne tombe malade...
Hélène fait appel au docteur Deberle, son voisin, propriétaire de son logement. Dès le premier regard, Henri Deberle est troublé par la beauté de la jeune femme. Une "page d'amour" s'ouvre, se referme, puis se tourne définitivement , au rythme des rémissions et des rechutes de l'enfant.
En effet, par l'amour exclusif qu'elle exige de sa mère, Jeanne sape le bonheur secret dont rêvent Hélène et le docteur Deberle. C'est elle qui, inconsciemment sans doute, décide de l'avenir de cet amour naissant, et coupable (Deberle est marié à l'exubérante et frivole Juliette).
C'est elle enfin qui en précipite le dénouement .
Je retiens de ce roman de magnifiques descriptions de Paris : vivante, lumineuse, nimbée de brumes, ou torturée par la violence de l'orage, la ville se métamorphose au fil du roman, s'invite dans l'intrigue et devient personnage à part entière. Zola observe avec l'acuité du photographe et la sensibilité du peintre. Il tisse des liens très forts entre son personnage de chair et le tableau qu'elle contemple :
"Souvent aussi, dans les heures d'espoir, elle avait confié l'allégresse de son coeur aux lointains perdus des faubourgs. Il n'était plus un monument qui ne lui rappelât une émotion triste ou heureuse. Paris vivait de son existence. Mais jamais elle ne l'aimait davantage qu'au crépuscule, lorsque, la journée finie, il consentait à un quart d'heure d'apaisement, d'oubli et de songerie, en attendant que le gaz fût allumé. "
C'est cette dimension-là qui , selon moi, porte l'empreinte littéraire d'un grand Zola, et que l'on retrouve si souvent dans son oeuvre.
Un très beau roman, mais y a-t-il des romans médiocres chez Zola ?
Ah, ce "Je vous aime ! oh ! je vous aime !" soufflé dans le cou d'Hélène...
Scandée par les descriptions d'un Paris sublimé -la ville, personnage à part entière, se confond avec les états d'âme de celle qui la contemple- cette "page" de passion dans une vie plutôt grise (une passion dans le désert) est suffisamment fiévreuse pour emporter le lecteur que je suis, exigeant mais fleur bleue.
Si j'ai aimé ce 8ème opus, c'est pour cette montée du désir adultérin plutôt que pour les affres de la jalousie chez une petite fille somme toute assez insupportable.
[Le personnage de l'entremetteuse, l'affreuse mère Fétu (Le fais-tu ?), n'est pas la meilleure idée qu'ait eue Zola alors que Malignon et Juliette Deberle très bien croqués annoncent déjà Proust.]
Lien : http://lavieerrante.over-blo..
Scandée par les descriptions d'un Paris sublimé -la ville, personnage à part entière, se confond avec les états d'âme de celle qui la contemple- cette "page" de passion dans une vie plutôt grise (une passion dans le désert) est suffisamment fiévreuse pour emporter le lecteur que je suis, exigeant mais fleur bleue.
Si j'ai aimé ce 8ème opus, c'est pour cette montée du désir adultérin plutôt que pour les affres de la jalousie chez une petite fille somme toute assez insupportable.
[Le personnage de l'entremetteuse, l'affreuse mère Fétu (Le fais-tu ?), n'est pas la meilleure idée qu'ait eue Zola alors que Malignon et Juliette Deberle très bien croqués annoncent déjà Proust.]
Lien : http://lavieerrante.over-blo..
Voilà un tome que j'ai trouvé bien différent du reste de la saga. C'est un roman sur l'amour : l'amour d'une fille pour sa mère, d'une mère pour sa fille, d'une femme et d'un homme, forcément tragique.
Hélène vit à Paris, seule avec sa fille Jeanne depuis la mort de son mari. Mais Jeanne est malade (hérédité Macquart). Et sa maladie va rapprocher sa mère de leur voisin , un jeune et beau docteur. sauf qu'Henri Deberle est marié.
Cette histoire somme toute classique permet à Zola d'écrire un très beau roman d'amour. Il rejoint mon top 3 (provisoire). Et c'est d'ailleurs le premier qui me fait pleurer.
Hélène vit à Paris, seule avec sa fille Jeanne depuis la mort de son mari. Mais Jeanne est malade (hérédité Macquart). Et sa maladie va rapprocher sa mère de leur voisin , un jeune et beau docteur. sauf qu'Henri Deberle est marié.
Cette histoire somme toute classique permet à Zola d'écrire un très beau roman d'amour. Il rejoint mon top 3 (provisoire). Et c'est d'ailleurs le premier qui me fait pleurer.
Un des romans, le huitième de la saga des Rougon-Macquart, l'action se passe à Passy dans Paris. L'intrigue est centrée sur trois personnages principaux : Jeanne ,une gamine de 11 ans, Hélène sa maman et le docteur. La mère est une sainte qui souffre du caractère infernal de sa fille qui est constamment malade de convulsions.
Très vite une relation amoureuse s'est installée entre Hélène et le docteur, ce que la gamine va difficilement devoir supporter.
« Une page d'amour » : un roman pas très connu d'Emile Zola.
Certains esprits chagrins lui trouvent une structure un peu creuse… certes… avec des thèmes principaux comme le coup de foudre, la passion amoureuse et la maladie d'un enfant…
Il n'en reste pas moins qu'à mes yeux, un Zola reste un Zola ; et que son style, rien que son style, constitue pour moi un ravissement.
J'ai remarqué dans ce roman-ci, comme également dans Pot Bouille et dans La faute de l'abbé Mouret le plaisir de l'écrivain à décrire des scènes de pieds nus, le plaisir de les embrasser , ce qui m'a fort plu : mon fantasme étant chez les femmes leurs pieds nus et leurs orteils (lire mes citations... qui ne mentionnent que celles parlant de ce sujet cfr. )
Très vite une relation amoureuse s'est installée entre Hélène et le docteur, ce que la gamine va difficilement devoir supporter.
« Une page d'amour » : un roman pas très connu d'Emile Zola.
Certains esprits chagrins lui trouvent une structure un peu creuse… certes… avec des thèmes principaux comme le coup de foudre, la passion amoureuse et la maladie d'un enfant…
Il n'en reste pas moins qu'à mes yeux, un Zola reste un Zola ; et que son style, rien que son style, constitue pour moi un ravissement.
J'ai remarqué dans ce roman-ci, comme également dans Pot Bouille et dans La faute de l'abbé Mouret le plaisir de l'écrivain à décrire des scènes de pieds nus, le plaisir de les embrasser , ce qui m'a fort plu : mon fantasme étant chez les femmes leurs pieds nus et leurs orteils (lire mes citations... qui ne mentionnent que celles parlant de ce sujet cfr. )
Les Dernières Actualités
Voir plus

Lire avec Jacques Perrin
Pecosa
36 livres

Les Rougon-Macquart
petitours2
21 livres
Autres livres de Émile Zola (294)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Les personnages des Rougon Macquart
Dans l'assommoir, quelle est l'infirmité qui touche Gervaise dès la naissance
Elle est alcoolique
Elle boîte
Elle est myope
Elle est dépensière
7 questions
593 lecteurs ont répondu
Thème :
Émile ZolaCréer un quiz sur ce livre593 lecteurs ont répondu