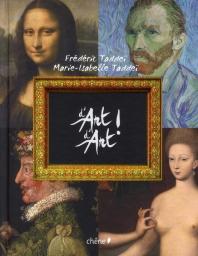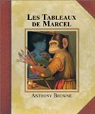Armand de Pontmartin
288 pages
Michel Lévy Frères, Libraires Editeurs (01/06/1872)
/5
2 notes
Michel Lévy Frères, Libraires Editeurs (01/06/1872)
Résumé :
Nouvelle édition, augmentée d'une préface.
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Critiques, Analyses et Avis (2)
Ajouter une critique
Tout dix-neuviémiste qui se respecte se doit d'avoir lu, au moins une fois dans sa vie, « Les Jeudis de Madame Charbonneau », dont le titre anodin cache soigneusement un portrait au vitriol du monde des lettres sous la Restauration. Publié en 1862, le roman connut un succès extraordinaire pendant trois décennies. Il demeure aujourd'hui un témoignage subjectif mais précieux sur la scène littéraire des années 1830-1840.
Armand Ferrard, comte de Pontmartin, était un aristocrate légitimiste originaire d'Avignon, rattaché lointainement à la famille des Bourbons. Mais c'était aussi un passionné de littérature, caressant lui-même des ambitions littéraires. À la suite de la bataille d'Hernani, qui marqua le début du Romantisme, il monta à Paris, et parvint à approcher et à fréquenter les plus grands auteurs de cette époque : Victor Hugo, Alphonse de Lamartine, Mme de Girardin, Alfred de Musset, George Sand, Sainte-Beuve, Jules Janin, Honoré de Balzac, Théophile Gautier, Joseph Méry, Maxime du Camp et bien d'autres…
Le petit aristocrate provincial fut globalement accueilli avec beaucoup de condescendance. On lui reconnût bien un certain talent, mais son titre nobiliaire dérangea la plupart des grands écrivains de l'époque, qui étaient plutôt républicains, sinon par conviction, au moins par esprit d'indépendance envers le pouvoir monarchiste. Se faisant très humble, Armand de Pontmartin mit toute son énergie à défendre les écrivains et se fit d'abord critique littéraire. Ce métier était déjà de nature à asseoir la promotion d'un écrivain, et la fonction d'Armand amena nombre d'entre eux à faire bonne figure envers M. le Comte et à lui offrir leurs derniers ouvrages, en espérant bien entendu une bonne critique. Durant plusieurs années, Pontmartin se contenta de ce rôle de promoteur mondain, trop heureux d'être au moins apprécié, même pour des raisons intéressées, par ces écrivains qu'il admirait. Mais l'amitié et l'influence du critique catholique Louis Veuillot le poussa à devenir un critique ardent, cruel, dénonçant impitoyablement les auteurs immoraux ou décadents.
En quatre ans, Pontmartin devint le bouc émissaire et la bête noire des écrivains de la Restauration, qui se répandirent allègrement, comme ils le faisaient aussi au sujet de Louis Veuillot, en plaisanteries salaces, en rumeurs infâmantes et en injures publiques. Hélas, si Louis Veuillot était de la trempe de ces paladins fanatiques nés pour avancer en dépit des coups bas et des crachats, Armand de Pontmartin vécut beaucoup plus mal d'être victime de la rancune perfide d'hommes de lettres qu'il admirait profondément. Lorsque la révolution de Juillet survient en 1848, comprenant que son monde est en train de s'écrouler, il mit fin à sa carrière de critique parisien et retourna dans sa Provence natale. Quelques années plus tard, il publia dans la presse locale quelques épisodes de sa vie parisienne qu'il finit par réécrire de façon romancée, tout en y ajoutant de nouvelles parties, et les publia en volume en 1862. Ce fut un immense succès littéraire, qui toucha bien entendu un public légitimiste, mais pas uniquement. Car Pontmartin était à la fois un excellent écrivain, un aristocrate auquel l'éducation avait conféré un certain raffinement littéraire, mais aussi un provençal volontiers franc du collier, drôle et ironique quand il s'agissait de dire du mal des gens. Ce cocktail fit de lui un narrateur passionnant, même si on ne partage pas ses idées.
Dans son récit, Pontmartin désigne tous les écrivains qu'il a fréquentés sous des pseudonymes de personnages grecs du théâtre antique. Cette délicatesse aurait pu le mettre à l'abri du scandale, mais au chapitre XXIII, il consacra trois pages à dire à quel écrivain correspondait tel nom grec dans son récit. Toute la rouerie insolente du personnage apparait dans ce vivant paradoxe.
Néanmoins, on peut bien évidemment se demander ce que vaut la parole d'un critique littéraire partial, qui traîne depuis toujours une réputation désastreuse. En fait, Armand de Pontmartin n'est pas difficile à comprendre : comme tout légitimiste et catholique de sa génération, Pontmartin perçoit la littérature comme un art semblable à la musique, la sculpture ou à la peinture, c'est-à-dire une expression artistique tournée vers la beauté, la morale, l'exemplarité, bref quelque chose qui élève l'âme. Or, l'avènement du Romantisme, notamment sous l'influence De Balzac, se pique désormais de réalisme, et n'hésite pas à mettre comme héros de romans des personnages négatifs, cupides, arrivistes ou assassins. Cette évolution de la littérature était inéluctable, mais parmi ceux qui l'ont vécue, il se trouva des esprits conservateurs qui s'y opposèrent fermement – en pure perte. Cet aveuglement honni par tous n'empêcha ni Veuillot, ni Pontmartin de consacrer leur vie à tenter de décourager la littérature immorale. Jusqu'à son dernier souffle, Pontmartin s'acharnera à défendre cette cause perdue, devenant même la risée de tout le milieu littéraire. Il n'était plus un critique, mais il publia de nombreux livres qui sont des études à charge contre des écrivains "déviants", qui firent beaucoup rire les intéressés.
En ce sens, « Les Jeudis de Madame Charbonneau » est certainement le livre le plus intéressant d'Armand de Pontmartin, d'abord parce que c'est un roman qu'il rédige à la cinquantaine, dans une heureuse période de sa vie où il est devenu maire d'un village gardois, Les Angles (depuis devenu une petite ville, mais qui ne comptait que 400 âmes en 1862).C'est donc un homme en position de force, avec un sentiment de tardive reconnaissance, qui revient sur ses années de jeunesse, avec beaucoup de dérision et d'ironie, tant sur les grands hommes qu'il a connus que sur lui-même, en tant que lettré malheureux comme en tant que maire malchanceux.
Le roman raconte le retour en Provence d'un homme de lettres lassé des perfidies du milieu littéraire parisien. Installé à C. (ville dont seule l'initiale est précisée, mais dont le nom du fleuve le traversant permet d'identifier avec certitude la ville de Carpentras), le narrateur redécouvre la douceur d'un climat au beau fixe, et de rapports humains simples et harmonieux. Hélas, on s'ennuie quand même un peu, dans cette existence rurale et contemplative, et un voisin lui recommande le salon hebdomadaire de Madame Charbonneau. Cette grande bourgeoise organise tous les jeudis à Carpentras un salon qui se veut littéraire, mais où il est surtout question de casser du sucre sur la vie littéraire parisienne. le narrateur est en ce sens un invité idéal, car il a lui aussi des choses terribles à raconter sur Paris. On l'écoute avec attention, et madame Charbonneau lui parle ensuite d'un invité qui doit les rejoindre le samedi suivant, qui fut critique littéraire parisien quelques années plus tôt, et qui est devenu maire d'un petit village nommé Gigondas. Madame Charbonneau incite le narrateur à revenir le jeudi suivant.
Comme on le devine, le narrateur, c'est Armand de Pontmartin en 1848, qui va écouter les souvenirs de jeunesse d'Armand de Pontmartin en 1862, lequel finit par dévier d'ailleurs, fort humoristiquement, sur ses premières années de gestion municipale, durant lesquelles il a dû réaliser, avec un certain amateurisme, les promesses électorales non tenues de son prédécesseur. D'ailleurs, si l'anecdote de la fontaine de Gigondas est véritablement authentique, c'est véritablement une histoire fabuleuse !
De ce fait, petit à petit, Madame Charbonneau et son salon s'effacent devant un long dialogue d'Armand de Pontmartin avec lui-même, qui serait tout à fait inepte si l'auteur n'y consacrait sa plus belle plume et ne tenait à rendre plaisantes ses aventures et ses déceptions. Loin du règlement de comptes, comme on l'a souvent perçu, « Les Jeudis de Madame Charbonneau » est avant tout la désillusion hilare d'un idéologue apaisé, et qui goûte plus qu'il ne veut l'avouer le déclin de ses colères morales. Lui-même ne s'épargne guère et mesure non seulement le jeune hurluberlu provincial qu'il a été, mais aussi le vieux farfelu passéiste qu'il est devenu. Certes, ses convictions demeurent inchangées, mais elles ne sont plus viscérales. D'ailleurs, dans la nouvelle préface de 1872, Armand de Pontmartin, qui a perdu toutes ses amitiés littéraires dix ans auparavant, à la publication de ce roman, confesse avoir juste voulu faire la satire d'un désenchanté, sans méchanceté aucune, se réclamant logiquement des exagérations et du caractère parodique de la satire, quitte effectivement à exagérer quelques propos rapportés. C'est entre autres ceux prêtés à son ami Jules Sandeau qui a poussé ce dernier à rompre tout contact avec lui, ce dont Armand de Pontmartin semble très attristé.
Excès de naïveté ? Sans doute. Persuadé d'écrire là son dernier livre, Armand de Pontmartin a d'autant moins épargné les orgueils et les égos de ses amis écrivains qu'il mesurait toute l'inanité de son propre orgueil et de son propre égo, ceux d'un homme de lettres peu intuitif qui ne comprenait pas que la littérature ait besoin d'évoluer au-delà de la morale. Mais hélas, au moment de réaliser cette autocritique, Armand de Pontmartin a embarqué avec lui quantité de grands noms de la littérature, dont les survivants n'estimaient pas, à tort ou à raison, avoir eux-mêmes une place à y occuper.
Ainsi, si « Les Jeudis de Madame Charbonneau » sont un portrait cinglant et amer du milieu littéraire parisien, ils ne sont pas, comme on pourrait le croire, la revanche tardive d'un raté, mais simplement le témoignage naïf et certainement sincère d'un homme qui s'est beaucoup dévoué aux autres – qui continuait d'ailleurs à le faire en devenant maire – et qui, très logiquement, ne s'imaginait pas parler de lui sans parler d'eux, avec un souci d'authenticité et de réalisme qui n'a pas été vraiment compris. En ce sens, « Les Jeudis de Madame Charbonneau » forme un document à l'intérêt historique et littéraire certain. Cependant, ce livre est aussi le témoignage savoureux et profondément humain d'un intellectuel déçu par ses pairs, mais qui, pour autant, n'a jamais totalement cessé de les aimer.
Armand Ferrard, comte de Pontmartin, était un aristocrate légitimiste originaire d'Avignon, rattaché lointainement à la famille des Bourbons. Mais c'était aussi un passionné de littérature, caressant lui-même des ambitions littéraires. À la suite de la bataille d'Hernani, qui marqua le début du Romantisme, il monta à Paris, et parvint à approcher et à fréquenter les plus grands auteurs de cette époque : Victor Hugo, Alphonse de Lamartine, Mme de Girardin, Alfred de Musset, George Sand, Sainte-Beuve, Jules Janin, Honoré de Balzac, Théophile Gautier, Joseph Méry, Maxime du Camp et bien d'autres…
Le petit aristocrate provincial fut globalement accueilli avec beaucoup de condescendance. On lui reconnût bien un certain talent, mais son titre nobiliaire dérangea la plupart des grands écrivains de l'époque, qui étaient plutôt républicains, sinon par conviction, au moins par esprit d'indépendance envers le pouvoir monarchiste. Se faisant très humble, Armand de Pontmartin mit toute son énergie à défendre les écrivains et se fit d'abord critique littéraire. Ce métier était déjà de nature à asseoir la promotion d'un écrivain, et la fonction d'Armand amena nombre d'entre eux à faire bonne figure envers M. le Comte et à lui offrir leurs derniers ouvrages, en espérant bien entendu une bonne critique. Durant plusieurs années, Pontmartin se contenta de ce rôle de promoteur mondain, trop heureux d'être au moins apprécié, même pour des raisons intéressées, par ces écrivains qu'il admirait. Mais l'amitié et l'influence du critique catholique Louis Veuillot le poussa à devenir un critique ardent, cruel, dénonçant impitoyablement les auteurs immoraux ou décadents.
En quatre ans, Pontmartin devint le bouc émissaire et la bête noire des écrivains de la Restauration, qui se répandirent allègrement, comme ils le faisaient aussi au sujet de Louis Veuillot, en plaisanteries salaces, en rumeurs infâmantes et en injures publiques. Hélas, si Louis Veuillot était de la trempe de ces paladins fanatiques nés pour avancer en dépit des coups bas et des crachats, Armand de Pontmartin vécut beaucoup plus mal d'être victime de la rancune perfide d'hommes de lettres qu'il admirait profondément. Lorsque la révolution de Juillet survient en 1848, comprenant que son monde est en train de s'écrouler, il mit fin à sa carrière de critique parisien et retourna dans sa Provence natale. Quelques années plus tard, il publia dans la presse locale quelques épisodes de sa vie parisienne qu'il finit par réécrire de façon romancée, tout en y ajoutant de nouvelles parties, et les publia en volume en 1862. Ce fut un immense succès littéraire, qui toucha bien entendu un public légitimiste, mais pas uniquement. Car Pontmartin était à la fois un excellent écrivain, un aristocrate auquel l'éducation avait conféré un certain raffinement littéraire, mais aussi un provençal volontiers franc du collier, drôle et ironique quand il s'agissait de dire du mal des gens. Ce cocktail fit de lui un narrateur passionnant, même si on ne partage pas ses idées.
Dans son récit, Pontmartin désigne tous les écrivains qu'il a fréquentés sous des pseudonymes de personnages grecs du théâtre antique. Cette délicatesse aurait pu le mettre à l'abri du scandale, mais au chapitre XXIII, il consacra trois pages à dire à quel écrivain correspondait tel nom grec dans son récit. Toute la rouerie insolente du personnage apparait dans ce vivant paradoxe.
Néanmoins, on peut bien évidemment se demander ce que vaut la parole d'un critique littéraire partial, qui traîne depuis toujours une réputation désastreuse. En fait, Armand de Pontmartin n'est pas difficile à comprendre : comme tout légitimiste et catholique de sa génération, Pontmartin perçoit la littérature comme un art semblable à la musique, la sculpture ou à la peinture, c'est-à-dire une expression artistique tournée vers la beauté, la morale, l'exemplarité, bref quelque chose qui élève l'âme. Or, l'avènement du Romantisme, notamment sous l'influence De Balzac, se pique désormais de réalisme, et n'hésite pas à mettre comme héros de romans des personnages négatifs, cupides, arrivistes ou assassins. Cette évolution de la littérature était inéluctable, mais parmi ceux qui l'ont vécue, il se trouva des esprits conservateurs qui s'y opposèrent fermement – en pure perte. Cet aveuglement honni par tous n'empêcha ni Veuillot, ni Pontmartin de consacrer leur vie à tenter de décourager la littérature immorale. Jusqu'à son dernier souffle, Pontmartin s'acharnera à défendre cette cause perdue, devenant même la risée de tout le milieu littéraire. Il n'était plus un critique, mais il publia de nombreux livres qui sont des études à charge contre des écrivains "déviants", qui firent beaucoup rire les intéressés.
En ce sens, « Les Jeudis de Madame Charbonneau » est certainement le livre le plus intéressant d'Armand de Pontmartin, d'abord parce que c'est un roman qu'il rédige à la cinquantaine, dans une heureuse période de sa vie où il est devenu maire d'un village gardois, Les Angles (depuis devenu une petite ville, mais qui ne comptait que 400 âmes en 1862).C'est donc un homme en position de force, avec un sentiment de tardive reconnaissance, qui revient sur ses années de jeunesse, avec beaucoup de dérision et d'ironie, tant sur les grands hommes qu'il a connus que sur lui-même, en tant que lettré malheureux comme en tant que maire malchanceux.
Le roman raconte le retour en Provence d'un homme de lettres lassé des perfidies du milieu littéraire parisien. Installé à C. (ville dont seule l'initiale est précisée, mais dont le nom du fleuve le traversant permet d'identifier avec certitude la ville de Carpentras), le narrateur redécouvre la douceur d'un climat au beau fixe, et de rapports humains simples et harmonieux. Hélas, on s'ennuie quand même un peu, dans cette existence rurale et contemplative, et un voisin lui recommande le salon hebdomadaire de Madame Charbonneau. Cette grande bourgeoise organise tous les jeudis à Carpentras un salon qui se veut littéraire, mais où il est surtout question de casser du sucre sur la vie littéraire parisienne. le narrateur est en ce sens un invité idéal, car il a lui aussi des choses terribles à raconter sur Paris. On l'écoute avec attention, et madame Charbonneau lui parle ensuite d'un invité qui doit les rejoindre le samedi suivant, qui fut critique littéraire parisien quelques années plus tôt, et qui est devenu maire d'un petit village nommé Gigondas. Madame Charbonneau incite le narrateur à revenir le jeudi suivant.
Comme on le devine, le narrateur, c'est Armand de Pontmartin en 1848, qui va écouter les souvenirs de jeunesse d'Armand de Pontmartin en 1862, lequel finit par dévier d'ailleurs, fort humoristiquement, sur ses premières années de gestion municipale, durant lesquelles il a dû réaliser, avec un certain amateurisme, les promesses électorales non tenues de son prédécesseur. D'ailleurs, si l'anecdote de la fontaine de Gigondas est véritablement authentique, c'est véritablement une histoire fabuleuse !
De ce fait, petit à petit, Madame Charbonneau et son salon s'effacent devant un long dialogue d'Armand de Pontmartin avec lui-même, qui serait tout à fait inepte si l'auteur n'y consacrait sa plus belle plume et ne tenait à rendre plaisantes ses aventures et ses déceptions. Loin du règlement de comptes, comme on l'a souvent perçu, « Les Jeudis de Madame Charbonneau » est avant tout la désillusion hilare d'un idéologue apaisé, et qui goûte plus qu'il ne veut l'avouer le déclin de ses colères morales. Lui-même ne s'épargne guère et mesure non seulement le jeune hurluberlu provincial qu'il a été, mais aussi le vieux farfelu passéiste qu'il est devenu. Certes, ses convictions demeurent inchangées, mais elles ne sont plus viscérales. D'ailleurs, dans la nouvelle préface de 1872, Armand de Pontmartin, qui a perdu toutes ses amitiés littéraires dix ans auparavant, à la publication de ce roman, confesse avoir juste voulu faire la satire d'un désenchanté, sans méchanceté aucune, se réclamant logiquement des exagérations et du caractère parodique de la satire, quitte effectivement à exagérer quelques propos rapportés. C'est entre autres ceux prêtés à son ami Jules Sandeau qui a poussé ce dernier à rompre tout contact avec lui, ce dont Armand de Pontmartin semble très attristé.
Excès de naïveté ? Sans doute. Persuadé d'écrire là son dernier livre, Armand de Pontmartin a d'autant moins épargné les orgueils et les égos de ses amis écrivains qu'il mesurait toute l'inanité de son propre orgueil et de son propre égo, ceux d'un homme de lettres peu intuitif qui ne comprenait pas que la littérature ait besoin d'évoluer au-delà de la morale. Mais hélas, au moment de réaliser cette autocritique, Armand de Pontmartin a embarqué avec lui quantité de grands noms de la littérature, dont les survivants n'estimaient pas, à tort ou à raison, avoir eux-mêmes une place à y occuper.
Ainsi, si « Les Jeudis de Madame Charbonneau » sont un portrait cinglant et amer du milieu littéraire parisien, ils ne sont pas, comme on pourrait le croire, la revanche tardive d'un raté, mais simplement le témoignage naïf et certainement sincère d'un homme qui s'est beaucoup dévoué aux autres – qui continuait d'ailleurs à le faire en devenant maire – et qui, très logiquement, ne s'imaginait pas parler de lui sans parler d'eux, avec un souci d'authenticité et de réalisme qui n'a pas été vraiment compris. En ce sens, « Les Jeudis de Madame Charbonneau » forme un document à l'intérêt historique et littéraire certain. Cependant, ce livre est aussi le témoignage savoureux et profondément humain d'un intellectuel déçu par ses pairs, mais qui, pour autant, n'a jamais totalement cessé de les aimer.
Voici l'histoire vraie d'un critique littéraire qui a longtemps souffert de ne passer que pour un amateur. Il a amassé, goutte à goutte, pendant des années, des trésors d'aigreur et de rancoeur. Un jour, l'ambition déchue se révolte, l'amour-propre blessé fait un dernier effort et crée cette compilation d'anecdotes où il enveloppe dans une haine commune, les bons et mauvais artistes, l'esprit et la sottise…
L'avant-crise, son passé, est assez simple : les yeux pleins d'espoirs et d'enthousiasme, il désirait se faire un petit nom dans la littérature.
Il entra par la petite porte dans un salon littéraire à l'aide d'un auteur en vogue qui l'a pris en affection.
Mais Oh … Pauvre choux ! Tu n'avais pas anticipé les regards de méfiance et de fausse courtoisie d'un salon littéraire.
C'était une victime et devinez pourquoi ? Il avait le malheur d'être noble, ce qui attirait les sots préjugés et suspicion des autres bohèmes.
Il s'arrêta à cette déception, n'avait pas le courage de briser les codes rigides et caricaturaux auxquels on l'identifiait à tort, n'avait pas l'audace de braver ses adversaires de salon en se montrant étonnamment joyeux, haut en couleur, humble, ce qui les auraient surpris et séduits ! Lamartine (noble aussi), pouvait être accueilli chaleureusement, fièrement, à bras ouverts dans les salons et lui-même se montrait fraternel.
Il avait ses ennemis également mais c'est pour vous dire que ce n'était nullement impossible pour lui de se mélanger avec les jeunes bohèmes et autres artistes en herbe.
Non lui, tout au contraire, dans un salon se tint rigide comme un bâton, et quand il était l'heure de se faire distinguer, vociféra un commentaire tout aussi lâche que stupide visant Delphine de Girardin qui lisait à voix haute un poème.
Splendide effet ! Il se lamentera plus tard d'avoir fait l'objet d'une vengeance qui aurait été commanditée par elle… Oh tient comme c'est étrange !
Ces quelques mésaventures ne l'ont pas empêché de se construire une belle notoriété de critique littéraire. Il est même craint et respecté. Il subissait, comme tant d'autres, la trahison des auteurs qu'il a louangé dans ses critiques et la versatilité d'autres critiques littéraires qui, parfois l'admiraient, et d'autre fois le dénigraient volontiers sans raison apparente.
Dans ses tumultes littéraires, il trouva refuge au sein d'un des salons littéraires du faubourg Saint-Germain. Alors qu'il se complaisait tant bien que mal en compagnie d'esprits médiocres mais courtois, une dernière déception acheva de le briser. Ledit salon avait sa bête noire, un auteur sur lequel on se défoulait. Mais aussitôt que l'auteur se trouva nommé à l'académie française, tout le salon se hâta d'assister au premier discours de l'auteur à l'académie, comme si c'eût toujours été de fidèles admirateurs, car il était de bon ton d'être vu de tous à ce genre de cérémonie…
C'était l'écoeurement de trop qui le poussa à s'exiler de Paris en pleine campagne où il compilera une à une toutes ses désillusions.
Il ouvre alors une brèche pour une histoire radicalement différente : il nous raconte comment, Maire d'un petit village, il fut sensible, expansif, altruiste… à l'excès ! Car comprenez-vous, il est tellement parfait qu'il en devient maladroit, à trop aider et s'ingérer avec bienveillance pour les autres, il se fait avoir, provoque des catastrophes et n'a que peu de gratitude.
Il fait semblant d'être modeste et lucide sur sa qualité de Maire mais on voit bien pourquoi il nous détaille tout cela : en réalité il veut compenser son vomi précédent et dire « voyez à quel point je suis bon, vertueux ! Et comme vous êtes ingrat ! Que ma vengeance est juste ! ».
Quelqu'en soit ses réelles intentions, ce qu'il a fait est touchant, tout comme l'aide qu'il a réellement donné à certains petits artistes parisiens à leurs débuts. On ne peut lui nier malgré tout une certaine bonté de coeur même si elle est enveloppée d'une lourde rancoeur.
Il y a cependant tout le long bien trop de toute cette rancoeur qui se promène avec la calomnie.
Entre autres : Il méprise les vaudevillistes et que dit-il ? Il les résume à des affairistes ne sachant pas communiquer autrement qu'en argot « bouffer » « casse-gueule » … Et donne l'impression qu'ils font leurs pièces sur le coin d'un bar, entre deux orgies… Tout ceci est grossièrement faux, ce procédé est infâme, digne des pires journaux de caricature de l'époque.
On y trouve aussi quelques contradictions. Il critique dans le public littéraire, ce qu'il appelle « l'homme bien informé » qui est cet homme pour qui l'oeuvre en elle-même ne compte pas. Au théâtre, il lorgne les loges et commente le tout public.
Il lit une oeuvre à scandale en remarquant que telle héroïne serait telle fille dans cette ville, tel créancier serait ce fameux banquier… Il se moque d'un auteur en le jugeant au travers de ses ventes…
Et que fait-il lui ? Il enchaîne successivement ragots sur ragots et anecdotes visant tel ou tel auteur sans y ressentir la moindre contradiction. Certes, il peut jouer sur les deux tableaux oui : il peut à tout à la fois être critique littéraire et ragoteur mais il y a très peu de substance pour la critique, ce ne sont que de vagues déclarations péremptoires sur la littérature moderne.
Le style est fin, orignal, recherché mais je lui reproche d'appliquer un surplus de vernis, artificiellement élégant, comme pour mieux redorer ses dénigrements d'assez bas étages. Il m'est difficile d'apprécier sa qualité de critique littéraire, il est bien trop généraliste dans cet ouvrage, il faudrait l'apprécier sur des jugements plus précis.
L'avant-crise, son passé, est assez simple : les yeux pleins d'espoirs et d'enthousiasme, il désirait se faire un petit nom dans la littérature.
Il entra par la petite porte dans un salon littéraire à l'aide d'un auteur en vogue qui l'a pris en affection.
Mais Oh … Pauvre choux ! Tu n'avais pas anticipé les regards de méfiance et de fausse courtoisie d'un salon littéraire.
C'était une victime et devinez pourquoi ? Il avait le malheur d'être noble, ce qui attirait les sots préjugés et suspicion des autres bohèmes.
Il s'arrêta à cette déception, n'avait pas le courage de briser les codes rigides et caricaturaux auxquels on l'identifiait à tort, n'avait pas l'audace de braver ses adversaires de salon en se montrant étonnamment joyeux, haut en couleur, humble, ce qui les auraient surpris et séduits ! Lamartine (noble aussi), pouvait être accueilli chaleureusement, fièrement, à bras ouverts dans les salons et lui-même se montrait fraternel.
Il avait ses ennemis également mais c'est pour vous dire que ce n'était nullement impossible pour lui de se mélanger avec les jeunes bohèmes et autres artistes en herbe.
Non lui, tout au contraire, dans un salon se tint rigide comme un bâton, et quand il était l'heure de se faire distinguer, vociféra un commentaire tout aussi lâche que stupide visant Delphine de Girardin qui lisait à voix haute un poème.
Splendide effet ! Il se lamentera plus tard d'avoir fait l'objet d'une vengeance qui aurait été commanditée par elle… Oh tient comme c'est étrange !
Ces quelques mésaventures ne l'ont pas empêché de se construire une belle notoriété de critique littéraire. Il est même craint et respecté. Il subissait, comme tant d'autres, la trahison des auteurs qu'il a louangé dans ses critiques et la versatilité d'autres critiques littéraires qui, parfois l'admiraient, et d'autre fois le dénigraient volontiers sans raison apparente.
Dans ses tumultes littéraires, il trouva refuge au sein d'un des salons littéraires du faubourg Saint-Germain. Alors qu'il se complaisait tant bien que mal en compagnie d'esprits médiocres mais courtois, une dernière déception acheva de le briser. Ledit salon avait sa bête noire, un auteur sur lequel on se défoulait. Mais aussitôt que l'auteur se trouva nommé à l'académie française, tout le salon se hâta d'assister au premier discours de l'auteur à l'académie, comme si c'eût toujours été de fidèles admirateurs, car il était de bon ton d'être vu de tous à ce genre de cérémonie…
C'était l'écoeurement de trop qui le poussa à s'exiler de Paris en pleine campagne où il compilera une à une toutes ses désillusions.
Il ouvre alors une brèche pour une histoire radicalement différente : il nous raconte comment, Maire d'un petit village, il fut sensible, expansif, altruiste… à l'excès ! Car comprenez-vous, il est tellement parfait qu'il en devient maladroit, à trop aider et s'ingérer avec bienveillance pour les autres, il se fait avoir, provoque des catastrophes et n'a que peu de gratitude.
Il fait semblant d'être modeste et lucide sur sa qualité de Maire mais on voit bien pourquoi il nous détaille tout cela : en réalité il veut compenser son vomi précédent et dire « voyez à quel point je suis bon, vertueux ! Et comme vous êtes ingrat ! Que ma vengeance est juste ! ».
Quelqu'en soit ses réelles intentions, ce qu'il a fait est touchant, tout comme l'aide qu'il a réellement donné à certains petits artistes parisiens à leurs débuts. On ne peut lui nier malgré tout une certaine bonté de coeur même si elle est enveloppée d'une lourde rancoeur.
Il y a cependant tout le long bien trop de toute cette rancoeur qui se promène avec la calomnie.
Entre autres : Il méprise les vaudevillistes et que dit-il ? Il les résume à des affairistes ne sachant pas communiquer autrement qu'en argot « bouffer » « casse-gueule » … Et donne l'impression qu'ils font leurs pièces sur le coin d'un bar, entre deux orgies… Tout ceci est grossièrement faux, ce procédé est infâme, digne des pires journaux de caricature de l'époque.
On y trouve aussi quelques contradictions. Il critique dans le public littéraire, ce qu'il appelle « l'homme bien informé » qui est cet homme pour qui l'oeuvre en elle-même ne compte pas. Au théâtre, il lorgne les loges et commente le tout public.
Il lit une oeuvre à scandale en remarquant que telle héroïne serait telle fille dans cette ville, tel créancier serait ce fameux banquier… Il se moque d'un auteur en le jugeant au travers de ses ventes…
Et que fait-il lui ? Il enchaîne successivement ragots sur ragots et anecdotes visant tel ou tel auteur sans y ressentir la moindre contradiction. Certes, il peut jouer sur les deux tableaux oui : il peut à tout à la fois être critique littéraire et ragoteur mais il y a très peu de substance pour la critique, ce ne sont que de vagues déclarations péremptoires sur la littérature moderne.
Le style est fin, orignal, recherché mais je lui reproche d'appliquer un surplus de vernis, artificiellement élégant, comme pour mieux redorer ses dénigrements d'assez bas étages. Il m'est difficile d'apprécier sa qualité de critique littéraire, il est bien trop généraliste dans cet ouvrage, il faudrait l'apprécier sur des jugements plus précis.
Citations et extraits (3)
Ajouter une citation
Midi approchait; nous remontâmes sur la place, qu'avait envahie une foule compacte. Les musiciens préludaient sur leurs instruments : la salle de bal, recouverte d'une tente, décorée de lauriers et de bois, attendait les danseurs. L'adjoint, le garde-champêtre, le doyen de la fabrique, se tenaient près de la fontaine, où il ne manquait plus que de l'eau. C'était à ma danseuse que j'avais réservé l'honneur de tourner le robinet. Je voulais prouver que ma gloire ne m'avait pas fait oublier mon premier engagement, et je présentai galamment ma main gantée de blanc à mademoiselle Eugénie Blanchard, fille du percepteur des contributions. Le général et la préfète voulurent bien nous faire vis-à-vis. J'avais l'oeil fixé sur l'horloge de la mairie, dont l'aiguille marquait midi moins deux minutes. Mon coeur palpitait, ma danseuse rougissait comme une pivoine. C'était un de ces instants solennels qui sont à la vie ordinaire ce que l'Himalaya est à nos collines.
L'orchestre joua la chaîne des dames. Au moment où je battais un triomphant six-quatre devant la préfète, midi sonna. Je m'arrêtai net, un long frémissement parcourut la foule : l'émotion, l'attente, le désir, l'enthousiasme étaient à leur zénith. Mademoiselle Eugénie, passée de l'écarlate au ponceau, s'approcha de la fontaine et tourna le robinet... L'orchestre jouait déjà les premières mesures de l'air : "Où peut-on être mieux qu'au sein de sa famille ?"
Rien ne coula. Rien ! Rien ! RIEN ! En ce moment, il me sembla que Shakespeare s'était trompé...
Un même cri, à grand'peine étouffé, vibra et mourut dans toutes ces poitrines. mes courtisans se hatèrent d'affirmer que l'eau n'avait pas eu le temps de monter et que nous allions la voir jaillir. L'adjoint se pencha sur le tuyau et, y collant son oreille, il nous assura qu'il entendait distinctement le bouillonnement de l'eau qui montait. Je me penchai à mon tour, et j'entendis en effet quelque chose comme un bruit souterrain, pareil à celui que produit la pioche d'un mineur. Nous vécûmes encore cinq minutes sur ce bruit et sur cette espérance. Ces cinq minutes envolées, les visages s'allongèrent d'une façon effrayante. Il fallut bien convenir que ce bruit consolateur, au lieu de se rapprocher, s'éloignait. Dix autres minutes effleurèrent mon front brûlant de leurs ailes de plomb et blanchirent plusieurs mèches de mes cheveux. Je n'osais plus regarder autour de moi; ma main serrait convulsivement la main de ma danseuse, qui ne soufflait mot. Je croyais lire ma honte inscrite sur toutes les figures. Un silence de glace avait succédé au joyeux murmure de la fête. L'orchestre se taisait; mes administrés étaient au désespoir, et mes invités réprimaient une forte envie de rire. Atterré, hébété, stupide, j'appelais tout bas une catastrophe, une révolution, une attaque d'apoplexie, un coup d'épée, un coup de tonnerre qui vint rompre, fût-ce en m'écrasant, cette situation intolérable.
Je fus exaucé : le coup de tonnerre demandé se personnifia dans ma servante, qui se précipita haletante sur la place, en criant :
- Monsieur ! Monsieur ! Il y a une fontaine dans votre salon !
À ces mots magiques, l'espèce d'enchantement qui nous tenait immobiles cessa subitement. Nous descendîmes, nous roulâmes comme une avalanche au bas de la côte. Un poignant spectacle nous y attendait.
Voici ce qui était arrivé.
L'eau, aussi capricieuse que les nymphes et les naïades, ses mythologiques patrones, avait déjoué traîtreusement les efforts de la science. Délogée du bassin où elle coulait depuis des siècles, violentée par une force motrice insuffisante, qui l'avait contrainte sans la dompter, elle s'était ouvert une issue, pendant que nous ajustions les tuyaux neufs destinés à la recevoir, et cette issue souterraine l'avait peu à peu conduite jusqu'au mur de mon rez-de-chaussée. Ce mur était vieux comme tout le reste de la maison...
Par un redoublement d'ironie, à l'instant même où, d'après mon programme, l'eau devait devait jaillir dans la fontaine officielle, elle me donnait, à domicile, une représentation extraordinaire. La trouée s'était faite à cinq pieds au-dessus du parquet, à travers une tapisserie des batailles d'Alexandre. Le piano, les tables à jeu, renversées sens dessus dessous, ressemblaient à des noyés dont on n'aperçoit plus que les jambes. Les albums, les cahiers de musique, les keepsakes, les tapis, les potiches, les cadres, les tentures, se confondaient dans un inexprimable chaos. Mon bon vin, échappé de ses bouteilles brisées, se mêlait à cette eau inhospitalière; mes dressoirs faisaient l'effet d'îles battues par la vague. Les jambons, les galantines, les volailles, le gibier, les soufflés, les compotes, les crèmes, prenaient un bain côte à côte avec mes beaux livres et mes belles reliures...
Je n'ai plus gardé qu'un vague souvenir des moments qui suivirent. Je ne pensais plus, je ne sentais plus, je ne voyais plus. J'avais de l'eau jusqu'à mi-jambe et je ne m'en apercevais pas. Il y avait là un médecin qui eût pitié de moi. il me prit la main, me tata le pouls, déclara que j'avais un violent accès de fièvre, donna ordre que l'on me hissât dans ma chambre, que l'on me fit mettre immédiatement au lit, que l'on me fit servir une potion calmante et qu'on fermât hermétiquement mes fenêtres. Ses ordres furent exécutés, comme sur une machine inerte. Toutefois, comme le sens littéraire résiste chez moi aux plus terribles catastrophes, j'eus le temps avant d'être emporté, d'ouïr les deux mots suivants, qui furent comme l'oraison de mon programme :
- On ne peut pas dire que M. le maire de Gigondas nous ait reçus sèchement, murmura le préfet.
- C'est tout à fait une hospitalité d'homme de lettres, dit la Philaminte : chez lui, la fontaine ne pouvait être qu'une fable.
L'orchestre joua la chaîne des dames. Au moment où je battais un triomphant six-quatre devant la préfète, midi sonna. Je m'arrêtai net, un long frémissement parcourut la foule : l'émotion, l'attente, le désir, l'enthousiasme étaient à leur zénith. Mademoiselle Eugénie, passée de l'écarlate au ponceau, s'approcha de la fontaine et tourna le robinet... L'orchestre jouait déjà les premières mesures de l'air : "Où peut-on être mieux qu'au sein de sa famille ?"
Rien ne coula. Rien ! Rien ! RIEN ! En ce moment, il me sembla que Shakespeare s'était trompé...
Un même cri, à grand'peine étouffé, vibra et mourut dans toutes ces poitrines. mes courtisans se hatèrent d'affirmer que l'eau n'avait pas eu le temps de monter et que nous allions la voir jaillir. L'adjoint se pencha sur le tuyau et, y collant son oreille, il nous assura qu'il entendait distinctement le bouillonnement de l'eau qui montait. Je me penchai à mon tour, et j'entendis en effet quelque chose comme un bruit souterrain, pareil à celui que produit la pioche d'un mineur. Nous vécûmes encore cinq minutes sur ce bruit et sur cette espérance. Ces cinq minutes envolées, les visages s'allongèrent d'une façon effrayante. Il fallut bien convenir que ce bruit consolateur, au lieu de se rapprocher, s'éloignait. Dix autres minutes effleurèrent mon front brûlant de leurs ailes de plomb et blanchirent plusieurs mèches de mes cheveux. Je n'osais plus regarder autour de moi; ma main serrait convulsivement la main de ma danseuse, qui ne soufflait mot. Je croyais lire ma honte inscrite sur toutes les figures. Un silence de glace avait succédé au joyeux murmure de la fête. L'orchestre se taisait; mes administrés étaient au désespoir, et mes invités réprimaient une forte envie de rire. Atterré, hébété, stupide, j'appelais tout bas une catastrophe, une révolution, une attaque d'apoplexie, un coup d'épée, un coup de tonnerre qui vint rompre, fût-ce en m'écrasant, cette situation intolérable.
Je fus exaucé : le coup de tonnerre demandé se personnifia dans ma servante, qui se précipita haletante sur la place, en criant :
- Monsieur ! Monsieur ! Il y a une fontaine dans votre salon !
À ces mots magiques, l'espèce d'enchantement qui nous tenait immobiles cessa subitement. Nous descendîmes, nous roulâmes comme une avalanche au bas de la côte. Un poignant spectacle nous y attendait.
Voici ce qui était arrivé.
L'eau, aussi capricieuse que les nymphes et les naïades, ses mythologiques patrones, avait déjoué traîtreusement les efforts de la science. Délogée du bassin où elle coulait depuis des siècles, violentée par une force motrice insuffisante, qui l'avait contrainte sans la dompter, elle s'était ouvert une issue, pendant que nous ajustions les tuyaux neufs destinés à la recevoir, et cette issue souterraine l'avait peu à peu conduite jusqu'au mur de mon rez-de-chaussée. Ce mur était vieux comme tout le reste de la maison...
Par un redoublement d'ironie, à l'instant même où, d'après mon programme, l'eau devait devait jaillir dans la fontaine officielle, elle me donnait, à domicile, une représentation extraordinaire. La trouée s'était faite à cinq pieds au-dessus du parquet, à travers une tapisserie des batailles d'Alexandre. Le piano, les tables à jeu, renversées sens dessus dessous, ressemblaient à des noyés dont on n'aperçoit plus que les jambes. Les albums, les cahiers de musique, les keepsakes, les tapis, les potiches, les cadres, les tentures, se confondaient dans un inexprimable chaos. Mon bon vin, échappé de ses bouteilles brisées, se mêlait à cette eau inhospitalière; mes dressoirs faisaient l'effet d'îles battues par la vague. Les jambons, les galantines, les volailles, le gibier, les soufflés, les compotes, les crèmes, prenaient un bain côte à côte avec mes beaux livres et mes belles reliures...
Je n'ai plus gardé qu'un vague souvenir des moments qui suivirent. Je ne pensais plus, je ne sentais plus, je ne voyais plus. J'avais de l'eau jusqu'à mi-jambe et je ne m'en apercevais pas. Il y avait là un médecin qui eût pitié de moi. il me prit la main, me tata le pouls, déclara que j'avais un violent accès de fièvre, donna ordre que l'on me hissât dans ma chambre, que l'on me fit mettre immédiatement au lit, que l'on me fit servir une potion calmante et qu'on fermât hermétiquement mes fenêtres. Ses ordres furent exécutés, comme sur une machine inerte. Toutefois, comme le sens littéraire résiste chez moi aux plus terribles catastrophes, j'eus le temps avant d'être emporté, d'ouïr les deux mots suivants, qui furent comme l'oraison de mon programme :
- On ne peut pas dire que M. le maire de Gigondas nous ait reçus sèchement, murmura le préfet.
- C'est tout à fait une hospitalité d'homme de lettres, dit la Philaminte : chez lui, la fontaine ne pouvait être qu'une fable.
C'était un spectacle tout nouveau pour moi. Figurez-vous un gourmand que l'on enfermerait dans une cuisine, et que l'on forcerait d'assister, bouche béante, à tous les détails les plus réalistes des préparatifs d'un grand dîner. Dans une salle étroite et longue, sombre et basse, étaient dressées des tables où s'asseyaient, par groupes inégaux, des jeunes gens de dix-huit à cinquante-cinq ans, préludant à la gloire par la fumée. Ici, des mentons imberbes contrastant avec d'énormes chevelures; là des barbes en broussailles cachant aux trois quarts des joues hâves et amaigries; plus loin, des calvities précoces, des yeux plombés, des regards fébriles; ; partout cet air inquiet et effaré où se trahit le désordre des habitudes. L'âcre senteur du tabac se mêlait à des odeurs fades et rances, particulières aux tables d'hôte de cinquième ordre. Je cherchais vainement sur tous ces visages la douce et poétique gaieté de la jeunesse, l'expansion des natures bien douées, l'aimable cordialité de compagnons de voyages, marchant ensemble par les sentiers difficiles. Le noviciat littéraire s'y révélait à moi sous ces formes rudes et âpres qui caractérisent les démocraties. Des sourires maladifs, un mélange incroyable de trivialité et d'affectation, des mouvements de bêtes fauves essayant leurs dents et leurs griffes, des attitudes faméliques, des mots mis à la torture pour ressembler à des idées, une familiarité brutale, l'envie évidente de dévorer tous leurs supérieurs pour se préparer à écraser tous leurs égaux, tels étaient les traits dominants de cette réunion bizarre, qui promenait en bohème l'art du dix-neuvième siècle.
Eutidème (Jules Sandeau) me présenta, et j'éprouvais aussitôt une sensation qui ne m'a jamais quitté pendant ma carrière littéraire. Je devinai, à une foule de nuances, que, pour ces artistes en littérature, j'étais et resterais toujours un amateur, un étranger, toléré seulement à titre d'hôte passager et d'homme sans conséquences; que l'on m'accablerait de sarcasmes; que l'on s'arrangerait pour faire de mon nom, de ma fortune, de ma position sociale, autant de barrières et d'obstacles entre mon ambition et mon but; que l'on refuserait, en un mot, d'accepter ce déplacement de mon amour-propre, aspirant à effacer le gentilhomme sous l'écrivain. Tous ces gens d'esprit, rimeurs, dramaturges, conteurs, rapins, musiciens, peintres, statuaires, éditeurs, directeurs de théâtres, qui n'étaient pas, semblait-il, grands partisans des distinctions nobiliaires, me donnaient du "monsieur le comte" avec la plus édifiante unanimité; mais évidemment, ce "monsieur le comte" signifiait : "À bon entendeur, salut ! Vous ne serez jamais des nôtres; restez chez vous, et ne chassez pas sur nos terres".
Eutidème (Jules Sandeau) me présenta, et j'éprouvais aussitôt une sensation qui ne m'a jamais quitté pendant ma carrière littéraire. Je devinai, à une foule de nuances, que, pour ces artistes en littérature, j'étais et resterais toujours un amateur, un étranger, toléré seulement à titre d'hôte passager et d'homme sans conséquences; que l'on m'accablerait de sarcasmes; que l'on s'arrangerait pour faire de mon nom, de ma fortune, de ma position sociale, autant de barrières et d'obstacles entre mon ambition et mon but; que l'on refuserait, en un mot, d'accepter ce déplacement de mon amour-propre, aspirant à effacer le gentilhomme sous l'écrivain. Tous ces gens d'esprit, rimeurs, dramaturges, conteurs, rapins, musiciens, peintres, statuaires, éditeurs, directeurs de théâtres, qui n'étaient pas, semblait-il, grands partisans des distinctions nobiliaires, me donnaient du "monsieur le comte" avec la plus édifiante unanimité; mais évidemment, ce "monsieur le comte" signifiait : "À bon entendeur, salut ! Vous ne serez jamais des nôtres; restez chez vous, et ne chassez pas sur nos terres".
Survint un des habitués du salon, Maurice de Prasly; il s'approcha du feu après avoir salué la maîtresse de la maison, et dit étourdiment : "Je suis gelé !"...
- Non, mon cher, vous n'êtes pas gelé., reprit doctoralement Plombagène : si vous étiez gelé, vous ne pourriez plus ni parler, ni marcher; il faut, pour la congélation du corps humain, vingt-huit degrés Réaumur, et nous n'avons ce soir que huit degrés centigrades. Marforius, dans son "Voyage au Spitzberg", donne de curieux détails sur les conditions nécessaires pour qu'un homme soit gelé : les yeux brûlent, le sang cesse de circuler, la vie abandonne les extrémités, les oreilles sont assourdies par un bourdonnement sinistre : j'ai les trois volumes in-4° de ce "Voyage" dans ma bibliothèque; si vous voulez, j'irai vous les chercher et nous les parcourrons ensemble. Au surplus, il n'y avait pas d'hommes mieux renseignés là-dessus que nos vétérans de la campagne de Russie. Je me souviens, entre autres, d'avoir fait causer un sergent qui avait eu l'oreille gauche gelée en sortant de Wilna; dix-neuf ans après, il s'en ressentait encore; nous étions ensemble dans la tranchée, c'était l'avant-veille de la prise d'Anvers...
- Mon ami, je vous en prie, sonnez pour qu'on nous apporte d'autres cartes! s'écria Hapragona, qui avait depuis longtemps compris la nécessité de ces diversions.
- Non, mon cher, vous n'êtes pas gelé., reprit doctoralement Plombagène : si vous étiez gelé, vous ne pourriez plus ni parler, ni marcher; il faut, pour la congélation du corps humain, vingt-huit degrés Réaumur, et nous n'avons ce soir que huit degrés centigrades. Marforius, dans son "Voyage au Spitzberg", donne de curieux détails sur les conditions nécessaires pour qu'un homme soit gelé : les yeux brûlent, le sang cesse de circuler, la vie abandonne les extrémités, les oreilles sont assourdies par un bourdonnement sinistre : j'ai les trois volumes in-4° de ce "Voyage" dans ma bibliothèque; si vous voulez, j'irai vous les chercher et nous les parcourrons ensemble. Au surplus, il n'y avait pas d'hommes mieux renseignés là-dessus que nos vétérans de la campagne de Russie. Je me souviens, entre autres, d'avoir fait causer un sergent qui avait eu l'oreille gauche gelée en sortant de Wilna; dix-neuf ans après, il s'en ressentait encore; nous étions ensemble dans la tranchée, c'était l'avant-veille de la prise d'Anvers...
- Mon ami, je vous en prie, sonnez pour qu'on nous apporte d'autres cartes! s'écria Hapragona, qui avait depuis longtemps compris la nécessité de ces diversions.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Quiz
Voir plus
QUIZ LIBRE (titres à compléter)
John Irving : "Liberté pour les ......................"
ours
buveurs d'eau
12 questions
288 lecteurs ont répondu
Thèmes :
roman
, littérature
, témoignageCréer un quiz sur ce livre288 lecteurs ont répondu