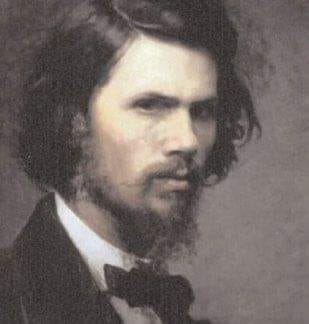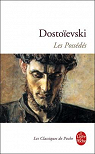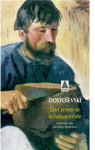Critiques de Fiodor Dostoïevski (1669)
Lorsque j'étais adolescente, il y avait un programme à la télévision qui réunissait assez facilement ma famille. de fait, parents et enfants trouvaient un égal plaisir à se repaître des enquêtes du lieutenant Columbo. C'était une série policière d'un genre assez nouveau pour l'époque. Contrairement à l'habitude, on savait dès le début qui était le coupable et quel était son mode opératoire.
Tout le génie de l'intrigue consistait donc, non pas à démasquer le coupable, mais à savoir comment ce diable d'inspecteur fouineur avec son air con-con inoffensif parviendrait à faire ployer le sang-froid du criminel qui semblait avoir réalisé le crime parfait.
Toujours avec ses airs de ne pas y toucher, par des maladresses calculées, par des questions anodines, par des détails apparemment sans lien avec l'affaire, par une rassurante bonhommie, par un art de faire croire qu'il tombe facilement dans le panneau, le roublard petit lieutenant de police jouait d'estoc et de taille dans la psychologie de son suspect jusqu'à l'excéder, jusqu'à l'exaspérer, jusqu'à lui faire cracher la boulette par inadvertance, jusqu'à le pousser dans ses derniers retranchements et le faire basculer de l'excès de confiance à l'angoisse de savoir son crime révélé au grand jour.
Eh bien cette série policière d'un genre nouveau (lors de sa création à la fin des années 1960), s'inspirait totalement de la technique narrative d'un roman cent ans plus âgé ; vous avez deviné je suppose : Crime Et Châtiment.
Effectivement, ici, Fiodor Mikhaïlovitch Dostoïevski ne cherche à aucun moment à nous dissimuler l'identité du criminel. Il essaie même très patiemment de nous faire pénétrer dans l'intimité de sa psychologie, de son quotidien, de son environnement physique et social, de ses pensées et de ses motivations, dans ses doutes et ses frayeurs d'avant ou d'après crime.
Le lieutenant Columbo de Crime Et Châtiment s'appelle Porphyre Petrovitch. (Il ne me semble pas que l'on nous donne son nom de famille, seulement qu'il est un cousin de Razoumikhine, autre personnage important du roman. Peut-être l'auteur a-t-il jugé préférable de ne pas embrouiller son lecteur en désignant deux personnages clés sous un même patronyme. En ceci, Dostoïevski diffère de William Faulkner qui lui n'eût certainement pas reculé devant la jouissance de baptiser d'un même nom quatorze Razoumikhine et dix-sept Raskolnikov différents !)
Pas d'erreur possible, avec Crime Et Châtiment, vous êtes dans du Dostoïevski pur jus, première pression à froid. du Dostoïevski typique, torturé, illuminé, proche de la folie, entre mystique et politique, mais, ce qui en fait son grand succès auprès des lecteurs, son approche un peu plus aisée que pour ses quatre autres grands romans, c'est qu'il se double d'une enquête policière, qu'on pourrait même catégoriser de thriller psychologique, ce qui le rend plus prenant, plus captivant que d'autres titres comme L'Idiot ou Les Possédés pour le néophyte qui découvre les grandes tragédies romanesques russes du XIXe siècle.
S'il ne fait pas de doute qu'avec ce roman Dostoïevski signe un roman policier, il ne semble pas non plus faire beaucoup discussion sur le fait qu'il s'agisse également d'un roman social et, d'une certaine manière, politique et philosophique.
Je pense qu'il serait une erreur que de s'attarder trop sur le protagoniste principal, Raskolnikov, pour comprendre l'essence et les motivations de l'auteur à s'embarquer dans un projet tel que Crime Et Châtiment. Je crois que le sujet principal est contenu dans le titre : le crime en général et le châtiment en général, pas l'histoire particulière d'un quelconque Raskolnikov, aussi intéressant et complexe soit-il.
Certes, le criminel, cela semble être lui et lui seul, mais quand j'y réfléchis plus attentivement, j'en vois au moins quatre des criminels — criminels à des degrés divers — quatre criminels, donc, et quatre châtiments distincts.
Le premier criminel auquel je pense, c'est l'ivrogne Marmeladov, coupable de faire sombrer sa famille dans la misère la plus noire, coupable de sucer comme un parasite le moindre rouble de ses proches pour s'aller mettre minable, pour se vautrer dans l'alcool, l'alcool, toujours l'alcool jusqu'à l'écoeurement, jusqu'à la déchéance, jusqu'à la honte.
La seconde criminelle, c'est sa femme, Catherine Ivanovna, elle qui utilise ses enfants pour les tâches les plus avilissantes et même, la plus avilissante de toutes, obliger la fille de son mari, Sophie, à se prostituer. le criminel, c'est aussi ce très trouble et très obscur Svidrigaïlov, dont on nous fait entendre qu'il n'est probablement pas pour rien dans le décès brutal de sa femme.
C'est trois-là, augmentés de Raskolnikov bien évidemment, représentent quatre facettes différentes du crime en général. On pourrait encore leur adjoindre les fourbes desseins de Loujine mais je n'insiste pas car ces quatre-là présentent de réelles similitudes.
La première d'entre-elles, c'est le sentiment de culpabilité. Il existe la loi, il existe le crime avéré ou la honte publique, mais il existe pire encore que tout ça, il existe le propre sentiment de culpabilité, un fardeau qui pèse des tonnes et qui vient de nous-même, une chape de plomb qui vous enfonce chaque jour un peu plus, jusqu'aux genoux, jusqu'au ventre, jusqu'au cou, un sentiment qui vous fait ployer mieux que n'importe quelle loi, mieux que n'importe quel doigt inquisiteur de la justice, mieux que l'oeil réprobateur de n'importe quelle divinité, jusqu'à vous aplatir, jusqu'à vous broyer de l'intérieur, jusqu'à vous faire rendre gorge, jusqu'à vous faire implorer grâce.
Marmeladov se fait honte au dernier degré d'avoir sombré si bas ; Catherine Ivanovna ne sait plus où se mettre quand elle pense à ce qu'endure Sophie ; Svidrigaïlov a l'argent qui lui brûle les doigts, cet argent qu'il détient de son épouse morte, Svidrigaïlov voudrait avoir l'air léger, détaché mais même en rêve la culpabilité le ronge, le corrode.
Raskolnikov est extraordinairement plus complexe. Il navigue entre remords et regrets, d'être allé si loin et d'être allé si peu loin, lui qui se voyait la carrure taillée pour les grandes oeuvres politiques, le voilà criminel aux abois, par manque de feu, par manque de force, par manque d'ambition réelle, mais surtout sous l'accablement exercé par le poids de la culpabilité, notamment vis-à-vis de sa mère et de sa soeur.
Dostoïevski nous entraine avec son Raskolnikov sur le terrain idéologique, le socialisme, le nihilisme, le progrès social, le projet révolutionnaire, des terrains sur lesquels il nous remmènera souvent, dans beaucoup de ses romans, un peu comme s'il devait régler des comptes avec le Dostoïevski qu'il a été, le jeune homme politiquement engagé qui fut déporté au bagne durant quatre années et qui, au moment où il écrit ses romans, ne croit probablement plus en grand-chose.
Ne subsiste que la culpabilité, l'impasse, comme dans Les Possédés, et la soif de rédemption qu'elle suscite. L'heure est alors venue de payer l'addition pour avoir cru pouvoir s'extraire de sa condition. L'heure est venue de subir le châtiment, ce qui me permet de trouver une transition commode pour aborder le second point commun des personnages sus-mentionnés, c'est qu'il ne semble exister que deux issues possibles, deux alternatives et deux seulement : le châtiment suprême, d'une certaine façon le soulagement le plus facile, le plus immédiat, et l'autre, le difficile, le dur à gagner, celui de s'humilier à la face du monde et de chercher son salut dans les canons de la religion, de faire sa conversion de Saul en Paul. Et au terme de ce châtiment, peut-être, une faible lueur : la rédemption...
On pourrait encore disserter durant bien des heures sur les motivations et les significations de cette oeuvre buissonnante, foisonnante mais remarquablement bien construite, où l'on retombe sur ses pieds, on l'on va là où l'auteur a décidé de nous conduire.
Sans être une fan absolue, j'avoue prendre beaucoup de plaisir à cette lecture (voir le P.S.) qui porte le sceau des grands chefs-d'oeuvres puisqu'elle ouvre plus de portes chez son lecteur à la clôture du roman qu'elle n'en a ouverte au départ par sa seule intrigue. Alors, une nouvelle fois, chapeau Dostoïevski.
Ceci dit, ce que j'exprime ici n'est qu'un avis, un misérable petit avis, qui ne représente pas grand-chose et qui ne prend de sens, si sens il y a, qu'en regard des autres, des très nombreux autres qui jalonnent les pourtours de Babelio.
P. S. : deux chapitres me paraissent particulièrement exceptionnels quant à leur intensité d'écriture. Il s'agit tout d'abord du double meurtre au chapitre VII de la première partie, et ensuite de la rencontre suffocante entre Dounia et Svidrigaïlov au chapitre V de la sixième partie. Assurément, deux morceaux d'anthologie.
Tout le génie de l'intrigue consistait donc, non pas à démasquer le coupable, mais à savoir comment ce diable d'inspecteur fouineur avec son air con-con inoffensif parviendrait à faire ployer le sang-froid du criminel qui semblait avoir réalisé le crime parfait.
Toujours avec ses airs de ne pas y toucher, par des maladresses calculées, par des questions anodines, par des détails apparemment sans lien avec l'affaire, par une rassurante bonhommie, par un art de faire croire qu'il tombe facilement dans le panneau, le roublard petit lieutenant de police jouait d'estoc et de taille dans la psychologie de son suspect jusqu'à l'excéder, jusqu'à l'exaspérer, jusqu'à lui faire cracher la boulette par inadvertance, jusqu'à le pousser dans ses derniers retranchements et le faire basculer de l'excès de confiance à l'angoisse de savoir son crime révélé au grand jour.
Eh bien cette série policière d'un genre nouveau (lors de sa création à la fin des années 1960), s'inspirait totalement de la technique narrative d'un roman cent ans plus âgé ; vous avez deviné je suppose : Crime Et Châtiment.
Effectivement, ici, Fiodor Mikhaïlovitch Dostoïevski ne cherche à aucun moment à nous dissimuler l'identité du criminel. Il essaie même très patiemment de nous faire pénétrer dans l'intimité de sa psychologie, de son quotidien, de son environnement physique et social, de ses pensées et de ses motivations, dans ses doutes et ses frayeurs d'avant ou d'après crime.
Le lieutenant Columbo de Crime Et Châtiment s'appelle Porphyre Petrovitch. (Il ne me semble pas que l'on nous donne son nom de famille, seulement qu'il est un cousin de Razoumikhine, autre personnage important du roman. Peut-être l'auteur a-t-il jugé préférable de ne pas embrouiller son lecteur en désignant deux personnages clés sous un même patronyme. En ceci, Dostoïevski diffère de William Faulkner qui lui n'eût certainement pas reculé devant la jouissance de baptiser d'un même nom quatorze Razoumikhine et dix-sept Raskolnikov différents !)
Pas d'erreur possible, avec Crime Et Châtiment, vous êtes dans du Dostoïevski pur jus, première pression à froid. du Dostoïevski typique, torturé, illuminé, proche de la folie, entre mystique et politique, mais, ce qui en fait son grand succès auprès des lecteurs, son approche un peu plus aisée que pour ses quatre autres grands romans, c'est qu'il se double d'une enquête policière, qu'on pourrait même catégoriser de thriller psychologique, ce qui le rend plus prenant, plus captivant que d'autres titres comme L'Idiot ou Les Possédés pour le néophyte qui découvre les grandes tragédies romanesques russes du XIXe siècle.
S'il ne fait pas de doute qu'avec ce roman Dostoïevski signe un roman policier, il ne semble pas non plus faire beaucoup discussion sur le fait qu'il s'agisse également d'un roman social et, d'une certaine manière, politique et philosophique.
Je pense qu'il serait une erreur que de s'attarder trop sur le protagoniste principal, Raskolnikov, pour comprendre l'essence et les motivations de l'auteur à s'embarquer dans un projet tel que Crime Et Châtiment. Je crois que le sujet principal est contenu dans le titre : le crime en général et le châtiment en général, pas l'histoire particulière d'un quelconque Raskolnikov, aussi intéressant et complexe soit-il.
Certes, le criminel, cela semble être lui et lui seul, mais quand j'y réfléchis plus attentivement, j'en vois au moins quatre des criminels — criminels à des degrés divers — quatre criminels, donc, et quatre châtiments distincts.
Le premier criminel auquel je pense, c'est l'ivrogne Marmeladov, coupable de faire sombrer sa famille dans la misère la plus noire, coupable de sucer comme un parasite le moindre rouble de ses proches pour s'aller mettre minable, pour se vautrer dans l'alcool, l'alcool, toujours l'alcool jusqu'à l'écoeurement, jusqu'à la déchéance, jusqu'à la honte.
La seconde criminelle, c'est sa femme, Catherine Ivanovna, elle qui utilise ses enfants pour les tâches les plus avilissantes et même, la plus avilissante de toutes, obliger la fille de son mari, Sophie, à se prostituer. le criminel, c'est aussi ce très trouble et très obscur Svidrigaïlov, dont on nous fait entendre qu'il n'est probablement pas pour rien dans le décès brutal de sa femme.
C'est trois-là, augmentés de Raskolnikov bien évidemment, représentent quatre facettes différentes du crime en général. On pourrait encore leur adjoindre les fourbes desseins de Loujine mais je n'insiste pas car ces quatre-là présentent de réelles similitudes.
La première d'entre-elles, c'est le sentiment de culpabilité. Il existe la loi, il existe le crime avéré ou la honte publique, mais il existe pire encore que tout ça, il existe le propre sentiment de culpabilité, un fardeau qui pèse des tonnes et qui vient de nous-même, une chape de plomb qui vous enfonce chaque jour un peu plus, jusqu'aux genoux, jusqu'au ventre, jusqu'au cou, un sentiment qui vous fait ployer mieux que n'importe quelle loi, mieux que n'importe quel doigt inquisiteur de la justice, mieux que l'oeil réprobateur de n'importe quelle divinité, jusqu'à vous aplatir, jusqu'à vous broyer de l'intérieur, jusqu'à vous faire rendre gorge, jusqu'à vous faire implorer grâce.
Marmeladov se fait honte au dernier degré d'avoir sombré si bas ; Catherine Ivanovna ne sait plus où se mettre quand elle pense à ce qu'endure Sophie ; Svidrigaïlov a l'argent qui lui brûle les doigts, cet argent qu'il détient de son épouse morte, Svidrigaïlov voudrait avoir l'air léger, détaché mais même en rêve la culpabilité le ronge, le corrode.
Raskolnikov est extraordinairement plus complexe. Il navigue entre remords et regrets, d'être allé si loin et d'être allé si peu loin, lui qui se voyait la carrure taillée pour les grandes oeuvres politiques, le voilà criminel aux abois, par manque de feu, par manque de force, par manque d'ambition réelle, mais surtout sous l'accablement exercé par le poids de la culpabilité, notamment vis-à-vis de sa mère et de sa soeur.
Dostoïevski nous entraine avec son Raskolnikov sur le terrain idéologique, le socialisme, le nihilisme, le progrès social, le projet révolutionnaire, des terrains sur lesquels il nous remmènera souvent, dans beaucoup de ses romans, un peu comme s'il devait régler des comptes avec le Dostoïevski qu'il a été, le jeune homme politiquement engagé qui fut déporté au bagne durant quatre années et qui, au moment où il écrit ses romans, ne croit probablement plus en grand-chose.
Ne subsiste que la culpabilité, l'impasse, comme dans Les Possédés, et la soif de rédemption qu'elle suscite. L'heure est alors venue de payer l'addition pour avoir cru pouvoir s'extraire de sa condition. L'heure est venue de subir le châtiment, ce qui me permet de trouver une transition commode pour aborder le second point commun des personnages sus-mentionnés, c'est qu'il ne semble exister que deux issues possibles, deux alternatives et deux seulement : le châtiment suprême, d'une certaine façon le soulagement le plus facile, le plus immédiat, et l'autre, le difficile, le dur à gagner, celui de s'humilier à la face du monde et de chercher son salut dans les canons de la religion, de faire sa conversion de Saul en Paul. Et au terme de ce châtiment, peut-être, une faible lueur : la rédemption...
On pourrait encore disserter durant bien des heures sur les motivations et les significations de cette oeuvre buissonnante, foisonnante mais remarquablement bien construite, où l'on retombe sur ses pieds, on l'on va là où l'auteur a décidé de nous conduire.
Sans être une fan absolue, j'avoue prendre beaucoup de plaisir à cette lecture (voir le P.S.) qui porte le sceau des grands chefs-d'oeuvres puisqu'elle ouvre plus de portes chez son lecteur à la clôture du roman qu'elle n'en a ouverte au départ par sa seule intrigue. Alors, une nouvelle fois, chapeau Dostoïevski.
Ceci dit, ce que j'exprime ici n'est qu'un avis, un misérable petit avis, qui ne représente pas grand-chose et qui ne prend de sens, si sens il y a, qu'en regard des autres, des très nombreux autres qui jalonnent les pourtours de Babelio.
P. S. : deux chapitres me paraissent particulièrement exceptionnels quant à leur intensité d'écriture. Il s'agit tout d'abord du double meurtre au chapitre VII de la première partie, et ensuite de la rencontre suffocante entre Dounia et Svidrigaïlov au chapitre V de la sixième partie. Assurément, deux morceaux d'anthologie.
L'Idiot, l'une des quatre ou cinq oeuvres phares de Fiodor Dostoïevski, est un assez long roman, dans la veine russe du XIXème, c'est-à-dire avec un nombre assez important de personnages, plusieurs familles s'étageant des couches moyennes à hautes de la société (mais pas de la très haute aristocratie comme chez Tolstoï) avec différentes identités constitutives assez complexes et autour desquelles gravitent un certains nombres de satellites, tous plus ou moins intéressés (argent, mariage, élévation sociale, simple désir d'être "rincé" à l'oeil, etc.).
Le corps du roman prend racine à Pétersbourg ou dans sa proche banlieue bien que Moscou ou des pays étrangers soient mentionnés à différents endroits.
Le sujet du roman semble être l'effet produit par l'apparition dans cette société d'un homme radicalement différent, mû par son seul désir d'être agréable aux autres, toujours conciliant et bienveillant. Une telle attitude est perçue, au mieux comme de la naïveté, le plus souvent pour de la bêtise et parfois comme une pathologie.
Ce trait de caractère du personnage est d'ailleurs renforcé et rendu ambigu par l'épilepsie qui a nécessité plusieurs années de traitement au héros, le prince Muichkine, dans un établissement spécialisé.
Ainsi, ses prises de positions inattendues, sa mansuétude, sa bonhommie sont souvent mises au compte d'une déficience intellectuelle. Combinées à son humilité naturelle, cette disposition place systématiquement le prince en position d'infériorité vis-à-vis de ses interlocuteurs dans un premier temps.
Mais, le plus souvent, ses mêmes interlocuteurs, tentés de se mettre un peu dans la position d'un "dîner de cons" se retrouvent surpris du caractère pénétrant de ses réflexions et de sa subtilité et en ressentent un certain malaise, en comprenant qu'ils ont un peu été la dupe de la situation, ne sachant plus trop qui est le "con" du dîner.
Mais un roman russe du XIXème ne serait pas tout à fait un roman russe du XIXème sans d'inextricables histoires d'amour, dont une oeuvre comme Anna Karénine constitue l'un des fleurons du genre.
Notre bon prince va évidemment semer le trouble dans le coeur de ces dames, et même, de ces messieurs, qui à son contact vont parfois changer radicalement. La folie de différents personnages n'est jamais très, très loin non plus, ce qui ajoute au cocktail une touche déjantée.
C'est évidemment un très bon roman, mais je lui reproche tout de même des insertions longues et parfois ennuyeuses de personnages comme Hippolyte, jeune nihiliste, à l'article de la mort en raison d'une tuberculose, et Lebedev, un fonctionnaire rapace, entremetteur, fourbe et mielleux, qui, selon moi, n'apportent pas forcément un élan, une grandeur supplémentaire au roman, mais semblent avoir été des expédients pour Dostoïevski, lui permettant à la fois d'aborder quelques notions connexes, mais surtout, de faire des pages, lui qui publiait ses romans en feuilletons et qui avait un besoin vital de se les faire payer comme qui dirait " au poids ".
D'où mes 4 étoiles et non 5, ce qui est toujours éminemment discutable sachant bien sûr que cela ne veut absolument pas dire que je n'ai pas pris beaucoup de plaisir à sa lecture, et au fait, quel genre d'idiote suis-je pour donner des avis sur des oeuvres qui ont fait leurs preuves ?
Le corps du roman prend racine à Pétersbourg ou dans sa proche banlieue bien que Moscou ou des pays étrangers soient mentionnés à différents endroits.
Le sujet du roman semble être l'effet produit par l'apparition dans cette société d'un homme radicalement différent, mû par son seul désir d'être agréable aux autres, toujours conciliant et bienveillant. Une telle attitude est perçue, au mieux comme de la naïveté, le plus souvent pour de la bêtise et parfois comme une pathologie.
Ce trait de caractère du personnage est d'ailleurs renforcé et rendu ambigu par l'épilepsie qui a nécessité plusieurs années de traitement au héros, le prince Muichkine, dans un établissement spécialisé.
Ainsi, ses prises de positions inattendues, sa mansuétude, sa bonhommie sont souvent mises au compte d'une déficience intellectuelle. Combinées à son humilité naturelle, cette disposition place systématiquement le prince en position d'infériorité vis-à-vis de ses interlocuteurs dans un premier temps.
Mais, le plus souvent, ses mêmes interlocuteurs, tentés de se mettre un peu dans la position d'un "dîner de cons" se retrouvent surpris du caractère pénétrant de ses réflexions et de sa subtilité et en ressentent un certain malaise, en comprenant qu'ils ont un peu été la dupe de la situation, ne sachant plus trop qui est le "con" du dîner.
Mais un roman russe du XIXème ne serait pas tout à fait un roman russe du XIXème sans d'inextricables histoires d'amour, dont une oeuvre comme Anna Karénine constitue l'un des fleurons du genre.
Notre bon prince va évidemment semer le trouble dans le coeur de ces dames, et même, de ces messieurs, qui à son contact vont parfois changer radicalement. La folie de différents personnages n'est jamais très, très loin non plus, ce qui ajoute au cocktail une touche déjantée.
C'est évidemment un très bon roman, mais je lui reproche tout de même des insertions longues et parfois ennuyeuses de personnages comme Hippolyte, jeune nihiliste, à l'article de la mort en raison d'une tuberculose, et Lebedev, un fonctionnaire rapace, entremetteur, fourbe et mielleux, qui, selon moi, n'apportent pas forcément un élan, une grandeur supplémentaire au roman, mais semblent avoir été des expédients pour Dostoïevski, lui permettant à la fois d'aborder quelques notions connexes, mais surtout, de faire des pages, lui qui publiait ses romans en feuilletons et qui avait un besoin vital de se les faire payer comme qui dirait " au poids ".
D'où mes 4 étoiles et non 5, ce qui est toujours éminemment discutable sachant bien sûr que cela ne veut absolument pas dire que je n'ai pas pris beaucoup de plaisir à sa lecture, et au fait, quel genre d'idiote suis-je pour donner des avis sur des oeuvres qui ont fait leurs preuves ?
Dostoïevski a écrit son meilleur roman en dernier et il en était parfaitement conscient.
Les Frères Karamazov sont un véritable drame spirituel où il reprend génialement tous les problèmes qui hantent son œuvre. Dostoïevski y explore en effet tous ses thèmes favoris, en projetant les unes contre les autres diverses perspectives existentielles concernant la foi, la rationalité, le bien et le mal, le rapport au religieux ou a l’athéisme, etc.
Le chapitre intitulé « Le Grand Inquisiteur » est un chef d’œuvre littéraire, philosophique, moral et religieux en soi. Il s’agit d’un conte philosophique rempli d’ironie fait par Ivan à son frère Aliocha pour lui présenter la question de la responsabilité de l’humain envers le divin. Jésus s’y fait reprocher par un inquisiteur espagnol à la Renaissance de nuire à l’Église et de rendre malheureuse l’humanité. En refusant l’omnipuissance, Jésus surestimerait l’humanité en lui laissant une liberté dont cette dernière serait indigne et qu’elle ne saurait utiliser. L'inquisiteur croit que l’Église toute-puissante permet de palier à ce manque de jugement commis par Jésus en enlevant cette liberté à l’humanité de manière à lui rendre son bonheur rendu impossible par son divin fondateur.
Une autre idée forte que l’on trouve dans le roman, c’est la conclusion que, si Dieu n’existe pas, l'humanité est livrée à elle-même dans l’amoralité la plus totale. Cette pensée n’a rien d’originale puisqu’on la trouve déjà chez Paul dans le Nouveau Testament : « Si les morts ne ressuscitent pas, Mangeons et buvons, car demain nous mourrons » (1 Cor 15, 37), mais elle est explorée de manière très marquante par Dostoïevski, qui aborde les travers d’une vie purement matérielle aux désirs infinis condamnée à l’insatisfaction sans repos.
La croyance en Dieu permettant, au contraire, exactement comme dans la Critique de la raison pratique de Kant, d’ouvrir la possibilité d’une existence morale digne de ce nom et une espérance permettant de vivre dans la sérénité.
Dostoïevski prévoyait une suite dans les derniers mois de sa vie, l’action aurait repris vingt années plus tard. Peut-être l’a-t-il écrit au Paradis? Si Dieu existe, peut-être aurons nous l’occasion de la lire dans l’autre monde...
Les Frères Karamazov sont un véritable drame spirituel où il reprend génialement tous les problèmes qui hantent son œuvre. Dostoïevski y explore en effet tous ses thèmes favoris, en projetant les unes contre les autres diverses perspectives existentielles concernant la foi, la rationalité, le bien et le mal, le rapport au religieux ou a l’athéisme, etc.
Le chapitre intitulé « Le Grand Inquisiteur » est un chef d’œuvre littéraire, philosophique, moral et religieux en soi. Il s’agit d’un conte philosophique rempli d’ironie fait par Ivan à son frère Aliocha pour lui présenter la question de la responsabilité de l’humain envers le divin. Jésus s’y fait reprocher par un inquisiteur espagnol à la Renaissance de nuire à l’Église et de rendre malheureuse l’humanité. En refusant l’omnipuissance, Jésus surestimerait l’humanité en lui laissant une liberté dont cette dernière serait indigne et qu’elle ne saurait utiliser. L'inquisiteur croit que l’Église toute-puissante permet de palier à ce manque de jugement commis par Jésus en enlevant cette liberté à l’humanité de manière à lui rendre son bonheur rendu impossible par son divin fondateur.
Une autre idée forte que l’on trouve dans le roman, c’est la conclusion que, si Dieu n’existe pas, l'humanité est livrée à elle-même dans l’amoralité la plus totale. Cette pensée n’a rien d’originale puisqu’on la trouve déjà chez Paul dans le Nouveau Testament : « Si les morts ne ressuscitent pas, Mangeons et buvons, car demain nous mourrons » (1 Cor 15, 37), mais elle est explorée de manière très marquante par Dostoïevski, qui aborde les travers d’une vie purement matérielle aux désirs infinis condamnée à l’insatisfaction sans repos.
La croyance en Dieu permettant, au contraire, exactement comme dans la Critique de la raison pratique de Kant, d’ouvrir la possibilité d’une existence morale digne de ce nom et une espérance permettant de vivre dans la sérénité.
Dostoïevski prévoyait une suite dans les derniers mois de sa vie, l’action aurait repris vingt années plus tard. Peut-être l’a-t-il écrit au Paradis? Si Dieu existe, peut-être aurons nous l’occasion de la lire dans l’autre monde...
Avec Les Démons (ou Les Possédés, titre moins conforme mais plus célèbre en français, notamment en raison de l'adaptation théâtrale qu'en a faite Albert Camus, voir le nota bene au bas de cet avis), Dostoïevski s'attelle à un immense canevas politico-sociétal qu'il est difficile de définir en deux mots et dont les limites me semblent, elles-mêmes, assez floues.
Afin de situer quelque peu l'oeuvre, je vous propose de commencer par cet extrait, issu de la bouche de Stepan agonisant (Troisième partie, Chapitre VII, à la fin du sous-chapitre 2), qui me semble révélateur avant de commenter (N.B. : Dostoïevski vient de citer le passage correspondant dans les évangiles, pour ceux que cela intéresse, il s'agit de l'épisode du démoniaque gérasénien qu'on trouve dans les évangiles de Marc, Matthieu ou Luc) :
« Ces démons qui sortent d'un malade et entrent dans des porcs, ce sont toutes les plaies, tous les miasmes, toute l'impureté, tous ces grands et petits démons, qui se sont accumulés, pendant des siècles et des siècles, dans notre grande et chère malade, dans notre Russie. Oui, cette Russie que j'aimais toujours. Mais une grande idée et une grande volonté l'éclaireront d'en haut comme ce possédé du démon, et tous ces démons en sortiront, toute l'impureté, toute cette turpitude qui suppure à la surface... et ils demanderont eux-mêmes à entrer dans des porcs. D'ailleurs peut-être y sont-ils déjà entrés ; peut-être ! C'est nous, nous, et eux, et Petroucha... et les autres avec lui, et moi peut-être le premier, et nous nous précipiterons, déments et enragés, du haut du rocher dans la mer et nous nous noieront tous, et ce sera bien fait pour nous parce que nous ne sommes bons qu'à cela. Mais la malade guérira et "s'assoira aux pieds de Jésus"... »
On comprend bien, je pense, le message que cherche à nous délivrer l'auteur. En ces années 1870, la Russie connaît des troubles, l'ancien ordre établi vacille (notamment depuis l'abolition du servage en 1861), la religion vit une crise et les ferments de la révolte " à la française " commencent à voir le jour.
Des opportunistes de tout poil cherchent à souffler sur les étincelles à coups d'idéologies (socialiste, nihiliste, autres) pour mettre le feu à la Russie et se saisir du pouvoir, quitte à s'adonner au bain de sang. L'aristocratie déchue et proche de la ruine (suite au partage des terres lors de l'abandon du servage) n'y est pas étrangère.
C'est donc ce faisceau de craintes et de menaces que l'auteur essaie de dépeindre dans cet étrange ouvrage, mi politique, mi social, mi romantique, mi mystique (les amateurs de Pagnol et qui savent mieux compter que moi noteront que comme César, moi aussi j'ai quatre tiers dans mon cocktail, voire même un peu plus, mais je n'ai jamais réussi à dénombrer aussi loin).
Fiodor Dostoïevski bâtit un scénario à échafaudage complexe, animé d'une myriade de personnages (les noms russes avec prénom + patronyme, à la longue, finissent par tous se ressembler, je vous conseille de mettre un repère à la page de présentation des personnages, ça vous sera utile jusqu'au bout), dont les principaux semblent être Nikolaï Vsévolodovitch Stavroguine et Petr Stépanovitch Verkhovenski.
Le premier symbolisant l'aristocratie décadente, le second, les classes supérieures arrivistes semant le trouble ; l'ensemble constituant " les démons " dont la Russie " possédée " devra se débarrasser pour recouvrer sa sérénité séculaire.
En somme, une lecture un peu alambiquée, mais pas désagréable, on ne sait pas trop où l'auteur nous emmène, mais il nous emmène. Un séjour en apnée dans la demie folie ambiante de presque tous ses personnages (comme presque toujours chez Dostoïevski), parmi les démons de la Russie tsariste. Tout ceci, bien sûr, n'est que mon diable d'avis, dont je vous invite à vous déposséder s'il ne vous convient pas, car, à lui seul, il ne signifie pas grand-chose.
N. B. : Selon les éditions et les traductions, le titre est transcrit soit sous la forme " Les Possédés ", soit sous la forme " Les Démons ", mais il s'agit bien du même livre. Traditionnellement et parce que les premières traductions françaises l'ont transcrit ainsi, le titre Les Possédés s'est popularisé, tandis que les traductions plus récentes et plus soucieuses de la lettre ont tendance à privilégier Les Démons.
Cette différence, d'ailleurs, se résout à une histoire de contenant et de contenu, c'est selon. Certains mauvais esprits ont tendance à croire qu'il y aurait peut-être aussi une toute petite motivation financière à faire croire à du nouveau sous le soleil avec ces changements de titre, mais personnellement je serais fort surprise qu'un quelconque démon de l'appât du gain puisse posséder un quelconque éditeur, mais allez savoir ?...
Afin de situer quelque peu l'oeuvre, je vous propose de commencer par cet extrait, issu de la bouche de Stepan agonisant (Troisième partie, Chapitre VII, à la fin du sous-chapitre 2), qui me semble révélateur avant de commenter (N.B. : Dostoïevski vient de citer le passage correspondant dans les évangiles, pour ceux que cela intéresse, il s'agit de l'épisode du démoniaque gérasénien qu'on trouve dans les évangiles de Marc, Matthieu ou Luc) :
« Ces démons qui sortent d'un malade et entrent dans des porcs, ce sont toutes les plaies, tous les miasmes, toute l'impureté, tous ces grands et petits démons, qui se sont accumulés, pendant des siècles et des siècles, dans notre grande et chère malade, dans notre Russie. Oui, cette Russie que j'aimais toujours. Mais une grande idée et une grande volonté l'éclaireront d'en haut comme ce possédé du démon, et tous ces démons en sortiront, toute l'impureté, toute cette turpitude qui suppure à la surface... et ils demanderont eux-mêmes à entrer dans des porcs. D'ailleurs peut-être y sont-ils déjà entrés ; peut-être ! C'est nous, nous, et eux, et Petroucha... et les autres avec lui, et moi peut-être le premier, et nous nous précipiterons, déments et enragés, du haut du rocher dans la mer et nous nous noieront tous, et ce sera bien fait pour nous parce que nous ne sommes bons qu'à cela. Mais la malade guérira et "s'assoira aux pieds de Jésus"... »
On comprend bien, je pense, le message que cherche à nous délivrer l'auteur. En ces années 1870, la Russie connaît des troubles, l'ancien ordre établi vacille (notamment depuis l'abolition du servage en 1861), la religion vit une crise et les ferments de la révolte " à la française " commencent à voir le jour.
Des opportunistes de tout poil cherchent à souffler sur les étincelles à coups d'idéologies (socialiste, nihiliste, autres) pour mettre le feu à la Russie et se saisir du pouvoir, quitte à s'adonner au bain de sang. L'aristocratie déchue et proche de la ruine (suite au partage des terres lors de l'abandon du servage) n'y est pas étrangère.
C'est donc ce faisceau de craintes et de menaces que l'auteur essaie de dépeindre dans cet étrange ouvrage, mi politique, mi social, mi romantique, mi mystique (les amateurs de Pagnol et qui savent mieux compter que moi noteront que comme César, moi aussi j'ai quatre tiers dans mon cocktail, voire même un peu plus, mais je n'ai jamais réussi à dénombrer aussi loin).
Fiodor Dostoïevski bâtit un scénario à échafaudage complexe, animé d'une myriade de personnages (les noms russes avec prénom + patronyme, à la longue, finissent par tous se ressembler, je vous conseille de mettre un repère à la page de présentation des personnages, ça vous sera utile jusqu'au bout), dont les principaux semblent être Nikolaï Vsévolodovitch Stavroguine et Petr Stépanovitch Verkhovenski.
Le premier symbolisant l'aristocratie décadente, le second, les classes supérieures arrivistes semant le trouble ; l'ensemble constituant " les démons " dont la Russie " possédée " devra se débarrasser pour recouvrer sa sérénité séculaire.
En somme, une lecture un peu alambiquée, mais pas désagréable, on ne sait pas trop où l'auteur nous emmène, mais il nous emmène. Un séjour en apnée dans la demie folie ambiante de presque tous ses personnages (comme presque toujours chez Dostoïevski), parmi les démons de la Russie tsariste. Tout ceci, bien sûr, n'est que mon diable d'avis, dont je vous invite à vous déposséder s'il ne vous convient pas, car, à lui seul, il ne signifie pas grand-chose.
N. B. : Selon les éditions et les traductions, le titre est transcrit soit sous la forme " Les Possédés ", soit sous la forme " Les Démons ", mais il s'agit bien du même livre. Traditionnellement et parce que les premières traductions françaises l'ont transcrit ainsi, le titre Les Possédés s'est popularisé, tandis que les traductions plus récentes et plus soucieuses de la lettre ont tendance à privilégier Les Démons.
Cette différence, d'ailleurs, se résout à une histoire de contenant et de contenu, c'est selon. Certains mauvais esprits ont tendance à croire qu'il y aurait peut-être aussi une toute petite motivation financière à faire croire à du nouveau sous le soleil avec ces changements de titre, mais personnellement je serais fort surprise qu'un quelconque démon de l'appât du gain puisse posséder un quelconque éditeur, mais allez savoir ?...
Encore novice en littérature russe, il était grand temps que je m'y mette. Souhaitant découvrir Dostoïevski depuis un moment, c'est sur l'Idiot que mon choix s'est arrêté, je ne le regrette pas d'ailleurs.
L'histoire est celle du prince Muichkine, épileptique, qui après avoir passé une grande partie de sa vie en Suisse pour recevoir les soins adéquats à sa maladie, revient à Saint-Pétersbourg pour retrouver une de ses parentes éloignées, Elisabeth Prokofievna( la générale Epantchine). Grâce à son titre et cette parenté avec la générale, notre bon prince va accumuler les rencontres avec des personnages hauts en couleurs. Son immersion dans une société calculatrice et corrompue va entraîner cette âme pure vouée à faire le bien dans une spirale d'intrigues superficielles qui placeront le prince en position d'idiot, car lucide dans son analyse des choses et des gens qui l'entourent. Débordant de simplicité et de gentillesse, Muichkine va vite devenir l'agneau dans la meute de loups...
Magnifique, grandiose, phénoménal, ce roman ne m'a pas laissée indifférente, j'ai presque honte d'avoir fait un court résumé car cette oeuvre ne se lit pas, elle se vit page à page. Grâce à ses nombreux personnages,tous pourvus de caractères bien distinct, le récit offre un portrait intéressant de la société russe du XIXème siècle. Le prince, catapulté au milieu de ces gens prêts à tout fait un peu office de ver dans la pomme, chamboulant les conventions, disant tout haut ce qu'il ne faudrait pas mentionner. Malgré tout, le prince n'est pas si idiot que ça, je l'ai trouvé irradiant de beauté, comme un ange descendu du ciel pour accomplir une mission, finissant par forcer l'admiration des hommes et la passion chez les femmes. Ce livre est fort, malgré son nombre conséquent de pages (900), il nous entraîne dans les abîmes de la folie humaine au fur et à mesure des événements. Tout comme son héros, Dostoïevski "sait raconter" et nous offre une intrigue vivante et haletante avec une fin magistrale à couper le souffle. J'ai adoré et je dirait aux lecteurs qui souhaitent découvrir l'Idiot de ne pas se laisser décourager par la taille du livre et certains passages relativement longs, il faut le lire avec le coeur, prendre le temps de le ressentir, il en vaut la peine!
A lire !
L'histoire est celle du prince Muichkine, épileptique, qui après avoir passé une grande partie de sa vie en Suisse pour recevoir les soins adéquats à sa maladie, revient à Saint-Pétersbourg pour retrouver une de ses parentes éloignées, Elisabeth Prokofievna( la générale Epantchine). Grâce à son titre et cette parenté avec la générale, notre bon prince va accumuler les rencontres avec des personnages hauts en couleurs. Son immersion dans une société calculatrice et corrompue va entraîner cette âme pure vouée à faire le bien dans une spirale d'intrigues superficielles qui placeront le prince en position d'idiot, car lucide dans son analyse des choses et des gens qui l'entourent. Débordant de simplicité et de gentillesse, Muichkine va vite devenir l'agneau dans la meute de loups...
Magnifique, grandiose, phénoménal, ce roman ne m'a pas laissée indifférente, j'ai presque honte d'avoir fait un court résumé car cette oeuvre ne se lit pas, elle se vit page à page. Grâce à ses nombreux personnages,tous pourvus de caractères bien distinct, le récit offre un portrait intéressant de la société russe du XIXème siècle. Le prince, catapulté au milieu de ces gens prêts à tout fait un peu office de ver dans la pomme, chamboulant les conventions, disant tout haut ce qu'il ne faudrait pas mentionner. Malgré tout, le prince n'est pas si idiot que ça, je l'ai trouvé irradiant de beauté, comme un ange descendu du ciel pour accomplir une mission, finissant par forcer l'admiration des hommes et la passion chez les femmes. Ce livre est fort, malgré son nombre conséquent de pages (900), il nous entraîne dans les abîmes de la folie humaine au fur et à mesure des événements. Tout comme son héros, Dostoïevski "sait raconter" et nous offre une intrigue vivante et haletante avec une fin magistrale à couper le souffle. J'ai adoré et je dirait aux lecteurs qui souhaitent découvrir l'Idiot de ne pas se laisser décourager par la taille du livre et certains passages relativement longs, il faut le lire avec le coeur, prendre le temps de le ressentir, il en vaut la peine!
A lire !
Les Nuits Blanches, c’est l’histoire d’un éclair, puis la nuit.
Les Nuits Blanches, c’est l’histoire d’un coup de chance suivi d’un coup de malchance ou l’inverse, selon le point de vue que l’on décide d’adopter.
Les Nuits Blanches, c’est l’histoire probable d’une rencontre improbable entre deux êtres improbables.
Dostoïevski est vraiment tout à fait lui-même dans cette nouvelle ; torturé, hypersensible, amoureux, naïf, pessimiste et inadapté socialement. Ses personnages sont tout cela, et l'on y sent en germe les fragiles penchants du prince Muichkine de L'Idiot.
Un homme, un original, un rêveur, un marginal passe son temps à se construire des contes (des films dirait-on aujourd’hui, mais les films n’existaient pas à l’époque) à propos de tout ; des lieux, des personnes qu’il croise, de la psychologie intime ou du revêtement extérieur de chaque maison qu’il côtoie.
Le soir, c’est son moment favori, car il y peut à loisir laisser divaguer son esprit fécond dans de folles digressions quand la nuit drape d’un voile de ténèbres ces si belles rues de Pétersbourg, ses confidentes, les témoins de ses nuits blanches.
Un soir précisément, alors qu’il est occupé à détailler les faciès des hommes et les façades des maisons, à moins que ça ne soit l’inverse, les faciès des maisons et les façades des hommes, bref, peu importe, un soir, donc, notre homme croise une femme accoudée au parapet d’un pont sur la Neva. Elle semble pleurer.
Gauche, timide, peu sûr de lui et conscient de sa relative inadaptation au monde des humains, le narrateur hésite à l’aborder, d’ailleurs, elle s’est détournée de lui. En voilà assez à notre homme pour dix jours de conjectures sur le pourquoi de cette femme sur ce pont à cette heure et dans cette attitude. Dommage, il aurait aimé s’approcher d’elle.
Soudain, un homme sur l’autre trottoir. Un homme éméché qui semble vouloir chercher noise à la petite créature du pont. Le narrateur court lui porter secours. L’importun est écarté, la conversation peut commencer… et il est temps pour moi de me taire.
Fiodor Dostoïevski met toute sa sensitivité, sa sensibilité, son acuité émotionnelle dans la narration de cette nouvelle, une pure et délectable histoire d’amour. Je ne veux surtout pas vous en dévoiler davantage et vous laisse le soin de la découvrir en vous rappelant que ceci n’est que mon avis, un avis aussi peu fiable et errant que les pensées du héros des Nuits Blanches, c’est-à-dire, pas grand-chose.
Les Nuits Blanches, c’est l’histoire d’un coup de chance suivi d’un coup de malchance ou l’inverse, selon le point de vue que l’on décide d’adopter.
Les Nuits Blanches, c’est l’histoire probable d’une rencontre improbable entre deux êtres improbables.
Dostoïevski est vraiment tout à fait lui-même dans cette nouvelle ; torturé, hypersensible, amoureux, naïf, pessimiste et inadapté socialement. Ses personnages sont tout cela, et l'on y sent en germe les fragiles penchants du prince Muichkine de L'Idiot.
Un homme, un original, un rêveur, un marginal passe son temps à se construire des contes (des films dirait-on aujourd’hui, mais les films n’existaient pas à l’époque) à propos de tout ; des lieux, des personnes qu’il croise, de la psychologie intime ou du revêtement extérieur de chaque maison qu’il côtoie.
Le soir, c’est son moment favori, car il y peut à loisir laisser divaguer son esprit fécond dans de folles digressions quand la nuit drape d’un voile de ténèbres ces si belles rues de Pétersbourg, ses confidentes, les témoins de ses nuits blanches.
Un soir précisément, alors qu’il est occupé à détailler les faciès des hommes et les façades des maisons, à moins que ça ne soit l’inverse, les faciès des maisons et les façades des hommes, bref, peu importe, un soir, donc, notre homme croise une femme accoudée au parapet d’un pont sur la Neva. Elle semble pleurer.
Gauche, timide, peu sûr de lui et conscient de sa relative inadaptation au monde des humains, le narrateur hésite à l’aborder, d’ailleurs, elle s’est détournée de lui. En voilà assez à notre homme pour dix jours de conjectures sur le pourquoi de cette femme sur ce pont à cette heure et dans cette attitude. Dommage, il aurait aimé s’approcher d’elle.
Soudain, un homme sur l’autre trottoir. Un homme éméché qui semble vouloir chercher noise à la petite créature du pont. Le narrateur court lui porter secours. L’importun est écarté, la conversation peut commencer… et il est temps pour moi de me taire.
Fiodor Dostoïevski met toute sa sensitivité, sa sensibilité, son acuité émotionnelle dans la narration de cette nouvelle, une pure et délectable histoire d’amour. Je ne veux surtout pas vous en dévoiler davantage et vous laisse le soin de la découvrir en vous rappelant que ceci n’est que mon avis, un avis aussi peu fiable et errant que les pensées du héros des Nuits Blanches, c’est-à-dire, pas grand-chose.
Epoustouflant !
Difficile de nier l'évidence : en lisant Dostoïevski on se trouve face à un maître de la littérature.
(Et très clairement, Crime et Châtiment fait partie des romans qu'il faut avoir lu dans sa vie)
Qui n'a jamais été si en colère qu'un jour il a été tenté de dire qu'il tuerai quelqu'un ? Le thème du meurtre en soi n'est pas une nouveauté dans la littérature. Ce qui l'est en revanche, c'est la manière dont l'auteur a traité ce thème.
Dans un premier temps, c'est la rage de Raskolnikov qu'on voit, convaincu que sa logeuse, l'horrible Aliona Ivanova est non seulement cruelle mais (comme le disent les étudiants socialistes à la taverne) "inutile". Un jugement très lourd à porter sur un de ses semblables. Comment peut-on en arriver à une telle sentence ? Chacun d'entre nous n'est-il pas l' "inutile" (ou pire!) de quelqu'un d'autre ? Qui a raison ? Aliona Ivanovna est décrite de telle façon qu'il est impossible pour le lecteur d'éprouver une quelconque compassion à son égard. Petit tyran cynique de son immeuble, si tous se moquent d'elle, elle a tout de même son rôle dans cette communauté, rôle qu'elle exerce de manière très zélée d'ailleurs. Mais, au fond, qu'est-ce qui peut justifier q'un être humain prenne la vie d'un de ses semblables ? Le geste de Rodia était-il vraiment nécessaire ?
De là s'en suivent de longues errances dans la démence pour notre personnage principal - le lecteur aussi peut se perdre entre rêve et réalité. D'abord opposé à l'idée de rédemption, que ce soit sur le plan judiciaire ou religieux, il finit bien sûr par faire pénitence pour racheter son âme.
J'ai été très admirative sur les questions philosophiques que pose cette oeuvre. Le jeu du chat et la souris entre Porphiri et Rodia. La description de la vie quotidienne pour ces pauvres diables à Saint Pétersbourg faite de violence - pas nécessairement physique. Et surtout, j'ai été fascinée par la rage et la fougue qui anime chacun de ses personnages. Il y a énormément de tension dans ce récit, l'atmosphère est lourde et presque oppressante, et avec tout cela, Dostoïevski réussit à en sortir quelque chose de beau.
XIXème siècle oblige, les portraits féminins sont assez stéréotypés - alors que les personnages masculins sont bien plus complexes et plus travaillés. D'un côté, la mère effacée soucieuse du bien-être de ses enfants au point que cela la rend aveugle, la soeur virginale qui incarne avec Sonia l'abnégation de soi (sur le plan moral pour l'une et physique pour l'autre) et enfin, la catin au coeur pur et pieuse méprisée par les "bonnes gens". Mais c'est quelque chose que l'on pardonne assez aisément à l'auteur. Il était dans l'air de son temps ....
Et je pense qu'il va falloir que je m'arrête là, car ce livre m'a tellement passionnée que j'en parlerai volontiers pendant des heures. Et ça finirait par faire une critique vraiment très longue (et indigeste!). Juste une petite remarque : la note du traducteur (André Markowicz) de l'édition Babel est très intéressante et si vous en avez l'occasion, je vous encourage à la lire.
Difficile de nier l'évidence : en lisant Dostoïevski on se trouve face à un maître de la littérature.
(Et très clairement, Crime et Châtiment fait partie des romans qu'il faut avoir lu dans sa vie)
Qui n'a jamais été si en colère qu'un jour il a été tenté de dire qu'il tuerai quelqu'un ? Le thème du meurtre en soi n'est pas une nouveauté dans la littérature. Ce qui l'est en revanche, c'est la manière dont l'auteur a traité ce thème.
Dans un premier temps, c'est la rage de Raskolnikov qu'on voit, convaincu que sa logeuse, l'horrible Aliona Ivanova est non seulement cruelle mais (comme le disent les étudiants socialistes à la taverne) "inutile". Un jugement très lourd à porter sur un de ses semblables. Comment peut-on en arriver à une telle sentence ? Chacun d'entre nous n'est-il pas l' "inutile" (ou pire!) de quelqu'un d'autre ? Qui a raison ? Aliona Ivanovna est décrite de telle façon qu'il est impossible pour le lecteur d'éprouver une quelconque compassion à son égard. Petit tyran cynique de son immeuble, si tous se moquent d'elle, elle a tout de même son rôle dans cette communauté, rôle qu'elle exerce de manière très zélée d'ailleurs. Mais, au fond, qu'est-ce qui peut justifier q'un être humain prenne la vie d'un de ses semblables ? Le geste de Rodia était-il vraiment nécessaire ?
De là s'en suivent de longues errances dans la démence pour notre personnage principal - le lecteur aussi peut se perdre entre rêve et réalité. D'abord opposé à l'idée de rédemption, que ce soit sur le plan judiciaire ou religieux, il finit bien sûr par faire pénitence pour racheter son âme.
J'ai été très admirative sur les questions philosophiques que pose cette oeuvre. Le jeu du chat et la souris entre Porphiri et Rodia. La description de la vie quotidienne pour ces pauvres diables à Saint Pétersbourg faite de violence - pas nécessairement physique. Et surtout, j'ai été fascinée par la rage et la fougue qui anime chacun de ses personnages. Il y a énormément de tension dans ce récit, l'atmosphère est lourde et presque oppressante, et avec tout cela, Dostoïevski réussit à en sortir quelque chose de beau.
XIXème siècle oblige, les portraits féminins sont assez stéréotypés - alors que les personnages masculins sont bien plus complexes et plus travaillés. D'un côté, la mère effacée soucieuse du bien-être de ses enfants au point que cela la rend aveugle, la soeur virginale qui incarne avec Sonia l'abnégation de soi (sur le plan moral pour l'une et physique pour l'autre) et enfin, la catin au coeur pur et pieuse méprisée par les "bonnes gens". Mais c'est quelque chose que l'on pardonne assez aisément à l'auteur. Il était dans l'air de son temps ....
Et je pense qu'il va falloir que je m'arrête là, car ce livre m'a tellement passionnée que j'en parlerai volontiers pendant des heures. Et ça finirait par faire une critique vraiment très longue (et indigeste!). Juste une petite remarque : la note du traducteur (André Markowicz) de l'édition Babel est très intéressante et si vous en avez l'occasion, je vous encourage à la lire.
Quelle belle claque littéraire !
Lecture achevée, je ne peux m'étonner d'apprendre que Victor Hugo comptait parmi les écrivains favoris de Dostoïevski. Il y a bien dans "Crime et Châtiment" une part de ses "Misérables", et dans la figure de Raskolnikov, quelques uns des traits de Jean Valjean.
Au cours de ma lecture, j'ai eu l'occasion de visiter à Saint-Pétersbourg le dernier appartement habité par Dostoïevski, et ce fut comme si je m'étais profondément imprégnée de sa personnalité, sentiment assez troublant je dois dire. Je peine à trouver les mots qui exprimeraient avec justesse la multitude d'émotions ressenties au fil des quelques 700 pages de ce roman finalement assez condensé, aux allures de huis-clos. Le sentiment d'oppression, la peur, le dégoût, la colère, l'affection, la pitié font quoi qu'il en soit partie du cortège.
Et que dire de la plume de l'auteur ? On comprend immédiatement à lire sa prose pourquoi les Russes sont aujourd'hui encore si attachés à son oeuvre qui dénote une compréhension profonde de l'ordre social et des misères humaines. Roman psychologique aux allures de polar, quête idéologique en butte avec une société qui tarde à s'émanciper et à se renouveler, "Crime et Châtiment" a connu un grand succès dès sa parution en 1866, malgré la noirceur de son thème, plutôt iconoclaste pour la période.
Un classique qui n'est pas prêt de sombrer dans l'oubli.
Challenge 19ème siècle 2016
Challenges PAVES
Challenge BBC
Lecture achevée, je ne peux m'étonner d'apprendre que Victor Hugo comptait parmi les écrivains favoris de Dostoïevski. Il y a bien dans "Crime et Châtiment" une part de ses "Misérables", et dans la figure de Raskolnikov, quelques uns des traits de Jean Valjean.
Au cours de ma lecture, j'ai eu l'occasion de visiter à Saint-Pétersbourg le dernier appartement habité par Dostoïevski, et ce fut comme si je m'étais profondément imprégnée de sa personnalité, sentiment assez troublant je dois dire. Je peine à trouver les mots qui exprimeraient avec justesse la multitude d'émotions ressenties au fil des quelques 700 pages de ce roman finalement assez condensé, aux allures de huis-clos. Le sentiment d'oppression, la peur, le dégoût, la colère, l'affection, la pitié font quoi qu'il en soit partie du cortège.
Et que dire de la plume de l'auteur ? On comprend immédiatement à lire sa prose pourquoi les Russes sont aujourd'hui encore si attachés à son oeuvre qui dénote une compréhension profonde de l'ordre social et des misères humaines. Roman psychologique aux allures de polar, quête idéologique en butte avec une société qui tarde à s'émanciper et à se renouveler, "Crime et Châtiment" a connu un grand succès dès sa parution en 1866, malgré la noirceur de son thème, plutôt iconoclaste pour la période.
Un classique qui n'est pas prêt de sombrer dans l'oubli.
Challenge 19ème siècle 2016
Challenges PAVES
Challenge BBC
La bonté existe-t-elle ? Y a-t-il une place pour elle dans ce monde ou n’est-elle considérée que comme une marque de faiblesse voire d’idiotie qui rendrait inapte à la vie sociale ? L’homme bon, s’il existe, est-il forcément voué à n’avoir qu’un destin tragique, ne connaître que les tourments de l’existence et jamais le bonheur qui est impossible à atteindre ?
Un lecteur Babelio écrivait, à propos des Frères Karamazov, qu’il était hermétique à la dimension métaphysique qu’on trouve chez Dostoïevski à cause du grand pessimisme sur le fond de la nature humaine que recèlent ses œuvres. C’est au contraire la seule dimension qui me parle et qui fait que j’aime autant cet écrivain.
Il offre une découverte de la société russe du XIXe siècle et nous invite à nous poser des questions, même si elles n’ont pas forcément de réponses uniques, dogmatiques et immuables. C’est le propre de toute démarche philosophique. J’aime cette façon de mêler intrigue romanesque, philosophie, politique et de nous inciter ainsi à réfléchir sur nous-mêmes, autrui et le monde.
Dostoïevski le fait dans L’Idiot à travers l’évocation du destin tragique du prince Muichkine qui revient de Suisse où il était soigné pour épilepsie. Dès son arrivée à Saint-Pétersbourg, il apparaît comme un être différent, un homme infiniment pur dont la candeur est objet de curiosité, de moqueries et de fascination. Elle ne lui permettra pas de sauver la trop belle Nastassia Philippovna. Sa maladie fait qu’on le croit idiot mais il est en fait plus intelligent que ne le pensent les gens. Il perçoit avec une sensibilité et une acuité intolérables le drame que vit Nastassia et veut donc à tout prix l’aider, quitte à sacrifier son propre bonheur. Il ne supporte pas le mal sous toutes ses formes et fait figure d’inadapté social. Il n’accepte pas le fonctionnement classique de la société dont la majorité s’accommode fort bien.
Nastassia est une orpheline. Totski l’a recueillie et en a fait sa maîtresse, il veut désormais épouser une femme respectable et non une courtisane. Il entreprend de se débarrasser de Nastassia. Il propose cent mille roubles à Gania Ivolguine pour l’épouser. Révoltée, Nastassia préfère s’enfuir avec Rogojine qui la convoite mais la mènera au déshonneur et au malheur. Le prince, qui est sous son charme, veut lui éviter ce sort funeste et prend le risque de provoquer la jalousie de Rogojine. Pour sauver Nastassia, il est prêt à renoncer à un mariage avec Aglaé que Nastassia voit pourtant comme une épouse idéale pour le prince.
Certains thèmes abordés dans ce roman restent d’actualité et ont même fait l’objet de nombreuses récupérations politiques : la peine de mort, le rapport à l’argent, la pauvreté, la redistribution des richesses.
Plusieurs personnages sont tragiques et émouvants. Nastassia a le sort funeste réservé jadis aux filles pauvres, sans famille mais belles et désirables, donc vouées à la prostitution de luxe. Hippolyte est mourant à cause de la phtisie alors qu’il n’a que dix-huit ans et, dans un ultime cri de désespoir, développe ses idées sur les pauvres qui se plaignent tout le temps, jalousent la fortune des riches car ils la voudraient pour eux et en oublient qu’ils ont la vie devant eux et la liberté de réaliser leurs rêves. Il raconte comment il a aidé, grâce à ses relations, un médecin renvoyé, tombé dans la misère avec sa femme enceinte, à retrouver un poste. Quant au prince Muichkine, malgré l’épilepsie, maladie qui touche le cerveau – le Grand Mal, à l’époque, était effrayant et ne se soignait pas – il apparaît comme un intellectuel. Sensible, philosophe et passionné, il a un avis sur de nombreux sujets, dont la peine de mort, acte cruel et froid, après avoir assisté à une horrible exécution en Europe. En Suisse, il parlait aux enfants et les guidait, il les a convaincus de cesser de persécuter une jeune fille que tout le monde maltraitait parce qu’elle avait été séduite par un homme avant d’être abandonnée. Ses efforts presque désespérés pour sauver la veuve et l’orphelin, rendre le monde, et surtout l’être humain, meilleurs semblent souvent vains, dérisoires mais néanmoins nécessaires, indispensables.
L’Idiot est, pour moi, un roman sombre et troublant qui donne l’impression que la bonté est minuscule face au Grand Mal qui finira inéluctablement par l’anéantir. Elle aura cependant laissé une trace infime sur terre et dans la vie de ceux qui l’auront croisée puis qui continueront leur paisible existence, à l’instar d’Aglaé, comme si de rien n’était.
Un lecteur Babelio écrivait, à propos des Frères Karamazov, qu’il était hermétique à la dimension métaphysique qu’on trouve chez Dostoïevski à cause du grand pessimisme sur le fond de la nature humaine que recèlent ses œuvres. C’est au contraire la seule dimension qui me parle et qui fait que j’aime autant cet écrivain.
Il offre une découverte de la société russe du XIXe siècle et nous invite à nous poser des questions, même si elles n’ont pas forcément de réponses uniques, dogmatiques et immuables. C’est le propre de toute démarche philosophique. J’aime cette façon de mêler intrigue romanesque, philosophie, politique et de nous inciter ainsi à réfléchir sur nous-mêmes, autrui et le monde.
Dostoïevski le fait dans L’Idiot à travers l’évocation du destin tragique du prince Muichkine qui revient de Suisse où il était soigné pour épilepsie. Dès son arrivée à Saint-Pétersbourg, il apparaît comme un être différent, un homme infiniment pur dont la candeur est objet de curiosité, de moqueries et de fascination. Elle ne lui permettra pas de sauver la trop belle Nastassia Philippovna. Sa maladie fait qu’on le croit idiot mais il est en fait plus intelligent que ne le pensent les gens. Il perçoit avec une sensibilité et une acuité intolérables le drame que vit Nastassia et veut donc à tout prix l’aider, quitte à sacrifier son propre bonheur. Il ne supporte pas le mal sous toutes ses formes et fait figure d’inadapté social. Il n’accepte pas le fonctionnement classique de la société dont la majorité s’accommode fort bien.
Nastassia est une orpheline. Totski l’a recueillie et en a fait sa maîtresse, il veut désormais épouser une femme respectable et non une courtisane. Il entreprend de se débarrasser de Nastassia. Il propose cent mille roubles à Gania Ivolguine pour l’épouser. Révoltée, Nastassia préfère s’enfuir avec Rogojine qui la convoite mais la mènera au déshonneur et au malheur. Le prince, qui est sous son charme, veut lui éviter ce sort funeste et prend le risque de provoquer la jalousie de Rogojine. Pour sauver Nastassia, il est prêt à renoncer à un mariage avec Aglaé que Nastassia voit pourtant comme une épouse idéale pour le prince.
Certains thèmes abordés dans ce roman restent d’actualité et ont même fait l’objet de nombreuses récupérations politiques : la peine de mort, le rapport à l’argent, la pauvreté, la redistribution des richesses.
Plusieurs personnages sont tragiques et émouvants. Nastassia a le sort funeste réservé jadis aux filles pauvres, sans famille mais belles et désirables, donc vouées à la prostitution de luxe. Hippolyte est mourant à cause de la phtisie alors qu’il n’a que dix-huit ans et, dans un ultime cri de désespoir, développe ses idées sur les pauvres qui se plaignent tout le temps, jalousent la fortune des riches car ils la voudraient pour eux et en oublient qu’ils ont la vie devant eux et la liberté de réaliser leurs rêves. Il raconte comment il a aidé, grâce à ses relations, un médecin renvoyé, tombé dans la misère avec sa femme enceinte, à retrouver un poste. Quant au prince Muichkine, malgré l’épilepsie, maladie qui touche le cerveau – le Grand Mal, à l’époque, était effrayant et ne se soignait pas – il apparaît comme un intellectuel. Sensible, philosophe et passionné, il a un avis sur de nombreux sujets, dont la peine de mort, acte cruel et froid, après avoir assisté à une horrible exécution en Europe. En Suisse, il parlait aux enfants et les guidait, il les a convaincus de cesser de persécuter une jeune fille que tout le monde maltraitait parce qu’elle avait été séduite par un homme avant d’être abandonnée. Ses efforts presque désespérés pour sauver la veuve et l’orphelin, rendre le monde, et surtout l’être humain, meilleurs semblent souvent vains, dérisoires mais néanmoins nécessaires, indispensables.
L’Idiot est, pour moi, un roman sombre et troublant qui donne l’impression que la bonté est minuscule face au Grand Mal qui finira inéluctablement par l’anéantir. Elle aura cependant laissé une trace infime sur terre et dans la vie de ceux qui l’auront croisée puis qui continueront leur paisible existence, à l’instar d’Aglaé, comme si de rien n’était.
Raskolnikov, ancien étudiant, vit pauvrement dans une chambre misérable. Dans sa terrible solitude et son accablement, il va inventer une théorie selon laquelle la société est composée de deux catégories d’individus. La catégorie inférieure; composée d’hommes soumis, posés, conservateurs et ayant pour seul but de perpétrer le monde. Et la catégorie de « vrais hommes » qui ont le talent et le don de dire une parole nouvelle, de mener l’humanité vers un but, vers une nouvelle organisation. Cette seconde catégorie de surhommes aurait alors tous les droits pour mener à bien leur mission ; même celui de tuer. Si l’idée est grandiose, le crime est permis et même nécessaire.
Raskolnikov se sent investi d’une mission, il se sent trop intelligent pour rester dans l’ornière. Il veut devenir un « Napoléon ». Il ne sera peut-être pas maitre du monde dans le présent, il sera sans doute d’abord supplicié. Mais plus tard, comme beaucoup de ces grands hommes destructeurs, il sera mis sur un piédestal et adulé.
Raskolnikov a tout pour réaliser ce projet fou. Il est intelligent, hautain, insensible, vaniteux, orgueilleux, audacieux, arrogant. Mais il est aussi mélancolique, généreux. Sa faille : il se pose des questions qu’un « Napoléon » ne se poserait pas. « L’homme est-il un pou ? », « Ai-je le droit de prendre ce pouvoir ? ». En lui, se confrontent deux personnages.
Son action manque de décorum, elle n’est pas glorieuse, elle n’est pas grandiose. On ne pourra que se moquer de lui et considérer qu’il a pêché comme le plus ordinaire des hommes, le plus vil. Il en a honte et n’assume pas le poids de ce fardeau. Il est trop fier pour reconnaitre son échec.
Le chemin est encore long, pour lui, pour accéder à la réalité de ce monde.
Raskolnikov est odieux et détestable dans sa conception d’un monde nihiliste, où l’homme devient un tout puissant, un surhomme qui a sa propre loi. Le pouvoir appartient, pour lui, à ceux qui osent s’en emparer sans s’embarrasser de scrupules moraux.
J’ai aimé l’univers de Dostoïevski qui a su explorer l’âme humaine. Dans cette œuvre, il nous démontre admirablement la bassesse de cet homme vaniteux et méchamment intelligent. Un monde sans valeur, ignorant le bien et le mal, sans moralité est un monde du néant. Raskolnikov ne pourra se sauver que par la mort ou la résurrection de l’homme qui est en lui. Un homme de foi, un homme ordinaire.
Raskolnikov se sent investi d’une mission, il se sent trop intelligent pour rester dans l’ornière. Il veut devenir un « Napoléon ». Il ne sera peut-être pas maitre du monde dans le présent, il sera sans doute d’abord supplicié. Mais plus tard, comme beaucoup de ces grands hommes destructeurs, il sera mis sur un piédestal et adulé.
Raskolnikov a tout pour réaliser ce projet fou. Il est intelligent, hautain, insensible, vaniteux, orgueilleux, audacieux, arrogant. Mais il est aussi mélancolique, généreux. Sa faille : il se pose des questions qu’un « Napoléon » ne se poserait pas. « L’homme est-il un pou ? », « Ai-je le droit de prendre ce pouvoir ? ». En lui, se confrontent deux personnages.
Son action manque de décorum, elle n’est pas glorieuse, elle n’est pas grandiose. On ne pourra que se moquer de lui et considérer qu’il a pêché comme le plus ordinaire des hommes, le plus vil. Il en a honte et n’assume pas le poids de ce fardeau. Il est trop fier pour reconnaitre son échec.
Le chemin est encore long, pour lui, pour accéder à la réalité de ce monde.
Raskolnikov est odieux et détestable dans sa conception d’un monde nihiliste, où l’homme devient un tout puissant, un surhomme qui a sa propre loi. Le pouvoir appartient, pour lui, à ceux qui osent s’en emparer sans s’embarrasser de scrupules moraux.
J’ai aimé l’univers de Dostoïevski qui a su explorer l’âme humaine. Dans cette œuvre, il nous démontre admirablement la bassesse de cet homme vaniteux et méchamment intelligent. Un monde sans valeur, ignorant le bien et le mal, sans moralité est un monde du néant. Raskolnikov ne pourra se sauver que par la mort ou la résurrection de l’homme qui est en lui. Un homme de foi, un homme ordinaire.
Tuer le père en trois leçons.
Après les écrits de Freud, Camus et Zweig sur ce roman, il était important qu'ODP vienne un peu baisser le niveau.
Le psy rêveur à barbe a qualifié l'auteur des Frères Karamazov de névrosé, bisexuel refoulé épileptique dans une préface dont j'ai compris une phrase sur trois. le copain de Sartre et des platanes (désolé) a de son côté (passager) puisé dans ce monument de 950 pages la genèse de « l'Homme révolté », celui qui dit toujours non. Enfin, le grand biographe des vedettes à ombrelles (et éventails) ou rouflaquettes sortait de chez Jardiland quand il compara sans emphase les personnages Dostoïevski à « des géants de la forêt, bruissants et vivants, dont les cimes touchent le ciel, tandis que par des milliers de filaments nerveux ils prennent racine dans le sol de l'épopée et que leur réseau sanguin se ramifie à travers des milliers de pages ». Il avait la chlorophylle poétique entre deux nouvelles de héros suicidés. Avec son meurtre aux circonstances mystérieuses, son enquête et son procès théâtralisé, Les Frères Karamazov suit la trame d'un roman policier. Fiodor Karamazov, la victime, n'a pas volé son sort d'homicidé. Être détestable, il a plumé et rendu folles ses deux épouses et il n'a pas une once d'affection pour ses trois fils : Aliocha (ou Alexis selon les pages), le benjamin, le saint du roman qui consacre sa vie à la religion et à répandre le bien autour de lui, le cadet Dimitri (Mitia pour les intimes), fêtard romantique, panier percé en dette d'affection et Ivan, aîné cultivé qui cultive son nihilisme. Cette progéniture légitime, complétée par un bâtard envieux et épileptique, au nom de bousin, Smerdiakov, a toutes les raisons d'hâter la succession. Dimitri ne cache pas sa détestation pour ce vieux qui lui refuse sa part d'héritage et qui convoite l'élue de son coeur ardent.
Si ce roman est un monument de la littérature, c'est qu'il explore avec génie les questions existentielles de tous ses personnages autour de la foi, de la liberté, du mal et du libre-arbitre (non, pas celui qui fait appel à la VAR, amis footeux).
Certains passages, et notamment celui consacré au poème d'Ivan, « le Grand Inquisiteur », sont incandescents et inflammables. Je vous le résume à ma sauce. La foi reposant sur la liberté de croire sans preuve, la résurrection du Christ tant attendue survient à Séville en pleine inquisition, barbecues d'infidèles et planchas de fornicateurs. Après quelques miracles recyclés des évangiles, le Grand Inquisiteur décide de brûler l'ancien crucifié (pas étonnant qu'il se fasse attendre quand on voit comme il est reçu !) en toute connaissance de cause, pour qu'il ne prive pas l'homme du doute, de l'espoir et de la possibilité de choisir entre le bien et le mal. Sans Dieu, il n'y a plus de frontières entre le bien et le mal. Avec, comment lui pardonner nos souffrances et accepter la justice des hommes ? Les absents n'ont pas toujours tort.
J'ai bien mis deux cents pages et une bonne partie de mes fêtes de fin d'année à rentrer dans le roman tant les digressions morales et la présentation des personnages m'ont parfois demandé une endurance de moine copiste, dont j'ai déjà hélas la coupe, et une patience de pêcheur face à mon impatience de pécheur. La suite du roman est une expérience de lecture assez unique par la richesse des personnages et des dialogues qui portent la narration à un niveau de quasi perfection.
Dernier roman de Dostoïevski, auteur avec qui il ne faut pas compter ses heures, il ne me reste plus qu'à remonter le temps de sa bibliographie.
Incontournable.
Après les écrits de Freud, Camus et Zweig sur ce roman, il était important qu'ODP vienne un peu baisser le niveau.
Le psy rêveur à barbe a qualifié l'auteur des Frères Karamazov de névrosé, bisexuel refoulé épileptique dans une préface dont j'ai compris une phrase sur trois. le copain de Sartre et des platanes (désolé) a de son côté (passager) puisé dans ce monument de 950 pages la genèse de « l'Homme révolté », celui qui dit toujours non. Enfin, le grand biographe des vedettes à ombrelles (et éventails) ou rouflaquettes sortait de chez Jardiland quand il compara sans emphase les personnages Dostoïevski à « des géants de la forêt, bruissants et vivants, dont les cimes touchent le ciel, tandis que par des milliers de filaments nerveux ils prennent racine dans le sol de l'épopée et que leur réseau sanguin se ramifie à travers des milliers de pages ». Il avait la chlorophylle poétique entre deux nouvelles de héros suicidés. Avec son meurtre aux circonstances mystérieuses, son enquête et son procès théâtralisé, Les Frères Karamazov suit la trame d'un roman policier. Fiodor Karamazov, la victime, n'a pas volé son sort d'homicidé. Être détestable, il a plumé et rendu folles ses deux épouses et il n'a pas une once d'affection pour ses trois fils : Aliocha (ou Alexis selon les pages), le benjamin, le saint du roman qui consacre sa vie à la religion et à répandre le bien autour de lui, le cadet Dimitri (Mitia pour les intimes), fêtard romantique, panier percé en dette d'affection et Ivan, aîné cultivé qui cultive son nihilisme. Cette progéniture légitime, complétée par un bâtard envieux et épileptique, au nom de bousin, Smerdiakov, a toutes les raisons d'hâter la succession. Dimitri ne cache pas sa détestation pour ce vieux qui lui refuse sa part d'héritage et qui convoite l'élue de son coeur ardent.
Si ce roman est un monument de la littérature, c'est qu'il explore avec génie les questions existentielles de tous ses personnages autour de la foi, de la liberté, du mal et du libre-arbitre (non, pas celui qui fait appel à la VAR, amis footeux).
Certains passages, et notamment celui consacré au poème d'Ivan, « le Grand Inquisiteur », sont incandescents et inflammables. Je vous le résume à ma sauce. La foi reposant sur la liberté de croire sans preuve, la résurrection du Christ tant attendue survient à Séville en pleine inquisition, barbecues d'infidèles et planchas de fornicateurs. Après quelques miracles recyclés des évangiles, le Grand Inquisiteur décide de brûler l'ancien crucifié (pas étonnant qu'il se fasse attendre quand on voit comme il est reçu !) en toute connaissance de cause, pour qu'il ne prive pas l'homme du doute, de l'espoir et de la possibilité de choisir entre le bien et le mal. Sans Dieu, il n'y a plus de frontières entre le bien et le mal. Avec, comment lui pardonner nos souffrances et accepter la justice des hommes ? Les absents n'ont pas toujours tort.
J'ai bien mis deux cents pages et une bonne partie de mes fêtes de fin d'année à rentrer dans le roman tant les digressions morales et la présentation des personnages m'ont parfois demandé une endurance de moine copiste, dont j'ai déjà hélas la coupe, et une patience de pêcheur face à mon impatience de pécheur. La suite du roman est une expérience de lecture assez unique par la richesse des personnages et des dialogues qui portent la narration à un niveau de quasi perfection.
Dernier roman de Dostoïevski, auteur avec qui il ne faut pas compter ses heures, il ne me reste plus qu'à remonter le temps de sa bibliographie.
Incontournable.
Le doux zéphyr du romantisme a-t-il conduit sa brise jusqu'à la glaciale Pétersbourg ?
En ce milieu du XIXème siècle, Dostoievski semble gagné par la fièvre romantique et imagine une rencontre intense, où deux solitudes abyssales sont soudain débordées par un comblement inouï : gare au choc thermique (et aux pics de variations de l'électrocardiogramme.)
“Nuit Magique, nuit de hasard on se sépare sans trop y croire”….Je nous rassure, ce n'est pas de Fiodor, même dans sa très spontanée traduction d'André Markowicz, mais finalement y a un peu de ça dans Les Nuits Blanches, court roman paru en 1848.
On retrouve cette saccade, ce style pressé, presque oral de Fiodor Dostoievski, si bien retranscrit par Markowicz, “j'ai d'autres soucis que le beau style” souligne le narrateur et plus loin “pardonnez moi si je parle encore de travers…je suis un rêveur.”
Un Rêveur. du libéralisme politique à la rédemption christique, l'immense auteur orthodoxe transpire derrière son avatar qui “a si peu de vie réelle”. L'ombre de l'écrivain plane au-dessus des personnages, et comme un Olympien il se révèle parfois à son “ami lecteur” ou insuffle son don de la narration à son personnage “vous êtes un conteur magnifique”, “vous parlez comme dans un livre” s'exclame ainsi Nastenka.
A l'Ouest, nous sommes habitués au monologue intérieur, à ces sentiments décortiqués du dedans, tout en essayant de faire sens, de se comprendre, de frotter notre langage contre l'autre, comme si tout ce que nous disions avait évidemment un sens équivoque, par des phrases anodines, des intonations, quand on dit il fait beau, il est tard, en fait on se dit je t'aime, tu comptes pour moi, je te pardonnes… c'est une sorte de convention souterraine bien établie et dont l'âme slave de Dostoievski ne s'embarrasse pas, ce qui est proprement désarmant : exprimer les choses les plus profondes, les plus graves, sans dérision, sans avatar, sans pudeur maladive, sans orgueil, ce que résume bien Nastenka “je ressens la moindre chose comme de trop près. Mais bon assez parlé de sentiments, suffit !”
Pourtant Dostoievski n'a rien d'un auteur mièvre ou premier degré, Michel del Castillo, dans sa Postface, souligne cette pitié ignoble de l'auteur qui “verse des larmes d'attendrissement en égorgeant lentement un enfant innocent”, déclinant ainsi la critique acerbe de Milan Kundera pour qui Dostoievski lui rappelait les tankistes russes qui tiraient sur les pragois en versant des larmes des compassion. Dostoeivski est implacable, impitoyable, il donne pour mieux reprendre, il sait par quelles ignominies, désespoirs ses personnages et son lecteur s'apprêtent à passer mais dans un dolorisme messianique il ne peut que les accompagner.
Ces nuits boréales, “nuits de conte” comme l'écrit l'auteur dès les premières lignes, ne peuvent-t-elles arriver que dans la candeur de la jeunesse comme conclut d'entrée de jeu le narrateur ? La jeunesse a-t-elle la primeur de l'amour véritable ?
Qu'en pensez-vous ?
En ce milieu du XIXème siècle, Dostoievski semble gagné par la fièvre romantique et imagine une rencontre intense, où deux solitudes abyssales sont soudain débordées par un comblement inouï : gare au choc thermique (et aux pics de variations de l'électrocardiogramme.)
“Nuit Magique, nuit de hasard on se sépare sans trop y croire”….Je nous rassure, ce n'est pas de Fiodor, même dans sa très spontanée traduction d'André Markowicz, mais finalement y a un peu de ça dans Les Nuits Blanches, court roman paru en 1848.
On retrouve cette saccade, ce style pressé, presque oral de Fiodor Dostoievski, si bien retranscrit par Markowicz, “j'ai d'autres soucis que le beau style” souligne le narrateur et plus loin “pardonnez moi si je parle encore de travers…je suis un rêveur.”
Un Rêveur. du libéralisme politique à la rédemption christique, l'immense auteur orthodoxe transpire derrière son avatar qui “a si peu de vie réelle”. L'ombre de l'écrivain plane au-dessus des personnages, et comme un Olympien il se révèle parfois à son “ami lecteur” ou insuffle son don de la narration à son personnage “vous êtes un conteur magnifique”, “vous parlez comme dans un livre” s'exclame ainsi Nastenka.
A l'Ouest, nous sommes habitués au monologue intérieur, à ces sentiments décortiqués du dedans, tout en essayant de faire sens, de se comprendre, de frotter notre langage contre l'autre, comme si tout ce que nous disions avait évidemment un sens équivoque, par des phrases anodines, des intonations, quand on dit il fait beau, il est tard, en fait on se dit je t'aime, tu comptes pour moi, je te pardonnes… c'est une sorte de convention souterraine bien établie et dont l'âme slave de Dostoievski ne s'embarrasse pas, ce qui est proprement désarmant : exprimer les choses les plus profondes, les plus graves, sans dérision, sans avatar, sans pudeur maladive, sans orgueil, ce que résume bien Nastenka “je ressens la moindre chose comme de trop près. Mais bon assez parlé de sentiments, suffit !”
Pourtant Dostoievski n'a rien d'un auteur mièvre ou premier degré, Michel del Castillo, dans sa Postface, souligne cette pitié ignoble de l'auteur qui “verse des larmes d'attendrissement en égorgeant lentement un enfant innocent”, déclinant ainsi la critique acerbe de Milan Kundera pour qui Dostoievski lui rappelait les tankistes russes qui tiraient sur les pragois en versant des larmes des compassion. Dostoeivski est implacable, impitoyable, il donne pour mieux reprendre, il sait par quelles ignominies, désespoirs ses personnages et son lecteur s'apprêtent à passer mais dans un dolorisme messianique il ne peut que les accompagner.
Ces nuits boréales, “nuits de conte” comme l'écrit l'auteur dès les premières lignes, ne peuvent-t-elles arriver que dans la candeur de la jeunesse comme conclut d'entrée de jeu le narrateur ? La jeunesse a-t-elle la primeur de l'amour véritable ?
Qu'en pensez-vous ?
Dostoïevski achève et publie Les Frères Karamazov en 1880, quelques mois avant sa mort. La Russie connaît alors son apogée territoriale, mais se trouve écartelée entre une volonté de modernité soutenue par le Tsar Alexandre II et par les intellectuels, au rang desquels Dostoïevski et Tolstoï, et des fondements archaïques reposant sur le servage des moujiks.
Ayant connu dansa jeunesse, la Sibérie et le bagne du fait de ses idées progressistes, Dostoïevski est, à la fin de sa vie, ayant acquis notoriété et sécurité matérielle, un nationaliste russe convaincu, attaché à la monarchie et à l'église, fondements de son pays, contre les dévoiements qu'il a pu observer durant ses années d'errance en Europe Occidentale. Cet homme n'est plus le Joueur, ni même le Raskolnikov en quête d'exception de 1866, et il est certain qu'il écrit là son "chef" d' "oeuvre", au sens propre.
Paradoxalement, l'ayant lu il y a quelques années, j'avais fini par mélanger les personnages entre eux et l'histoire se confondait avec celle de Crimes et Châtiments, et d'autres romans, alors que le Joueur par exemple, premier roman lu de lui, se détache toujours clairement.
Faux paradoxe en fait, car cela s'explique très bien par le style inimitable de Dostoïevski : Les Frères Karamazov sont des personnages archétypes ne cessant de s'opposer et se rapprocher, souvent par paires, dans une démarche dialectique visant en fait à analyser l'âme humaine -ou l'âme russe- dans toutes ses facettes et contradictions. Dostoïevski nous restitue ainsi une fresque romanesque, mais surtout tout un monde, digne de la meilleure fantasy, ou de Zola et Balzac, sauf que l'action ou la société ne sont pas au coeur du récit ; ce sont les transports de l'âme que met à nu Dostoïevski. Ses personnages sont en perpétuel mouvement intérieur, totalement déconstruits, et souvent dans l'outrance. Les nihilistes ou les grandes spiritualités ne trouveraient sans doute rien à redire à cette vision de la condition humaine : l'homme, en dehors du monde spirituel, chez Dostoïevski, erre dans le néant, n'est qu'une planche de bois ballotée par l'océan.
En fait, l'élément qui redonne cohérence au récit de Dostoïevski -bien qu'il puisse être lu et relu à différents niveaux de lecture- est sans doute sa réflexion philosophique permanente.
On ne s'ennuie pas en le lisant. Ses dialogues sont riches et variés, par leurs thèmes et leur style moderne. Le scénario est riche, construit autour de l'énigme (quasi policière) d'un parricide, et des sentiments complexes et flottants entre personnages. Il y a aussi de la tragédie Shakespearienne chez Dostoïevski.
Mais ses dialogues et rebondissements, pour moi, ne sont que prétexte, et sans doute est-ce pourquoi je les avais partiellement oubliés. le questionnement de Dostoïevski, et c'est ce qui marque le lecteur à mon sens, plane en permanence sur la scène des hommes ; et il y participe parfois -tel les dieux homériques- par un commentaire de leurs actes et pensées.
Pour autant, cette pensée omnipotente reste questionnement plus que science, et des philosophes aussi différents que Nietzche, Camus et Freud ont pu s'inspirer de lui pour des conclusions toutes différentes. Contrairement à Tolstoï, à la fois plus terrien et mystique convaincu, Dostoïevski continue de plâner dans un doute aérien, ne tranche rien. Il n'est pas étonnant qu'il ait séduit le père de la psychanalyse. Dostoïevski, faisant taire ses propres inquiétudes, est un analyste des passions humaines, dont il observe de manière quasi-scientifique tel ou tel impact sur les êtres et les rapports humains.
Pour finir, nous avons donc là un très grand livre -dont le nombre de pages ne doit pas rebuter : il se lit d'un traite dès que l'on est pris par le souffle de son auteur, comme dans un Victor Hugo-, plein d'une sagesse incertaine -qu'on retrouve chez Camus par exemple-.
Je n'aurai qu'un seul regret : que mon baluchon pour l'île déserte babeliesque soit trop étroit pour y caler mes deux tomes des Frères Karamazov.
Ayant connu dansa jeunesse, la Sibérie et le bagne du fait de ses idées progressistes, Dostoïevski est, à la fin de sa vie, ayant acquis notoriété et sécurité matérielle, un nationaliste russe convaincu, attaché à la monarchie et à l'église, fondements de son pays, contre les dévoiements qu'il a pu observer durant ses années d'errance en Europe Occidentale. Cet homme n'est plus le Joueur, ni même le Raskolnikov en quête d'exception de 1866, et il est certain qu'il écrit là son "chef" d' "oeuvre", au sens propre.
Paradoxalement, l'ayant lu il y a quelques années, j'avais fini par mélanger les personnages entre eux et l'histoire se confondait avec celle de Crimes et Châtiments, et d'autres romans, alors que le Joueur par exemple, premier roman lu de lui, se détache toujours clairement.
Faux paradoxe en fait, car cela s'explique très bien par le style inimitable de Dostoïevski : Les Frères Karamazov sont des personnages archétypes ne cessant de s'opposer et se rapprocher, souvent par paires, dans une démarche dialectique visant en fait à analyser l'âme humaine -ou l'âme russe- dans toutes ses facettes et contradictions. Dostoïevski nous restitue ainsi une fresque romanesque, mais surtout tout un monde, digne de la meilleure fantasy, ou de Zola et Balzac, sauf que l'action ou la société ne sont pas au coeur du récit ; ce sont les transports de l'âme que met à nu Dostoïevski. Ses personnages sont en perpétuel mouvement intérieur, totalement déconstruits, et souvent dans l'outrance. Les nihilistes ou les grandes spiritualités ne trouveraient sans doute rien à redire à cette vision de la condition humaine : l'homme, en dehors du monde spirituel, chez Dostoïevski, erre dans le néant, n'est qu'une planche de bois ballotée par l'océan.
En fait, l'élément qui redonne cohérence au récit de Dostoïevski -bien qu'il puisse être lu et relu à différents niveaux de lecture- est sans doute sa réflexion philosophique permanente.
On ne s'ennuie pas en le lisant. Ses dialogues sont riches et variés, par leurs thèmes et leur style moderne. Le scénario est riche, construit autour de l'énigme (quasi policière) d'un parricide, et des sentiments complexes et flottants entre personnages. Il y a aussi de la tragédie Shakespearienne chez Dostoïevski.
Mais ses dialogues et rebondissements, pour moi, ne sont que prétexte, et sans doute est-ce pourquoi je les avais partiellement oubliés. le questionnement de Dostoïevski, et c'est ce qui marque le lecteur à mon sens, plane en permanence sur la scène des hommes ; et il y participe parfois -tel les dieux homériques- par un commentaire de leurs actes et pensées.
Pour autant, cette pensée omnipotente reste questionnement plus que science, et des philosophes aussi différents que Nietzche, Camus et Freud ont pu s'inspirer de lui pour des conclusions toutes différentes. Contrairement à Tolstoï, à la fois plus terrien et mystique convaincu, Dostoïevski continue de plâner dans un doute aérien, ne tranche rien. Il n'est pas étonnant qu'il ait séduit le père de la psychanalyse. Dostoïevski, faisant taire ses propres inquiétudes, est un analyste des passions humaines, dont il observe de manière quasi-scientifique tel ou tel impact sur les êtres et les rapports humains.
Pour finir, nous avons donc là un très grand livre -dont le nombre de pages ne doit pas rebuter : il se lit d'un traite dès que l'on est pris par le souffle de son auteur, comme dans un Victor Hugo-, plein d'une sagesse incertaine -qu'on retrouve chez Camus par exemple-.
Je n'aurai qu'un seul regret : que mon baluchon pour l'île déserte babeliesque soit trop étroit pour y caler mes deux tomes des Frères Karamazov.
« L’œuvre de Dostoïevski a soumis l’intelligence française à une assez longue épreuve. Deux siècles d’ordre et de discipline classiques nous préparaient mal à la compréhension d’un auteur en révolte ouverte contre les règles d’unité et de composition qui nous sont familières. »
André Markowicz
Un siècle après la délicate réception de son oeuvre en France, il me paraît incontestable que le génial auteur russe continue à poser un défi à l’intelligence et à la rationalité occidentales. Alors que je n’ai jamais eu aucune difficulté à comprendre et à aimer Tolstoï, « le peintre de la vie dans ses formes et ses achèvements » selon la jolie formule de l’homme de lettres russe Vassili Rozanov, j’ai d’emblée éprouvé quelques difficultés à suivre Dostoïevski dans sa sinueuse description des tourments de l’âme, ou dans son rapport passionné au Christ. La composition, sursaturée d’idées et de motifs récurrents, noyant l’intrigue sous des digressions prenant la forme de confessions ou de dialogues interminables, a de quoi dérouter. Tel un kaléidoscope réfractant la réalité à l’infini où chaque élément, si minime soit-il, reflète l’idée maîtresse comme la goutte d’eau le soleil, elle parvient néanmoins à exercer un effet hypnotique sur le lecteur qui, de gré ou de force, finit par succomber au charme diabolique et enchanteur d’une prose qui déborde de toutes parts.
Pour être honnête, j’ai complètement raté ma première incursion dans l’oeuvre du grand maître russe. La lecture de l’Idiot à l’automne dernier fut pour moi une expérience ennuyeuse, pénible, assortie de la désavantageuse impression de n’y avoir à peu près rien compris. Désarçonnée par la forme qui, à mes yeux, ressortit davantage au théâtre qu’au roman, par la folie des personnages qui, en une fraction de seconde, passent du rire aux larmes, de l’amour à la haine, de la rage à la compassion, passablement hermétique à la dimension christique du héros, je pensais en avoir fini avec Dostoïevski… jusqu’à ce qu’une lecture récente, Offenses de Constance Debré, prolongée par celle de La chute d’Albert Camus, ne ravive ma curiosité. Ces deux livres questionnant le sens de la vie, plus particulièrement interrogeant le sens et la notion même de faute, engagent en effet, chacun à leur façon, un dialogue avec l’un de ses livres le plus célèbre : Crime et châtiment.
L’argument du livre, dont le succès fut immédiat en Russie, dès sa publication en 1866, est connu même de ceux qui ne l’ont pas lu :
Raskolnikov, ancien étudiant en Droit de 23 ans, sans le sou et sans profession, assassine à coups de hache une vieille prêteuse sur gage et la soeur de celle-ci. La suite du roman s’attache à décrire les conséquences du meurtre sur la psyché du criminel, tandis que l’étau de la justice se resserre inexorablement sur lui.
Si la misère, la souffrance, l’injustice, le besoin éperdu d’argent figurent incontestablement au rang des mobiles du double meurtre, ils sont loin de rendre compte d’un acte qui reste largement inexpliqué et inexplicable aux yeux mêmes de son auteur. Bien qu’ayant longuement médité son crime, l’ayant même, à certains égards, prémédité, Raskolnikov apparaît bien plus comme le jouet d’un Destin implacable et indéchiffrable que comme l’acteur de sa propre vie. C’est ainsi qu’apprenant tout à fait fortuitement que le lendemain à sept heures, la vieille usurière sera seule chez elle, Raskolnikov comprend du même coup que son sort est scellé :
« Il ne lui restait plus que quelques pas à faire pour rentrer chez lui. Il arriva dans son réduit comme un condamné à mort. Il ne réfléchissait plus à rien ; il en était incapable. Il sentit, de tout son être, qu’il n’avait plus ni volonté ni raison et que tout était décidé sans appel. »
Pour autant, cette sorte de fatalité qui l’accable ne l’exonère ni des doutes qui le taraudent avant et après l’acte, ni de la culpabilité qui le ronge insidieusement et le rend à moitié fou, ni du châtiment, seul à même de le sauver, si tant est qu’il pût être sauvé. Mais si Raskolnikov est bien coupable, il l’est au même titre que tous les hommes, nés libres et par conséquent « coupables pour tout et pour tous ». Et s’il doit répondre de ses fautes et de ses crimes, c’est devant le tribunal de Dieu, seul à même, dans son omniscience, de le juger, non devant le tribunal des hommes, inapte, par nature, à rendre la justice.
Mais là encore, ramener Raskolnikov au statut de victime d’un Destin implacable est terriblement réducteur. En dernier ressort, le jeune homme a délibérément commis un crime, un crime de sang froid, même s’il était, au moment du passage à l’acte, dans un état de fièvre indescriptible. Pourquoi ? Par souci de justice ? Afin de rétablir en sa faveur un sort jugé inéquitable? Afin de débarrasser la surface du globe d’un être nuisible, d’un « pou inutile, mauvais, néfaste » ? Afin de se mettre à l’épreuve, de se mesurer aux « âmes supérieures » qui, à l’instar de Napoléon, ne s’embarrassent pas de scrupules lorsqu’il s’agit d’éliminer un ou plusieurs « poux » entravant l’accomplissement de leur destinée ?
André Markowicz fournit un début de réponse, me semble-t-il, lorsqu’il décrit les personnages de Dostoïevski comme des êtres impuissants à se définir qui, la conscience toujours en alerte, ont la passion de se « vérifier ». Est-ce pour se « vérifier » que Raskolnikov en vient, après moult hésitations et revirements, à commettre son crime? Markowicz évoque également le dédoublement, un trouble psychiatrique qui semble avoir particulièrement affecté Dostoiëvski, que l’on retrouve chez bon nombre de ses personnages :
« Il me semble que je me dédouble, dit Versilov dans Les frères Karamazov : je me partage par la pensée, et cette sensation me cause une peur affreuse. C’est comme si l’on avait son double à côté de soi : alors que l’on est sensé et raisonnable, ce double veut à tout prix faire quelque chose d’absurde. »
Est-ce son double maléfique qui pousse Raskolnikov à commettre un acte absurde, un crime sans mobile, sans désir, sans nécessité? Pourtant, à aucun moment, Raskolnikov ne renie son crime. Il l’assume jusqu’au bout. Ce qu’il semble ne pas assumer en revanche, c’est son attitude envers lui-même une fois l’acte commis. Il s’accuse non du crime, mais de sa lâcheté, de sa faiblesse, de l’enfer mental dans lequel il s’est enfermé.
« Il avait honte précisément de ce que lui, Raskolnikov, s’était perdu, si aveuglément, avec une aussi totale absence d’espoir, si obscurément et si stupidement, suivant quelque arrêt d’une aveugle destinée et qu’il devait s’humilier, se soumettre à « l’absurdité » d’une quelconque condamnation, s’il voulait trouver enfin un peu de repos. »
Dès lors, pourquoi vivre? s’interroge-t-il à plusieurs reprises. Vivre pour exister?
« La satisfaction d’exister ne lui suffisait pas ; il avait toujours voulu davantage. »
Maintes fois tenté par le suicide, il y a finalement renoncé. Pourquoi? Par lâcheté? Ou bien parce que gisait au fond de lui une mince, mais tenace, espérance? L’espérance en un amour qui, seul, peut donner un sens à une vie absurde dépourvue de sens?
« Il ne sut pas comment cela se passa, mais il se sentit soulevé par une force inconnue et jeté aux pieds de Sonia. Il pleurait et il étreignait ses genoux. (…)Elle avait compris, elle n’avait plus de doute maintenant, il l’aimait, il l’aimait d’un amour sans limite et son heure était enfin venue… »
André Markowicz
Un siècle après la délicate réception de son oeuvre en France, il me paraît incontestable que le génial auteur russe continue à poser un défi à l’intelligence et à la rationalité occidentales. Alors que je n’ai jamais eu aucune difficulté à comprendre et à aimer Tolstoï, « le peintre de la vie dans ses formes et ses achèvements » selon la jolie formule de l’homme de lettres russe Vassili Rozanov, j’ai d’emblée éprouvé quelques difficultés à suivre Dostoïevski dans sa sinueuse description des tourments de l’âme, ou dans son rapport passionné au Christ. La composition, sursaturée d’idées et de motifs récurrents, noyant l’intrigue sous des digressions prenant la forme de confessions ou de dialogues interminables, a de quoi dérouter. Tel un kaléidoscope réfractant la réalité à l’infini où chaque élément, si minime soit-il, reflète l’idée maîtresse comme la goutte d’eau le soleil, elle parvient néanmoins à exercer un effet hypnotique sur le lecteur qui, de gré ou de force, finit par succomber au charme diabolique et enchanteur d’une prose qui déborde de toutes parts.
Pour être honnête, j’ai complètement raté ma première incursion dans l’oeuvre du grand maître russe. La lecture de l’Idiot à l’automne dernier fut pour moi une expérience ennuyeuse, pénible, assortie de la désavantageuse impression de n’y avoir à peu près rien compris. Désarçonnée par la forme qui, à mes yeux, ressortit davantage au théâtre qu’au roman, par la folie des personnages qui, en une fraction de seconde, passent du rire aux larmes, de l’amour à la haine, de la rage à la compassion, passablement hermétique à la dimension christique du héros, je pensais en avoir fini avec Dostoïevski… jusqu’à ce qu’une lecture récente, Offenses de Constance Debré, prolongée par celle de La chute d’Albert Camus, ne ravive ma curiosité. Ces deux livres questionnant le sens de la vie, plus particulièrement interrogeant le sens et la notion même de faute, engagent en effet, chacun à leur façon, un dialogue avec l’un de ses livres le plus célèbre : Crime et châtiment.
L’argument du livre, dont le succès fut immédiat en Russie, dès sa publication en 1866, est connu même de ceux qui ne l’ont pas lu :
Raskolnikov, ancien étudiant en Droit de 23 ans, sans le sou et sans profession, assassine à coups de hache une vieille prêteuse sur gage et la soeur de celle-ci. La suite du roman s’attache à décrire les conséquences du meurtre sur la psyché du criminel, tandis que l’étau de la justice se resserre inexorablement sur lui.
Si la misère, la souffrance, l’injustice, le besoin éperdu d’argent figurent incontestablement au rang des mobiles du double meurtre, ils sont loin de rendre compte d’un acte qui reste largement inexpliqué et inexplicable aux yeux mêmes de son auteur. Bien qu’ayant longuement médité son crime, l’ayant même, à certains égards, prémédité, Raskolnikov apparaît bien plus comme le jouet d’un Destin implacable et indéchiffrable que comme l’acteur de sa propre vie. C’est ainsi qu’apprenant tout à fait fortuitement que le lendemain à sept heures, la vieille usurière sera seule chez elle, Raskolnikov comprend du même coup que son sort est scellé :
« Il ne lui restait plus que quelques pas à faire pour rentrer chez lui. Il arriva dans son réduit comme un condamné à mort. Il ne réfléchissait plus à rien ; il en était incapable. Il sentit, de tout son être, qu’il n’avait plus ni volonté ni raison et que tout était décidé sans appel. »
Pour autant, cette sorte de fatalité qui l’accable ne l’exonère ni des doutes qui le taraudent avant et après l’acte, ni de la culpabilité qui le ronge insidieusement et le rend à moitié fou, ni du châtiment, seul à même de le sauver, si tant est qu’il pût être sauvé. Mais si Raskolnikov est bien coupable, il l’est au même titre que tous les hommes, nés libres et par conséquent « coupables pour tout et pour tous ». Et s’il doit répondre de ses fautes et de ses crimes, c’est devant le tribunal de Dieu, seul à même, dans son omniscience, de le juger, non devant le tribunal des hommes, inapte, par nature, à rendre la justice.
Mais là encore, ramener Raskolnikov au statut de victime d’un Destin implacable est terriblement réducteur. En dernier ressort, le jeune homme a délibérément commis un crime, un crime de sang froid, même s’il était, au moment du passage à l’acte, dans un état de fièvre indescriptible. Pourquoi ? Par souci de justice ? Afin de rétablir en sa faveur un sort jugé inéquitable? Afin de débarrasser la surface du globe d’un être nuisible, d’un « pou inutile, mauvais, néfaste » ? Afin de se mettre à l’épreuve, de se mesurer aux « âmes supérieures » qui, à l’instar de Napoléon, ne s’embarrassent pas de scrupules lorsqu’il s’agit d’éliminer un ou plusieurs « poux » entravant l’accomplissement de leur destinée ?
André Markowicz fournit un début de réponse, me semble-t-il, lorsqu’il décrit les personnages de Dostoïevski comme des êtres impuissants à se définir qui, la conscience toujours en alerte, ont la passion de se « vérifier ». Est-ce pour se « vérifier » que Raskolnikov en vient, après moult hésitations et revirements, à commettre son crime? Markowicz évoque également le dédoublement, un trouble psychiatrique qui semble avoir particulièrement affecté Dostoiëvski, que l’on retrouve chez bon nombre de ses personnages :
« Il me semble que je me dédouble, dit Versilov dans Les frères Karamazov : je me partage par la pensée, et cette sensation me cause une peur affreuse. C’est comme si l’on avait son double à côté de soi : alors que l’on est sensé et raisonnable, ce double veut à tout prix faire quelque chose d’absurde. »
Est-ce son double maléfique qui pousse Raskolnikov à commettre un acte absurde, un crime sans mobile, sans désir, sans nécessité? Pourtant, à aucun moment, Raskolnikov ne renie son crime. Il l’assume jusqu’au bout. Ce qu’il semble ne pas assumer en revanche, c’est son attitude envers lui-même une fois l’acte commis. Il s’accuse non du crime, mais de sa lâcheté, de sa faiblesse, de l’enfer mental dans lequel il s’est enfermé.
« Il avait honte précisément de ce que lui, Raskolnikov, s’était perdu, si aveuglément, avec une aussi totale absence d’espoir, si obscurément et si stupidement, suivant quelque arrêt d’une aveugle destinée et qu’il devait s’humilier, se soumettre à « l’absurdité » d’une quelconque condamnation, s’il voulait trouver enfin un peu de repos. »
Dès lors, pourquoi vivre? s’interroge-t-il à plusieurs reprises. Vivre pour exister?
« La satisfaction d’exister ne lui suffisait pas ; il avait toujours voulu davantage. »
Maintes fois tenté par le suicide, il y a finalement renoncé. Pourquoi? Par lâcheté? Ou bien parce que gisait au fond de lui une mince, mais tenace, espérance? L’espérance en un amour qui, seul, peut donner un sens à une vie absurde dépourvue de sens?
« Il ne sut pas comment cela se passa, mais il se sentit soulevé par une force inconnue et jeté aux pieds de Sonia. Il pleurait et il étreignait ses genoux. (…)Elle avait compris, elle n’avait plus de doute maintenant, il l’aimait, il l’aimait d’un amour sans limite et son heure était enfin venue… »
« Les Karamazov de Dosto, c’est le roman philosophique ! »
Voilà comment l’imposture sur pattes qui m’a tenu lieu de prof de philo qualifia il y a trente ans ce roman. Qualification jetée comme un slogan publicitaire, et hélas (la formule lapidaire étant le seul moyen d’expression de cette « prof » incapable d’assurer des cours qu’elle délégua toute l’année à ses élèves sous forme d’exposés, se contentant d’éructer ici et là) non étayée.
Ainsi m’a t-il fallu une éternité pour oser briser le totem de cette assertion tétanisante et me lancer dans ce Dostoievski-là qui me faisait si peur, persuadée que je n’y comprendrai rien. Perception fausse bien sûr, mais j’en veux encore à cette incapable de n’avoir pas su éclairer en son temps ses jeunes élèves sur ce roman qui aborde en effet la quasi-totalité du programme de philo : la religion – la spiritualité – le mysticisme, la conscience, la morale, la justice, le droit, la beauté, le bien – le mal, l’inné – l’acquis …
Tout cela encapsulé dans ce drame familial et magnifié par les personnages incandescents des trois frères positionnés chacun, qui dans la souffrance, qui dans l’extase, à des degrés opposés sur ces questions essentielles : Yvan l’athée cynique, Aliocha le pur religieux, et Dimitri, tiraillé entre ses deux figures. Autant dire qu’il est difficile au lecteur de ne pas se questionner lui-même à un moment ou un autre du roman quand celui-ci, par le biais de l’un des personnages, lui tend un miroir. Difficile aussi de ne pas s’extasier devant l’énormité de ce roman, sa profondeur, sa portée, sa sensibilité, que, faute de savoir l’appréhender d’un point de vue philosophique, j’ai savouré sur le plan littéraire et adoré retrouver la plume heurtée et à vif de l’auteur, en particulier dans des chapitres comme « Le grand Inquisiteur », « Les femmes croyantes », « Illioucha »…
Grande expérience de lecture que ce roman qui enrichit son lecteur !
Voilà comment l’imposture sur pattes qui m’a tenu lieu de prof de philo qualifia il y a trente ans ce roman. Qualification jetée comme un slogan publicitaire, et hélas (la formule lapidaire étant le seul moyen d’expression de cette « prof » incapable d’assurer des cours qu’elle délégua toute l’année à ses élèves sous forme d’exposés, se contentant d’éructer ici et là) non étayée.
Ainsi m’a t-il fallu une éternité pour oser briser le totem de cette assertion tétanisante et me lancer dans ce Dostoievski-là qui me faisait si peur, persuadée que je n’y comprendrai rien. Perception fausse bien sûr, mais j’en veux encore à cette incapable de n’avoir pas su éclairer en son temps ses jeunes élèves sur ce roman qui aborde en effet la quasi-totalité du programme de philo : la religion – la spiritualité – le mysticisme, la conscience, la morale, la justice, le droit, la beauté, le bien – le mal, l’inné – l’acquis …
Tout cela encapsulé dans ce drame familial et magnifié par les personnages incandescents des trois frères positionnés chacun, qui dans la souffrance, qui dans l’extase, à des degrés opposés sur ces questions essentielles : Yvan l’athée cynique, Aliocha le pur religieux, et Dimitri, tiraillé entre ses deux figures. Autant dire qu’il est difficile au lecteur de ne pas se questionner lui-même à un moment ou un autre du roman quand celui-ci, par le biais de l’un des personnages, lui tend un miroir. Difficile aussi de ne pas s’extasier devant l’énormité de ce roman, sa profondeur, sa portée, sa sensibilité, que, faute de savoir l’appréhender d’un point de vue philosophique, j’ai savouré sur le plan littéraire et adoré retrouver la plume heurtée et à vif de l’auteur, en particulier dans des chapitres comme « Le grand Inquisiteur », « Les femmes croyantes », « Illioucha »…
Grande expérience de lecture que ce roman qui enrichit son lecteur !
"Souvenirs de la maison des morts" (le titre littéralement serait "Notes de la maison morte") est un récit autobiographique ainsi qu'un témoignage si l'on considère qu'il s'agit du premier livre écrit sur le système pénitentiaire russe.
Dostoïevski, commencera son récit sitôt après avoir purgé une peine de quatre ans de bagne (janvier 1850- janvier 1854), il y décrit son quotidien, parle de ses codétenus avec sensibilité et évoque de nombreuses anecdotes.
Il s'agit d'un récit très prenant car si Dostoïevski est un observateur averti, il s'agit aussi et surtout d'une partie de son vécu, quatre années ce n'est pas rien.
Je me suis dis que probablement plus qu'un autre, ce témoignage pouvait éclairer sur ce qu'est l'âme slave, ce mélange subtil de fatalisme et d'acceptation de la servitude comme une forme d'atavisme, je ne suis pas spécialiste des lectures sur le thème de la détention mais cet ouvrage dégage une certaine profondeur.
Etrangement ce livre est celui que j'ai le plus apprécié de l'auteur, le plus marquant, simplement peut-être parce que ce n'est pas un roman et que la réalité d'une histoire vraiment vécue est souvent plus impressionnante.
je précise que je n'ai lu que trois autres livres de l'auteur : Crime et Châtiment, le joueur et l'idiot.
Dostoïevski, commencera son récit sitôt après avoir purgé une peine de quatre ans de bagne (janvier 1850- janvier 1854), il y décrit son quotidien, parle de ses codétenus avec sensibilité et évoque de nombreuses anecdotes.
Il s'agit d'un récit très prenant car si Dostoïevski est un observateur averti, il s'agit aussi et surtout d'une partie de son vécu, quatre années ce n'est pas rien.
Je me suis dis que probablement plus qu'un autre, ce témoignage pouvait éclairer sur ce qu'est l'âme slave, ce mélange subtil de fatalisme et d'acceptation de la servitude comme une forme d'atavisme, je ne suis pas spécialiste des lectures sur le thème de la détention mais cet ouvrage dégage une certaine profondeur.
Etrangement ce livre est celui que j'ai le plus apprécié de l'auteur, le plus marquant, simplement peut-être parce que ce n'est pas un roman et que la réalité d'une histoire vraiment vécue est souvent plus impressionnante.
je précise que je n'ai lu que trois autres livres de l'auteur : Crime et Châtiment, le joueur et l'idiot.
Comment critiquer un tel monument? Depuis longtemps déjà, je n'osais m'attaquer à cet auteur majeur et puis le Père Noël m'a forcé la main, aucun regret, bien au contraire ! En effet, non seulement la lecture n'en est pas difficile mais quelle profondeur.
Le narrateur, à travers l'histoire de Raskolnikoff, se propose de nous confronter aux contradictions de la morale qui nous agitent parfois. L'assassinat est-il toujours un crime? Si l'on considère les actes de la victime, peut-on considérer qu'en tout cas, elle mérite la vie? Et n'est-ce pas le fait des Grands Hommes que de prendre cette décision pour le bien commun? Voilà le dilemme tranché (à la hache) par Raskolnikoff, qui se veut un destin hors du commun, et rien ne semble pouvoir le faire changer d'avis . Pourtant, ses actes ne laissent pas de le hanter et peut être devrait-il y voir un message de son inconscient? En tout cas, depuis, plus rien ne peut le rendre heureux, il a comme perdu sa vie en ôtant celle de quelqu'un d'autre. Cela pose la question des droits que l'on peut, ou non, s'octroyer à soi-même en dépit de la Loi et de la morale (comme de se faire justice soi-même par exemple) et plus généralement peut être de la peine de mort.
Le narrateur, pour finir, nous propose l'amour comme voie de rédemption. Je ne sais si cela est possible mais il se peut après tout que la découverte du véritable amour lui rende l'Humanité que sa raison et ses actes lui avait fait perdre. Quoiqu'il en soit, c'est pour moi un bijou de finesse psychologique, philosophique et littéraire et une ouverture certaine à l'introspection. A lire et à relire !
Le narrateur, à travers l'histoire de Raskolnikoff, se propose de nous confronter aux contradictions de la morale qui nous agitent parfois. L'assassinat est-il toujours un crime? Si l'on considère les actes de la victime, peut-on considérer qu'en tout cas, elle mérite la vie? Et n'est-ce pas le fait des Grands Hommes que de prendre cette décision pour le bien commun? Voilà le dilemme tranché (à la hache) par Raskolnikoff, qui se veut un destin hors du commun, et rien ne semble pouvoir le faire changer d'avis . Pourtant, ses actes ne laissent pas de le hanter et peut être devrait-il y voir un message de son inconscient? En tout cas, depuis, plus rien ne peut le rendre heureux, il a comme perdu sa vie en ôtant celle de quelqu'un d'autre. Cela pose la question des droits que l'on peut, ou non, s'octroyer à soi-même en dépit de la Loi et de la morale (comme de se faire justice soi-même par exemple) et plus généralement peut être de la peine de mort.
Le narrateur, pour finir, nous propose l'amour comme voie de rédemption. Je ne sais si cela est possible mais il se peut après tout que la découverte du véritable amour lui rende l'Humanité que sa raison et ses actes lui avait fait perdre. Quoiqu'il en soit, c'est pour moi un bijou de finesse psychologique, philosophique et littéraire et une ouverture certaine à l'introspection. A lire et à relire !
Ah les crocrocro, les crocrocro…
Aussi rare en Russie que la démocratie, un sac Hermès sur pattes est exposé à Saint-Petersbourg dans une galerie marchande au début des années 1860 par un couple d’allemands cupides.
Comme la bêtise fricote souvent avec la témérité et que l’inconscience n’a pas attendu que des imbéciles carencés en sensations fortes fassent des selfies avec des animaux sauvages ou au bord de précipices en reculant (oui, oui encore un ou deux pas, t’inquiètes, vas-y !), un fonctionnaire russe veut contempler la bête d’un peu trop près et se fait avaler pour le goûter. Un alligâteau.
Si Jonas fut vomi par la baleine car le prophète, plus pénible qu’un GPS bavard en voiture, lui était resté sur l’estomac, que Pinocchio fut recraché par le requin car le pantin en bois était aussi calorique d’un cure-dent, Ivan Matvéïtch s’installe confortablement dans le ventre de l’animal, espace vide, spacieux (comme quoi, certains sacs à mains sont bien rangés !) et il n’est pas mécontent de sa nouvelle célébrité car il peut communiquer avec l’extérieur.
Elena, sa veuve mais pas trop, profite de l’aubaine pour se faire consoler par quelques bons amis en itch, et le couple d’allemands triple le prix d’entrée pour exploiter cette nouvelle attraction. Seul le narrateur, collègue et ami du parasite est contraint de venir lui donner lecture des articles plus ou moins élogieux parus dans la presse. Pas de quoi verser quelques larmes de crocos qui vagit et se lamente quand il crie.
Pendant l’écriture des « Carnets du Sous-sol », on peut comprendre que Fédor du logis ait ressenti parfois le besoin de remonter à l’étage pour s’aérer la plume avec l’écriture de cette nouvelle fantastique légère et amusante un peu Gogolisée.
Derrière la fable absurde, néanmoins, comme Dosto n’est pas un grand comique par nature, il ne peut retenir son allergie de l’occident oxydant et une critique politique et sociale. Le catholicisme, le socialisme, le capitalisme sont aussi mâchouillés et mals digérés que le fonctionnaire russe.
La lecture n’est pas déplaisante mais ces 70 pages ne pèsent pas grand-chose dans la bibliographie de l’immense écrivain russe. Il n’est pas étonnant que cette œuvre reste assez méconnue et caïman oubliée. Elle est au niveau de mes jeux de mots de la journée.
C'est toujours mieux que cette comptine pour enfant qui justifie l'extinction de l'espèce et que je m’ôte plus de la tête. Un lézard au plafond.
Aussi rare en Russie que la démocratie, un sac Hermès sur pattes est exposé à Saint-Petersbourg dans une galerie marchande au début des années 1860 par un couple d’allemands cupides.
Comme la bêtise fricote souvent avec la témérité et que l’inconscience n’a pas attendu que des imbéciles carencés en sensations fortes fassent des selfies avec des animaux sauvages ou au bord de précipices en reculant (oui, oui encore un ou deux pas, t’inquiètes, vas-y !), un fonctionnaire russe veut contempler la bête d’un peu trop près et se fait avaler pour le goûter. Un alligâteau.
Si Jonas fut vomi par la baleine car le prophète, plus pénible qu’un GPS bavard en voiture, lui était resté sur l’estomac, que Pinocchio fut recraché par le requin car le pantin en bois était aussi calorique d’un cure-dent, Ivan Matvéïtch s’installe confortablement dans le ventre de l’animal, espace vide, spacieux (comme quoi, certains sacs à mains sont bien rangés !) et il n’est pas mécontent de sa nouvelle célébrité car il peut communiquer avec l’extérieur.
Elena, sa veuve mais pas trop, profite de l’aubaine pour se faire consoler par quelques bons amis en itch, et le couple d’allemands triple le prix d’entrée pour exploiter cette nouvelle attraction. Seul le narrateur, collègue et ami du parasite est contraint de venir lui donner lecture des articles plus ou moins élogieux parus dans la presse. Pas de quoi verser quelques larmes de crocos qui vagit et se lamente quand il crie.
Pendant l’écriture des « Carnets du Sous-sol », on peut comprendre que Fédor du logis ait ressenti parfois le besoin de remonter à l’étage pour s’aérer la plume avec l’écriture de cette nouvelle fantastique légère et amusante un peu Gogolisée.
Derrière la fable absurde, néanmoins, comme Dosto n’est pas un grand comique par nature, il ne peut retenir son allergie de l’occident oxydant et une critique politique et sociale. Le catholicisme, le socialisme, le capitalisme sont aussi mâchouillés et mals digérés que le fonctionnaire russe.
La lecture n’est pas déplaisante mais ces 70 pages ne pèsent pas grand-chose dans la bibliographie de l’immense écrivain russe. Il n’est pas étonnant que cette œuvre reste assez méconnue et caïman oubliée. Elle est au niveau de mes jeux de mots de la journée.
C'est toujours mieux que cette comptine pour enfant qui justifie l'extinction de l'espèce et que je m’ôte plus de la tête. Un lézard au plafond.
Le joueur fut rédigé sous la pression d’un pari fou. Comme d’habitude criblé de dettes et menacé de saisie, Dostoïevski a accepté les conditions abusives de son éditeur : si son prochain roman ne paraît pas à la date attendue, l’écrivain devra lui céder, gratuitement et pour une durée de neuf ans, les droits de publication de tous ses futurs écrits. L’auteur est alors plongé dans la rédaction de Crime et châtiment. Il lui reste vingt-sept jours pour présenter un livre. Et il va y réussir, dictant un autre court roman à une sténographe, Anna Grigorievna Snitkina, qu’il épousera l’année suivante, et, deux heures avant l’échéance, alors que l’éditeur s’est délibérément éclipsé, faisant enregistrer au commissariat le dépôt de son texte.
Sauvé in extremis, Dostoïevski n’a pas signé ce contrat suicidaire sous la seule pression du désespoir et du manque d’argent. Il aime jouer avec le feu et se déclare lui-même malade du jeu et de la dépendance qu’il crée. Depuis l’adolescence, il a pris l’habitude de solliciter ses proches pour financer son goût des jeux de hasard, et, depuis quelques années, a découvert le frisson de la roulette lors de ses séjours dans les villes d’eaux, alors si courues, d’Europe occidentale. Il y laisse chaque fois jusqu’à sa chemise et plus encore, avant de se refaire dans l’urgence dans des élans éperdus de création littéraire. Sa vie est un chaos qui rejaillit jusque dans son œuvre, son génie ne s’épanouissant qu’au bord du gouffre. Il gagne beaucoup d’argent, mais en manque constamment, éternel flambeur pour qui thésauriser n’est qu’avarice, le défaut de son père.
C’est donc son double que l’on découvre ici, dans la ville d’eau imaginaire de Roulettenbourg où se presse la bonne société européenne, confinée dans un entre-soi hiérarchisé et hypocrite, avide de distraction et de scandale. Alexeï Ivanovitch est le précepteur des enfants d’un Général sur le retour, ruiné mais prêt à toutes les folies – et donc très impatient d’hériter de sa vieille tante, la Baboulinka, qu’il fait passer pour déjà morte – pour épouser Mademoiselle Blanche, une demi-mondaine française. Lui-même épris de Paulina Alexandrovna, la belle-fille du Général, le jeune homme entretient avec elle une relation maladive, très semblable à celle qui lie l’auteur à sa maîtresse Pauline Souslova, dans un jeu pervers d’attraction-répulsion où il semble prendre un certain plaisir à se faire humilier.
Tout ce petit monde oisif ne gravitant qu’autour des obsessions de l’amour et de l’argent, c’est naturellement autour de ces deux thèmes que se font et se défont les relations entre les personnages. Pendant que la promiscuité de la villégiature favorise jeux et calculs amoureux – si elle se montre indifférente au timide et transi Anglais Mr Astley, Paulina aimerait bien plaire au marquis des Grieux, un Français qui joue les pique-assiette sans jamais se départir de sa terrible condescendance –, l’on s’en va s’offrir d’autres sensations sonnantes et trébuchantes au casino, en particulier autour de la roulette. Envoyé jouer pour le compte de Paulina, puis de la Baboulinka soudain débarquée comme une apparition à Roulettenbourg, Alexeï, conscient de mettre les doigts dans un piège dont il ne sortira plus tant le jeu le prend déjà aux tripes, tombe peu à peu dans l’addiction.
C’est ainsi qu’à la cinglante peinture d’un microcosme gouverné par l’ambition et par la soif d’argent, occasion pour lui de fustiger les si méprisantes nations occidentales pourtant bien petitement calculatrices comparées à la flamboyance passionnée de l’âme russe, l’écrivain adjoint le portrait incomparablement lucide d’un joueur compulsif, malade du jeu et de l’excitation qu’il provoque, en réalité prisonnier de ses désirs : désir d’argent, mais aussi désir d’amour, puisque lorsque son personnage réalise que Paulina l’aime, sa propre passion s’éteint. Ce qu’il aime, ce n’est pas l’objet de son désir, mais sa passion même : le désir.
Considéré comme la préfiguration de ses œuvres les plus connues, Le joueur est le roman d’une obsession d’autodestruction. Conscient de sa folie mais incapable d’y résister, fasciné jusqu’à l’horreur par l’abîme dans lequel il se regarde tomber, son protagoniste confronté à l’absurdité de ses désirs, y compris amoureux puisqu’ils le font s’éprendre de femmes dominatrices, capricieuses et ambivalentes – figures qui deviendront récurrentes chez Dostoïevski –, porte déjà en germe cette fièvre de la passion paroxystique pouvant conduire aux pires extrêmes, y compris le crime.
Lien : https://leslecturesdecanneti..
Sauvé in extremis, Dostoïevski n’a pas signé ce contrat suicidaire sous la seule pression du désespoir et du manque d’argent. Il aime jouer avec le feu et se déclare lui-même malade du jeu et de la dépendance qu’il crée. Depuis l’adolescence, il a pris l’habitude de solliciter ses proches pour financer son goût des jeux de hasard, et, depuis quelques années, a découvert le frisson de la roulette lors de ses séjours dans les villes d’eaux, alors si courues, d’Europe occidentale. Il y laisse chaque fois jusqu’à sa chemise et plus encore, avant de se refaire dans l’urgence dans des élans éperdus de création littéraire. Sa vie est un chaos qui rejaillit jusque dans son œuvre, son génie ne s’épanouissant qu’au bord du gouffre. Il gagne beaucoup d’argent, mais en manque constamment, éternel flambeur pour qui thésauriser n’est qu’avarice, le défaut de son père.
C’est donc son double que l’on découvre ici, dans la ville d’eau imaginaire de Roulettenbourg où se presse la bonne société européenne, confinée dans un entre-soi hiérarchisé et hypocrite, avide de distraction et de scandale. Alexeï Ivanovitch est le précepteur des enfants d’un Général sur le retour, ruiné mais prêt à toutes les folies – et donc très impatient d’hériter de sa vieille tante, la Baboulinka, qu’il fait passer pour déjà morte – pour épouser Mademoiselle Blanche, une demi-mondaine française. Lui-même épris de Paulina Alexandrovna, la belle-fille du Général, le jeune homme entretient avec elle une relation maladive, très semblable à celle qui lie l’auteur à sa maîtresse Pauline Souslova, dans un jeu pervers d’attraction-répulsion où il semble prendre un certain plaisir à se faire humilier.
Tout ce petit monde oisif ne gravitant qu’autour des obsessions de l’amour et de l’argent, c’est naturellement autour de ces deux thèmes que se font et se défont les relations entre les personnages. Pendant que la promiscuité de la villégiature favorise jeux et calculs amoureux – si elle se montre indifférente au timide et transi Anglais Mr Astley, Paulina aimerait bien plaire au marquis des Grieux, un Français qui joue les pique-assiette sans jamais se départir de sa terrible condescendance –, l’on s’en va s’offrir d’autres sensations sonnantes et trébuchantes au casino, en particulier autour de la roulette. Envoyé jouer pour le compte de Paulina, puis de la Baboulinka soudain débarquée comme une apparition à Roulettenbourg, Alexeï, conscient de mettre les doigts dans un piège dont il ne sortira plus tant le jeu le prend déjà aux tripes, tombe peu à peu dans l’addiction.
C’est ainsi qu’à la cinglante peinture d’un microcosme gouverné par l’ambition et par la soif d’argent, occasion pour lui de fustiger les si méprisantes nations occidentales pourtant bien petitement calculatrices comparées à la flamboyance passionnée de l’âme russe, l’écrivain adjoint le portrait incomparablement lucide d’un joueur compulsif, malade du jeu et de l’excitation qu’il provoque, en réalité prisonnier de ses désirs : désir d’argent, mais aussi désir d’amour, puisque lorsque son personnage réalise que Paulina l’aime, sa propre passion s’éteint. Ce qu’il aime, ce n’est pas l’objet de son désir, mais sa passion même : le désir.
Considéré comme la préfiguration de ses œuvres les plus connues, Le joueur est le roman d’une obsession d’autodestruction. Conscient de sa folie mais incapable d’y résister, fasciné jusqu’à l’horreur par l’abîme dans lequel il se regarde tomber, son protagoniste confronté à l’absurdité de ses désirs, y compris amoureux puisqu’ils le font s’éprendre de femmes dominatrices, capricieuses et ambivalentes – figures qui deviendront récurrentes chez Dostoïevski –, porte déjà en germe cette fièvre de la passion paroxystique pouvant conduire aux pires extrêmes, y compris le crime.
Lien : https://leslecturesdecanneti..
Ha, détestable, il l’est…!
Combien a-t-il pu l’abhorrer, ce livre, vaudeville comme façade, trop pourrie pour tenir debout, faux roman de genre, vrai pique à l’âme, authentique pièce de bord, apparement accessoire, sûrement centrale, difficilement tenable, la morale transpirant par les hauts de fenêtres, un affrontement n’en dépassant pas vraiment le cadre.
Dosto s’est fait mal.
…
Ce qui devrait importer le plus, forcément, c’est encore de parler de ses traductions.
Celle-ci par l’Age d’Homme, comme une évidence, pardonnant par là-même le réflexe corporatiste du bandeau « blurb », nous annonçant une redécouverte de la langue du maitre, que l’on aurait auparavant « flaubertisé », nous promettant une version sans artifices et pleine de répétitions, redondances signifiantes de ses obsessions, de lui-même.
…
Matériaux préparatoires en annexe, tortueux chemins narratifs accouchant de la bonne version, cent fois explorée jusqu’à paraitre la bonne, pleine d’erreurs à mesure qu’elles s’écrivent, jusqu’à presque sonner juste.
…
Une évidence, de la détestation, voire d’une certaine moquerie.
Longueur toute relative, délice d’exégète, vilain coup de canif ou méchante passe de rasoir, selon les goûts.
La spécialiste M.F. Kempf, lors de sa postface dont la longueur justifie le titre d’étude, se permet une lecture toute sémiotique de ce roman, tout en laissant de côté l’aspect peut-être le plus frappant de l’oeuvre du maitre, entièrement torturée d’interrogations morales, la pomme de la connaissance comme délice de salaud.
…
Veltchaninov — personnage principal, soit le « flamboyant » en français — est de ceux qui tranchent des deux côtés, laissant le soin au lecteur de détester sa vivacité, de supporter ses faiblesses, ou bien d’abonder en son bon sens.
L’éternel mari en question, dont le redondant patronyme en rappelle d’autres en apparence aussi stupides — l’Akaki Akakiévitch de Gogol en tête — ne cesse de surprendre, vivante interrogation dont on ne sait s’il faut l’inviter à un certain diner, ou bien si c’est nous-même qui mériterait d’en être l’attraction… cons que nous sommes à le tenir pour… bien qu’il en soit un fieffé spécimen…
…
Cet affrontement entre deux personnages dostoïevskiens jusqu’à la moelle tient toutes ses promesses, jusqu’au bout…
Combien a-t-il pu l’abhorrer, ce livre, vaudeville comme façade, trop pourrie pour tenir debout, faux roman de genre, vrai pique à l’âme, authentique pièce de bord, apparement accessoire, sûrement centrale, difficilement tenable, la morale transpirant par les hauts de fenêtres, un affrontement n’en dépassant pas vraiment le cadre.
Dosto s’est fait mal.
…
Ce qui devrait importer le plus, forcément, c’est encore de parler de ses traductions.
Celle-ci par l’Age d’Homme, comme une évidence, pardonnant par là-même le réflexe corporatiste du bandeau « blurb », nous annonçant une redécouverte de la langue du maitre, que l’on aurait auparavant « flaubertisé », nous promettant une version sans artifices et pleine de répétitions, redondances signifiantes de ses obsessions, de lui-même.
…
Matériaux préparatoires en annexe, tortueux chemins narratifs accouchant de la bonne version, cent fois explorée jusqu’à paraitre la bonne, pleine d’erreurs à mesure qu’elles s’écrivent, jusqu’à presque sonner juste.
…
Une évidence, de la détestation, voire d’une certaine moquerie.
Longueur toute relative, délice d’exégète, vilain coup de canif ou méchante passe de rasoir, selon les goûts.
La spécialiste M.F. Kempf, lors de sa postface dont la longueur justifie le titre d’étude, se permet une lecture toute sémiotique de ce roman, tout en laissant de côté l’aspect peut-être le plus frappant de l’oeuvre du maitre, entièrement torturée d’interrogations morales, la pomme de la connaissance comme délice de salaud.
…
Veltchaninov — personnage principal, soit le « flamboyant » en français — est de ceux qui tranchent des deux côtés, laissant le soin au lecteur de détester sa vivacité, de supporter ses faiblesses, ou bien d’abonder en son bon sens.
L’éternel mari en question, dont le redondant patronyme en rappelle d’autres en apparence aussi stupides — l’Akaki Akakiévitch de Gogol en tête — ne cesse de surprendre, vivante interrogation dont on ne sait s’il faut l’inviter à un certain diner, ou bien si c’est nous-même qui mériterait d’en être l’attraction… cons que nous sommes à le tenir pour… bien qu’il en soit un fieffé spécimen…
…
Cet affrontement entre deux personnages dostoïevskiens jusqu’à la moelle tient toutes ses promesses, jusqu’au bout…
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur

Les romans les mieux notés
heros_pitch
195 livres

Petits mais costauds
Gwen21
75 livres
Auteurs proches de Fiodor Dostoïevski
Quiz
Voir plus
Crime et Châtiment
Qui est le meurtrier ?
Raskolnikov
Raspoutine
Raton-Laveur
Razoumikhine
9 questions
195 lecteurs ont répondu
Thème : Crime et Châtiment de
Fiodor DostoïevskiCréer un quiz sur cet auteur195 lecteurs ont répondu