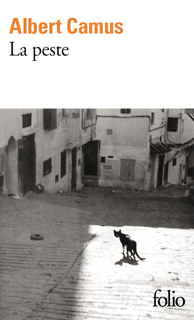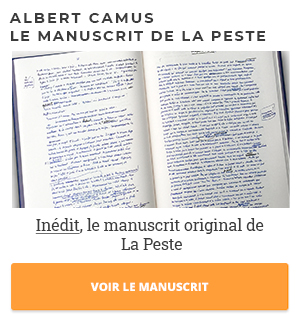Critiques filtrées sur 4 étoiles
À peine le roman ouvert que le lecteur est déjà immergé dans l'horreur que traverse la ville d'Oran. Autour de lui, les rats morts s'amoncellent et laissent présager le pire. Bien vite, le mot est lancé : la peste. Les autorités et les habitants, pris au dépourvu, doivent faire face à un fléau et s'organiser au mieux dans la précipitation. Cette entame est addictive, mais de courte durée. le mal qui ronge la ville est vite identifié et s'ensuit alors le récit d'une survie collective où chacun doit son salut au hasard.
L'auteur pointe ainsi les tourments humains et arrive à poser les mots justes sur les ressentis de chacun. Il n'impose aucun avis, mais donne la parole à tous ses protagonistes quitte à confronter leurs opinions et, parfois, trouver un entre-deux. Les pensées de chacun sont prises en compte offrant au liseur un roman sociétal riche et intéressant. Pour arriver à cette neutralité, l'écrivain fait le choix d'une narration distante en la personne d'un témoin objectif. Si cela apporte une objectivité bienvenue, le lectorat regrette cependant le manque d'émotions ressenties à la lecture du roman. En effet, il tient place de spectateur et regarde l'intrigue d'un oeil dénué de sentiments. Il a du mal à s'attacher aux personnages qui lui semblent lointains. le narrateur relate des faits et lui en prend connaissance. C'est une lecture contemplative. D'autant que la plume de l'auteur est grandement appréciée. Celui-ci use d'un langage soutenu et de nombreuses descriptions. Ces dernières rendent l'ensemble très visuel au point que le liseur peut aisément imaginer les protagonistes, rejouer certaines scènes dans sa tête ou encore profiter des décors. Une telle exigence de la part de l'écrivain demande la pareille à un lectorat dont l'attention s'envole parfois lors de moments tirant légèrement en longueur.
Enfin, ce titre ne peut faire qu'échos chez le lecteur suite à l'épidémie de Covid-19 qu'il a traversé. Il revoit dans le récit ses propres peurs, l'inefficacité des autorités, le manque de moyens sanitaires, les théories diverses et souvent infondées, etc. le parallèle est dramatique autant que fascinant.
Lien : https://livresratures.wordpr..
L'auteur pointe ainsi les tourments humains et arrive à poser les mots justes sur les ressentis de chacun. Il n'impose aucun avis, mais donne la parole à tous ses protagonistes quitte à confronter leurs opinions et, parfois, trouver un entre-deux. Les pensées de chacun sont prises en compte offrant au liseur un roman sociétal riche et intéressant. Pour arriver à cette neutralité, l'écrivain fait le choix d'une narration distante en la personne d'un témoin objectif. Si cela apporte une objectivité bienvenue, le lectorat regrette cependant le manque d'émotions ressenties à la lecture du roman. En effet, il tient place de spectateur et regarde l'intrigue d'un oeil dénué de sentiments. Il a du mal à s'attacher aux personnages qui lui semblent lointains. le narrateur relate des faits et lui en prend connaissance. C'est une lecture contemplative. D'autant que la plume de l'auteur est grandement appréciée. Celui-ci use d'un langage soutenu et de nombreuses descriptions. Ces dernières rendent l'ensemble très visuel au point que le liseur peut aisément imaginer les protagonistes, rejouer certaines scènes dans sa tête ou encore profiter des décors. Une telle exigence de la part de l'écrivain demande la pareille à un lectorat dont l'attention s'envole parfois lors de moments tirant légèrement en longueur.
Enfin, ce titre ne peut faire qu'échos chez le lecteur suite à l'épidémie de Covid-19 qu'il a traversé. Il revoit dans le récit ses propres peurs, l'inefficacité des autorités, le manque de moyens sanitaires, les théories diverses et souvent infondées, etc. le parallèle est dramatique autant que fascinant.
Lien : https://livresratures.wordpr..
Un classique de la litterature francaise qui revient dans l'actualité avec l'episode covid même si la gravité de la maladie n'est pas comparable.Ce livre sd deroule a Alger et l'aiteur nous decrit les etapes de decouverte de l'epidemie et les mesures prises on est dans un reportage journalistique ici ,precis et sans fioritures.Un livre incontournable.
"On croit difficilement aux fléaux lorsqu'ils vous tombent sur la tête.Il y a eu dans le monde autant de pestes que de guerres. Et pourtant pestes et guerres trouvent les gens toujours aussi dépourvus".
C'est à Oran, Algérie, que la peste frappe dans les années 1940. La ville est alors confinée, coupée du reste du monde.Plus personne n'y vient et on ne peut plus en sortir même si, à l'intérieur, c'est beaucoup moins strict qu'aujourd'hui : on continue à aller au restaurant, au café et au cinéma. Alors que le nombre de morts augmente le docteur Rieux, son ami Tarrou, le journaliste Rambert, le prêtre Paneloux et l'employé de mairie Grand vont lutter de toutes leurs forces contre le fléau.
La peste chez Camus est une métaphore du nazisme. Oran c'est la France occupée, les soignants les résistants. Face aux pénuries le marché noir se développe, des personnes tentent de quitter la ville et des passeurs se proposent de les y aider moyennant finance Mais La peste de Camus marche aussi très bien pour parler du covid 19: on retrouve les soignants épuisés, les quarantaines à l'hôtel, les pompes funèbres débordées... et les séparations douloureuses : "C'est ainsi, par exemple, qu'un sentiment aussi individuel que celui de la séparation d'avec un être aimé devint soudain, dès les premières semaines, celui de tout un peuple, et, avec la peur, la souffrance principale de ce long temps d'exil". le ressenti des personnages dans cette situation de crise me semble fort bien analysé.
L'objet du roman c'est aussi de poser la question du sens de la vie et de comment se comporter pour être un homme bien -un homme, hein, pas un être humain car ici les femmes sont réduites au rôle de tapisserie. A ces questions Camus apporte une réponse à la fois très exigeante pour soi-même et bienveillante pour les faiblesses humaines. Par dessus tout il place l'amour et la recherche du bonheur : "Mais Rieux se redressa et dit d'une voix ferme que cela était stupide et qu'il n'y avait pas de honte à préférer le bonheur".
Malgré des longueurs, ce que j'ai apprécié dans cette lecture c'est l'observation fine de l'âme humaine, de ses désirs et de ce qu'ils peuvent avoir d'intemporel puisque, plus de soixante-dix ans après leur écriture, certains passages me touchent au coeur. J'ai été particulièrement émue par tout ce qui concerne les difficultés de la séparation et l'angoisse pour ceux qu'on aime au point que ça a parfois rendu ma lecture un peu douloureuse.
Lien : http://monbiblioblog.revolub..
C'est à Oran, Algérie, que la peste frappe dans les années 1940. La ville est alors confinée, coupée du reste du monde.Plus personne n'y vient et on ne peut plus en sortir même si, à l'intérieur, c'est beaucoup moins strict qu'aujourd'hui : on continue à aller au restaurant, au café et au cinéma. Alors que le nombre de morts augmente le docteur Rieux, son ami Tarrou, le journaliste Rambert, le prêtre Paneloux et l'employé de mairie Grand vont lutter de toutes leurs forces contre le fléau.
La peste chez Camus est une métaphore du nazisme. Oran c'est la France occupée, les soignants les résistants. Face aux pénuries le marché noir se développe, des personnes tentent de quitter la ville et des passeurs se proposent de les y aider moyennant finance Mais La peste de Camus marche aussi très bien pour parler du covid 19: on retrouve les soignants épuisés, les quarantaines à l'hôtel, les pompes funèbres débordées... et les séparations douloureuses : "C'est ainsi, par exemple, qu'un sentiment aussi individuel que celui de la séparation d'avec un être aimé devint soudain, dès les premières semaines, celui de tout un peuple, et, avec la peur, la souffrance principale de ce long temps d'exil". le ressenti des personnages dans cette situation de crise me semble fort bien analysé.
L'objet du roman c'est aussi de poser la question du sens de la vie et de comment se comporter pour être un homme bien -un homme, hein, pas un être humain car ici les femmes sont réduites au rôle de tapisserie. A ces questions Camus apporte une réponse à la fois très exigeante pour soi-même et bienveillante pour les faiblesses humaines. Par dessus tout il place l'amour et la recherche du bonheur : "Mais Rieux se redressa et dit d'une voix ferme que cela était stupide et qu'il n'y avait pas de honte à préférer le bonheur".
Malgré des longueurs, ce que j'ai apprécié dans cette lecture c'est l'observation fine de l'âme humaine, de ses désirs et de ce qu'ils peuvent avoir d'intemporel puisque, plus de soixante-dix ans après leur écriture, certains passages me touchent au coeur. J'ai été particulièrement émue par tout ce qui concerne les difficultés de la séparation et l'angoisse pour ceux qu'on aime au point que ça a parfois rendu ma lecture un peu douloureuse.
Lien : http://monbiblioblog.revolub..
Cette oeuvre d'Albert Camus fait partie des grands romans français du XXème siècle.
Excellent roman et le parallèle avec la montée du nazisme est d'une pertinence ...
Cependant, passé le charme de cette merveilleuse découverte, je ne peux m'empêcher de me demander si ce roman n'a pas été écrit pour le prix Nobel. Il y a un côté devoir noté qui me dérange (excellente note par ailleurs). Ce duel avec Sartre n'aurait il pas poussé Camus à la jouer à l'épate ? Tout cela me semble trop calculé, trop travaillé au détriment de l'émotion. L'écriture en devient froide et rigide, élitiste. le livre entier pourrait servir de citation.
J'ai aimé "La peste" mais j'ai adoré "L'étranger".
Cependant, passé le charme de cette merveilleuse découverte, je ne peux m'empêcher de me demander si ce roman n'a pas été écrit pour le prix Nobel. Il y a un côté devoir noté qui me dérange (excellente note par ailleurs). Ce duel avec Sartre n'aurait il pas poussé Camus à la jouer à l'épate ? Tout cela me semble trop calculé, trop travaillé au détriment de l'émotion. L'écriture en devient froide et rigide, élitiste. le livre entier pourrait servir de citation.
J'ai aimé "La peste" mais j'ai adoré "L'étranger".
L'horreur de la peste parfaitement illustrée par un des plus grand auteur du XXe siècle , description efficace des diverses réactions humaines en période de " crise" ( l'égoisme , la peur , la solidarité , ... ).
On retrouve aussi la philosophie de Camus : l' Absurde , en exposant la fragilité de la vie humaine et en employant un certain fatalisme .
Un autre parallèle est à faire avec la persécution des Juifs .
On retrouve aussi la philosophie de Camus : l' Absurde , en exposant la fragilité de la vie humaine et en employant un certain fatalisme .
Un autre parallèle est à faire avec la persécution des Juifs .
Je me souviens l'avoir lu il y a quelques temps déjà... Donc mes souvenirs ne sont plus tout aussi frais.
On nous l'avais imposé au BAC en lecture et évidemment personne dans la classe ne l'avait lu. C'était écrit petit et le livre était bien gros.
Puis un jour, deux ans plus tard, je parcourais ma bibliothèque et je tombe dessus en me disant "c'est con, je ne vais pas mourir sans l'avoir lu, surtout que je l'ai acheté et tout... bon allez !"
Alors je me suis mis à le lire, d'une traite car l'histoire m'avais beaucoup plus ! Mais je ne mets pas 4/5 car je me souviens des longueurs que proposait le livre, les quelques répétitions pour bien faire comprendre au lecteur que cela s'aggrave etc. Je trouvais que c'était trop.
Dans l'ensemble, le livre est intéressant (encore plus en ce moment avec lae Covid !) et se lit assez facilement. Bon faut quand même s'y mettre, mais je vous encourage à le lire !
On nous l'avais imposé au BAC en lecture et évidemment personne dans la classe ne l'avait lu. C'était écrit petit et le livre était bien gros.
Puis un jour, deux ans plus tard, je parcourais ma bibliothèque et je tombe dessus en me disant "c'est con, je ne vais pas mourir sans l'avoir lu, surtout que je l'ai acheté et tout... bon allez !"
Alors je me suis mis à le lire, d'une traite car l'histoire m'avais beaucoup plus ! Mais je ne mets pas 4/5 car je me souviens des longueurs que proposait le livre, les quelques répétitions pour bien faire comprendre au lecteur que cela s'aggrave etc. Je trouvais que c'était trop.
Dans l'ensemble, le livre est intéressant (encore plus en ce moment avec lae Covid !) et se lit assez facilement. Bon faut quand même s'y mettre, mais je vous encourage à le lire !
Cette critique contient des spoilers.
« La peste » a fait l'objet de toutes sortes d'interprétations variées et de lectures symboliques, dont Albert Camus fut parfois lui-même l'instigateur : en un rat - ai-je entendu quelque part dans une conversation de fats -, on a voulu suggérer l'invasion sournoise du totalitarisme ; en la peste, le fléau de l'occupation nazie ; et à la place de la lutte des médecins et des citoyens, la Résistance contre l'Ennemi. de mon côté, je n'ai pas le goût de me livrer à ce genre de double lecture, même si je ne nie pas au lecteur le droit de tirer du récit les leçons qu'il voudra - après tout, s'il se satisfait d'un symbolisme simpliste et qu'il y trouve comme une forme épurée et sublimée de ce qu'il croit avoir retenu et compris d'un fait précis, je l'abandonne volontiers à son heureuse fascination, mais que l'on ne m'empêche pas alors de m'en tenir à ce qui est écrit. J'ai observé, pour ma part, une maladie contagieuse et mortelle s'emparer progressivement d'une ville jusqu'à la couper du reste du monde et l'amputer, chaque jour et des mois durant, d'un nombre croissant de vies humaines - j'ai observé les humeurs et les pensées de ses habitants prisonniers, tantôt résignés ou révoltés, racontées par un narrateur ordonné et consciencieux. Ce roman est à la fois la rencontre d'une maladie aux contours épidémiologiques et aux symptômes vraisemblables, dont le progrès est relaté avec une rigueur scientifique qui suppose une documentation préalable, et d'une étude psychologique minutieuse, presque impatientante - d'abord celle des personnages, peu nombreux, mais dont les motivations sont à chaque fois très détaillées, comme si l'auteur souhaitait présenter une analyse de chaque « type » humain et de sa lutte morale entre « bien » et « mal » exacerbée par le fléau, mais aussi celle de la masse, de la population entière, comme si celle-ci formait une unité, un seul mouvement. Ces deux aspects surtout retiennent l'intérêt du lecteur : en premier lieu, ce que devient la médecine quand elle ne peut guérir ni prémunir, et n'est plus que logistique et statistiques ; ensuite, ce que devient l'homme quand il est exposé à une crise sanitaire d'une telle ampleur, alors que les libres plaisirs qui constituaient le petit bonheur de sa vie quotidienne sont brusquement prohibés et que la pérennité même de son existence est menacée et rendue incertaine, selon des circonstances extérieures et qu'il ne peut contrôler.
Pour commencer, il faut s'imaginer la ville côtière d'Oran, en Algérie française des années 1940, où le quotidien tranquille est soudainement perturbé par un afflux de rats agonisants dans les immeubles et sur les trottoirs. Rapidement, les premiers cas isolés d'une maladie mortelle se déclarent, présentant des symptômes d'une univocité telle que les médecins soupçonnent, presque immédiatement et par la force d'une conviction qui se passe de tests scientifiques, la réémergence de la peste bubonique, longtemps disparue. Comme la ville compte plus de deux cents mille habitants et que chaque médecin ne rencontre d'abord qu'un ou deux malades parmi ses patients, il s'écoule un certain temps de latence pendant laquelle l'épidémie continue de prendre de l'ampleur, avant que l'on songe à additionner la totalité des cas et que la communauté scientifique donne enfin l'alerte. Un médecin qui n'aura observé qu'une poignée de malades atteints d'une fièvre foudroyante, aux ganglions durs et suppurants, même s'il y reconnaît - tel un présage - les signes illustrés par les terribles fresques du Moyen-Age, n'envisagera pas d'annoncer au monde entier la nouvelle, séance tenante. Non, il lui faudra un appui épidémiologique, l'argument du nombre de morts pesant seul assez lourd pour que les autorités se décident à reconnaître la gravité de la situation et la nécessité du recours à des mesures préventives exceptionnelles. Les chiffres et les modélisations pronostiques sont la preuve écrite et certaine qu'un désastre humain se profile, et là où la parole du médecin est écoutée d'une oreille distraite et sceptique, ces constats indubitables imposent une réaction immédiate des services administratifs qui n'ont alors d'autre choix - sous peine qu'on leur reproche, en connaissance de cause, de n'avoir « rien fait » - que d'agir en conséquence. C'est ainsi, acculées à leur devoir de protection des citoyens, de prévision et de gestion des crises mettant en danger la santé publique, que les autorités ferment les portes de la ville et instaurent toutes sortes de mesures contraignantes pour juguler l'épidémie.
Que la peste puisse ressurgir des tréfonds de l'Histoire, dans une ville qui n'a plus connu d'évènements extraordinaires depuis des siècles, voilà une incongruité qui heurte le schéma routinier d'habitants incrédules, hébétés, pour qui leur existence banale revêt le caractère d'intouchabilité du quotidien commun, qui échappe nécessairement aux grands désastres de l'humanité. Cet ancien mythe ne peut nullement pénétrer les préoccupations ordinaires de cette société bien rangée : c'est une évidence, il n'y a pas sa place - il appartient à d'autres temps, d'autres lieux et d'autres destinées. Que l'on songe seulement aux balbutiements ridicules d'un médecin qui oserait formuler un tel diagnostic, au milieu des cafés et des restaurants bondés, ou devant les tramways qui circulent tranquillement, chargés de leurs lots pressés de travailleurs ! A moins d'être un observateur droit et vrai, comme le vieux médecin Castel pour qui la réalité n'est pas une demi-mesure, un flou mensonger ou une déformation accommodante, l'incertitude l'emporte toujours sur la preuve clinique et la suspicion syndromique, et l'on retarde ainsi le bouleversement qui précède l'acceptation d'un changement brutal et inattendu dans notre existence jusqu'alors si confortablement rassurante. Les services d'administration de la ville, à partir de l'instant où ils seront confrontés aux prévisions alarmantes des données épidémiologiques irréfutables, pousseront l'absurdité jusqu'à son extrémité en faisant appliquer des mesures au seul titre des chiffres, et sans se résoudre à en nommer précisément la cause. Alors que les premières observations des symptômes de la maladie, rapportées par quelques médecins comme Castel, auraient pu permettre une réaction plus précoce et radicale, on se contente d'en traiter les conséquences, avec un train de retard, sans avoir du tout usé de son esprit rationnel et scientifique pour étudier - dès avant son expansion - l'origine du mal et ses mécanismes de transmission. On ne justifie pas la fermeture de la ville par l'identification, parmi ses habitants, de la peste bubonique, mais seulement sur la base d'une liste de morts qui s'allonge de façon inquiétante et qui risquerait de nuire au bien général placé sous la responsabilité des autorités administratives.
La problématique de la santé publique a dépassé celle de l'intérêt médical et étiologique : c'est à peine si un sérum curatif est essayé sur les malades, à la fin de l'épidémie, tant les forces et le temps des médecins sont entièrement consacrés à la gestion du nombre des cas infectés. La prise en charge d'un pestiféré, au lieu de s'inscrire dans un service de « soins », relève en fait de la simple évacuation sanitaire - afin d'éviter la contamination des voisins et des proches -, ainsi que d'un recensement de décès. Invariablement, les formes graves succombent au mal et il s'agit surtout que les corps entrent dans un circuit sécurisé de désinfection et que leurs relents ne polluent pas l'air des habitations. Les familles ne s'y trompent pas : le médecin perd peu à peu sa figure de bienfaiteur et de guérisseur, pour devenir celle du croque-mort qui retire les mourants à leur foyer et les expédie, sous les sirènes stridentes des ambulances, vers une fin certaine. Quand la médecine est rendue impuissante, dépassée par la virulence inédite de l'infection et engloutie par l'amoncellement de données que suppose une prise en charge globale, devenue pure gestion et statistique, qui préfère la sauvegarde d'un plus grand nombre - en prévenant la contamination par des mesures d'isolement et en s'assurant de voir chaque malade mourir dans un lit médicalisé, même improvisé - aux recherches médicales sur la cause de l'épidémie - le bacille de la peste -, elle n'est plus un art, ni une science, et l'homme n'apprend rien - mais il est vrai au moins qu'il aura répertorié les noms et prénoms de tous ses morts et en aura préservé le digne souvenir.
On peut s'interroger sur la pertinence des choix stratégiques des autorités d'Oran, qui agissent toujours, comme elles ne manquent pas de le rappeler, selon l'avis des médecins. La ville étant le premier et unique foyer connu de l'épidémie, il est d'abord décidé d'interrompre tous ses contacts avec le monde extérieur - sorties de voyageurs, courriers, etc. -, tant et si bien qu'à aucun moment la maladie ne devient une menace pandémique. Fait étrange, le confinement est limité aux remparts d'Oran, mais il n'est jamais question d'empêcher les déplacements des habitants ou de restreindre leur quotidien à l'intérieur même de la ville - en assignant par exemple chacun à demeure. Cafés, restaurants, boutiques et transports en commun restent ouverts, sans qu'aucune instance ne spécifie des gestes barrières à observer pour se protéger de la contamination - lavage de mains, port de masques, distance minimale d'un mètre ou limitation des effusions amicales ou des réunions de groupe. L'exercice d'un métier n'est pas interdit, quoique l'isolement de la ville empiète sur les activités des uns et des autres, notamment par un couvre-feu qui n'était du reste pas exceptionnel à l'époque, ni n'empêche-t-on les promenades, représentations théâtrales ou séances cinématographiques. Les contraintes, outre l'interdiction de quitter la ville, se manifestent surtout lorsque l'on est soi-même, ou l'un de nos proches, touché par la maladie : le cas diagnostiqué est alors impérativement transféré dans l'un des hôpitaux - qui sont pour la plupart des écoles et autres bâtiments publics transformés à cet effet - et son entourage est dispersé dans les camps de quarantaine - stades et terrains de sports dont la surface a été aménagée en rangées de tentes. Les hôpitaux de fortune, où l'on multiplie toujours les lits et où l'on prodigue de moins en moins de soins véritables, sont gérés aussi bien par des citoyens ordinaires que par des médecins et infirmières, faute d'effectifs suffisants. L'équipement y est minime - masques et blouses - mais simple, loin des appareillages complexes dont nous disposons aujourd'hui : les mesures d'hygiène et le circuit des cadavres jusqu'à la fosse commune, puis jusqu'au four crématoire, sont calculés dans un souci d'efficacité austère. Une fois qu'un malade est englouti dans la machine infernale de la logistique sanitaire et administrative, sa famille ne le revoit plus, mais est dûment informée de son décès, à l'heure venue.
Les privations de liberté les plus contraignantes interviennent donc surtout a posteriori d'une infection par la peste, et non par mesure de prévention stricte - j'entends par là, mesure de prévention dans un foyer qui n'aurait pas du tout été en contact avec le bacille, mise à part bien sûr la limitation des déplacements et des rapports en dehors de la ville. J'ignore si ces lacunes flagrantes dans la prévention de la propagation d'une maladie contagieuse et mortelle sont le résultat d'un défaut de vision chez Camus - s'est-il suffisamment documenté, a-t-il auguré à tort un scénario bancal ? - ou bien le fruit d'une pensée libre, qui n'a pas même envisagé qu'on puisse confiner les gens chez eux et restreindre leurs activités professionnelles et sociales, parce qu'elle l'aurait jugé d'une inhumanité indécente et d'une contrainte inacceptable.
Lorsqu'une maladie mortelle touche une large part de population, il est impossible de contempler le dernier soupir de chaque homme, femme et enfant, et ceux-ci deviennent bientôt une rangée de chiffres noirs sur des feuilles de compte. Or, on sait bien que l'on ne ressent pas une peine et une empathie en proportion du nombre de ses bénéficiaires : au delà d'un certain point - et je prétends même que ce point se situe en dessous d'une dizaine d'individus -, on ne peut distribuer à chaque perte humaine le juste montant de chagrin qui lui revient, par dignité. Pire, lorsqu'on voit mourir un homme et que l'on est simultanément conscient que de multiples scènes semblables ont lieu au même moment partout dans la ville, l'épuisement gagne jusqu'à nos sentiments - l'expression la plus patente de notre humanité - et l'on se surprend alors dans un état d'instabilité émotionnelle où l'on oscille entre exacerbation et atténuation de nos élans compassionnels. Là réside le grand péril de la codification des règles de prévention et d'hygiène : un soignant, qu'il soit médecin ou citoyen volontaire, ne tient pas la longueur - il n'a pas l'endurance indispensable à la lutte rationnelle et systématique contre la contagion. Passés les premiers jours d'urgence et de vigilance accrue, il s'use à la tâche, effiloche à la fois ses sens et ses émotions, tandis que la maladie - bacille microscopique et primaire - profite de ses inattentions pour franchir les barrières qu'on a voulu ériger entre elle et ses hôtes. C'est pourquoi il faudrait, dans ce combat de chaque instant et de toutes les précautions, un renouvellement incessant de volontaires, par intervalles de quelques jours à semaines : la fibre héroïque ne se prolonge guère au delà, et seul un sang neuf et enthousiaste aura la patience et les scrupules nécessaires à l'éradication d'un ennemi invisible, après quoi, il s'en désintéresse et le néglige. Il est contraire à la vie de se contenir sans répit, de mesurer chacun de ses gestes, de limiter ses mouvements jusqu'à ressembler le plus possible au végétal dans sa serre, fixe et inanimé, que l'on vient nourrir par cargaison de terreau, et qui n'entretient avec son environnement qu'un minimum d'interactions - en somme, juste le nécessaire pour encore exister.
« La Peste » de Camus est un de ces romans ayant connu un succès qu'il lui aurait été difficile d'atteindre aujourd'hui, selon les standards de notre littérature contemporaine. le fil narratif, lent et minutieux, peut s'avérer impatientant au lecteur avide de rebondissements, et les scènes morbides capables d'exciter sa délectable panoplie d'affects apitoyés ne sont pas assez profuses pour satisfaire son grand appétit du misérable et du souffrant. Aucun des personnages ne surprend par une action grandiose ou une réaction imprévue : tout est annoncé - par de nombreux indices - longtemps à l'avance, en totale conformité des caractères détaillés par un narrateur scrupuleux, attentif aux plus petites variations d'atmosphère et d'humeur. On remarquera, d'ailleurs, que ces personnages sont peu nombreux - j'en compte cinq ou six d'importance, tous d'humbles représentants d'une humanité morale et touchante, c'est à dire motivés par ce qu'ils estiment « bon » et « mauvais » en ce monde. le récit est ponctué de leurs prises de parole aux conclusions presque solennelles, imbibées d'une sorte de sagesse de grand-mère, mi dicton, mi philosophie - le narrateur lui-même a parfois recours a des circonlocutions pour expliquer des idées et des raisonnements pourtant enfantins et dont le peu de densité ne justifie guère qu'il y accorde tant de lignes de reformulation. On peut donc reprocher à l'auteur ces leçons de vie enrobées de bonhomie et de mystère, car prononcées par des gens simples et sur des questionnements favorablement « humains » - bien et mal, bonheur, devoir, justice, etc. - et où la conscience est longuement inspectée. Ainsi, Rieux - médecin investi dans un métier qui devient presque un sacerdoce - s'interroge sur son humanité, l'accompagnement du mort et de ses proches, sa capacité et son devoir de sauver des vies. Cottard - ancien criminel en fuite pour qui la peste est une aubaine qui le soustraira quelques temps à la police - tâche de mener une existence de générosité exemplaire et ne cesse de s'inquiéter qu'un homme puisse racheter ou non ses péchés aux yeux de ses semblables. Grand - petit fonctionnaire appliqué et qui n'a jamais rien exigé pour lui-même - s'épuise à chercher la perfection dans la première phrase de son roman inachevé. Rambert - journaliste pris au piège dans cette ville étrangère - est tiraillé entre son désir de s'échapper et sa volonté d'aider ses compagnons de misère. Enfin, Tarrou - personnage fantaisiste et observateur curieux - se torture l'esprit à l'idée de faire du « mal » en croyant faire du « bien ».
Aussi, la ville d'Oran est un personnage à part entière, ou plutôt une peinture plus globale et artiste de l'évolution de l'épidémie et des états d'âme de ses habitants. le climat, surtout, fait figure d'indicateur : les longs mois d'exil s'allongent sous une grisaille de pluie, tandis qu'un rayon de soleil voit sortir dans les rues des visages emplis d'espoir et de vigueur retrouvés, sans que l'on ne sache si le phénomène naturel provoque une réaction épidermique, ou si c'est cette dernière qui se traduit - par le goût de l'auteur - en une esquisse météorologique. A mon sens, cette stratégie narrative est une manière de toucher à l'art dans l'écriture - lorsque la peinture est réalisée avec le recul et la finesse que seuls peuvent prodiguer des travaux préparatoires et un projet ambitieux et longtemps médité. Face au fléau qui les frappe tous simultanément, les plaintes, protestations et abattements des habitants semblent s'accorder à l'unisson et s'exprimer en un seul cri commun : ce sont à chaque fois des vagues d'humeurs qui traversent la ville et s'y propagent jusque dans ses recoins, et non des figures solitaires et distinctes. Tantôt, c'est l'espoir qui saisit tous les coeurs, puis la résignation, l'apathie, le regain héroïque, et parfois la révolte contre les mesures d'isolement que les autorités imposent - dont le moindre mal est la restriction des libertés de déplacement hors de la ville et l'impression d'enfermement relatif qui en découle, mais dont les conséquences souterraines affectent surtout profondément l'économie, appauvrissant les ménages et conduisant à des pénuries d'aliments et de produits. Nombreux sont ceux qui croient faire figure d'exception et veulent, comme le journaliste Rambert, échapper à la loi - mais les règles de quarantaine ne sont efficaces que si elles sont appliquées jusqu'au bout et en tout lieu et toute personne. Aucune forme de laxisme ne peut subsister si l'on souhaite faire barrière à l'épidémie : c'est la raison pour laquelle toute demi mesure ou retard d'application d'une disposition préventive est à bannir systématiquement, ou bien le but n'est pas atteint et plus rien ne justifie l'instauration d'un quelconque moyen. Autant donner à un poulet un traitement contre la perte des plumes alors qu'il est déjà nu et rose - ce qui revient à lui infliger inutilement des diarrhées indésirables !
le prêtre se tient en embuscade et attend patiemment que son tour vienne, il se repaît des catastrophes et des fléaux où le pouvoir de sa parole divine est renforcé, sublimé par des oreilles souffrantes et égarées. Ainsi, la foule afflue dans l'église lorsque Paneloux prononce son
« La peste » a fait l'objet de toutes sortes d'interprétations variées et de lectures symboliques, dont Albert Camus fut parfois lui-même l'instigateur : en un rat - ai-je entendu quelque part dans une conversation de fats -, on a voulu suggérer l'invasion sournoise du totalitarisme ; en la peste, le fléau de l'occupation nazie ; et à la place de la lutte des médecins et des citoyens, la Résistance contre l'Ennemi. de mon côté, je n'ai pas le goût de me livrer à ce genre de double lecture, même si je ne nie pas au lecteur le droit de tirer du récit les leçons qu'il voudra - après tout, s'il se satisfait d'un symbolisme simpliste et qu'il y trouve comme une forme épurée et sublimée de ce qu'il croit avoir retenu et compris d'un fait précis, je l'abandonne volontiers à son heureuse fascination, mais que l'on ne m'empêche pas alors de m'en tenir à ce qui est écrit. J'ai observé, pour ma part, une maladie contagieuse et mortelle s'emparer progressivement d'une ville jusqu'à la couper du reste du monde et l'amputer, chaque jour et des mois durant, d'un nombre croissant de vies humaines - j'ai observé les humeurs et les pensées de ses habitants prisonniers, tantôt résignés ou révoltés, racontées par un narrateur ordonné et consciencieux. Ce roman est à la fois la rencontre d'une maladie aux contours épidémiologiques et aux symptômes vraisemblables, dont le progrès est relaté avec une rigueur scientifique qui suppose une documentation préalable, et d'une étude psychologique minutieuse, presque impatientante - d'abord celle des personnages, peu nombreux, mais dont les motivations sont à chaque fois très détaillées, comme si l'auteur souhaitait présenter une analyse de chaque « type » humain et de sa lutte morale entre « bien » et « mal » exacerbée par le fléau, mais aussi celle de la masse, de la population entière, comme si celle-ci formait une unité, un seul mouvement. Ces deux aspects surtout retiennent l'intérêt du lecteur : en premier lieu, ce que devient la médecine quand elle ne peut guérir ni prémunir, et n'est plus que logistique et statistiques ; ensuite, ce que devient l'homme quand il est exposé à une crise sanitaire d'une telle ampleur, alors que les libres plaisirs qui constituaient le petit bonheur de sa vie quotidienne sont brusquement prohibés et que la pérennité même de son existence est menacée et rendue incertaine, selon des circonstances extérieures et qu'il ne peut contrôler.
Pour commencer, il faut s'imaginer la ville côtière d'Oran, en Algérie française des années 1940, où le quotidien tranquille est soudainement perturbé par un afflux de rats agonisants dans les immeubles et sur les trottoirs. Rapidement, les premiers cas isolés d'une maladie mortelle se déclarent, présentant des symptômes d'une univocité telle que les médecins soupçonnent, presque immédiatement et par la force d'une conviction qui se passe de tests scientifiques, la réémergence de la peste bubonique, longtemps disparue. Comme la ville compte plus de deux cents mille habitants et que chaque médecin ne rencontre d'abord qu'un ou deux malades parmi ses patients, il s'écoule un certain temps de latence pendant laquelle l'épidémie continue de prendre de l'ampleur, avant que l'on songe à additionner la totalité des cas et que la communauté scientifique donne enfin l'alerte. Un médecin qui n'aura observé qu'une poignée de malades atteints d'une fièvre foudroyante, aux ganglions durs et suppurants, même s'il y reconnaît - tel un présage - les signes illustrés par les terribles fresques du Moyen-Age, n'envisagera pas d'annoncer au monde entier la nouvelle, séance tenante. Non, il lui faudra un appui épidémiologique, l'argument du nombre de morts pesant seul assez lourd pour que les autorités se décident à reconnaître la gravité de la situation et la nécessité du recours à des mesures préventives exceptionnelles. Les chiffres et les modélisations pronostiques sont la preuve écrite et certaine qu'un désastre humain se profile, et là où la parole du médecin est écoutée d'une oreille distraite et sceptique, ces constats indubitables imposent une réaction immédiate des services administratifs qui n'ont alors d'autre choix - sous peine qu'on leur reproche, en connaissance de cause, de n'avoir « rien fait » - que d'agir en conséquence. C'est ainsi, acculées à leur devoir de protection des citoyens, de prévision et de gestion des crises mettant en danger la santé publique, que les autorités ferment les portes de la ville et instaurent toutes sortes de mesures contraignantes pour juguler l'épidémie.
Que la peste puisse ressurgir des tréfonds de l'Histoire, dans une ville qui n'a plus connu d'évènements extraordinaires depuis des siècles, voilà une incongruité qui heurte le schéma routinier d'habitants incrédules, hébétés, pour qui leur existence banale revêt le caractère d'intouchabilité du quotidien commun, qui échappe nécessairement aux grands désastres de l'humanité. Cet ancien mythe ne peut nullement pénétrer les préoccupations ordinaires de cette société bien rangée : c'est une évidence, il n'y a pas sa place - il appartient à d'autres temps, d'autres lieux et d'autres destinées. Que l'on songe seulement aux balbutiements ridicules d'un médecin qui oserait formuler un tel diagnostic, au milieu des cafés et des restaurants bondés, ou devant les tramways qui circulent tranquillement, chargés de leurs lots pressés de travailleurs ! A moins d'être un observateur droit et vrai, comme le vieux médecin Castel pour qui la réalité n'est pas une demi-mesure, un flou mensonger ou une déformation accommodante, l'incertitude l'emporte toujours sur la preuve clinique et la suspicion syndromique, et l'on retarde ainsi le bouleversement qui précède l'acceptation d'un changement brutal et inattendu dans notre existence jusqu'alors si confortablement rassurante. Les services d'administration de la ville, à partir de l'instant où ils seront confrontés aux prévisions alarmantes des données épidémiologiques irréfutables, pousseront l'absurdité jusqu'à son extrémité en faisant appliquer des mesures au seul titre des chiffres, et sans se résoudre à en nommer précisément la cause. Alors que les premières observations des symptômes de la maladie, rapportées par quelques médecins comme Castel, auraient pu permettre une réaction plus précoce et radicale, on se contente d'en traiter les conséquences, avec un train de retard, sans avoir du tout usé de son esprit rationnel et scientifique pour étudier - dès avant son expansion - l'origine du mal et ses mécanismes de transmission. On ne justifie pas la fermeture de la ville par l'identification, parmi ses habitants, de la peste bubonique, mais seulement sur la base d'une liste de morts qui s'allonge de façon inquiétante et qui risquerait de nuire au bien général placé sous la responsabilité des autorités administratives.
La problématique de la santé publique a dépassé celle de l'intérêt médical et étiologique : c'est à peine si un sérum curatif est essayé sur les malades, à la fin de l'épidémie, tant les forces et le temps des médecins sont entièrement consacrés à la gestion du nombre des cas infectés. La prise en charge d'un pestiféré, au lieu de s'inscrire dans un service de « soins », relève en fait de la simple évacuation sanitaire - afin d'éviter la contamination des voisins et des proches -, ainsi que d'un recensement de décès. Invariablement, les formes graves succombent au mal et il s'agit surtout que les corps entrent dans un circuit sécurisé de désinfection et que leurs relents ne polluent pas l'air des habitations. Les familles ne s'y trompent pas : le médecin perd peu à peu sa figure de bienfaiteur et de guérisseur, pour devenir celle du croque-mort qui retire les mourants à leur foyer et les expédie, sous les sirènes stridentes des ambulances, vers une fin certaine. Quand la médecine est rendue impuissante, dépassée par la virulence inédite de l'infection et engloutie par l'amoncellement de données que suppose une prise en charge globale, devenue pure gestion et statistique, qui préfère la sauvegarde d'un plus grand nombre - en prévenant la contamination par des mesures d'isolement et en s'assurant de voir chaque malade mourir dans un lit médicalisé, même improvisé - aux recherches médicales sur la cause de l'épidémie - le bacille de la peste -, elle n'est plus un art, ni une science, et l'homme n'apprend rien - mais il est vrai au moins qu'il aura répertorié les noms et prénoms de tous ses morts et en aura préservé le digne souvenir.
On peut s'interroger sur la pertinence des choix stratégiques des autorités d'Oran, qui agissent toujours, comme elles ne manquent pas de le rappeler, selon l'avis des médecins. La ville étant le premier et unique foyer connu de l'épidémie, il est d'abord décidé d'interrompre tous ses contacts avec le monde extérieur - sorties de voyageurs, courriers, etc. -, tant et si bien qu'à aucun moment la maladie ne devient une menace pandémique. Fait étrange, le confinement est limité aux remparts d'Oran, mais il n'est jamais question d'empêcher les déplacements des habitants ou de restreindre leur quotidien à l'intérieur même de la ville - en assignant par exemple chacun à demeure. Cafés, restaurants, boutiques et transports en commun restent ouverts, sans qu'aucune instance ne spécifie des gestes barrières à observer pour se protéger de la contamination - lavage de mains, port de masques, distance minimale d'un mètre ou limitation des effusions amicales ou des réunions de groupe. L'exercice d'un métier n'est pas interdit, quoique l'isolement de la ville empiète sur les activités des uns et des autres, notamment par un couvre-feu qui n'était du reste pas exceptionnel à l'époque, ni n'empêche-t-on les promenades, représentations théâtrales ou séances cinématographiques. Les contraintes, outre l'interdiction de quitter la ville, se manifestent surtout lorsque l'on est soi-même, ou l'un de nos proches, touché par la maladie : le cas diagnostiqué est alors impérativement transféré dans l'un des hôpitaux - qui sont pour la plupart des écoles et autres bâtiments publics transformés à cet effet - et son entourage est dispersé dans les camps de quarantaine - stades et terrains de sports dont la surface a été aménagée en rangées de tentes. Les hôpitaux de fortune, où l'on multiplie toujours les lits et où l'on prodigue de moins en moins de soins véritables, sont gérés aussi bien par des citoyens ordinaires que par des médecins et infirmières, faute d'effectifs suffisants. L'équipement y est minime - masques et blouses - mais simple, loin des appareillages complexes dont nous disposons aujourd'hui : les mesures d'hygiène et le circuit des cadavres jusqu'à la fosse commune, puis jusqu'au four crématoire, sont calculés dans un souci d'efficacité austère. Une fois qu'un malade est englouti dans la machine infernale de la logistique sanitaire et administrative, sa famille ne le revoit plus, mais est dûment informée de son décès, à l'heure venue.
Les privations de liberté les plus contraignantes interviennent donc surtout a posteriori d'une infection par la peste, et non par mesure de prévention stricte - j'entends par là, mesure de prévention dans un foyer qui n'aurait pas du tout été en contact avec le bacille, mise à part bien sûr la limitation des déplacements et des rapports en dehors de la ville. J'ignore si ces lacunes flagrantes dans la prévention de la propagation d'une maladie contagieuse et mortelle sont le résultat d'un défaut de vision chez Camus - s'est-il suffisamment documenté, a-t-il auguré à tort un scénario bancal ? - ou bien le fruit d'une pensée libre, qui n'a pas même envisagé qu'on puisse confiner les gens chez eux et restreindre leurs activités professionnelles et sociales, parce qu'elle l'aurait jugé d'une inhumanité indécente et d'une contrainte inacceptable.
Lorsqu'une maladie mortelle touche une large part de population, il est impossible de contempler le dernier soupir de chaque homme, femme et enfant, et ceux-ci deviennent bientôt une rangée de chiffres noirs sur des feuilles de compte. Or, on sait bien que l'on ne ressent pas une peine et une empathie en proportion du nombre de ses bénéficiaires : au delà d'un certain point - et je prétends même que ce point se situe en dessous d'une dizaine d'individus -, on ne peut distribuer à chaque perte humaine le juste montant de chagrin qui lui revient, par dignité. Pire, lorsqu'on voit mourir un homme et que l'on est simultanément conscient que de multiples scènes semblables ont lieu au même moment partout dans la ville, l'épuisement gagne jusqu'à nos sentiments - l'expression la plus patente de notre humanité - et l'on se surprend alors dans un état d'instabilité émotionnelle où l'on oscille entre exacerbation et atténuation de nos élans compassionnels. Là réside le grand péril de la codification des règles de prévention et d'hygiène : un soignant, qu'il soit médecin ou citoyen volontaire, ne tient pas la longueur - il n'a pas l'endurance indispensable à la lutte rationnelle et systématique contre la contagion. Passés les premiers jours d'urgence et de vigilance accrue, il s'use à la tâche, effiloche à la fois ses sens et ses émotions, tandis que la maladie - bacille microscopique et primaire - profite de ses inattentions pour franchir les barrières qu'on a voulu ériger entre elle et ses hôtes. C'est pourquoi il faudrait, dans ce combat de chaque instant et de toutes les précautions, un renouvellement incessant de volontaires, par intervalles de quelques jours à semaines : la fibre héroïque ne se prolonge guère au delà, et seul un sang neuf et enthousiaste aura la patience et les scrupules nécessaires à l'éradication d'un ennemi invisible, après quoi, il s'en désintéresse et le néglige. Il est contraire à la vie de se contenir sans répit, de mesurer chacun de ses gestes, de limiter ses mouvements jusqu'à ressembler le plus possible au végétal dans sa serre, fixe et inanimé, que l'on vient nourrir par cargaison de terreau, et qui n'entretient avec son environnement qu'un minimum d'interactions - en somme, juste le nécessaire pour encore exister.
« La Peste » de Camus est un de ces romans ayant connu un succès qu'il lui aurait été difficile d'atteindre aujourd'hui, selon les standards de notre littérature contemporaine. le fil narratif, lent et minutieux, peut s'avérer impatientant au lecteur avide de rebondissements, et les scènes morbides capables d'exciter sa délectable panoplie d'affects apitoyés ne sont pas assez profuses pour satisfaire son grand appétit du misérable et du souffrant. Aucun des personnages ne surprend par une action grandiose ou une réaction imprévue : tout est annoncé - par de nombreux indices - longtemps à l'avance, en totale conformité des caractères détaillés par un narrateur scrupuleux, attentif aux plus petites variations d'atmosphère et d'humeur. On remarquera, d'ailleurs, que ces personnages sont peu nombreux - j'en compte cinq ou six d'importance, tous d'humbles représentants d'une humanité morale et touchante, c'est à dire motivés par ce qu'ils estiment « bon » et « mauvais » en ce monde. le récit est ponctué de leurs prises de parole aux conclusions presque solennelles, imbibées d'une sorte de sagesse de grand-mère, mi dicton, mi philosophie - le narrateur lui-même a parfois recours a des circonlocutions pour expliquer des idées et des raisonnements pourtant enfantins et dont le peu de densité ne justifie guère qu'il y accorde tant de lignes de reformulation. On peut donc reprocher à l'auteur ces leçons de vie enrobées de bonhomie et de mystère, car prononcées par des gens simples et sur des questionnements favorablement « humains » - bien et mal, bonheur, devoir, justice, etc. - et où la conscience est longuement inspectée. Ainsi, Rieux - médecin investi dans un métier qui devient presque un sacerdoce - s'interroge sur son humanité, l'accompagnement du mort et de ses proches, sa capacité et son devoir de sauver des vies. Cottard - ancien criminel en fuite pour qui la peste est une aubaine qui le soustraira quelques temps à la police - tâche de mener une existence de générosité exemplaire et ne cesse de s'inquiéter qu'un homme puisse racheter ou non ses péchés aux yeux de ses semblables. Grand - petit fonctionnaire appliqué et qui n'a jamais rien exigé pour lui-même - s'épuise à chercher la perfection dans la première phrase de son roman inachevé. Rambert - journaliste pris au piège dans cette ville étrangère - est tiraillé entre son désir de s'échapper et sa volonté d'aider ses compagnons de misère. Enfin, Tarrou - personnage fantaisiste et observateur curieux - se torture l'esprit à l'idée de faire du « mal » en croyant faire du « bien ».
Aussi, la ville d'Oran est un personnage à part entière, ou plutôt une peinture plus globale et artiste de l'évolution de l'épidémie et des états d'âme de ses habitants. le climat, surtout, fait figure d'indicateur : les longs mois d'exil s'allongent sous une grisaille de pluie, tandis qu'un rayon de soleil voit sortir dans les rues des visages emplis d'espoir et de vigueur retrouvés, sans que l'on ne sache si le phénomène naturel provoque une réaction épidermique, ou si c'est cette dernière qui se traduit - par le goût de l'auteur - en une esquisse météorologique. A mon sens, cette stratégie narrative est une manière de toucher à l'art dans l'écriture - lorsque la peinture est réalisée avec le recul et la finesse que seuls peuvent prodiguer des travaux préparatoires et un projet ambitieux et longtemps médité. Face au fléau qui les frappe tous simultanément, les plaintes, protestations et abattements des habitants semblent s'accorder à l'unisson et s'exprimer en un seul cri commun : ce sont à chaque fois des vagues d'humeurs qui traversent la ville et s'y propagent jusque dans ses recoins, et non des figures solitaires et distinctes. Tantôt, c'est l'espoir qui saisit tous les coeurs, puis la résignation, l'apathie, le regain héroïque, et parfois la révolte contre les mesures d'isolement que les autorités imposent - dont le moindre mal est la restriction des libertés de déplacement hors de la ville et l'impression d'enfermement relatif qui en découle, mais dont les conséquences souterraines affectent surtout profondément l'économie, appauvrissant les ménages et conduisant à des pénuries d'aliments et de produits. Nombreux sont ceux qui croient faire figure d'exception et veulent, comme le journaliste Rambert, échapper à la loi - mais les règles de quarantaine ne sont efficaces que si elles sont appliquées jusqu'au bout et en tout lieu et toute personne. Aucune forme de laxisme ne peut subsister si l'on souhaite faire barrière à l'épidémie : c'est la raison pour laquelle toute demi mesure ou retard d'application d'une disposition préventive est à bannir systématiquement, ou bien le but n'est pas atteint et plus rien ne justifie l'instauration d'un quelconque moyen. Autant donner à un poulet un traitement contre la perte des plumes alors qu'il est déjà nu et rose - ce qui revient à lui infliger inutilement des diarrhées indésirables !
le prêtre se tient en embuscade et attend patiemment que son tour vienne, il se repaît des catastrophes et des fléaux où le pouvoir de sa parole divine est renforcé, sublimé par des oreilles souffrantes et égarées. Ainsi, la foule afflue dans l'église lorsque Paneloux prononce son
Que la peste puisse, à la moitié du XXème siècle, toucher une ville comme Oran, n'est pas irréaliste. Même si, dans ce cas, elle ne toucherait pas que cette seule ville.
Camus analyse la progression du virus, et celle de la mortalité associée, mais surtout les effets que cette fatalité produit sur les hommes: tout un chacun, le médecin, le fonctionnaire, le juge, le fou, le curé, le journaliste parachuté... Évidemment, le courage ne sera pas chez tous au même niveau.
L'Administration hésite, les médecins sont prudents, le curé, lui, voit à la fois la punition peut-être méritée, et l'occasion de toucher la grâce.
La mort frappe au hasard, et l'on s'y habituerait, si elle ne frappait pas aussi le plus innocent des enfants.
Les portes de la ville se ferment, les enterrements s'automatisent et se déshumanisent, les sérums font ce qu'ils peuvent, c'est-à-dire très peu.
Ces faits donnent à Camus l'occasion d'exprimer de façon magistrale ses talents de romancier, et sa philosophie désenchantée quant aux qualités des hommes.
Certaines pages sont magnifiques, à la fois d'une grande profondeur, et d'un style touchant à la perfection.
La peste est un prétexte, pour Camus, de nous dire ce qu'il sait de l'humanité. C'est cela qui est, ici, passionnant.
Camus analyse la progression du virus, et celle de la mortalité associée, mais surtout les effets que cette fatalité produit sur les hommes: tout un chacun, le médecin, le fonctionnaire, le juge, le fou, le curé, le journaliste parachuté... Évidemment, le courage ne sera pas chez tous au même niveau.
L'Administration hésite, les médecins sont prudents, le curé, lui, voit à la fois la punition peut-être méritée, et l'occasion de toucher la grâce.
La mort frappe au hasard, et l'on s'y habituerait, si elle ne frappait pas aussi le plus innocent des enfants.
Les portes de la ville se ferment, les enterrements s'automatisent et se déshumanisent, les sérums font ce qu'ils peuvent, c'est-à-dire très peu.
Ces faits donnent à Camus l'occasion d'exprimer de façon magistrale ses talents de romancier, et sa philosophie désenchantée quant aux qualités des hommes.
Certaines pages sont magnifiques, à la fois d'une grande profondeur, et d'un style touchant à la perfection.
La peste est un prétexte, pour Camus, de nous dire ce qu'il sait de l'humanité. C'est cela qui est, ici, passionnant.
Une longue et tragique description des conséquences d'une épidémie de peste s'abattant sur une ville, qui résonne évidemment d'une manière particulière eu égard aux temps présents.
Dans un style réaliste, Camus décrit l'agonie physique des malades mais également morale de la ville, qui est assez personnifiée. L'on suit plusieurs personnages, tous masculins, qui abordent cette épidémie de manières très diverses.
Progressivement, les dialogues entre les personnages s'orientent vers des réflexions philosophiques à propos de la mort, de la raison et de la nécessité de vivre, etc.
C'est un récit très bien mené, avec les qualités littéraires universellement reconnues d'Albert Camus, mais je pense qu'on sur-analyse un peu cette oeuvre, cherchant parfois de l'interprétation profonde à l'excès.
Dans un style réaliste, Camus décrit l'agonie physique des malades mais également morale de la ville, qui est assez personnifiée. L'on suit plusieurs personnages, tous masculins, qui abordent cette épidémie de manières très diverses.
Progressivement, les dialogues entre les personnages s'orientent vers des réflexions philosophiques à propos de la mort, de la raison et de la nécessité de vivre, etc.
C'est un récit très bien mené, avec les qualités littéraires universellement reconnues d'Albert Camus, mais je pense qu'on sur-analyse un peu cette oeuvre, cherchant parfois de l'interprétation profonde à l'excès.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Albert Camus (102)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Que savez-vous de "La peste" d'Albert Camus ?
En quelle année est publié "La peste" ?
1945
1946
1947
1948
20 questions
1778 lecteurs ont répondu
Thème : La Peste de
Albert CamusCréer un quiz sur ce livre1778 lecteurs ont répondu