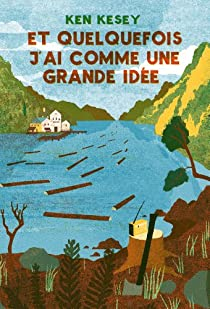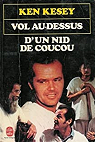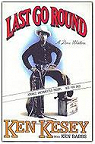Critiques filtrées sur 5 étoiles
Pow-pow-pow ! Et quelques fois j'ai comme une grande idée : comme sortir ce livre de ma PAL grâce à vos suggestions dans ma liste Pour les aventuriers littéraires ! C'est vrai qu'il faut être en forme pour suivre le fond au début, mais très vite on se prend au jeu de toutes ces voix dans notre tête !
.
Oregon, milieu du vingtième siècle. Une grève des bûcherons paralyse la ville et son économie mais n'aboutit à rien, car la famille Stamper continue d'approvisionner la grande entreprise en bois. Un syndicaliste tente de comprendre quel est le blocage de ce clan récalcitrant, afin de le convaincre de se rallier à la cause. Celui-ci vient en effet de rompre les négociations en accrochant devant sa maison un bras humain faisant un doigt d'honneur… Ca vous met dans l'ambiance ! Mais lorsque notre syndicaliste interroge l'épouse Stamper, il s'entend répondre que les raisons remontent à plusieurs générations. Autant dire que le mal s'annonce difficile à déraciner.
.
A ce moment-là de l'histoire une petite voix dans ma tête a chouiné : Pitié, ne me dites pas que de longues descriptions ennuyeuses de décennies de querelles familiales nous attendent …?
.
« - Foutaise ! Tout ce que je veux savoir, c'est pourquoi il s'est mis en tête de changer d'avis.
- Pour cela, il faudrait que vous sachiez d'abord comment s'est formé tout ce qu'il y a dedans, pas vrai ?
- Comment ça, tout ce qu'il y a dedans ?
- Dans sa tête, monsieur Draeger.
- Oui, bon, d'accord. D'accord, j'ai compris. J'ai le temps qu'il faut. »
.
Ouf : on va nous placer dans sa tête, ça promet d'être plus fun que prévu ! L'épouse commence alors son récit, qui sera interrompu et complété par les voix des autres personnages. Ce roman, incroyablement polyphonique, ouvre l'album de famille sur l'arrivée des Stamper à Wakonda, Oregon, les péripéties de son intégration et les querelles familiales jusqu'à ce jour. Henri Stamper était jeune lorsqu'il a décidé de s'établir à Wakonda. Il y a fondé son affaire mais aussi sa famille, composée de son fils Hank puis, avec sa seconde épouse, de son fils Lee parti faire ses études ailleurs. Il a fait venir d'autres membres de sa famille pour l'aider à faire tourner son entreprise de bucherons.
.
Cependant, arrogant et bourru, Henri a fait des mécontents, aussi bien au village que dans sa famille, et il se pourrait bien que ceux-ci ne se soient pas privés d'agir à leur tour comme bon leur semblait lorsque l'occasion s'est présentée, au mépris des dommages collatéraux… Aussi lorsque, pour assurer les demandes en bois durant la grève, la famille Stamper rappelle Lee pour les aider dans l'entreprise familiale, ils sont loin de se douter qu'il accepte uniquement pour accomplir sa vengeance ! Parallèlement, la tension monte au sein des habitants de la ville, qui voient d'un très mauvais oeil le fait que les Stamper puissent s'enrichir sur le dos de leur grève.
.
Le fait qu'une histoire de grève s'ajoute à l'histoire familiale s'annonce complexe à démêler. Ajoutez à cela que l'auteur est Ken Kesey, on se prépare tout de suite à voler au-dessus d'un nid de coucous… C'est encore plus réjouissant ! Aucune narration n'aurait pu mieux faire le taf : L'auteur superpose les époques sur un même lieu, en racontant en même temps (oui-oui, en même temps, vous dis-je^^), l'arrivée difficile de la famille Stamper à Wakonda, le développement de la famille et l'entreprise d'Henri, le départ de son fils, son retour, la grève, bref : tout. Comment fait-il ? En intercalant dans le même récit des paragraphes - ou des bout de phrases s'interrompant les uns les autres !! - de ces différentes époques qui sont, en outre, racontées - ou pensées - par différents narrateurs !! Si-si c'est possible : il l'a fait. Comment on s'en sort matériellement ? Eh bien, comme on peut au départ : L'auteur modifie la typographie à chaque fois : les pensées De Lee en italique viennent interrompre - et interpeller ! - le récit de Hank en lettres normales ; entre parenthèses, elles peuvent aussi s'inviter dans un dialogue avec son père ; le récit de leur installation dans la ville est interrompu par un événement lié qui a lieu au même endroit 40 ans après (avec un intriguant cercueil jeté à la rivière qui ne présage rien de bon) que l'on distingue grâce à des parenthèses sur une typologie normale, etc…
.
Rapidement, on prend le pli : lorsqu'il nous parle d'un personnage, l'auteur utilise la focalisation interne. « Je » est donc, d'un paragraphe à l'autre, l'un ou l'autre des personnages principaux (Hank ou Lee le plus souvent) sans autre indication pour s'y retrouver que le contenu de leurs pensées et ressentis. Pour mon plus grand plaisir (j'adore savoir ce que pensent les gens^^), les parenthèses dans ce paragraphe signalent souvent les pensées concomitantes de l'autre personnage : ce procédé place le lecteur au coeur du bouillonnement émotionnel et intellectuel de chaque personnage et de leur interaction en temps réel, lui permettant de les comprendre au mieux et, surtout, de comprendre d'où vient leur incompréhension mutuelle, leur incapacité à se comprendre : c'est comme s'ils parlaient deux langages différents tellement ils ont deux systèmes de pensées et deux sensibilités différentes. le mâle alpha direct qui règle ses problèmes en face, aux poings s'il le faut, et l'intellectuel névrosé, plus stratégique et sournois.
.
Et c'est un crève-coeur de les voir se déchirer alors qu'on sent que, finalement, ils ne souhaitent qu'une seule et même chose : l'amour et la considération de l'autre, chacun s'étant toujours trouvé pas assez bien pour l'autre (pas assez fort ou pas assez intelligent). Hank notamment m'a beaucoup touchée car il essaye sans arrêt d'intégrer Lee à la famille, pour qu'il soit fier d'eux ou juste qu'ils se comprennent et partagent des choses, et qu'ensemble ils parviennent à vivre et réaliser des projets main dans la main, comme deux frères. Mais il le dit à la façon bourrue que son père Henri lui a toujours fait connaître ("on va mater tout ça à grand coups de trique, crénom de dieu"^^), et jamais Lee ne reçoit correctement le message, du fait notamment de leur passé commun, ce qui augmente sa rage envers Hank et cette famille dont il se sent exclu et moqué. On sent donc dès le début qu'un drame est sur le point d'éclore de tout cela, d'autant que l'abcès du passé n'est pas crevé…
.
Entendre, comprendre et ressentir chaque personnage est au centre de la narration de Ken Kesey. Ce qui est remarquable dans ce roman, c'est que la plume suit ce mouvement dans une construction qui, si elle peut paraître schizophrénique au départ, est en réalité d'une précision chirurgicale : Au départ, les interventions des personnages viennent s'immiscer dans la narration omnisciente via italique ou parenthèses ; mais bientôt nous rencontrons les personnages principaux et, lorsqu'ils racontent à la première personne, leurs voix prennent toute la place et deviennent ainsi, alternativement, la narration principale ; alors le processus s'inverse naturellement : les paragraphes épars dévolus à la narration omnisciente sont réduits à l'état de didascalies par la typographie : petits paragraphes en italique entre deux points de vue internes De Lee ou Hank. Ken Kesey en joue d'ailleurs avec le lecteur, lui laissant entendre que même pour lui, parfois, cette narration moderne est compliquée à tenir grammaticalement parlant, notamment pour la concordance des temps, même si elle offre une grande liberté d'effets et un grand potentiel de rendu, extraordinaire !
.
Immédiatement, le lecteur un peu assidu a donc une formidable vision d'ensemble, sans être obligé d'attendre, en piaffant d'impatience, que le contexte veuille bien s'installer de manière linéaire ; Dans le même temps, il faut l'avouer, il peut aussi choper, durant les moments les plus intenses, une formidable migraine à vouloir tenter d'entendre toutes ces voix qui tentent de s'exprimer simultanément dans sa tête, sur différents tons et à différentes époques. Peut-être faut-il être un chouillas schizophrène pour parvenir sans problème à reconstituer cette histoire à l'aide de ces bribes, au départ. Mais c'est un formidable puzzle que nous offre l'initiateur des fameuses parties d'Acid tests (vous trouverez dans la liste Pour les aventuriers de la littérature un livre de Tom Wolfe consacré à ces drogue-party). Peut-être aussi faut-il avoir ressenti et expérimenté cette sensation pour avoir le génie de la reproduire si précisément à l'écrit, en parvenant malgré tout - c'est là l'exploit - au but poursuivi : se faire comprendre du lecteur. Pour ma part, le procédé et la construction m'ont immédiatement parus naturels, une évidence collant au fond et le servant brillamment, s'accordant parfaitement à chacun des personnages, dont la psychologie a été pensée avec soin, et à leurs points de vue magnifiquement retranscrits.
.
Voilà, j'en parle très mal, je m'en rends compte. Mais c'est pour lire des livres comme ça que je suis devenue lectrice. Une fresque de 900 pages où le contexte économique et social, mais aussi l'omniprésence de la nature en toile de fond, rendent cette profondeur propre aux grands romans américains que j'affectionne tant ! Plutôt que de regretter qu'il n'ait écrit que deux romans, je vais donc m'estimer chanceuse d'avoir pu les lire, « crénom de dieu » ! (désolée par avance pour les livres qui vont passer après ça…^^).
.
Oregon, milieu du vingtième siècle. Une grève des bûcherons paralyse la ville et son économie mais n'aboutit à rien, car la famille Stamper continue d'approvisionner la grande entreprise en bois. Un syndicaliste tente de comprendre quel est le blocage de ce clan récalcitrant, afin de le convaincre de se rallier à la cause. Celui-ci vient en effet de rompre les négociations en accrochant devant sa maison un bras humain faisant un doigt d'honneur… Ca vous met dans l'ambiance ! Mais lorsque notre syndicaliste interroge l'épouse Stamper, il s'entend répondre que les raisons remontent à plusieurs générations. Autant dire que le mal s'annonce difficile à déraciner.
.
A ce moment-là de l'histoire une petite voix dans ma tête a chouiné : Pitié, ne me dites pas que de longues descriptions ennuyeuses de décennies de querelles familiales nous attendent …?
.
« - Foutaise ! Tout ce que je veux savoir, c'est pourquoi il s'est mis en tête de changer d'avis.
- Pour cela, il faudrait que vous sachiez d'abord comment s'est formé tout ce qu'il y a dedans, pas vrai ?
- Comment ça, tout ce qu'il y a dedans ?
- Dans sa tête, monsieur Draeger.
- Oui, bon, d'accord. D'accord, j'ai compris. J'ai le temps qu'il faut. »
.
Ouf : on va nous placer dans sa tête, ça promet d'être plus fun que prévu ! L'épouse commence alors son récit, qui sera interrompu et complété par les voix des autres personnages. Ce roman, incroyablement polyphonique, ouvre l'album de famille sur l'arrivée des Stamper à Wakonda, Oregon, les péripéties de son intégration et les querelles familiales jusqu'à ce jour. Henri Stamper était jeune lorsqu'il a décidé de s'établir à Wakonda. Il y a fondé son affaire mais aussi sa famille, composée de son fils Hank puis, avec sa seconde épouse, de son fils Lee parti faire ses études ailleurs. Il a fait venir d'autres membres de sa famille pour l'aider à faire tourner son entreprise de bucherons.
.
Cependant, arrogant et bourru, Henri a fait des mécontents, aussi bien au village que dans sa famille, et il se pourrait bien que ceux-ci ne se soient pas privés d'agir à leur tour comme bon leur semblait lorsque l'occasion s'est présentée, au mépris des dommages collatéraux… Aussi lorsque, pour assurer les demandes en bois durant la grève, la famille Stamper rappelle Lee pour les aider dans l'entreprise familiale, ils sont loin de se douter qu'il accepte uniquement pour accomplir sa vengeance ! Parallèlement, la tension monte au sein des habitants de la ville, qui voient d'un très mauvais oeil le fait que les Stamper puissent s'enrichir sur le dos de leur grève.
.
Le fait qu'une histoire de grève s'ajoute à l'histoire familiale s'annonce complexe à démêler. Ajoutez à cela que l'auteur est Ken Kesey, on se prépare tout de suite à voler au-dessus d'un nid de coucous… C'est encore plus réjouissant ! Aucune narration n'aurait pu mieux faire le taf : L'auteur superpose les époques sur un même lieu, en racontant en même temps (oui-oui, en même temps, vous dis-je^^), l'arrivée difficile de la famille Stamper à Wakonda, le développement de la famille et l'entreprise d'Henri, le départ de son fils, son retour, la grève, bref : tout. Comment fait-il ? En intercalant dans le même récit des paragraphes - ou des bout de phrases s'interrompant les uns les autres !! - de ces différentes époques qui sont, en outre, racontées - ou pensées - par différents narrateurs !! Si-si c'est possible : il l'a fait. Comment on s'en sort matériellement ? Eh bien, comme on peut au départ : L'auteur modifie la typographie à chaque fois : les pensées De Lee en italique viennent interrompre - et interpeller ! - le récit de Hank en lettres normales ; entre parenthèses, elles peuvent aussi s'inviter dans un dialogue avec son père ; le récit de leur installation dans la ville est interrompu par un événement lié qui a lieu au même endroit 40 ans après (avec un intriguant cercueil jeté à la rivière qui ne présage rien de bon) que l'on distingue grâce à des parenthèses sur une typologie normale, etc…
.
Rapidement, on prend le pli : lorsqu'il nous parle d'un personnage, l'auteur utilise la focalisation interne. « Je » est donc, d'un paragraphe à l'autre, l'un ou l'autre des personnages principaux (Hank ou Lee le plus souvent) sans autre indication pour s'y retrouver que le contenu de leurs pensées et ressentis. Pour mon plus grand plaisir (j'adore savoir ce que pensent les gens^^), les parenthèses dans ce paragraphe signalent souvent les pensées concomitantes de l'autre personnage : ce procédé place le lecteur au coeur du bouillonnement émotionnel et intellectuel de chaque personnage et de leur interaction en temps réel, lui permettant de les comprendre au mieux et, surtout, de comprendre d'où vient leur incompréhension mutuelle, leur incapacité à se comprendre : c'est comme s'ils parlaient deux langages différents tellement ils ont deux systèmes de pensées et deux sensibilités différentes. le mâle alpha direct qui règle ses problèmes en face, aux poings s'il le faut, et l'intellectuel névrosé, plus stratégique et sournois.
.
Et c'est un crève-coeur de les voir se déchirer alors qu'on sent que, finalement, ils ne souhaitent qu'une seule et même chose : l'amour et la considération de l'autre, chacun s'étant toujours trouvé pas assez bien pour l'autre (pas assez fort ou pas assez intelligent). Hank notamment m'a beaucoup touchée car il essaye sans arrêt d'intégrer Lee à la famille, pour qu'il soit fier d'eux ou juste qu'ils se comprennent et partagent des choses, et qu'ensemble ils parviennent à vivre et réaliser des projets main dans la main, comme deux frères. Mais il le dit à la façon bourrue que son père Henri lui a toujours fait connaître ("on va mater tout ça à grand coups de trique, crénom de dieu"^^), et jamais Lee ne reçoit correctement le message, du fait notamment de leur passé commun, ce qui augmente sa rage envers Hank et cette famille dont il se sent exclu et moqué. On sent donc dès le début qu'un drame est sur le point d'éclore de tout cela, d'autant que l'abcès du passé n'est pas crevé…
.
Entendre, comprendre et ressentir chaque personnage est au centre de la narration de Ken Kesey. Ce qui est remarquable dans ce roman, c'est que la plume suit ce mouvement dans une construction qui, si elle peut paraître schizophrénique au départ, est en réalité d'une précision chirurgicale : Au départ, les interventions des personnages viennent s'immiscer dans la narration omnisciente via italique ou parenthèses ; mais bientôt nous rencontrons les personnages principaux et, lorsqu'ils racontent à la première personne, leurs voix prennent toute la place et deviennent ainsi, alternativement, la narration principale ; alors le processus s'inverse naturellement : les paragraphes épars dévolus à la narration omnisciente sont réduits à l'état de didascalies par la typographie : petits paragraphes en italique entre deux points de vue internes De Lee ou Hank. Ken Kesey en joue d'ailleurs avec le lecteur, lui laissant entendre que même pour lui, parfois, cette narration moderne est compliquée à tenir grammaticalement parlant, notamment pour la concordance des temps, même si elle offre une grande liberté d'effets et un grand potentiel de rendu, extraordinaire !
.
Immédiatement, le lecteur un peu assidu a donc une formidable vision d'ensemble, sans être obligé d'attendre, en piaffant d'impatience, que le contexte veuille bien s'installer de manière linéaire ; Dans le même temps, il faut l'avouer, il peut aussi choper, durant les moments les plus intenses, une formidable migraine à vouloir tenter d'entendre toutes ces voix qui tentent de s'exprimer simultanément dans sa tête, sur différents tons et à différentes époques. Peut-être faut-il être un chouillas schizophrène pour parvenir sans problème à reconstituer cette histoire à l'aide de ces bribes, au départ. Mais c'est un formidable puzzle que nous offre l'initiateur des fameuses parties d'Acid tests (vous trouverez dans la liste Pour les aventuriers de la littérature un livre de Tom Wolfe consacré à ces drogue-party). Peut-être aussi faut-il avoir ressenti et expérimenté cette sensation pour avoir le génie de la reproduire si précisément à l'écrit, en parvenant malgré tout - c'est là l'exploit - au but poursuivi : se faire comprendre du lecteur. Pour ma part, le procédé et la construction m'ont immédiatement parus naturels, une évidence collant au fond et le servant brillamment, s'accordant parfaitement à chacun des personnages, dont la psychologie a été pensée avec soin, et à leurs points de vue magnifiquement retranscrits.
.
Voilà, j'en parle très mal, je m'en rends compte. Mais c'est pour lire des livres comme ça que je suis devenue lectrice. Une fresque de 900 pages où le contexte économique et social, mais aussi l'omniprésence de la nature en toile de fond, rendent cette profondeur propre aux grands romans américains que j'affectionne tant ! Plutôt que de regretter qu'il n'ait écrit que deux romans, je vais donc m'estimer chanceuse d'avoir pu les lire, « crénom de dieu » ! (désolée par avance pour les livres qui vont passer après ça…^^).
Il y a peut-être trois semaines j'ai commencé un roman qui pour moi est un chef d'oeuvre.
"Et quelquefois j'ai comme une grande idée " est comme dirait Lehan-fan " une oeuvre grandiose ".
Ken Kesey est l'auteur du célèbre " vol au-dessus d'un nid de coucou ", c'est aussi ce joyeux luron qui avec sa bande des "merry pranksters "sillonnèrent les États Unis dans ce bus bariolé, ces fameux "acid test " si bien narré par Tom Wolfe.
" Et quelquefois j'ai comme une grande idée " est un roman sur le combat, un combat permanent, celle de deux frères que tout oppose.
Hank,l'aîné, le costaud, celui qui remplace le patriarche Henry, qui fait face à la grève des bûcherons.
Leland le second fils issu du deuxième mariage de Henry est l'intellectuel de la famille plutôt introverti, mal dans sa peau à cause d'un secret qui l'étouffe.
C'est aussi le combat de l'homme contre la nature, cette forêt de l'Oregon, des arbres centenaires magnifiques, ces feuilles qui craquent sous les pas, les odeurs de mousses qui pourrissent, la rivière Wakonda, puissante qui a chaque crue emporte des pans entiers de rivage, se sont le vol des oies sauvages, leurs cries assourdissants qui annonce la fin de l'automne.
La lune et son aura lumineux, la confidente de Leland.
Ce récit m'a pris au ventre, un roman dense, touffu comme cette forêt.
La narration particulière de Ken Kesey avec ces parenthèses qui ponctue le récit.un grand merci aux éditions de monsieur Toussaint l'ouverture pour ce grand livre jubilatoire et mes excuses à celles et ceux qui m'ont envoyé des messages.
"Et quelquefois j'ai comme une grande idée " est comme dirait Lehan-fan " une oeuvre grandiose ".
Ken Kesey est l'auteur du célèbre " vol au-dessus d'un nid de coucou ", c'est aussi ce joyeux luron qui avec sa bande des "merry pranksters "sillonnèrent les États Unis dans ce bus bariolé, ces fameux "acid test " si bien narré par Tom Wolfe.
" Et quelquefois j'ai comme une grande idée " est un roman sur le combat, un combat permanent, celle de deux frères que tout oppose.
Hank,l'aîné, le costaud, celui qui remplace le patriarche Henry, qui fait face à la grève des bûcherons.
Leland le second fils issu du deuxième mariage de Henry est l'intellectuel de la famille plutôt introverti, mal dans sa peau à cause d'un secret qui l'étouffe.
C'est aussi le combat de l'homme contre la nature, cette forêt de l'Oregon, des arbres centenaires magnifiques, ces feuilles qui craquent sous les pas, les odeurs de mousses qui pourrissent, la rivière Wakonda, puissante qui a chaque crue emporte des pans entiers de rivage, se sont le vol des oies sauvages, leurs cries assourdissants qui annonce la fin de l'automne.
La lune et son aura lumineux, la confidente de Leland.
Ce récit m'a pris au ventre, un roman dense, touffu comme cette forêt.
La narration particulière de Ken Kesey avec ces parenthèses qui ponctue le récit.un grand merci aux éditions de monsieur Toussaint l'ouverture pour ce grand livre jubilatoire et mes excuses à celles et ceux qui m'ont envoyé des messages.
À propos d'un monument…
S'attaquer à Et quelquefois j'ai comme une grande idée, de Ken Kesey – traduit par Antoine Cazé – est déjà une aventure en soi. Tenter de le chroniquer ensuite, confine à l'inconscience. Ou à une forme extrême de suffisance. Deux raisons de refuser l'obstacle et de me limiter à quelques conseils adressés aux futurs lecteurs de ces 894 pages.
D'abord, commencer par la fin, et ce conseil de « l'époustouflant » éditeur, Monsieur Toussaint Louverture : « Ne vous laissez pas décourager, prenez le temps, remettez à plus tard si besoin, mais n'abandonnez pas, c'est l'un des plus grands livres qu'il nous ait été donné de lire ». Dont acte.
Ensuite, se laisser porter et emporter par le souffle épique (bien qu'en prose) qui balaie cette vengeance familiale au sein de la famille Stamper, sur fond de fronde et de grève dans les forêts de l'Oregon. Apprécier l'incroyable précision apportée dans la construction des personnages, que ce soit le clan Stamper – Leland, Henry, Hank, Joe Ben ou Viv – ou les autres, qu'on ne peut pas vraiment qualifier de secondaires : Teddy le barman du Snag, Jenny l'indienne la prostituée qui connaît le passé ou Floyd Evenwrite le syndicaliste aux petits pieds.
Essayer de s'accrocher pour comprendre la psychologie des liens qui séparent ou relient les frangins Stamper, interpréter ce qui se transmet dans ce qui ne se dit pas, s'y retrouver dans les époques dont Keysey se joue, tout comme des personnages dont les noms et les prises de paroles peuvent changer à chaque page.
Et aussi se délecter de ces paysages exceptionnels, tout aussi indispensables à l'oeuvre que le sont les Stamper : la rivière, la forêt, un arbre qui tombe, une plage, la pluie, l'eau qui monte… Et avoir le souffle coupé par quelques scènes d'anthologie : un bras suspendu, une chasse de nuit, un bucheronnage mortel…
Le reste se résume à un gigantesque ouragan littéraire dans lequel Keysey te prend, te retourne, te perd, te câline, te réconforte et te remet dans ta lecture avant de t'abandonner à nouveau comme une loque épuisée sur les pentes boisées de la Wakonda.
Cette lecture est une contradiction permanente : réjouissante et épuisante, addictive et inabordable, douloureuse et impossible à lâcher. Comme souvent les grands livres. Comme toujours les monuments. Qu'il faudra que je relise pour essayer d'en faire une vraie chronique !
S'attaquer à Et quelquefois j'ai comme une grande idée, de Ken Kesey – traduit par Antoine Cazé – est déjà une aventure en soi. Tenter de le chroniquer ensuite, confine à l'inconscience. Ou à une forme extrême de suffisance. Deux raisons de refuser l'obstacle et de me limiter à quelques conseils adressés aux futurs lecteurs de ces 894 pages.
D'abord, commencer par la fin, et ce conseil de « l'époustouflant » éditeur, Monsieur Toussaint Louverture : « Ne vous laissez pas décourager, prenez le temps, remettez à plus tard si besoin, mais n'abandonnez pas, c'est l'un des plus grands livres qu'il nous ait été donné de lire ». Dont acte.
Ensuite, se laisser porter et emporter par le souffle épique (bien qu'en prose) qui balaie cette vengeance familiale au sein de la famille Stamper, sur fond de fronde et de grève dans les forêts de l'Oregon. Apprécier l'incroyable précision apportée dans la construction des personnages, que ce soit le clan Stamper – Leland, Henry, Hank, Joe Ben ou Viv – ou les autres, qu'on ne peut pas vraiment qualifier de secondaires : Teddy le barman du Snag, Jenny l'indienne la prostituée qui connaît le passé ou Floyd Evenwrite le syndicaliste aux petits pieds.
Essayer de s'accrocher pour comprendre la psychologie des liens qui séparent ou relient les frangins Stamper, interpréter ce qui se transmet dans ce qui ne se dit pas, s'y retrouver dans les époques dont Keysey se joue, tout comme des personnages dont les noms et les prises de paroles peuvent changer à chaque page.
Et aussi se délecter de ces paysages exceptionnels, tout aussi indispensables à l'oeuvre que le sont les Stamper : la rivière, la forêt, un arbre qui tombe, une plage, la pluie, l'eau qui monte… Et avoir le souffle coupé par quelques scènes d'anthologie : un bras suspendu, une chasse de nuit, un bucheronnage mortel…
Le reste se résume à un gigantesque ouragan littéraire dans lequel Keysey te prend, te retourne, te perd, te câline, te réconforte et te remet dans ta lecture avant de t'abandonner à nouveau comme une loque épuisée sur les pentes boisées de la Wakonda.
Cette lecture est une contradiction permanente : réjouissante et épuisante, addictive et inabordable, douloureuse et impossible à lâcher. Comme souvent les grands livres. Comme toujours les monuments. Qu'il faudra que je relise pour essayer d'en faire une vraie chronique !
Que ce roman est long ! C'est pourtant avec un plaisir fou que je me suis laissé embarquer par son auteur, l'Américain Ken Kesey (1935-2001), dans les huit cents pages touffues et fourmillantes de son deuxième roman au titre surprenant, Et quelquefois j'ai comme une grande idée.
Pionnier du mouvement psychédélique des années soixante, Kesey expérimenta largement ce que l'on pourrait appeler la création assistée par substances hallucinogènes. Son premier roman, Vol au-dessus d'un nid de coucou », avait rencontré un succès dopé par le cinéma et Jack Nicholson. Et quelquefois j'ai comme une grande idée, publié en 1964, porté à l'écran en 1972 (Le Clan des irréductibles, de Paul Newman, avec lui-même et Henry Fonda), attendit 2013 pour être publié en français.
Dans l'Oregon, sur la façade pacifique des Etats-Unis, se dressent des millions de sapins géants, certains pouvant atteindre la hauteur vertigineuse de cent mètres. L'action se passe en plein coeur d'une forêt, dans un petit bourg traversé par une rivière tumultueuse qui va se jeter dans l'océan. Ses habitants vivent directement ou indirectement de l'abattage des arbres. Mais les temps sont durs, les bûcherons décident de se mettre en grève et leur syndicat en appelle à la solidarité de tous.
Chez les Stamper, un clan de bûcherons structuré comme une PME familiale, on ne l'entend pas de cette oreille. On a même l'intention de profiter de l'occasion pour augmenter la production de grumes, ces tronçons de sapins abattus qui descendent la rivière jusqu'aux scieries. Leur chef, Hank Stamper, trente-six ans si mes calculs sont bons, est un mâle alpha, une force de la nature, un homme qui ne doute ni n'a peur de rien, animé d'une mentalité typique de pionnier américain.
Pour faire face à l'afflux de travail, Hank fait appel à son demi-frère, Leland ou Lee, vingt-quatre ans, parti depuis douze ans vivre à New York avec sa mère. Fondamentalement différent de Hank, envers lequel il garde une rancune haineuse, Lee est un étudiant cérébral d'apparence chétive. Il revient dans la famille avec des plans de vengeance…
L'on pourrait imaginer que Lee ne fera pas le poids devant la personnalité écrasante de Hank, mais tous deux ont appris à ne jamais rien lâcher, une devise rabâchée par leur père, Henry, fondateur du clan, un octogénaire dont les moyens physiques et intellectuels déclinent fortement. La rivalité entre les deux frères prend le pas en intensité dramatique sur le conflit des bûcherons, sous l'oeil fasciné du lecteur, qui doit bien reconnaître que le brutal Hank n'a pas que des défauts et que le subtil Leland ne manque pas de perversité. Un bras de fer infernal, non dénué d'humour ; une incertitude haletante ; et un manège troublant qui se dessine autour de Viv, la jolie épouse de Hank.
S'y mêlent de nombreux personnages secondaires hauts en couleur, présents tout au long d'un texte d'une audace incroyable, où les voix s'intercalent, différenciées par les typographies, chacun prenant la parole ou s'exprimant par la pensée en contrepoint des descriptions du narrateur, un peu comme dans une scène polyphonique d'opéra. Ce parti littéraire, associé à une traduction d'une justesse saisissante, m'a réellement plongé en plein coeur de l'intrigue, comme si j'y étais... Et j'y étais si bien, que je relisais certains passages deux fois, trois fois…
Un séjour fascinant dans une nature moite et agressive, où soufflent des vents furieux poussant des nuages noirs, où les berges sont indéfiniment taillées et retaillées par la rivière, où des oiseaux et des insectes multicolores vibrionnent autour d'arbres géants menaçants, sans oublier, tout proche, le rugissement d'un océan majestueux.
Et quelquefois j'ai comme une grande idée est un livre difficile, notamment dans les soixante premières pages, incompréhensibles à la première lecture. Il faut savoir les franchir et venir les relire après la fin de l'ouvrage. Elles paraissent alors limpides, parce qu'on se sera adapté au mode d'écriture de l'auteur. le livre comporte quelques extravagances, quelques invraisemblances, peut-être même quelques incohérences. Peu importe ! Ce roman éblouissant m'a fait vivre une expérience étonnante.
Lien : http://cavamieuxenlecrivant...
Pionnier du mouvement psychédélique des années soixante, Kesey expérimenta largement ce que l'on pourrait appeler la création assistée par substances hallucinogènes. Son premier roman, Vol au-dessus d'un nid de coucou », avait rencontré un succès dopé par le cinéma et Jack Nicholson. Et quelquefois j'ai comme une grande idée, publié en 1964, porté à l'écran en 1972 (Le Clan des irréductibles, de Paul Newman, avec lui-même et Henry Fonda), attendit 2013 pour être publié en français.
Dans l'Oregon, sur la façade pacifique des Etats-Unis, se dressent des millions de sapins géants, certains pouvant atteindre la hauteur vertigineuse de cent mètres. L'action se passe en plein coeur d'une forêt, dans un petit bourg traversé par une rivière tumultueuse qui va se jeter dans l'océan. Ses habitants vivent directement ou indirectement de l'abattage des arbres. Mais les temps sont durs, les bûcherons décident de se mettre en grève et leur syndicat en appelle à la solidarité de tous.
Chez les Stamper, un clan de bûcherons structuré comme une PME familiale, on ne l'entend pas de cette oreille. On a même l'intention de profiter de l'occasion pour augmenter la production de grumes, ces tronçons de sapins abattus qui descendent la rivière jusqu'aux scieries. Leur chef, Hank Stamper, trente-six ans si mes calculs sont bons, est un mâle alpha, une force de la nature, un homme qui ne doute ni n'a peur de rien, animé d'une mentalité typique de pionnier américain.
Pour faire face à l'afflux de travail, Hank fait appel à son demi-frère, Leland ou Lee, vingt-quatre ans, parti depuis douze ans vivre à New York avec sa mère. Fondamentalement différent de Hank, envers lequel il garde une rancune haineuse, Lee est un étudiant cérébral d'apparence chétive. Il revient dans la famille avec des plans de vengeance…
L'on pourrait imaginer que Lee ne fera pas le poids devant la personnalité écrasante de Hank, mais tous deux ont appris à ne jamais rien lâcher, une devise rabâchée par leur père, Henry, fondateur du clan, un octogénaire dont les moyens physiques et intellectuels déclinent fortement. La rivalité entre les deux frères prend le pas en intensité dramatique sur le conflit des bûcherons, sous l'oeil fasciné du lecteur, qui doit bien reconnaître que le brutal Hank n'a pas que des défauts et que le subtil Leland ne manque pas de perversité. Un bras de fer infernal, non dénué d'humour ; une incertitude haletante ; et un manège troublant qui se dessine autour de Viv, la jolie épouse de Hank.
S'y mêlent de nombreux personnages secondaires hauts en couleur, présents tout au long d'un texte d'une audace incroyable, où les voix s'intercalent, différenciées par les typographies, chacun prenant la parole ou s'exprimant par la pensée en contrepoint des descriptions du narrateur, un peu comme dans une scène polyphonique d'opéra. Ce parti littéraire, associé à une traduction d'une justesse saisissante, m'a réellement plongé en plein coeur de l'intrigue, comme si j'y étais... Et j'y étais si bien, que je relisais certains passages deux fois, trois fois…
Un séjour fascinant dans une nature moite et agressive, où soufflent des vents furieux poussant des nuages noirs, où les berges sont indéfiniment taillées et retaillées par la rivière, où des oiseaux et des insectes multicolores vibrionnent autour d'arbres géants menaçants, sans oublier, tout proche, le rugissement d'un océan majestueux.
Et quelquefois j'ai comme une grande idée est un livre difficile, notamment dans les soixante premières pages, incompréhensibles à la première lecture. Il faut savoir les franchir et venir les relire après la fin de l'ouvrage. Elles paraissent alors limpides, parce qu'on se sera adapté au mode d'écriture de l'auteur. le livre comporte quelques extravagances, quelques invraisemblances, peut-être même quelques incohérences. Peu importe ! Ce roman éblouissant m'a fait vivre une expérience étonnante.
Lien : http://cavamieuxenlecrivant...
Attention, chef d'oeuvre ! Et quelquefois j'ai comme une grande idée, c'est le titre de ce roman ample et somptueux de Ken Kesey, auteur américain que je découvre ici, c'est aussi la phrase qui a trotté longtemps dans ma tête en refermant ce livre après sa lecture ; j'avais en effet été bien inspiré de l'emprunter tout récemment auprès de ma médiathèque préférée...
Approchez un peu, venez que je vous en parle...
Nous sommes dans les années soixante, en Oregon, à Waconda, petite bourgade forestière près de la rivière Waconda Auga, où tout le monde se connaît ; ici les familles vivent de l'exploitation de la forêt depuis des générations, grâce aux arbres et aux grumes dont ils font le commerce depuis des lustres...
Une grève étrangle la communauté de Waconda. Tous les bûcherons suivent le mouvement de grève sauf une famille, les Stamper. Ceux-ci possèdent une entreprise non-syndiquée, jouent aux casseurs de grève en continuant à travailler pour fournir en secret la scierie régionale Wakonda Pacific.
Jusqu'ici c'est à peu près banal ce que je vous raconte, il n'y a pas forcément de quoi en faire un roman de 900 pages !
Deux histoires vont alors s'entrelacer.
Tout d'abord nous découvrons celle des Stamper, ce clan familial de bûcherons qui ne reculent devant rien ni personne et font un peu ce qu'ils veulent.
Ce clan est tenu avec poigne par son patriarche, le vieil Henry Stamper, personnage haut en couleurs qui a monté cette affaire, figure rude, c'est encore une force de la nature malgré son âge avancé. Il y a aussi Hank Samper, le fils, lui aussi a le caractère trempé, celui qui est fait de l'acier qu'on utilise pour fabriquer les haches, il fait tout pour se hisser au niveau de son père. Quand cela est nécessaire, le père et le fils savent serrer les rangs face à la vindicte populaire ou lorsque les éléments naturels se déchaînent. Il y a aussi Joe Ben, le cousin fidèle au clan, toujours jovial...
Hank Stamper est marié à une jeune femme Viviane, sorte de fleur des prés égarée dans ce parterre de ronces, on se demande comment elle est arrivée dans cette histoire, elle apporte de la lumière, sa présence est une sorte de respiration magique et insoupçonnée qui traverse les pages...
Une deuxième histoire vient se greffer à la première : un des jeunes frères Stamper qui avait quitté sa famille il y a une dizaine d'années dans des circonstances un peu énigmatiques il faut bien l'avouer, est appelé en renfort pour faire tourner l'entreprise familiale dans le contexte social tendu du moment. Il s'appelle Leland, introverti, rêveur, toujours plongé dans les livres, il est le contraire de son frère aîné qu'il déteste. Il revient avec comme seul dessein d'assouvir une vengeance. Lui aussi connaît l'acier comme cette lame de couteau qui sommeille dans son coeur.
Voilà, le tableau est dressé !
Je pourrais aussi vous parler de quelques autres personnages qui sont loin d'être des figurants... Floyd Evenwrite le leader syndiqué, et puis pourquoi pas aussi Jenny l'Indienne qui connaît la Parole de vérité. Sans oublier la violence d'une nature à la beauté sans limite... Chacun tient un rôle qui va mettre en lumière le destin du clan des Stamper dans ce voyage crépusculaire.
Mais la force du récit, c'est sa narration, car ce livre n'est pas raconté par un seul narrateur.
Ainsi, plusieurs personnages nous parlent, deviennent successivement des narrateurs, ils s'intercalent, chacun laissant la place à l'autre, puis revenant...
Parfois cela se passe dans un même chapitre, une même page, parfois une même phrase où tout ceci va s'imbriquer dans un flux de conscience polyphonique. Au début, on se croirait pris dans les eaux tumultueuses et hystériques de la Waconda Auga, mais très vite on se rend compte que l'écriture est prodigieusement orchestrée d'une main de maître. Alors on se laisse porter par les flots de l'écriture et cela en devient magistral.
C'est un roman choral difficile d'accès aux premiers abords, qu'il m'a fallu apprivoiser. Avec ses voix, avec ses phrases, avec ses pages. Avec sa rivière démesurée qui emportent les berges, avec ses forêts sombres et les hommes qui sont dedans et y travaillent, ces hommes rustres qui désirent, se confrontent, s'affrontent, ne renoncent jamais à leurs rêves, tandis que des oies traversent le paysage sous le regard enchanté de la jeune Viviane.
Ici Ken Kesey brise tous les codes narratifs classiques et non seulement il le fait avec une maîtrise extraordinaire, mais cela fonctionne au bénéfice du ressort narratif.
C'est un livre qui vous prend dans sa nasse, qui vous agrippe, ne vous lâche plus, c'est un livre généreux qui donne beaucoup d'une ambition folle, démesurée, autant celle des personnages et de la nature indomptable que de celui qui est aux manettes de tout ce vertige insensé.
Peut-être alors qu'il n'y a rien d'autre à faire comme lorsqu'on est saisi par une vague, s'abandonner oui, avancer en aveugle, dépourvu de tous préjugés, avancer en tâtonnant et de n'en mesurer véritablement la puissance qu'au sortir de ses neuf cents pages.
C'est cette écriture qui délivre alors toute l'émotion qui se dégage du récit, les points de vue changent selon la personne qui raconte les événements, pour nous montrer comment les choses avancent d'un versant à l'autre de l'histoire qui se façonne sous nos yeux... Les choses ne sont jamais figées par un seul regard. C'est peut-être alors au lecteur omniscient, de recueillir les fragments de cette histoire, couturer l'ensemble dans un immense puzzle faulknérien et de s'en faire une idée de ce qu'il a vu.
L'histoire atteint alors sous nos yeux la force d'une tragédie antique par sa manière d'être contée, délivrant les enjeux, les malentendus, toute son humanité, dans une nature conquérante, belle et d'une violence inouïe...
Au loin un cerf brame tandis que les oies remontent inlassablement vers le Canada. Est-ce que Viviane continue de contempler leur vol en imaginant elle aussi atteindre un jour d'autres rivages ?
Et quelquefois j'ai comme une grande idée d'être emporté dans des histoires où il ne se passe presque rien...
Approchez un peu, venez que je vous en parle...
Nous sommes dans les années soixante, en Oregon, à Waconda, petite bourgade forestière près de la rivière Waconda Auga, où tout le monde se connaît ; ici les familles vivent de l'exploitation de la forêt depuis des générations, grâce aux arbres et aux grumes dont ils font le commerce depuis des lustres...
Une grève étrangle la communauté de Waconda. Tous les bûcherons suivent le mouvement de grève sauf une famille, les Stamper. Ceux-ci possèdent une entreprise non-syndiquée, jouent aux casseurs de grève en continuant à travailler pour fournir en secret la scierie régionale Wakonda Pacific.
Jusqu'ici c'est à peu près banal ce que je vous raconte, il n'y a pas forcément de quoi en faire un roman de 900 pages !
Deux histoires vont alors s'entrelacer.
Tout d'abord nous découvrons celle des Stamper, ce clan familial de bûcherons qui ne reculent devant rien ni personne et font un peu ce qu'ils veulent.
Ce clan est tenu avec poigne par son patriarche, le vieil Henry Stamper, personnage haut en couleurs qui a monté cette affaire, figure rude, c'est encore une force de la nature malgré son âge avancé. Il y a aussi Hank Samper, le fils, lui aussi a le caractère trempé, celui qui est fait de l'acier qu'on utilise pour fabriquer les haches, il fait tout pour se hisser au niveau de son père. Quand cela est nécessaire, le père et le fils savent serrer les rangs face à la vindicte populaire ou lorsque les éléments naturels se déchaînent. Il y a aussi Joe Ben, le cousin fidèle au clan, toujours jovial...
Hank Stamper est marié à une jeune femme Viviane, sorte de fleur des prés égarée dans ce parterre de ronces, on se demande comment elle est arrivée dans cette histoire, elle apporte de la lumière, sa présence est une sorte de respiration magique et insoupçonnée qui traverse les pages...
Une deuxième histoire vient se greffer à la première : un des jeunes frères Stamper qui avait quitté sa famille il y a une dizaine d'années dans des circonstances un peu énigmatiques il faut bien l'avouer, est appelé en renfort pour faire tourner l'entreprise familiale dans le contexte social tendu du moment. Il s'appelle Leland, introverti, rêveur, toujours plongé dans les livres, il est le contraire de son frère aîné qu'il déteste. Il revient avec comme seul dessein d'assouvir une vengeance. Lui aussi connaît l'acier comme cette lame de couteau qui sommeille dans son coeur.
Voilà, le tableau est dressé !
Je pourrais aussi vous parler de quelques autres personnages qui sont loin d'être des figurants... Floyd Evenwrite le leader syndiqué, et puis pourquoi pas aussi Jenny l'Indienne qui connaît la Parole de vérité. Sans oublier la violence d'une nature à la beauté sans limite... Chacun tient un rôle qui va mettre en lumière le destin du clan des Stamper dans ce voyage crépusculaire.
Mais la force du récit, c'est sa narration, car ce livre n'est pas raconté par un seul narrateur.
Ainsi, plusieurs personnages nous parlent, deviennent successivement des narrateurs, ils s'intercalent, chacun laissant la place à l'autre, puis revenant...
Parfois cela se passe dans un même chapitre, une même page, parfois une même phrase où tout ceci va s'imbriquer dans un flux de conscience polyphonique. Au début, on se croirait pris dans les eaux tumultueuses et hystériques de la Waconda Auga, mais très vite on se rend compte que l'écriture est prodigieusement orchestrée d'une main de maître. Alors on se laisse porter par les flots de l'écriture et cela en devient magistral.
C'est un roman choral difficile d'accès aux premiers abords, qu'il m'a fallu apprivoiser. Avec ses voix, avec ses phrases, avec ses pages. Avec sa rivière démesurée qui emportent les berges, avec ses forêts sombres et les hommes qui sont dedans et y travaillent, ces hommes rustres qui désirent, se confrontent, s'affrontent, ne renoncent jamais à leurs rêves, tandis que des oies traversent le paysage sous le regard enchanté de la jeune Viviane.
Ici Ken Kesey brise tous les codes narratifs classiques et non seulement il le fait avec une maîtrise extraordinaire, mais cela fonctionne au bénéfice du ressort narratif.
C'est un livre qui vous prend dans sa nasse, qui vous agrippe, ne vous lâche plus, c'est un livre généreux qui donne beaucoup d'une ambition folle, démesurée, autant celle des personnages et de la nature indomptable que de celui qui est aux manettes de tout ce vertige insensé.
Peut-être alors qu'il n'y a rien d'autre à faire comme lorsqu'on est saisi par une vague, s'abandonner oui, avancer en aveugle, dépourvu de tous préjugés, avancer en tâtonnant et de n'en mesurer véritablement la puissance qu'au sortir de ses neuf cents pages.
C'est cette écriture qui délivre alors toute l'émotion qui se dégage du récit, les points de vue changent selon la personne qui raconte les événements, pour nous montrer comment les choses avancent d'un versant à l'autre de l'histoire qui se façonne sous nos yeux... Les choses ne sont jamais figées par un seul regard. C'est peut-être alors au lecteur omniscient, de recueillir les fragments de cette histoire, couturer l'ensemble dans un immense puzzle faulknérien et de s'en faire une idée de ce qu'il a vu.
L'histoire atteint alors sous nos yeux la force d'une tragédie antique par sa manière d'être contée, délivrant les enjeux, les malentendus, toute son humanité, dans une nature conquérante, belle et d'une violence inouïe...
Au loin un cerf brame tandis que les oies remontent inlassablement vers le Canada. Est-ce que Viviane continue de contempler leur vol en imaginant elle aussi atteindre un jour d'autres rivages ?
Et quelquefois j'ai comme une grande idée d'être emporté dans des histoires où il ne se passe presque rien...
Un doigt d'honneur…
Et sur la toiture, dressé vers le ciel, un bras au bout d'une pique, dont le poing fermé ne laisse s'ériger que le majeur, comme une invitation à tous, d'aller se faire foutre…
Les Stamper ont passé un contrat avec la Waconda Pacific pour bucheronner la forêt mal grès l'avis de grève de leurs confrères. Ils sont la famille emblématique de cette bourgade de l'Oregon, Waconda, que la rivière du même nom borde. Afin d'honorer leurs engagements et par manque de main d'oeuvre, ils font revenir Lee, le demi-frère de Hank, parti faire ses études sur la côte Est. Mais derrière la lutte syndicale qui les oppose au reste des habitants, une vengeance fratricide ne demande qu'à être ranimée…
Ce n'est pas une histoire que l'on apprivoise facilement. le caractère entier des personnages, bourru, la nature sauvage des situations, les rivalités qui se sont développées entre eux n'autorise pas le lecteur à dompter facilement la narration et à se permettre de prendre des raccourcis. Chaque mot de l'auteur est pesé. Chaque mot de l'auteur compte. Ken Kesey prends son temps et un malin plaisir à épaissir l'atmosphère déjà chargé d'humidité et de testostérone. C'est une histoire sur le courage, la force et la volonté d'individus plongés dans un milieu hostile, qu'il s'agisse de la forêt à déboiser ou de la petite circonscription et des rivalités syndicales. C'est une histoire d'égo, où il est mal vu de baisser les bras devant l'adversité, ainsi, la devise des Stamper : « Ne rien lâcher ».
Le style de Ken Kesey est particulier car il fait parler chacun des protagonistes à la première personne, permettant au lecteur d'être pratiquement dans la tête de ceux-ci. Il ouvre ainsi la vision sous différents angles de son histoire, un peu comme le phénomène de l'hyper conscience qu'il a expérimenté avec le LSD. Ken Kesey a connu cette drogue lors d'un passage en tant qu'étudiant en médecine dans un hôpital psychiatrique, à la suite duquel il a écrit « vol au-dessus d'un nid de coucou ». Il a poursuivi cette aventure hallucinée avec un groupe d'amis, dans un autocar repeint dans des couleurs psychédéliques, au volant duquel on retrouve Neal Cassady, compagnon de route de Jack Kerouac et figure emblématique de la beat génération. Cette joyeuse troupe a traversé les Etats-Unis, distribuant des « jus d'orange arrangés » aux populations qu'ils croisaient…
Grâce à la parfaite maitrise de cet effet de style et au talent de Kesey, il en ressort un texte d'une grande qualité littéraire et la sensation d'être plongé dans un état de conscience omnisciente car on finit par être partout et en tout, à la fois.
L'auteur dira lui-même qu'après avoir écrit « et quelques fois j'ai comme une grande idée… », il ne pourrait plus jamais écrire quelque chose d'aussi bon.
Ce roman de Ken Kesey est un grand moment de lecture, fastidieux et magique, qu'il ne faut surtout pas manquer. Il a été adapté au cinéma par Paul Newman : « le clan des irréductibles ».
Traduction d'Antoine Cazé.
Illustrations de Nicolas Badout / NKL.
Edition limitée Waconda, N°0137.
Editions Monsieur Toussaint Louverture, 767 pages.
Et sur la toiture, dressé vers le ciel, un bras au bout d'une pique, dont le poing fermé ne laisse s'ériger que le majeur, comme une invitation à tous, d'aller se faire foutre…
Les Stamper ont passé un contrat avec la Waconda Pacific pour bucheronner la forêt mal grès l'avis de grève de leurs confrères. Ils sont la famille emblématique de cette bourgade de l'Oregon, Waconda, que la rivière du même nom borde. Afin d'honorer leurs engagements et par manque de main d'oeuvre, ils font revenir Lee, le demi-frère de Hank, parti faire ses études sur la côte Est. Mais derrière la lutte syndicale qui les oppose au reste des habitants, une vengeance fratricide ne demande qu'à être ranimée…
Ce n'est pas une histoire que l'on apprivoise facilement. le caractère entier des personnages, bourru, la nature sauvage des situations, les rivalités qui se sont développées entre eux n'autorise pas le lecteur à dompter facilement la narration et à se permettre de prendre des raccourcis. Chaque mot de l'auteur est pesé. Chaque mot de l'auteur compte. Ken Kesey prends son temps et un malin plaisir à épaissir l'atmosphère déjà chargé d'humidité et de testostérone. C'est une histoire sur le courage, la force et la volonté d'individus plongés dans un milieu hostile, qu'il s'agisse de la forêt à déboiser ou de la petite circonscription et des rivalités syndicales. C'est une histoire d'égo, où il est mal vu de baisser les bras devant l'adversité, ainsi, la devise des Stamper : « Ne rien lâcher ».
Le style de Ken Kesey est particulier car il fait parler chacun des protagonistes à la première personne, permettant au lecteur d'être pratiquement dans la tête de ceux-ci. Il ouvre ainsi la vision sous différents angles de son histoire, un peu comme le phénomène de l'hyper conscience qu'il a expérimenté avec le LSD. Ken Kesey a connu cette drogue lors d'un passage en tant qu'étudiant en médecine dans un hôpital psychiatrique, à la suite duquel il a écrit « vol au-dessus d'un nid de coucou ». Il a poursuivi cette aventure hallucinée avec un groupe d'amis, dans un autocar repeint dans des couleurs psychédéliques, au volant duquel on retrouve Neal Cassady, compagnon de route de Jack Kerouac et figure emblématique de la beat génération. Cette joyeuse troupe a traversé les Etats-Unis, distribuant des « jus d'orange arrangés » aux populations qu'ils croisaient…
Grâce à la parfaite maitrise de cet effet de style et au talent de Kesey, il en ressort un texte d'une grande qualité littéraire et la sensation d'être plongé dans un état de conscience omnisciente car on finit par être partout et en tout, à la fois.
L'auteur dira lui-même qu'après avoir écrit « et quelques fois j'ai comme une grande idée… », il ne pourrait plus jamais écrire quelque chose d'aussi bon.
Ce roman de Ken Kesey est un grand moment de lecture, fastidieux et magique, qu'il ne faut surtout pas manquer. Il a été adapté au cinéma par Paul Newman : « le clan des irréductibles ».
Traduction d'Antoine Cazé.
Illustrations de Nicolas Badout / NKL.
Edition limitée Waconda, N°0137.
Editions Monsieur Toussaint Louverture, 767 pages.
Un grand, très grand roman.
Dans son billet berni_29 évoque Faulkner, et il n'a pas tort… Grand merci à lui pour la découverte.
Oregon, années 60, dans une ville de bûcherons. Lee, étudiant en littérature sur la côte Est, revient à la maison natale pour concocter une vengeance contre son demi-frère Hank, celui qui est resté et a poursuivi l'entreprise de leur père.
Je me suis sentie, à la lecture, dans la peau d'une ethnologue en mission d'étude auprès d'une peuplade aux étranges coutumes : la gent mâle.
Ethnologue, voire zoologiste, tant ces hommes se comportent comme une meute, menée par un vieux mâle auquel on ne peut succéder qu'en se mesurant.
Se mesurant à lui, se mesurant aux autres jeunes mâles pour obtenir la prééminence… et la femelle convoitée. Surtout, ne rien montrer de ses émotions, ne rien lâcher.
Tout le roman repose là-dessus : sur la rivalité, sur la rancune, sur la vengeance.
Une meute tragiquement condamnée à la rivalité, à la compétition permanente entre père et fils, entre frères, entre syndiqués et non-syndiqués… à la rage et à la culpabilité de ne pas être à la hauteur.
Cinquante ans plus tard, c'est sur ces principes moisis que repose l'électorat trumpiste, pas pour rendre l'Amérique "great again", non : pour affirmer son individualisme et emmerder au maximum son voisin – quitte à suspendre à sa façade, en guise de drapeau, un bras terminé par un doigt d'honneur.
Vi vi, un vrai bras humain.
Au rebours de cette virilité crasse, de l'absolue laideur des sentiments, l'écriture de Ken Kesey est d'une beauté remarquable. L'auteur fait s'exprimer chaque personnage tour à tour, et souvent en même temps, jouant des italiques et des parenthèses tout en conservant une merveilleuse fluidité.
Quant à l'étiquette "nature writing", il me semble comprendre son sens pour la première fois en lisant Ken Kesey, en longeant avec lui les berges de l'indomptable rivière jusqu'au Pacifique, en prenant garde aux horaires des marées et au retour des oies sauvages.
Croyez-moi : c'est un grand, un très grand roman.
Très belle traduction d'Antoine Cazé.
Challenge USA : un livre, un État (Oregon)
Club de lecture janvier 2024 : "Un titre à rallonge"
Dans son billet berni_29 évoque Faulkner, et il n'a pas tort… Grand merci à lui pour la découverte.
Oregon, années 60, dans une ville de bûcherons. Lee, étudiant en littérature sur la côte Est, revient à la maison natale pour concocter une vengeance contre son demi-frère Hank, celui qui est resté et a poursuivi l'entreprise de leur père.
Je me suis sentie, à la lecture, dans la peau d'une ethnologue en mission d'étude auprès d'une peuplade aux étranges coutumes : la gent mâle.
Ethnologue, voire zoologiste, tant ces hommes se comportent comme une meute, menée par un vieux mâle auquel on ne peut succéder qu'en se mesurant.
Se mesurant à lui, se mesurant aux autres jeunes mâles pour obtenir la prééminence… et la femelle convoitée. Surtout, ne rien montrer de ses émotions, ne rien lâcher.
Tout le roman repose là-dessus : sur la rivalité, sur la rancune, sur la vengeance.
Une meute tragiquement condamnée à la rivalité, à la compétition permanente entre père et fils, entre frères, entre syndiqués et non-syndiqués… à la rage et à la culpabilité de ne pas être à la hauteur.
Cinquante ans plus tard, c'est sur ces principes moisis que repose l'électorat trumpiste, pas pour rendre l'Amérique "great again", non : pour affirmer son individualisme et emmerder au maximum son voisin – quitte à suspendre à sa façade, en guise de drapeau, un bras terminé par un doigt d'honneur.
Vi vi, un vrai bras humain.
Au rebours de cette virilité crasse, de l'absolue laideur des sentiments, l'écriture de Ken Kesey est d'une beauté remarquable. L'auteur fait s'exprimer chaque personnage tour à tour, et souvent en même temps, jouant des italiques et des parenthèses tout en conservant une merveilleuse fluidité.
Quant à l'étiquette "nature writing", il me semble comprendre son sens pour la première fois en lisant Ken Kesey, en longeant avec lui les berges de l'indomptable rivière jusqu'au Pacifique, en prenant garde aux horaires des marées et au retour des oies sauvages.
Croyez-moi : c'est un grand, un très grand roman.
Très belle traduction d'Antoine Cazé.
Challenge USA : un livre, un État (Oregon)
Club de lecture janvier 2024 : "Un titre à rallonge"
Comment ne pas se noyer dans un tel déluge de feux, de pluies, de grumes. J' ai lâché comme Joe Ben, coincé sous une grume de 5 tonnes, la mer montait. Avec Hank au début je m'étranglais de rire...
la dernière bouffée d'air est restée dans la poitrine de Hank. j'avais bu de l'eau par erreur....
Hallucinant 890 pages équivalant à 1800 pages d'Amélie Nothomb, Tous les mots sont resserrés drus, comme les grands pins, sans moyen de reprendre sa respiration, La descente aux enfers, en continu, Ulysse face à la nature sans le plus petit Dieu pour lui adoucir les vertèbres du dos.
à suivre...
la dernière bouffée d'air est restée dans la poitrine de Hank. j'avais bu de l'eau par erreur....
Hallucinant 890 pages équivalant à 1800 pages d'Amélie Nothomb, Tous les mots sont resserrés drus, comme les grands pins, sans moyen de reprendre sa respiration, La descente aux enfers, en continu, Ulysse face à la nature sans le plus petit Dieu pour lui adoucir les vertèbres du dos.
à suivre...
Ce livre fut sans aucun doute une de mes plus belles découvertes littéraires et est paradoxalement un de ceux dont j'ai le plus de mal à parler.
"Et quelquefois j'ai comme une grande idée" est un roman fleuve d'une immense richesse empruntant autant au nature writing et à la parabole biblique qu'à la tragédie grecque.
Les 200 premieres pages sont déroutantes avec d'incessants changements de narrateur. Il faut accepter de ne pas tout maitriser et se laisser porter pour rejoindre tranquillement la rive. Passé cet écueil, le livre de Ken Kesey s'offre à vous.
La toile de fond tient en quelques lignes. Dans une petite ville forestière d'Oregon, une famille de bûcherons soudée et rude à la tâche passe outre la grève décidée par le syndicat et se met toute la corporation à dos. Chacun puise son énergie dans la nature et la rend dans son travail.
Jusqu'au jour où revient le fils cadet, porteur d'une vengeance qui ne sera pas dévoilée d'emblée. Car le livre, sans pour autant verser dans la longueur ou l'ennui, prend le temps, suggère, distille.
"Et quelques fois j'ai comme une grande idée" est un roman âpre, physique et envoûtant, c'est une histoire de résistance et d'amour batie sur trois piliers (la famille, le travail et la forêt) et dont la dernière image clôture magistralement le récit. Ce livre exerce toujours sur moi le même pouvoir de fascination et méritait bien ses dix ans d'écriture. le prix à payer pour un chef d'oeuvre...
"Et quelquefois j'ai comme une grande idée" est un roman fleuve d'une immense richesse empruntant autant au nature writing et à la parabole biblique qu'à la tragédie grecque.
Les 200 premieres pages sont déroutantes avec d'incessants changements de narrateur. Il faut accepter de ne pas tout maitriser et se laisser porter pour rejoindre tranquillement la rive. Passé cet écueil, le livre de Ken Kesey s'offre à vous.
La toile de fond tient en quelques lignes. Dans une petite ville forestière d'Oregon, une famille de bûcherons soudée et rude à la tâche passe outre la grève décidée par le syndicat et se met toute la corporation à dos. Chacun puise son énergie dans la nature et la rend dans son travail.
Jusqu'au jour où revient le fils cadet, porteur d'une vengeance qui ne sera pas dévoilée d'emblée. Car le livre, sans pour autant verser dans la longueur ou l'ennui, prend le temps, suggère, distille.
"Et quelques fois j'ai comme une grande idée" est un roman âpre, physique et envoûtant, c'est une histoire de résistance et d'amour batie sur trois piliers (la famille, le travail et la forêt) et dont la dernière image clôture magistralement le récit. Ce livre exerce toujours sur moi le même pouvoir de fascination et méritait bien ses dix ans d'écriture. le prix à payer pour un chef d'oeuvre...
Un PAVÉ. Oui, un pavé de 800 pages (mélangées et compactées comme un granit) ; « 235x160x40 mm », « 8 années de travail acharné d'une vingtaine de personnes » (précise l'achevé d'imprimer) ; un kilo cent sur la balance (ajoutera-t-on pour faire bonne mesure)… Un pavé, donc, qu'on s'est trimbalé à bout de bras pendant toute une semaine. Qu'on n'en finit pas de digérer parce qu'il vous reste forcément sur l'estomac. Qu'on s'est pris, en plus, en pleine tronche plus d'une fois, car ça cogne et ça morfle aussi là-dedans, au physique comme au moral… Et pourtant on en redemande ! Qui le croirait ? On vient à peine de tourner la dernière page qu'on reprend illico depuis le début… Pour savoir la suite, paradoxalement. Pour se redonner une chance de mieux comprendre. Pour ne pas lâcher comme cela les personnages auxquels on s'est attaché. Pour prolonger l'envoûtement. Pour ruminer ses impressions, réverbérer ses réflexions. Bref, parce qu'on n'en a pas fini — et qu'on n'est pas prêt d'en avoir fini —de ce livre qu'on a reçu comme un choc et qui va laisser des traces.
Plantons d'abord le décor (si le mot peut convenir pour qualifier ce qui est acteur ou facteur de l'histoire plus que simple toile de fond). Les pentes boisées et les forêts de conifères de l'Oregon, battues l'hiver par les vents et les pluies venues de l'océan, hantées par l'ours et le lynx. Une nature sauvage, impériale, mystérieuse… naguère encore territoire sacré des Indiens, dorénavant chantier ouvert à une industrie forestière en plein développement. Au milieu, un fleuve nourri de toutes les eaux irriguant les montagnes, qui les rejette sans cesse à la mer toute proche sans jamais se vider, qui flue et reflue comme un coeur au rythme des marées, qui, bringuebalé d'amont et d'aval, ne cesse d'éroder les rives de son lit et menace à tout instant de déborder et d'engloutir. Un fleuve, donc, comme un baromètre du temps qu'il fait (avec les crachins et les brumes toujours accrochés à la surface de ses eaux) ; comme une métaphore du temps qui passe et qui repasse (au fil et à la boucle des saisons, des générations ou des migrations d'oies sauvages) ; comme une allégorie du chemin, du tao ou de la Voie (que suivent identiquement les grumes débardées vers la scierie et les hommes projetés vers leur destin). Et sur le bord du fleuve, constamment rafistolée, consolidée et protégée contre les attaques sournoises de celui-ci, sentinelle héroïque et solitaire, une grande maison de famille en bois, qui tient encore le coup, depuis trois générations malgré tout, et qui focalise toute l'histoire.
Les protagonistes ? Une communauté de bûcherons qui fait vivre la petite ville côtière de Wakonda. Des hommes durs, frustes et têtus, pour qui vivre, au quotidien, c'est lutter. Toujours lutter. Lutter à la vie, à la mort… Contre les fûts gigantesques qui les narguent depuis le ciel et qui répliquent aux attaques de la tronçonneuse (« les salopards ! ») en s'abattant brutalement et en écrasant tout dans leur chute. Contre la pluie, la boue, le froid, le vent, ou sinon contre le cagnard, la fatigue, les éblouissements, et toujours le vent… tous ces éléments toujours ligués pour prendre le corps en faute et le lui faire payer salement. Lutte contre la déclivité des pentes et les accidents du terrain. Contre les caprices et les lâchages des machines ou des matériels vétustes et dangereux. Contre les contraintes économiques, les échéances draconiennes des contrats de production, contre les tenailles de l'exploitation sociale. Mais lutte intestine aussi, déterminée, jusqu'au-boutiste, impitoyable, dans un contexte dramatique de conflit syndical. Deux camps dressés l'un contre l'autre : les grévistes contre les jaunes, dirait-on à première vue. D'un côté, les Stamper, groupés autour de la petite entreprise familiale indépendante, de Hank le chef de clan et de Henry le vieux patriarche excentrique, qui entendent profiter de la situation de crise pour honorer un contrat juteux avec la compagnie qui achète le bois. de l'autre, la ville entière, faisant cause commune avec les syndiqués et grévistes qui font le gros de la population et la font donc vivre. Mais, derrière ces positions ostensibles, se cachent et s'affrontent en réalité deux manières d'être, deux modes et presque philosophies de vie, deux types d'hommes aussi. Voici l'alternative en effet : loi du groupe, dont l'union fait la force, ou exigence des individualités, qui les pousse sans cesse à se surmonter elles-mêmes et entre elles ? Communisme rampant, attroupement et nivellement des égaux, ou bien individualisme triomphant et sursaut des egos ? Bref, solidaires ou solitaires (comme dans l'anecdote ou l'apologue qui ouvre le dernier chapitre) ? En fait, les hommes sont ici comme les arbres : tiraillés entre la pression qui les serre les uns contre les autres, pour se protéger des éléments, et l'élan qui les dresse les uns contre les autres, pour jaillir chacun le plus droit et le plus haut possible vers le ciel. de ce point de vue, les Stamper rappellent un peu les anciens séquoias, aujourd'hui disparus de forêts dorénavant entièrement dévolues au pin industriel… Et l'affrontement final des deux frères ennemis, dans un flirt obstiné et absurde avec la mort, pour le simple prestige, pour obtenir coûte que coûte la reconnaissance, prend alors soudain comme des accents hégéliens (ni Maître ni Esclave ? Mais alors où va-t-on, nom de Dieu !?).
D'abord, de ces personnages, on ne voit que l'écorce, épaisse et rugueuse. de sombres brutes en apparence, qui bossent aussi dur qu'ils cognent, boivent sec, parlent dru et cru, jurent d'ailleurs et invectivent plus qu'ils ne parlent, et semblent marcher à l'instinct plus qu'à la pensée ou au sentiment. Mais l'auteur use d'un procédé original et déconcertant pour dépouiller progressivement cette enveloppe grossière. Moyennant en effet quelques simples conventions typographiques, il interpole constamment, dans la narration et les descriptions objectives, des fragments ou des segments de subjectivité brute, entrelaçant même indifféremment à la première personne du singulier les voix intérieures et extérieures des différents protagonistes. Ainsi perce-t-il les carapaces et découvre-t-il, à petites touches, des émotions, des impressions, des convictions, des résolutions pourtant bien masquées, et même des tendresses et des finesses insoupçonnées, soudain mises à nu, troublantes et fragiles, comme le bois écorcé.
Du coup, cette histoire de bûcherons (une histoire d'hommes, dopée à la testostérone, brutale, tendue et explosive jusque dans l'écriture), qui ressemblait assez à un western décalé dans l'espace (au nord-ouest) et le temps (en plein XXe siècle), prend bientôt — comme chez Faulkner à qui elle fait irrésistiblement penser… et comme à un pair plus que comme à un maître — une épaisseur, une profondeur, une consistance psychologiques, archétypiques et quasiment ontologiques, en même temps qu'une signification véritablement universelle. Ajoutons à cela la créativité de l'écriture, la démiurgie du style, l'habileté architecturale, l'ambition du projet, le tour de force du résultat (sans oublier le magnifique travail du traducteur tout au service de l'oeuvre)… et nous tenons assurément là un chef-d'oeuvre, à l'égal des plus grands et qui a tout pour devenir un classique.
Plantons d'abord le décor (si le mot peut convenir pour qualifier ce qui est acteur ou facteur de l'histoire plus que simple toile de fond). Les pentes boisées et les forêts de conifères de l'Oregon, battues l'hiver par les vents et les pluies venues de l'océan, hantées par l'ours et le lynx. Une nature sauvage, impériale, mystérieuse… naguère encore territoire sacré des Indiens, dorénavant chantier ouvert à une industrie forestière en plein développement. Au milieu, un fleuve nourri de toutes les eaux irriguant les montagnes, qui les rejette sans cesse à la mer toute proche sans jamais se vider, qui flue et reflue comme un coeur au rythme des marées, qui, bringuebalé d'amont et d'aval, ne cesse d'éroder les rives de son lit et menace à tout instant de déborder et d'engloutir. Un fleuve, donc, comme un baromètre du temps qu'il fait (avec les crachins et les brumes toujours accrochés à la surface de ses eaux) ; comme une métaphore du temps qui passe et qui repasse (au fil et à la boucle des saisons, des générations ou des migrations d'oies sauvages) ; comme une allégorie du chemin, du tao ou de la Voie (que suivent identiquement les grumes débardées vers la scierie et les hommes projetés vers leur destin). Et sur le bord du fleuve, constamment rafistolée, consolidée et protégée contre les attaques sournoises de celui-ci, sentinelle héroïque et solitaire, une grande maison de famille en bois, qui tient encore le coup, depuis trois générations malgré tout, et qui focalise toute l'histoire.
Les protagonistes ? Une communauté de bûcherons qui fait vivre la petite ville côtière de Wakonda. Des hommes durs, frustes et têtus, pour qui vivre, au quotidien, c'est lutter. Toujours lutter. Lutter à la vie, à la mort… Contre les fûts gigantesques qui les narguent depuis le ciel et qui répliquent aux attaques de la tronçonneuse (« les salopards ! ») en s'abattant brutalement et en écrasant tout dans leur chute. Contre la pluie, la boue, le froid, le vent, ou sinon contre le cagnard, la fatigue, les éblouissements, et toujours le vent… tous ces éléments toujours ligués pour prendre le corps en faute et le lui faire payer salement. Lutte contre la déclivité des pentes et les accidents du terrain. Contre les caprices et les lâchages des machines ou des matériels vétustes et dangereux. Contre les contraintes économiques, les échéances draconiennes des contrats de production, contre les tenailles de l'exploitation sociale. Mais lutte intestine aussi, déterminée, jusqu'au-boutiste, impitoyable, dans un contexte dramatique de conflit syndical. Deux camps dressés l'un contre l'autre : les grévistes contre les jaunes, dirait-on à première vue. D'un côté, les Stamper, groupés autour de la petite entreprise familiale indépendante, de Hank le chef de clan et de Henry le vieux patriarche excentrique, qui entendent profiter de la situation de crise pour honorer un contrat juteux avec la compagnie qui achète le bois. de l'autre, la ville entière, faisant cause commune avec les syndiqués et grévistes qui font le gros de la population et la font donc vivre. Mais, derrière ces positions ostensibles, se cachent et s'affrontent en réalité deux manières d'être, deux modes et presque philosophies de vie, deux types d'hommes aussi. Voici l'alternative en effet : loi du groupe, dont l'union fait la force, ou exigence des individualités, qui les pousse sans cesse à se surmonter elles-mêmes et entre elles ? Communisme rampant, attroupement et nivellement des égaux, ou bien individualisme triomphant et sursaut des egos ? Bref, solidaires ou solitaires (comme dans l'anecdote ou l'apologue qui ouvre le dernier chapitre) ? En fait, les hommes sont ici comme les arbres : tiraillés entre la pression qui les serre les uns contre les autres, pour se protéger des éléments, et l'élan qui les dresse les uns contre les autres, pour jaillir chacun le plus droit et le plus haut possible vers le ciel. de ce point de vue, les Stamper rappellent un peu les anciens séquoias, aujourd'hui disparus de forêts dorénavant entièrement dévolues au pin industriel… Et l'affrontement final des deux frères ennemis, dans un flirt obstiné et absurde avec la mort, pour le simple prestige, pour obtenir coûte que coûte la reconnaissance, prend alors soudain comme des accents hégéliens (ni Maître ni Esclave ? Mais alors où va-t-on, nom de Dieu !?).
D'abord, de ces personnages, on ne voit que l'écorce, épaisse et rugueuse. de sombres brutes en apparence, qui bossent aussi dur qu'ils cognent, boivent sec, parlent dru et cru, jurent d'ailleurs et invectivent plus qu'ils ne parlent, et semblent marcher à l'instinct plus qu'à la pensée ou au sentiment. Mais l'auteur use d'un procédé original et déconcertant pour dépouiller progressivement cette enveloppe grossière. Moyennant en effet quelques simples conventions typographiques, il interpole constamment, dans la narration et les descriptions objectives, des fragments ou des segments de subjectivité brute, entrelaçant même indifféremment à la première personne du singulier les voix intérieures et extérieures des différents protagonistes. Ainsi perce-t-il les carapaces et découvre-t-il, à petites touches, des émotions, des impressions, des convictions, des résolutions pourtant bien masquées, et même des tendresses et des finesses insoupçonnées, soudain mises à nu, troublantes et fragiles, comme le bois écorcé.
Du coup, cette histoire de bûcherons (une histoire d'hommes, dopée à la testostérone, brutale, tendue et explosive jusque dans l'écriture), qui ressemblait assez à un western décalé dans l'espace (au nord-ouest) et le temps (en plein XXe siècle), prend bientôt — comme chez Faulkner à qui elle fait irrésistiblement penser… et comme à un pair plus que comme à un maître — une épaisseur, une profondeur, une consistance psychologiques, archétypiques et quasiment ontologiques, en même temps qu'une signification véritablement universelle. Ajoutons à cela la créativité de l'écriture, la démiurgie du style, l'habileté architecturale, l'ambition du projet, le tour de force du résultat (sans oublier le magnifique travail du traducteur tout au service de l'oeuvre)… et nous tenons assurément là un chef-d'oeuvre, à l'égal des plus grands et qui a tout pour devenir un classique.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Ken Kesey (2)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Dead or Alive ?
Harlan Coben
Alive (vivant)
Dead (mort)
20 questions
1821 lecteurs ont répondu
Thèmes :
auteur américain
, littérature américaine
, états-unisCréer un quiz sur ce livre1821 lecteurs ont répondu