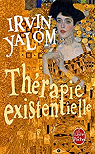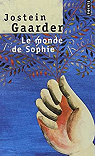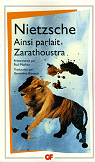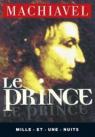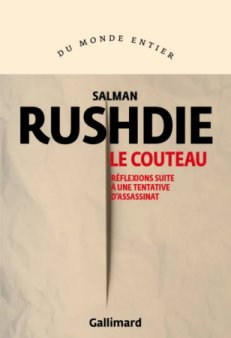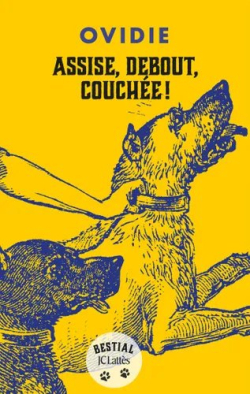Alphonso Lingis
Vincent Barras (Traducteur)Denise Medico (Traducteur)/5 3 notes
Vincent Barras (Traducteur)Denise Medico (Traducteur)/5 3 notes
Résumé :
Alphonso Lingis nous saisit par la puissance à la fois d’un style profondément singulier et d’une réflexion critique alliant références philosophiques et démarche anthropologique, marquée par son originalité et sa radicalité, portant sur des questions qui vont de la corporéité aux expériences-limites, au langage, à la sexualité, en y mêlant des récits d’expériences ... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après La communauté de ceux qui n'ont rien en communVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (3)
Ajouter une critique
C'est un très joli livre que j'ai découvert dans ma boîte aux lettres ce matin-là. D'un format haut et étroit, ceint d'un papier de soie qui ne contient, en rouge sur fond grège, que le titre. A l'intérieur, même sobriété dans la mise. Des photos en noir et blanc, prises par l'auteur pour marquer les passages entre les huit sections de l'ouvrage. Des corps et des visages lumineux. Merci donc aux éditions MF et à Babelio pour cet envoi qui fait suite à une masse-critique non fiction.
Alphonso La Lingis m'était complètement inconnu. Dans la notice que j'ai compulsée, il est pourtant célébré pour avoir introduit aux Etats-Unis des auteurs tels Merleau-Ponty, Levinas. Fervent lecteur de Nietzsche, Deleuze, Lacan, Bataille, et Foucault, on le dit aussi influencé par Levi-Strauss. Quel tableau idéal ! N'en jetez plus, ces influences revendiquées ont suffi à me le recommander chaudement.
Ce à quoi je n'avais toutefois pas prêté suffisamment attention, c'est qu'Alphonso La lingis s'inscrit dans le champ de la « Performance philosophy » et intègre, à ce titre, des éléments théâtraux dans son discours philosophique. Il fait ainsi dialoguer les arts, la corporéité et les concepts dans un questionnement existentiel dans des conférences originales et déconcertantes.
Voilà qui explique peut-être le désarroi qui a été le mien. Il semble que je sois imprégnée par une manière de philosopher très cartésienne ou au moins méthodique. J'attends qu'on définisse les concepts sur lesquels on va travailler et qu'on se tienne à l'assise que l'on a élaborée afin de bâtir, petit à petit l'échafaudage d'une réflexion.
Pas grand-chose qui se rapporte à cette manière de faire ici. J'ai plutôt eu la sensation d'une cascade de mots qui se déversaient sous mes yeux et qui m'invitaient à me laisser bercer de leurs sonorités et de leur rythme. Un subtile collage d'analyses appartenant à différents champs disciplinaires qui ne conduisaient jamais à l'élaboration d'une notion mais indiquaient plutôt la direction que pouvait prendre la réflexion.
Avec, surtout au début, des écueils que je n'ai pas su dépasser : « La pensée est commandée d'être en commandement, de commander ses propres facultés sensorimotrices ». La phrase en elle-même abime dans une réflexivité qui ramène toute perception à son intellectualisation. Mais la suite du texte affirme que nous échappons à ce solipsisme par une capacité de nous dédoubler et de mettre un écart entre la perception que nous avons de nous et celle anticipée de nous-mêmes, une image de nous-mêmes tels que nous serons quand nous agirons en interaction avec les possibles que représente la société. En tâtonnant, je me représente les champs de pensée qui innerve cette réflexion : la collusion peut-être entre la phénoménologie et la manière dont Foucault historicise toute réalité comme construction sociale informée de ses représentations par les acteurs qui la constitue. N'empêche que le propos de ce passage n'est pas de démontrer cette liaison que je suppose mais d'affirmer quelque chose qui, peut-être, est de cet ordre-là. Puis aussitôt, sans en rien faire, sans que ce postulat, parce que ce ne sera jamais que cela, ne serve à échafauder un raisonnement, on passe à autre chose.
Car c'est le reproche principal que je ferais au livre : on ne voit pas à quoi servent les raisonnements qu'on a élaboré à grande peine. A peine ont-ils été érigés qu'ils disparaissent derrière le nuage d'une autre réflexion en cours d'élaboration. Ca m'a perdue. Ca ajouté au fait que je ne sache jamais précisément d'où on parlait. Parfois, il est question du sujet comme d'un précipité de besoins psychologiques et psychiques par-dessus lesquels se superposent les structures sociales que ma connaissance sociologique, anthropologique, politique, etc. permet de révéler. Conception biologico-sociologisante, dont acte. Parfois, le sujet apparait comme l'essentialisation d'une posture dans l'existence : ceux qui sont dans l'idolâtrie et ceux qui sont dans la fétichisation. le premier se trouvant du côté de la célébration excédentaire et jubilatoire de la vie quand le second, désengagé des substances des choses, racornit et se condense sur la rancune. On serait alors dans une conception psychanalytique d'une libido exultante ou contrariée, dans ce qui ferait le lit des névroses selon les premiers écrits de Freud. Ou dans un existentialisme façon Sartre ? Ou dans une réflexion d'ordre ethnologique, comme l'induit la référence à tel gamin indien qui brandit son érection tarifée devant des touristes rances ? Je veux bien reconnaitre qu'il me manque de nombreuses notions et références. Je veux bien accepter que ce texte en soit truffé. Mais j'ai tout de même eu la sensation qu'on me faisait passer à l'aveugle et sans motif du coq à l'âne.
Pourtant, en dépit de ces importantes réserves, j'ai aimé certaines bulles d'affirmations, comme cette conception de la réalité des choses informée des images de cette chose même projetées depuis elle-même et qui conditionnent son existence : ces reflets, ombres et halos « rendent visible ce que l'on prend pour l'apparence première. » Les choses sont des « façades phosphorescentes sur les niveaux et horizons des espaces sensuels » et c'est ainsi qu'elles engendrent une forme saisissable.
J'ai aimé aussi la réflexion très inspirée de Foucault sur la torture et la manière dont nos Etats modernes la pratique, dans le secret des geôles, pour ramener l'autre à son statut de mangeur de charogne, de cannibale même (Musa, si tu me lis...) quand les monarchies d'avant le siècle des Lumières les infligeaient en public pour restaurer l'intégrité du roi dans son corps symbolique.
J'ai été touchée aussi des mots de vulnérabilité, tendresse, empathie pour caractériser la communauté dans la mort.
Mais je n'ai pas vu le fil qui reliait toutes les parties de l'ouvrage entre elles. Pas plus que je ne saurais dire ce que pose Alphonso La Lingis par rapport à cette question de ceux qui n'ont rien en commun sinon que c'est notre condition de mortel qui nous réunit.
Malgré ces apparences très dogmatiques – tout est écrit au présent de vérité générale, dans un usage que j'ai trouvé relever davantage de l'aplomb que de la manière philosophique– et sa revendication à un discours scientifique aussi divers que là encore péremptoire, ce livre est peut-être à considérer davantage comme une rêverie. On en prendrait un petit bout pour élaborer quelques intuitions à partir du canevas qui est proposé. Cela supposerait que l'on nourrisse juste assez notre intellect pour débrider ensuite le reste de nos potentialités.
Que l'on renonce à philosopher en raisonneur pour résonner poétiquement. Je vois la piste, j'y reviendrai peut-être.
Surtout si je parviens à faire taire mon esprit corrosif, ma défiance pour ce genre de subterfuge qui amène souvent à sanctifier leur auteur de l'aura du mage gourou. Ce qui serait un comble pour un philosophe, non ?
Alphonso La Lingis m'était complètement inconnu. Dans la notice que j'ai compulsée, il est pourtant célébré pour avoir introduit aux Etats-Unis des auteurs tels Merleau-Ponty, Levinas. Fervent lecteur de Nietzsche, Deleuze, Lacan, Bataille, et Foucault, on le dit aussi influencé par Levi-Strauss. Quel tableau idéal ! N'en jetez plus, ces influences revendiquées ont suffi à me le recommander chaudement.
Ce à quoi je n'avais toutefois pas prêté suffisamment attention, c'est qu'Alphonso La lingis s'inscrit dans le champ de la « Performance philosophy » et intègre, à ce titre, des éléments théâtraux dans son discours philosophique. Il fait ainsi dialoguer les arts, la corporéité et les concepts dans un questionnement existentiel dans des conférences originales et déconcertantes.
Voilà qui explique peut-être le désarroi qui a été le mien. Il semble que je sois imprégnée par une manière de philosopher très cartésienne ou au moins méthodique. J'attends qu'on définisse les concepts sur lesquels on va travailler et qu'on se tienne à l'assise que l'on a élaborée afin de bâtir, petit à petit l'échafaudage d'une réflexion.
Pas grand-chose qui se rapporte à cette manière de faire ici. J'ai plutôt eu la sensation d'une cascade de mots qui se déversaient sous mes yeux et qui m'invitaient à me laisser bercer de leurs sonorités et de leur rythme. Un subtile collage d'analyses appartenant à différents champs disciplinaires qui ne conduisaient jamais à l'élaboration d'une notion mais indiquaient plutôt la direction que pouvait prendre la réflexion.
Avec, surtout au début, des écueils que je n'ai pas su dépasser : « La pensée est commandée d'être en commandement, de commander ses propres facultés sensorimotrices ». La phrase en elle-même abime dans une réflexivité qui ramène toute perception à son intellectualisation. Mais la suite du texte affirme que nous échappons à ce solipsisme par une capacité de nous dédoubler et de mettre un écart entre la perception que nous avons de nous et celle anticipée de nous-mêmes, une image de nous-mêmes tels que nous serons quand nous agirons en interaction avec les possibles que représente la société. En tâtonnant, je me représente les champs de pensée qui innerve cette réflexion : la collusion peut-être entre la phénoménologie et la manière dont Foucault historicise toute réalité comme construction sociale informée de ses représentations par les acteurs qui la constitue. N'empêche que le propos de ce passage n'est pas de démontrer cette liaison que je suppose mais d'affirmer quelque chose qui, peut-être, est de cet ordre-là. Puis aussitôt, sans en rien faire, sans que ce postulat, parce que ce ne sera jamais que cela, ne serve à échafauder un raisonnement, on passe à autre chose.
Car c'est le reproche principal que je ferais au livre : on ne voit pas à quoi servent les raisonnements qu'on a élaboré à grande peine. A peine ont-ils été érigés qu'ils disparaissent derrière le nuage d'une autre réflexion en cours d'élaboration. Ca m'a perdue. Ca ajouté au fait que je ne sache jamais précisément d'où on parlait. Parfois, il est question du sujet comme d'un précipité de besoins psychologiques et psychiques par-dessus lesquels se superposent les structures sociales que ma connaissance sociologique, anthropologique, politique, etc. permet de révéler. Conception biologico-sociologisante, dont acte. Parfois, le sujet apparait comme l'essentialisation d'une posture dans l'existence : ceux qui sont dans l'idolâtrie et ceux qui sont dans la fétichisation. le premier se trouvant du côté de la célébration excédentaire et jubilatoire de la vie quand le second, désengagé des substances des choses, racornit et se condense sur la rancune. On serait alors dans une conception psychanalytique d'une libido exultante ou contrariée, dans ce qui ferait le lit des névroses selon les premiers écrits de Freud. Ou dans un existentialisme façon Sartre ? Ou dans une réflexion d'ordre ethnologique, comme l'induit la référence à tel gamin indien qui brandit son érection tarifée devant des touristes rances ? Je veux bien reconnaitre qu'il me manque de nombreuses notions et références. Je veux bien accepter que ce texte en soit truffé. Mais j'ai tout de même eu la sensation qu'on me faisait passer à l'aveugle et sans motif du coq à l'âne.
Pourtant, en dépit de ces importantes réserves, j'ai aimé certaines bulles d'affirmations, comme cette conception de la réalité des choses informée des images de cette chose même projetées depuis elle-même et qui conditionnent son existence : ces reflets, ombres et halos « rendent visible ce que l'on prend pour l'apparence première. » Les choses sont des « façades phosphorescentes sur les niveaux et horizons des espaces sensuels » et c'est ainsi qu'elles engendrent une forme saisissable.
J'ai aimé aussi la réflexion très inspirée de Foucault sur la torture et la manière dont nos Etats modernes la pratique, dans le secret des geôles, pour ramener l'autre à son statut de mangeur de charogne, de cannibale même (Musa, si tu me lis...) quand les monarchies d'avant le siècle des Lumières les infligeaient en public pour restaurer l'intégrité du roi dans son corps symbolique.
J'ai été touchée aussi des mots de vulnérabilité, tendresse, empathie pour caractériser la communauté dans la mort.
Mais je n'ai pas vu le fil qui reliait toutes les parties de l'ouvrage entre elles. Pas plus que je ne saurais dire ce que pose Alphonso La Lingis par rapport à cette question de ceux qui n'ont rien en commun sinon que c'est notre condition de mortel qui nous réunit.
Malgré ces apparences très dogmatiques – tout est écrit au présent de vérité générale, dans un usage que j'ai trouvé relever davantage de l'aplomb que de la manière philosophique– et sa revendication à un discours scientifique aussi divers que là encore péremptoire, ce livre est peut-être à considérer davantage comme une rêverie. On en prendrait un petit bout pour élaborer quelques intuitions à partir du canevas qui est proposé. Cela supposerait que l'on nourrisse juste assez notre intellect pour débrider ensuite le reste de nos potentialités.
Que l'on renonce à philosopher en raisonneur pour résonner poétiquement. Je vois la piste, j'y reviendrai peut-être.
Surtout si je parviens à faire taire mon esprit corrosif, ma défiance pour ce genre de subterfuge qui amène souvent à sanctifier leur auteur de l'aura du mage gourou. Ce qui serait un comble pour un philosophe, non ?
Babelio m'ouvre les voix d'un texte philosophique pure, d'un écrivain nord-américain, selon le quatrième de couverture, il serait une figure majeure de la pensée philosophique, critique éthique dans le paysage intellectuel anglo-saxon, Je vais m'égarer dans la prose ardue d'un texte philosophique à la prolixe verbale assez pointue, une nouvelle langue pour le novice que je suis, Il serait mal aisé de croire pouvoir pénétrer facilement cette oeuvre aux frontières gardées par la culture acquise au fil des années, j'ai toujours été freiné par cette langue aux codes bien établis, j'ai tenté de lire, Éthique de Spinoza, et aussi Ainsi parlait Zarathoustra de Friedrich Nietzsche, je n'ai pas réussi à finir ces lectures trop complexes et demandant une assise philosophique assez pointue, que je n'avais pas.
La préface m'a semblé abordable, détaillant la structure de cet essai philosophique, comportant sept chapitres, ainsi que le titre La communauté de ceux qui n'ont rien en commun. Dès le premier chapitre, l'autre communauté, je me suis embourbé dans une forme prosaïque inexplicable, j'ai perdu le fil de la lecture, relisant chaque phrase pour y comprendre la quintessence, sans succès, j'ai cru lire une langue étrangère, devenant esclave d'un travail forcé, j'ai cru devoir apprendre un autre langage, j'ai subi cette lecture forcée, pas à cause du style, mais je me suis accroché à cet essai pour le finir et tenter de pouvoir intercepter quelques idées et les distiller dans mon cerveau et y puiser l'idée principale.
Mais je me suis épuisé dans cette dyslexie verbale philosophique, où chaque phrase était un dur labeur de compréhension et de fluidité, je reprendrai cet essai plus tard lorsque j'aurai pu apprivoiser cette langue littéraire si communautaire pour des novices.
La préface m'a semblé abordable, détaillant la structure de cet essai philosophique, comportant sept chapitres, ainsi que le titre La communauté de ceux qui n'ont rien en commun. Dès le premier chapitre, l'autre communauté, je me suis embourbé dans une forme prosaïque inexplicable, j'ai perdu le fil de la lecture, relisant chaque phrase pour y comprendre la quintessence, sans succès, j'ai cru lire une langue étrangère, devenant esclave d'un travail forcé, j'ai cru devoir apprendre un autre langage, j'ai subi cette lecture forcée, pas à cause du style, mais je me suis accroché à cet essai pour le finir et tenter de pouvoir intercepter quelques idées et les distiller dans mon cerveau et y puiser l'idée principale.
Mais je me suis épuisé dans cette dyslexie verbale philosophique, où chaque phrase était un dur labeur de compréhension et de fluidité, je reprendrai cet essai plus tard lorsque j'aurai pu apprivoiser cette langue littéraire si communautaire pour des novices.
Reçu dans le cadre d'une opération masse critique.
Alphonso Lingis nous livre avec « La communauté de ceux qui n'ont rien en commun » un ouvrage philosophique complexe abordant nombre de sujets. le texte et les réflexions sont riches. Cependant, j'ai dû m'accrocher pour y venir à bout. En effet, bien que fort intéressant, les idées s'enchainent quelquefois sans cohésion concrète. Lorsque j'intégrais enfin les propos de l'auteur, la phrase suivante m'égarait à nouveau. de plus, beaucoup de ces brillantes conceptions me faisaient me questionner sans cesse sur cette phrase : « mmh ok ouais, mais où veux-tu en venir ? ». Bref, une lecture ayant toutefois un grand potentiel conseillée pour les amateurs du genre mais qui m'a personnellement laissée « froide ».
Alphonso Lingis nous livre avec « La communauté de ceux qui n'ont rien en commun » un ouvrage philosophique complexe abordant nombre de sujets. le texte et les réflexions sont riches. Cependant, j'ai dû m'accrocher pour y venir à bout. En effet, bien que fort intéressant, les idées s'enchainent quelquefois sans cohésion concrète. Lorsque j'intégrais enfin les propos de l'auteur, la phrase suivante m'égarait à nouveau. de plus, beaucoup de ces brillantes conceptions me faisaient me questionner sans cesse sur cette phrase : « mmh ok ouais, mais où veux-tu en venir ? ». Bref, une lecture ayant toutefois un grand potentiel conseillée pour les amateurs du genre mais qui m'a personnellement laissée « froide ».
autres livres classés : philosophieVoir plus
Les plus populaires : Non-fiction
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Quiz
Voir plus
Philo pour tous
Jostein Gaarder fut au hit-parade des écrits philosophiques rendus accessibles au plus grand nombre avec un livre paru en 1995. Lequel?
Les Mystères de la patience
Le Monde de Sophie
Maya
Vita brevis
10 questions
441 lecteurs ont répondu
Thèmes :
spiritualité
, philosophieCréer un quiz sur ce livre441 lecteurs ont répondu