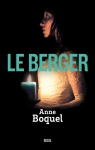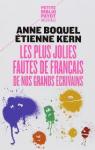Critiques de Anne Boquel (101)
Histoire d’un enfermement au propre comme au figuré, et d’un effondrement, celui de Lucie, jeune conservatrice de musée dans l’Oise, une jeune femme ni malheureuse ni vraiment heureuse, souffrant d’un mal-être qu’elle ne sait pas vraiment définir mais qui est la faille, la porte d’entrée à l’entreprise de soumission et de destruction qu’est le mouvement sectaire. Tous les mécanismes de l’emprise et de l’embrigadement sont minutieusement décortiqués dans ce roman : la fragilité, le mal-être, le vide intérieur puis la fascination grandissante envers le gourou, ici Le berger, le sentiment de culpabilité de ne pas être digne de la communauté. « Elle frémissait presque à la pensée qu’elle aurait dû être jugée indigne de faire partie de la Fraternité, qu’elle se promettait de redoubler de dévouement. Elle sentait monter en elle un besoin de pureté, une exigence qu’elle n’avait jamais connue… Elle deviendrait meilleure. Ainsi s’évanouirait le vide de sa vie. » « S’oublier complétement et vider son esprit pour percevoir la présente de Dieu. »
Puis vient l’isolement, l’éloignement des proches, la loi du silence et le lavage de cerveau qui mène, dans ce cas précis, à la Conversion et la Consécration. Lucie est dans l’attente de la « voix intérieure » mais son esprit résiste, malgré tout, son ancienne vie n’est pas encore totalement morte en elle. Sa sensibilité et ses facultés intellectuelles, sa capacité d’analyse sont autant d’obstacles au processus de soumission et d’anéantissement du Berger. Yves, le restaurateur d’œuvres d’art, est le seul qui la relie encore au monde réel et à la vraie vie, mais jusqu’à quand ? « Au bout de quelques jours, elle n’y pensait plus, happée de nouveau par les entraînements de la prière. » Mais les habitudes, les rituels vont bientôt remplacer la volonté et la lucidité de Lucie. « Elle suivait seule la voie de l’ascèse jamais peut-être elle ne se sentit aussi heureuse que pendant ces quelques semaines où elle atteignit les suprêmes voluptés du dépassement de soi. Elle ne survivait plus qu’avec un vrai repas par jour. »
C’est à une lente construction des mailles d’un redoutable filet que l’on assiste. « Le bonheur était là, dans les rires de frères qui l’entouraient de chaleur et de joie, dans les yeux d’Arthur qui continuaient de la fixer avec une douceur insistante… dans les mains brûlantes du Berger dont elle sentait continuellement la marque autour de ses poignets. »
Un premier roman réussi sur un sujet délicat très bien traité.
Puis vient l’isolement, l’éloignement des proches, la loi du silence et le lavage de cerveau qui mène, dans ce cas précis, à la Conversion et la Consécration. Lucie est dans l’attente de la « voix intérieure » mais son esprit résiste, malgré tout, son ancienne vie n’est pas encore totalement morte en elle. Sa sensibilité et ses facultés intellectuelles, sa capacité d’analyse sont autant d’obstacles au processus de soumission et d’anéantissement du Berger. Yves, le restaurateur d’œuvres d’art, est le seul qui la relie encore au monde réel et à la vraie vie, mais jusqu’à quand ? « Au bout de quelques jours, elle n’y pensait plus, happée de nouveau par les entraînements de la prière. » Mais les habitudes, les rituels vont bientôt remplacer la volonté et la lucidité de Lucie. « Elle suivait seule la voie de l’ascèse jamais peut-être elle ne se sentit aussi heureuse que pendant ces quelques semaines où elle atteignit les suprêmes voluptés du dépassement de soi. Elle ne survivait plus qu’avec un vrai repas par jour. »
C’est à une lente construction des mailles d’un redoutable filet que l’on assiste. « Le bonheur était là, dans les rires de frères qui l’entouraient de chaleur et de joie, dans les yeux d’Arthur qui continuaient de la fixer avec une douceur insistante… dans les mains brûlantes du Berger dont elle sentait continuellement la marque autour de ses poignets. »
Un premier roman réussi sur un sujet délicat très bien traité.
Je tiens à remercier les Éditions du Seuil ainsi que Masse Critique Babelio de m'avoir permis de découvrir cette lecture.
Lucie Vautier est conservatrice dans un petit musée d'Art religieux à Bessancourt où elle exerce son métier en compagnie de son assistante et accessoirement confidente, Mariette. le moins qu'on puisse dire, c'est que sa vie est terne et qu'elle n'y trouve pas franchement source d'épanouissement ! Bien trop « accommodante », notamment avec Louis, son petit ami du moment (qui cherche d'ailleurs une échappatoire, Lucie le sait bien …) comme elle l'a toujours été avec pratiquement tout le monde … Seule relation agréable à ses yeux, même si elle ne sait pas vraiment la définir, cette forme de complicité développée avec un collègue de la DRAC, Yves, restaurateur de musée …
Mariette la presse, depuis un certain temps, d'assister avec elle à des cérémonies d'un groupe de prières évangélique, la Fraternité. Peu enthousiaste, elle finira par céder à la curiosité et rencontrera Thierry « le berger », celui qui sait vous regarder comme une personne digne d'intérêt … Agnès, Stéphanie, Marilyne, Véronique, Arthur, autant de maillons actifs d'une chaine solide, prête à vous emprisonner habilement dans ses filets.
C'est l'histoire – somme toute banale – du danger que représentent les communautés « pseudo-religieuses » sectaires, qui savent si bien repérer les signes de vulnérabilité de leurs futures proies (ennui, solitude, manque affectif ou d'estime de soi, dépression etc …) Pour le seul bien-être d'une poignée de manipulateurs narcissiques (plus rarement d'un seul gourou) prêts à tout sans l'ombre d'un scrupule ou d'une quelconque compassion à l'égard de leurs victimes … Et surtout, cette incompréhension pour tout regard extérieur, devant ce talent inné, cette capacité sidérante à faire « prendre des vessies pour des lanternes » à tant d'adeptes aveuglés (et affamés) pourtant très souvent issus d'un milieu social privilégié …
Lucie Vautier est conservatrice dans un petit musée d'Art religieux à Bessancourt où elle exerce son métier en compagnie de son assistante et accessoirement confidente, Mariette. le moins qu'on puisse dire, c'est que sa vie est terne et qu'elle n'y trouve pas franchement source d'épanouissement ! Bien trop « accommodante », notamment avec Louis, son petit ami du moment (qui cherche d'ailleurs une échappatoire, Lucie le sait bien …) comme elle l'a toujours été avec pratiquement tout le monde … Seule relation agréable à ses yeux, même si elle ne sait pas vraiment la définir, cette forme de complicité développée avec un collègue de la DRAC, Yves, restaurateur de musée …
Mariette la presse, depuis un certain temps, d'assister avec elle à des cérémonies d'un groupe de prières évangélique, la Fraternité. Peu enthousiaste, elle finira par céder à la curiosité et rencontrera Thierry « le berger », celui qui sait vous regarder comme une personne digne d'intérêt … Agnès, Stéphanie, Marilyne, Véronique, Arthur, autant de maillons actifs d'une chaine solide, prête à vous emprisonner habilement dans ses filets.
C'est l'histoire – somme toute banale – du danger que représentent les communautés « pseudo-religieuses » sectaires, qui savent si bien repérer les signes de vulnérabilité de leurs futures proies (ennui, solitude, manque affectif ou d'estime de soi, dépression etc …) Pour le seul bien-être d'une poignée de manipulateurs narcissiques (plus rarement d'un seul gourou) prêts à tout sans l'ombre d'un scrupule ou d'une quelconque compassion à l'égard de leurs victimes … Et surtout, cette incompréhension pour tout regard extérieur, devant ce talent inné, cette capacité sidérante à faire « prendre des vessies pour des lanternes » à tant d'adeptes aveuglés (et affamés) pourtant très souvent issus d'un milieu social privilégié …
Alors, voyons voir de quoi que ça cause, ce livre ? Comme le titre l’indique, nous y verrons une histoire extrêmement bien fournie sur les parents de nos écrivains célèbres et classiques. Beaucoup de familles vont y passer, leurs interactions et leurs rapports décortiqués par les deux auteurs qui ont déjà collaboré sur un autre livre du même acabit ; Une histoire des haines d’écrivains, qu’il faudra que je me procure aussi d’ailleurs !
Au menu, diverses noms que nous connaissons déjà, citons Balzac, Baudelaire, Flaubert, Duras…et tant d’autres ! Chaque famille d’écrivain a une réaction qui lui est propre, et que les deux auteurs ont compilé ici, dans ce livre divisé en plusieurs chapitres. A la fin, nous avons même droit à une rubrique, « Notices biographiques » qui m’ont bien intéressé. J’avoue que, si je lis beaucoup, je me rends compte qu’au final, je lis peu d’auteurs classiques et donc, je ne les connais pas tant que ça. Cette rubrique m’a bien intéressé parce qu’elle m’en disait plus sur l’histoire de la famille, tandis que les chapitres prenaient le temps d’expliciter plus en détail.
Dans nos parents d’écrivains, on a diverses figures toutes aussi intéressantes à étudier les unes que les autres ; les parents qui acceptent la vocation de leur rejeton et qui l’y encouragent, même, et ceux qui au contraire ne veulent pas en entendre parler, ne donnent pas leur soutien et refusent que leur enfant parte sur cette voie alors qu’ils auraient pu briller ailleurs. On ne peut pas leur en vouloir, en remettant les choses dans leur contexte : l’écriture assurerait-elle le revenu suffisant pour que leur rejeton vive dignement ? Et si la littérature les éloignait les uns des autres ? Puisqu’il n’a pas le bac ou le diplôme, il ne peut pas écrire…tant de remarques qui, encore maintenant, reviennent couramment. C’est ce qui m’a motivé à lire ce livre, voir la réaction des parents face aux enfants qui se plongent dans une carrière littéraire, remplie d’incertitudes, c’est vrai.
On y voit des conflits qui se terminent bien, ou mal. Des parents qui, au départ réticents, finissent par collaborer avec leur rejeton qui a pris la plume. Les liens sont toujours là et même si certains parents ne sont pas d’accord avec la vocation, ils aident quand même.
Quelques autres aspects dépeints dans ce livre, et qui nous ramènent à ces parents tourmentés : l’aspect autobiographique de certains titres, comme Poil de Carotte de Jules Renard et Vipère au Poing de Hervé Bazin (que j’ai recommandé dans #MardiConseil sur Twitter), mais il y en a plein d’autres ! Devant les confessions d’un enfant, les parents ne savent parfois plus où se mettre. Mensonges, reproches publiés et donc lus par des lecteurs qui pourraient les reconnaitre, vérités qui blessent, tout y passe ! Que penserait ma famille si j’écrivais mon autobiographie ? Je crois que je les tourmenterai, hélas !
Je pense qu’il y a aussi un élément à ne pas oublier : les auteurs étudiés sont en majorité du XIXème et XXème siècle, donc les mentalités étaient sensiblement différentes de celles que nous avons aujourd’hui. On parle beaucoup de peur de déchéance sociale dans cet essai. L’aspect social est en effet très important pour ces parents d’écrivains qui ont peur d’être déclassés ou mal vus par ceux qui les connaissent, c’est pourquoi quelques uns acceptent à contrecœur la vocation de leur rejeton en demandant néanmoins qu’il porte un pseudonyme, pour ne pas entacher la réputation de la famille.
Enfin, cet essai dépeint les relations qu’ont entretenu les auteurs avec leurs parents ; tantôt bonnes, tantôt mauvaises. De l’admiration de leur travail au rejet total, il y a toutes sortes de réactions que l’on juge consternantes, ou pas. Tout ceci appuyé par un nombre incroyable de documents, des correspondances notamment, qui nous permettent de lire vraiment les réactions des uns et des autres ; les déceptions comme les joies, les conseils littéraires des chers parents à leur enfant-plume.
C’est un livre à lire si vous le désirez, qui vous renseigne sur les rapports entre les parents d’écrivains et leur enfant qui, pour la plupart, ont quand même choisi leur propre futur alors qu’ils étaient destinés à autre chose, selon leur famille. Pour ceux qui, comme moi, sont curieux et avides d’en savoir plus sur les écrivains classiques, je leur recommande volontiers cette lecture. On y lit la vie d’un auteur, les rapports avec la famille, et on peut s’imaginer ce qu’est la vie d’un auteur. Par la même occasion, on se rendra compte que les choses n’ont pas forcément changé aujourd’hui.
Pour preuve, il n’est pas rare de voir ces questions apparaitre régulièrement : Peut-on vivre de son écriture ? Peut-on considérer qu’écrire est une vraie profession ? Voici des questions que se sont aussi posés les parents d’écrivains.
Lien : https://saveurlitteraire.wor..
Au menu, diverses noms que nous connaissons déjà, citons Balzac, Baudelaire, Flaubert, Duras…et tant d’autres ! Chaque famille d’écrivain a une réaction qui lui est propre, et que les deux auteurs ont compilé ici, dans ce livre divisé en plusieurs chapitres. A la fin, nous avons même droit à une rubrique, « Notices biographiques » qui m’ont bien intéressé. J’avoue que, si je lis beaucoup, je me rends compte qu’au final, je lis peu d’auteurs classiques et donc, je ne les connais pas tant que ça. Cette rubrique m’a bien intéressé parce qu’elle m’en disait plus sur l’histoire de la famille, tandis que les chapitres prenaient le temps d’expliciter plus en détail.
Dans nos parents d’écrivains, on a diverses figures toutes aussi intéressantes à étudier les unes que les autres ; les parents qui acceptent la vocation de leur rejeton et qui l’y encouragent, même, et ceux qui au contraire ne veulent pas en entendre parler, ne donnent pas leur soutien et refusent que leur enfant parte sur cette voie alors qu’ils auraient pu briller ailleurs. On ne peut pas leur en vouloir, en remettant les choses dans leur contexte : l’écriture assurerait-elle le revenu suffisant pour que leur rejeton vive dignement ? Et si la littérature les éloignait les uns des autres ? Puisqu’il n’a pas le bac ou le diplôme, il ne peut pas écrire…tant de remarques qui, encore maintenant, reviennent couramment. C’est ce qui m’a motivé à lire ce livre, voir la réaction des parents face aux enfants qui se plongent dans une carrière littéraire, remplie d’incertitudes, c’est vrai.
On y voit des conflits qui se terminent bien, ou mal. Des parents qui, au départ réticents, finissent par collaborer avec leur rejeton qui a pris la plume. Les liens sont toujours là et même si certains parents ne sont pas d’accord avec la vocation, ils aident quand même.
Quelques autres aspects dépeints dans ce livre, et qui nous ramènent à ces parents tourmentés : l’aspect autobiographique de certains titres, comme Poil de Carotte de Jules Renard et Vipère au Poing de Hervé Bazin (que j’ai recommandé dans #MardiConseil sur Twitter), mais il y en a plein d’autres ! Devant les confessions d’un enfant, les parents ne savent parfois plus où se mettre. Mensonges, reproches publiés et donc lus par des lecteurs qui pourraient les reconnaitre, vérités qui blessent, tout y passe ! Que penserait ma famille si j’écrivais mon autobiographie ? Je crois que je les tourmenterai, hélas !
Je pense qu’il y a aussi un élément à ne pas oublier : les auteurs étudiés sont en majorité du XIXème et XXème siècle, donc les mentalités étaient sensiblement différentes de celles que nous avons aujourd’hui. On parle beaucoup de peur de déchéance sociale dans cet essai. L’aspect social est en effet très important pour ces parents d’écrivains qui ont peur d’être déclassés ou mal vus par ceux qui les connaissent, c’est pourquoi quelques uns acceptent à contrecœur la vocation de leur rejeton en demandant néanmoins qu’il porte un pseudonyme, pour ne pas entacher la réputation de la famille.
Enfin, cet essai dépeint les relations qu’ont entretenu les auteurs avec leurs parents ; tantôt bonnes, tantôt mauvaises. De l’admiration de leur travail au rejet total, il y a toutes sortes de réactions que l’on juge consternantes, ou pas. Tout ceci appuyé par un nombre incroyable de documents, des correspondances notamment, qui nous permettent de lire vraiment les réactions des uns et des autres ; les déceptions comme les joies, les conseils littéraires des chers parents à leur enfant-plume.
C’est un livre à lire si vous le désirez, qui vous renseigne sur les rapports entre les parents d’écrivains et leur enfant qui, pour la plupart, ont quand même choisi leur propre futur alors qu’ils étaient destinés à autre chose, selon leur famille. Pour ceux qui, comme moi, sont curieux et avides d’en savoir plus sur les écrivains classiques, je leur recommande volontiers cette lecture. On y lit la vie d’un auteur, les rapports avec la famille, et on peut s’imaginer ce qu’est la vie d’un auteur. Par la même occasion, on se rendra compte que les choses n’ont pas forcément changé aujourd’hui.
Pour preuve, il n’est pas rare de voir ces questions apparaitre régulièrement : Peut-on vivre de son écriture ? Peut-on considérer qu’écrire est une vraie profession ? Voici des questions que se sont aussi posés les parents d’écrivains.
Lien : https://saveurlitteraire.wor..
Livre reçu dans le cadre d'une opération Masse Critique (Merci Babelio et l'éditeur !).
Un livre qui se lit bien, et vite. Les chapitres sont assez courts, quelques pages seulement, et ne rentrent pas forcément dans les détails, mais s'attachent plutôt à présenter quelques faits marquants et représentatifs du type d'amitié qu'entretenaient les auteurs.
C'est intéressant, la bibliographie permet d'aller creuser si le coeur nous en dit, mais le livre donne déjà une idée assez large des amitiés littéraires, dans des périodes et des endroits variés.
J'ai 2 petits bémols à émettre :
- l'ouvrage aurait gagné à développer un peu plus les chapitres, je suis parfois restée sur ma faim.
- la couverture reprend des codes plutôt fantastique/gothique et peut induire en erreur (mais ça, c'est plus mon point de vue de médiatrice du livre...)
Et maintenant, pourquoi j'ai mis 4 étoiles !
Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'en substance, ce livre m'a posé la question de l'amitié, tant elle peut être variée. Elle prend une dimension supplémentaire lorsqu'il s'agit d'êtres illustres, intellectuels, qui réussissent à mettre des mots sur les sentiments. Lire les passages de correspondances m'a particulièrement enthousiasmée. J'ai découvert des amitiés, parfois très proches d'amours platoniques, empreintes d'admiration. C'est beau, ça donne envie de s'arrêter un peu, de faire un pas de côté pour observer ses propres amitiés. J'ai découvert des auteurs, aussi, que j'ai maintenant envie de découvrir via leurs écrits (et ça, j'aime bien !).
Un livre qui a donc réussi l'exploit d'être à la fois léger et profond.
A quand le tome 2 ?
Un livre qui se lit bien, et vite. Les chapitres sont assez courts, quelques pages seulement, et ne rentrent pas forcément dans les détails, mais s'attachent plutôt à présenter quelques faits marquants et représentatifs du type d'amitié qu'entretenaient les auteurs.
C'est intéressant, la bibliographie permet d'aller creuser si le coeur nous en dit, mais le livre donne déjà une idée assez large des amitiés littéraires, dans des périodes et des endroits variés.
J'ai 2 petits bémols à émettre :
- l'ouvrage aurait gagné à développer un peu plus les chapitres, je suis parfois restée sur ma faim.
- la couverture reprend des codes plutôt fantastique/gothique et peut induire en erreur (mais ça, c'est plus mon point de vue de médiatrice du livre...)
Et maintenant, pourquoi j'ai mis 4 étoiles !
Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'en substance, ce livre m'a posé la question de l'amitié, tant elle peut être variée. Elle prend une dimension supplémentaire lorsqu'il s'agit d'êtres illustres, intellectuels, qui réussissent à mettre des mots sur les sentiments. Lire les passages de correspondances m'a particulièrement enthousiasmée. J'ai découvert des amitiés, parfois très proches d'amours platoniques, empreintes d'admiration. C'est beau, ça donne envie de s'arrêter un peu, de faire un pas de côté pour observer ses propres amitiés. J'ai découvert des auteurs, aussi, que j'ai maintenant envie de découvrir via leurs écrits (et ça, j'aime bien !).
Un livre qui a donc réussi l'exploit d'être à la fois léger et profond.
A quand le tome 2 ?
Il y a des hasards parfois qu’on n’explique pas et qui sont source de belles surprises. Contactée par Babelio pour participer à une Masse Critique à laquelle je n’avais pas prévu de m’inscrire à l’origine, j’ai reçu Le Crâne de mon ami. Les plus belles amitiés d’écrivains de Goethe à García Marquez d’Anne Boquel et Étienne Kern. J’ai eu un coup de foudre pour ce livre qui nous emmène à la rencontre des plus grands auteurs.
Ce livre insolite fait suite à un autre qui portait sur les « haines » d’écrivains, les plus grandes rivalités qui opposaient les génies de la littérature. Après avoir traité ce pan des relations humaines, il ne restait plus à Anne Boquel et Étienne Kern qu’à aborder le versant opposé : l’amitié. Un peu sur le mode d’un recueil de nouvelles, le duo d’auteurs retrace, dans treize chapitres, treize amitiés mythiques qu’ont noué les plus grands romanciers, poètes et dramaturges de notre patrimoine culturel.
Classé parmi les documents en lettres, Le Crâne de mon ami se lit pourtant comme de la littérature. Boquel et Kern nous mettent toujours en situation avant d’entrer dans le vif du sujet. Le décor est planté, les accessoires soigneusement disposés avant que les acteurs n’entrent en scène. Pour cet ouvrage, les deux auteurs ont aussi ratissé large pour nous parler de ces amitiés d’écrivains. Ainsi, on traverse les époques et les pays à la rencontre de ces hommes et femmes d’exception. Le lecteur, plus qu’un spectateur extérieur, s’y croit alors vraiment.
Une fois ce décor installé, on entre au cœur du sujet : lesdites amitiés entretenues par ces grands noms. On découvre alors ces derniers sous un tout nouvel angle. En effet, on les connaît déjà par le prisme de leurs œuvres, et parfois de la médiatisation qui a pu les entourer. Mais Anne Boquel et Étienne Kern nous plongent dans l’intimité des auteurs de notre patrimoine culturel.
Le Crâne de mon ami nous montre alors à quel point l’amitié est chose complexe. Elle commence ou finit bien souvent avec un fait qui laisserait présager tout le contraire d’une franche camaraderie. Et entre les deux, elle emprunte la plupart du temps un chemin très sinueux, pavé de jalousies ou de rivalités plus ou moins masquées. Mais indéfectiblement, chacune de ces amitiés mythiques est teintée de tendresse et de bienveillance. Chacune de ces treize histoires nous met ainsi du baume au cœur.
Le Crâne de mon ami, avec son titre aussi insolite soit-il, est une belle découverte ! Anne Boquel et Étienne Kern nous emmènent à la rencontre des plus grands auteurs par le prisme des amitiés, parfois complexes ou farfelues mais toujours authentiques, qu’ils ont nouées. À lire par tous les passionné.e.s de littérature, ou tout simplement de belles histoires.
Lien : https://lesmarquespagedunecr..
Ce livre insolite fait suite à un autre qui portait sur les « haines » d’écrivains, les plus grandes rivalités qui opposaient les génies de la littérature. Après avoir traité ce pan des relations humaines, il ne restait plus à Anne Boquel et Étienne Kern qu’à aborder le versant opposé : l’amitié. Un peu sur le mode d’un recueil de nouvelles, le duo d’auteurs retrace, dans treize chapitres, treize amitiés mythiques qu’ont noué les plus grands romanciers, poètes et dramaturges de notre patrimoine culturel.
Classé parmi les documents en lettres, Le Crâne de mon ami se lit pourtant comme de la littérature. Boquel et Kern nous mettent toujours en situation avant d’entrer dans le vif du sujet. Le décor est planté, les accessoires soigneusement disposés avant que les acteurs n’entrent en scène. Pour cet ouvrage, les deux auteurs ont aussi ratissé large pour nous parler de ces amitiés d’écrivains. Ainsi, on traverse les époques et les pays à la rencontre de ces hommes et femmes d’exception. Le lecteur, plus qu’un spectateur extérieur, s’y croit alors vraiment.
Une fois ce décor installé, on entre au cœur du sujet : lesdites amitiés entretenues par ces grands noms. On découvre alors ces derniers sous un tout nouvel angle. En effet, on les connaît déjà par le prisme de leurs œuvres, et parfois de la médiatisation qui a pu les entourer. Mais Anne Boquel et Étienne Kern nous plongent dans l’intimité des auteurs de notre patrimoine culturel.
Le Crâne de mon ami nous montre alors à quel point l’amitié est chose complexe. Elle commence ou finit bien souvent avec un fait qui laisserait présager tout le contraire d’une franche camaraderie. Et entre les deux, elle emprunte la plupart du temps un chemin très sinueux, pavé de jalousies ou de rivalités plus ou moins masquées. Mais indéfectiblement, chacune de ces amitiés mythiques est teintée de tendresse et de bienveillance. Chacune de ces treize histoires nous met ainsi du baume au cœur.
Le Crâne de mon ami, avec son titre aussi insolite soit-il, est une belle découverte ! Anne Boquel et Étienne Kern nous emmènent à la rencontre des plus grands auteurs par le prisme des amitiés, parfois complexes ou farfelues mais toujours authentiques, qu’ils ont nouées. À lire par tous les passionné.e.s de littérature, ou tout simplement de belles histoires.
Lien : https://lesmarquespagedunecr..
Je m’intéresse autant aux écrits d’un auteur qu’à l’auteur lui-même : je trouve en effet souvent qu’une connaissance plus intime de ceux que je lis permet de mieux comprendre leur œuvre, que ce soit parce que les deux se ressemblent, ou au contraire parce qu’ils sont complètement antithétiques. C’est pourquoi je me suis intéressée au Crâne de mon ami, recueil qui nous raconte diverses amitiés littéraires s’étant forgées entre les XIXème et et XXème siècles. A la réception de cet ouvrage, j’avais décidé de me plonger dans une amitié littéraire par jour, et seulement une, pour avoir le temps de savourer chacune de ces tranches de vie, anecdotes plus ou moins heureuses racontées par Anne Boquel et Etienne Kern. J’ai tellement été happée par la première que j’ai lu dans la foulée la deuxième, puis la troisième… finalement, le tout a été englouti en une soirée.
La principale raison de cet engouement est la connaissance, même si plus ou moins importante, de la majorité des auteurs présentés – connus tous de nom, et les trois quarts déjà lus au moins une fois -, qui m’a donné envie de découvrir, voire de redécouvrir sous un autre angle des écrivains que j’apprécie en majorité. Excepté concernant la relation principalement épistolaire entre Flaubert et Sand, qui m’est plus que familière (merci l’agrég’ et l’analyse poussée des évènements politiques de 1848 et de 1871 qui en a découlé), j’ai pu m’immiscer dans des amitiés qui m’étaient inédites et qui, bien qu’entre de grands noms de la littérature mondiale, restent on ne peut plus banales, nous montrant à quel point ces grands noms sont, somme toute, des êtres humains comme les autres. Qui plus est, ces amitiés sont particulièrement bien racontées, entre érudition mêlant extraits de correspondance, de journaux intimes… et romanesque : l’on sent que les auteurs se sont remarquablement bien documentés sur leur sujet, qu’ils sont eux-mêmes des passionnés de littérature, qu’ils ne sont finalement pas de simples compilateurs de documents racontant ces amitiés, mais bien des écrivains à part entière, notamment par leur capacité de redonner vie à ces relations amicales avec beaucoup de réussite.
Seul bémol à cette lecture, j’ai trouvé que les dernières amitiés étaient relatées beaucoup plus brièvement que les autres, sans qu’il y ait à mon sens de véritable explication à cette brièveté, puisque l’érudition présente précédemment est toujours de mise : moins de documentation, ou de connaissances sur ces auteurs, peut-être ? J’ai regretté rester sur ma faim sur des auteurs que je connais justement moins, comme Mishima et Kawabata, ou encore Garcia Marquez et Vargas Llosa.
Un ouvrage qui fut donc à la fois très enrichissant et agréable à lire. Je remercie Babelio et les éditions Payot de m’avoir permis de le découvrir.
Lien : https://lartetletreblog.word..
La principale raison de cet engouement est la connaissance, même si plus ou moins importante, de la majorité des auteurs présentés – connus tous de nom, et les trois quarts déjà lus au moins une fois -, qui m’a donné envie de découvrir, voire de redécouvrir sous un autre angle des écrivains que j’apprécie en majorité. Excepté concernant la relation principalement épistolaire entre Flaubert et Sand, qui m’est plus que familière (merci l’agrég’ et l’analyse poussée des évènements politiques de 1848 et de 1871 qui en a découlé), j’ai pu m’immiscer dans des amitiés qui m’étaient inédites et qui, bien qu’entre de grands noms de la littérature mondiale, restent on ne peut plus banales, nous montrant à quel point ces grands noms sont, somme toute, des êtres humains comme les autres. Qui plus est, ces amitiés sont particulièrement bien racontées, entre érudition mêlant extraits de correspondance, de journaux intimes… et romanesque : l’on sent que les auteurs se sont remarquablement bien documentés sur leur sujet, qu’ils sont eux-mêmes des passionnés de littérature, qu’ils ne sont finalement pas de simples compilateurs de documents racontant ces amitiés, mais bien des écrivains à part entière, notamment par leur capacité de redonner vie à ces relations amicales avec beaucoup de réussite.
Seul bémol à cette lecture, j’ai trouvé que les dernières amitiés étaient relatées beaucoup plus brièvement que les autres, sans qu’il y ait à mon sens de véritable explication à cette brièveté, puisque l’érudition présente précédemment est toujours de mise : moins de documentation, ou de connaissances sur ces auteurs, peut-être ? J’ai regretté rester sur ma faim sur des auteurs que je connais justement moins, comme Mishima et Kawabata, ou encore Garcia Marquez et Vargas Llosa.
Un ouvrage qui fut donc à la fois très enrichissant et agréable à lire. Je remercie Babelio et les éditions Payot de m’avoir permis de le découvrir.
Lien : https://lartetletreblog.word..
“La grande différence entre l'amour et l'amitié, c'est qu'il ne peut y avoir d'amitié sans réciprocité.” Michel Tournier
Si pour vous parler de ce livre j’emprunte une citation à Michel Tournier c’est parce que c’est bien lui qui dans un grand éclat de rire, a suggéré aux auteurs d’écrire « un bouquin sur les écrivains qui s’aiment ».
Anne Boquel et Etienne Kern, normaliens mais surtout passionnés de littérature, se sont donc lancer dans un travail de recherche pour nous proposer treize histoires d'amitié entre écrivains.
Hugo et Dumas, Sand et Flaubert, Woolf et Mansfield, Kawabata et Mishima, Kerouac et Ginsberg, Césaire et Senghor. Gabriel Garcia Marquez et Mario Vargas Llosa …. : des écrivains exceptionnels mais qui quand il s’agit d’amitié ne sont finalement que des hommes ou des femmes comme vous et moi.
Des amis écrivains qui se rencontrent sur des coups de foudre, travaillent ensemble, se soutiennent, se jalousent un peu, s’insupportent par moment, se fâchent violement parfois mais s’aiment intensément.
On découvre l'histoire littéraire du côté de l’intime, on entre par la petite porte dans la grande littérature et c’est passionnant.
Ça se lit par petits bouts ou d’un trait selon l’humeur du moment mais s’il y a bien un livre pour la communauté Babelio, c’est celui-là !
Un formidable travail de documentation et de solide références pour cet essai des plus intéressants mais qui en plus se laisse lire sans efforts.
Je vous en recommande chaudement la lecture
Si pour vous parler de ce livre j’emprunte une citation à Michel Tournier c’est parce que c’est bien lui qui dans un grand éclat de rire, a suggéré aux auteurs d’écrire « un bouquin sur les écrivains qui s’aiment ».
Anne Boquel et Etienne Kern, normaliens mais surtout passionnés de littérature, se sont donc lancer dans un travail de recherche pour nous proposer treize histoires d'amitié entre écrivains.
Hugo et Dumas, Sand et Flaubert, Woolf et Mansfield, Kawabata et Mishima, Kerouac et Ginsberg, Césaire et Senghor. Gabriel Garcia Marquez et Mario Vargas Llosa …. : des écrivains exceptionnels mais qui quand il s’agit d’amitié ne sont finalement que des hommes ou des femmes comme vous et moi.
Des amis écrivains qui se rencontrent sur des coups de foudre, travaillent ensemble, se soutiennent, se jalousent un peu, s’insupportent par moment, se fâchent violement parfois mais s’aiment intensément.
On découvre l'histoire littéraire du côté de l’intime, on entre par la petite porte dans la grande littérature et c’est passionnant.
Ça se lit par petits bouts ou d’un trait selon l’humeur du moment mais s’il y a bien un livre pour la communauté Babelio, c’est celui-là !
Un formidable travail de documentation et de solide références pour cet essai des plus intéressants mais qui en plus se laisse lire sans efforts.
Je vous en recommande chaudement la lecture
Amitiés improbables, amitiés inéluctables, coups de foudre, rencontres étonnantes sont la trame de cet ouvrage qui offre les plus belles affections ou sympathies d’écrivains célèbres. Treize histoires de camaraderies sincères nourries d’affinités profondes et de respect, ponctuées des travers de l’âme humaine, toujours intenses et douloureuses lors du décès de l’un ou de l’autre.
Du XVIII au XXème siècle, nous retrouvons notamment Goethe et Schiller, Sand et Flaubert, Woolf et Mansfield, Senghor et Césaire, Char et Camus … dans toute la richesse et la complexité des relations de l’entraide à l’amour, de la rivalité à l’impulsion, de l’admiration à l’envie. L’ensemble est très intéressant et complète habilement les connaissances sur les auteurs que nous pouvions avoir.
Une lecture originale et savoureuse.
Bonus : une couverture vraiment magnifique !
Lien : http://aufildeslivresblogetc..
Du XVIII au XXème siècle, nous retrouvons notamment Goethe et Schiller, Sand et Flaubert, Woolf et Mansfield, Senghor et Césaire, Char et Camus … dans toute la richesse et la complexité des relations de l’entraide à l’amour, de la rivalité à l’impulsion, de l’admiration à l’envie. L’ensemble est très intéressant et complète habilement les connaissances sur les auteurs que nous pouvions avoir.
Une lecture originale et savoureuse.
Bonus : une couverture vraiment magnifique !
Lien : http://aufildeslivresblogetc..
De 1794 à 1967 au quatre coins du monde, les auteurs nous plongent dans la vie des écrivains et surtout nous parle de l'amitié. L'amitié fusionnelle entre William Wordsworth et Samuel Taylor Coleridge, l'amitié impossible entre Tolstoï et Tourgueniev, le coup de foudre amical malgré leurs différences entre George Sand et Gustave Flaubert, l'amitié singulière et étonnante entre Virginia Woolf et Katherine Mansfield, l'amitié maître/disciple entre Yukio Mishima et Kawabata... et bien d'autres...
On a des anecdotes, des moments de vie, on découvre leurs oeuvres. Chacun avec ses déboires, ses travers, ses défauts ou bien ses qualités, ses passions ou ses envies. L'histoire de chaque écrivain a un contexte intéressant. Et surtout on parle d'amitié née parfois d'un conflit, de la découverte d'affinités ou de points communs. Si j'avais un défaut à lui faire, ce serait qu'il m'a manqué des photographies pour agrémenter le texte et le rendre plus vivant. Un ouvrage vraiment intéressant. (...)
Ma page Facebook Au chapitre d'Elodie
Lien : http://auchapitre.canalblog...
On a des anecdotes, des moments de vie, on découvre leurs oeuvres. Chacun avec ses déboires, ses travers, ses défauts ou bien ses qualités, ses passions ou ses envies. L'histoire de chaque écrivain a un contexte intéressant. Et surtout on parle d'amitié née parfois d'un conflit, de la découverte d'affinités ou de points communs. Si j'avais un défaut à lui faire, ce serait qu'il m'a manqué des photographies pour agrémenter le texte et le rendre plus vivant. Un ouvrage vraiment intéressant. (...)
Ma page Facebook Au chapitre d'Elodie
Lien : http://auchapitre.canalblog...
« Le succès des autres me gêne, mais beaucoup moins que s’il était mérité » déclare sournoisement Jules Renard. Les autres ? Quels autres ? Chateaubriant ? « Un matamore de tragédie » ! Musset ? « Un fœtus conservé dans l’alcool » ! Zola ? « Un ressemeleur en littérature » ! Hugo ? Dumas ? Lamartine ? Sand ? Pouah, n’en parlons pas !
Qui a dit que les grands écrivains étaient des gens courtois et mesurés ? Les écrivains sont de sales bêtes vindicatives et orgueilleuses, pétris de méchanceté et de jalousie. Personne ne hait avec autant d’enthousiasme et de constance qu’un écrivain et, si une partie de leur vindicte tombe sur les critiques littéraires, les éditeurs et les directeurs de théâtre, c’est principalement leurs pairs qui sont les cibles de leurs ires. Quand on lui demande s’il a des ennemis, Eugène Sue répond avec ravissement : « Oh ! Très biens, parfaits et en quantité. » Car s’il est bon d’avoir des alliés dans la petite guerre de tranchées que se livrent les auteurs du XIXe siècle, il est encore meilleur d’avoir des ennemis. Un bon ennemi, ça vous pose un homme, ça vous donne de la prestance, de la profondeur, surtout quand celui-ci est prestigieux. Qui n’a pas rêvé de se déclarer l’ennemi personnel de Victor Hugo ? La némésis d’Emile Zola ?
Mais les écrivains ne sont pas seulement des querelleurs chroniques, ce sont aussi des hommes d’esprit. Bienvenu au festival de la vacherie ingénieuse organisé par Etienne Kern et Anne Boquel ! Amateurs de traits d’esprit féroces, de mauvaise foi crasse et de verve satirique, vous allez vous régaler avec cet excellent petit essai, « Un histoire des haines d’écrivains ». Mensonges, ruses, calomnies, ragots… Nos grands hommes ne reculent devant rien pour esquinter leurs adversaires et faire reluire un peu plus leurs propres piédestaux et ceci pour le plus vif plaisir des heureux lecteurs que nous sommes. Oh, on le sait bien, se moquer de ses petits camarades, c’est mal, mais c’est tellement marrant aussi ! Et de toute façon, les autres vous le rendent bien et à coups de truelle en plus.
Eh oui, des sales bêtes, ces écrivains, mais personnes ne leur a pas demandé d’être des saints, juste des génies. Et un poil de mesquinerie, doublé d’un soupçon d’orgueil et de fiel, ça vous rend tout de suite un bonhomme plus sympathique, non ?
Qui a dit que les grands écrivains étaient des gens courtois et mesurés ? Les écrivains sont de sales bêtes vindicatives et orgueilleuses, pétris de méchanceté et de jalousie. Personne ne hait avec autant d’enthousiasme et de constance qu’un écrivain et, si une partie de leur vindicte tombe sur les critiques littéraires, les éditeurs et les directeurs de théâtre, c’est principalement leurs pairs qui sont les cibles de leurs ires. Quand on lui demande s’il a des ennemis, Eugène Sue répond avec ravissement : « Oh ! Très biens, parfaits et en quantité. » Car s’il est bon d’avoir des alliés dans la petite guerre de tranchées que se livrent les auteurs du XIXe siècle, il est encore meilleur d’avoir des ennemis. Un bon ennemi, ça vous pose un homme, ça vous donne de la prestance, de la profondeur, surtout quand celui-ci est prestigieux. Qui n’a pas rêvé de se déclarer l’ennemi personnel de Victor Hugo ? La némésis d’Emile Zola ?
Mais les écrivains ne sont pas seulement des querelleurs chroniques, ce sont aussi des hommes d’esprit. Bienvenu au festival de la vacherie ingénieuse organisé par Etienne Kern et Anne Boquel ! Amateurs de traits d’esprit féroces, de mauvaise foi crasse et de verve satirique, vous allez vous régaler avec cet excellent petit essai, « Un histoire des haines d’écrivains ». Mensonges, ruses, calomnies, ragots… Nos grands hommes ne reculent devant rien pour esquinter leurs adversaires et faire reluire un peu plus leurs propres piédestaux et ceci pour le plus vif plaisir des heureux lecteurs que nous sommes. Oh, on le sait bien, se moquer de ses petits camarades, c’est mal, mais c’est tellement marrant aussi ! Et de toute façon, les autres vous le rendent bien et à coups de truelle en plus.
Eh oui, des sales bêtes, ces écrivains, mais personnes ne leur a pas demandé d’être des saints, juste des génies. Et un poil de mesquinerie, doublé d’un soupçon d’orgueil et de fiel, ça vous rend tout de suite un bonhomme plus sympathique, non ?
A travers différents thèmes, les auteurs décrivent les réactions de parents d'écrivains. Des anecdotes intéressantes et des notices biographiques, mais on regrette
l'absence de sommaire et quelques impressions de redites.
l'absence de sommaire et quelques impressions de redites.
Si vous avez des difficultés avec l’orthographe, la grammaire et la conjugaison, sachez que d’autres sont passés par là avant vous, et que certains grands écrivains sont aussi de grands auteurs de… fautes de français ! Ce livre est une amusante et réjouissante compilation des erreurs et des bourdes commises par les auteurs célèbres, comme Victor Hugo, Honoré de Balzac ou encore Jules Verne (qui, dans une lettre à ses parents, évoque par exemple des « maisons criblées […] de bal », confondant ainsi le mot bal avec son homonyme balle, et oubliant, en outre, de mettre au pluriel le mot erroné !)…
.Règle 3 : Accorder l’adjectif. 4 : accorder le déterminant. 5 : accorder le verbe. 6 : redouter l’accord du participe. 7 : respecter l’emploi des modes et des temps….. 10 : éviter les pléonasmes et autres redondances. 11 : ne pas torturer la syntaxe. 12 : de l’importance de se relire, mais aussi règle 16 : oser la faute….
OUI ! Ils sont comme nous, enfin du moins comme moi, ils en font tous, même les plus grands et les plus érudits. Ils en font des énormes, des impardonnables, des magnifiques, des futiles, des flamboyantes, des toutes petites ou d’étourderie. Anne Bocquel et Etienne Kern ont ressemblés les plus jolies fautes de français de nos grands écrivains et ils sont tous là : Voltaire, Lamartine, Balzac, Hugo, Stendhal, Chateaubriand, Zola, Rimbaud, Proust, Gide, Claudel, Camus, Mauriac, Céline et les autres, ils en ont tous fait. Alors ce soir, chers lecteurs, un peu d’indulgence lorsque vous surveillerez les devoirs de vos petits frères.
« Sous le pont Mirabeau coule la Seine
Et nos amours
Faut-il qu’il m’en souvienne
Et la joie venait toujours après la peine »
Une jolie faute d’accord se cache dans cette strophe sauras-tu la retrouver ?
A glisser sous le sapin pour déculpabiliser l’enfant que nous sommes encore, car il faut aussi, règle 15 : savoir rire de la faute et surtout, règle 17 : écrire avec son cœur….
Lien : http://www.baz-art.org/archi..
OUI ! Ils sont comme nous, enfin du moins comme moi, ils en font tous, même les plus grands et les plus érudits. Ils en font des énormes, des impardonnables, des magnifiques, des futiles, des flamboyantes, des toutes petites ou d’étourderie. Anne Bocquel et Etienne Kern ont ressemblés les plus jolies fautes de français de nos grands écrivains et ils sont tous là : Voltaire, Lamartine, Balzac, Hugo, Stendhal, Chateaubriand, Zola, Rimbaud, Proust, Gide, Claudel, Camus, Mauriac, Céline et les autres, ils en ont tous fait. Alors ce soir, chers lecteurs, un peu d’indulgence lorsque vous surveillerez les devoirs de vos petits frères.
« Sous le pont Mirabeau coule la Seine
Et nos amours
Faut-il qu’il m’en souvienne
Et la joie venait toujours après la peine »
Une jolie faute d’accord se cache dans cette strophe sauras-tu la retrouver ?
A glisser sous le sapin pour déculpabiliser l’enfant que nous sommes encore, car il faut aussi, règle 15 : savoir rire de la faute et surtout, règle 17 : écrire avec son cœur….
Lien : http://www.baz-art.org/archi..
Dans l’ensemble ce livre est agréable à lire, même s’il faut le dire l’histoire de ce Champs d’Asile reste dans l’ensemble sans grand intérêt, c’est d’ailleurs sûrement pour cela que cet épisode est un peu oublié de l’histoire. Néanmoins d’un point de vue historique il reste assez bien fourni et exhaustif malgré les sources « rares », enfin je crois, car ce n’est pas un épisode que je connais sur le bout des doigts.
Cependant et malgré la découverte de cette histoire, ce livre reste à moitié ennuyeux à lire. Déjà parce qu’il ne se passe pas grand-chose, mais aussi parce qu’on sait d’avance que cette entreprise est vouée à l’échec. Certes on découvre le déroulement de ce projet, et les limites que l’utopie a vite rencontrées, mais malgré cela on s’ennuie un peu quand même, et c’est là sûrement le seul point faible de ce livre, car outre cela cet ouvrage reste très instructif, clair et facile à lire.
D’ailleurs quand on le lit, on a un peu l’impression de lire un roman d’aventure style "L’île au trésor", puisqu’en effet on y rencontre des cannibales, des soldats, des commandants et des capitaines qui se tirent dans les pattes, une faune et une flore sauvages et hostiles, etc, etc… Ce qui du coup, fait que parfois on oublie un peu que l’on lit un livre qui se classe dans les documentaires et non dans les romans. Même si, il faut le dire, l’écriture ne possède pas le rythme d’un roman, en même temps j’avoue m’être bien fait chier avec "L’île au trésor", comme quoi tout n’est pas qu’une question d’écriture…
Néanmoins malgré cela, la lecture -même si comme je l’ai dit on peut s’ennuyer par moment- reste agréable. Prendre connaissance des gens qui se sont fatigués pour rien, voir des hauts placés s’inquiétaient (un peu) sur ce petit groupe inoffensif au final, et savoir qu’en plus après d’autres sont parvenus à dompter cette nature, ce livre qui sonne comme une farce apporte le plaisir de la découverte. A lire avant tout par curiosité.
Je remercie en passant les éditions Flammarion et Babelio pour ce partenariat.
Lien : http://voyagelivresque.canal..
Cependant et malgré la découverte de cette histoire, ce livre reste à moitié ennuyeux à lire. Déjà parce qu’il ne se passe pas grand-chose, mais aussi parce qu’on sait d’avance que cette entreprise est vouée à l’échec. Certes on découvre le déroulement de ce projet, et les limites que l’utopie a vite rencontrées, mais malgré cela on s’ennuie un peu quand même, et c’est là sûrement le seul point faible de ce livre, car outre cela cet ouvrage reste très instructif, clair et facile à lire.
D’ailleurs quand on le lit, on a un peu l’impression de lire un roman d’aventure style "L’île au trésor", puisqu’en effet on y rencontre des cannibales, des soldats, des commandants et des capitaines qui se tirent dans les pattes, une faune et une flore sauvages et hostiles, etc, etc… Ce qui du coup, fait que parfois on oublie un peu que l’on lit un livre qui se classe dans les documentaires et non dans les romans. Même si, il faut le dire, l’écriture ne possède pas le rythme d’un roman, en même temps j’avoue m’être bien fait chier avec "L’île au trésor", comme quoi tout n’est pas qu’une question d’écriture…
Néanmoins malgré cela, la lecture -même si comme je l’ai dit on peut s’ennuyer par moment- reste agréable. Prendre connaissance des gens qui se sont fatigués pour rien, voir des hauts placés s’inquiétaient (un peu) sur ce petit groupe inoffensif au final, et savoir qu’en plus après d’autres sont parvenus à dompter cette nature, ce livre qui sonne comme une farce apporte le plaisir de la découverte. A lire avant tout par curiosité.
Je remercie en passant les éditions Flammarion et Babelio pour ce partenariat.
Lien : http://voyagelivresque.canal..
L'aventure d'une poignée de grognards de la Grande Armée après la chute de l'Empire de l'autre côté de l'Atlantique menée par Lallemand, un ancien général de Napoléon, tel est le sujet de cet ouvrage. Episode méconnu de l'Histoire, ce livre ravira très probablement les admirateurs et les passionnés de Napoléon Ier. On suit les errances d'un démiurge à la tête d'âmes bonapartistes perdues au milieu d'une colonie texane : le "champ d'asile". Le but : rebâtir un empire napoléonien pour porter secours à Bonaparte à Sainte-Hélène. Mais, l'aventure tourne court au milieu des pirates et des tribus amérindiennes...
La 4ème de couverture est prometteuse : on attend le souffle épique d'un roman historique. Il n'en est malheureusement rien. Il ne s'agit pas non plus d'un ouvrage historique mais plus d'un livre de vulgarisation manquant parfois de rythme alors que les ingrédients étaient réunis pour faire revivre cette triste épopée de ces derniers fidèles que l'Histoire a oubliés.
La 4ème de couverture est prometteuse : on attend le souffle épique d'un roman historique. Il n'en est malheureusement rien. Il ne s'agit pas non plus d'un ouvrage historique mais plus d'un livre de vulgarisation manquant parfois de rythme alors que les ingrédients étaient réunis pour faire revivre cette triste épopée de ces derniers fidèles que l'Histoire a oubliés.
Le triste épisode du Champs d'asile est de ceux que l'histoire a presque effacé. Il se résume en quelques mots : une poignée de grognards immigrés aux Etats Unis, rescapés de la restauration des Bourbons, s’installent au Texas fonder une colonie censée devenir le point d’ancrage d’un nouvel Empire napoléonien. L’aventure, ou plutôt le calvaire, tourne court et finie comme son principal instigateur, le général Charles Lallemand, dans le dénuement, misérable et oublié de tous. Napoléon, comme l’on sait, mourra à Sainte-Hélène.
Les auteurs ne cachent en rien le peu d’intérêt que revêt le champs d’asile : "Le Champs d'asile, beaucoup de bruit pour rien ? Un voyage avorté, une citée mort-née, des illusions laminées. Un échec lamentable, un épisode pathétique, un évènement au fond anodin. Risquons le mot : insignifiant".
Il faut donc bien du talent pour transformer un évènement insignifiant en récit de 262 pages qui intéresse le lecteur. Anne Boquel et Etienne Kern échouent malheureusement et ce pour plusieurs raisons.
Il y a tout d’abord un choix narratif peu judicieux. Ce n’est ni un roman historique, et contrairement à ce que promet la 4ème de couverture il ne se lit pas comme tel, ni un ouvrage historique malgré la qualité du travail de recherche. Là aussi les auteurs sont honnêtes avec le lecteur et assument leur parti pris l’expliquant longuement en post-scriptum. On ressent une certaine humilité d’ailleurs. Leur ouvrage serait un « non fiction narrative book ». Ils ne cherchent donc ni à faire du Champs d’asile une aventure de personnages romanesques (point de dialogues par exemple) ni à dresser la chronologie complète des faits historiques dans toute la rigueur de leurs sources. Ces dernières bien maigres n’auraient peut être pas suffit. C’est donc un entre-deux peu valorisant.
L’organisation du livre en 5 actes d’une tragédie n’aide pas. On comprend le fil conducteur mais il est un peu factice. Contrairement à la tragédie il n’y a point de fatalité dans le désastre du Champs d’asile. Le découpage en pas moins de 70 chapitres ne parvient pas non plus à donner du rythme à un récit ou rien ne se passe en réalité. Le style enfin s’enfle de mots, de réitérations, de répétitions, de transitions poussives. Certains y verront peut être du souffle, j’y trouve du remplissage.
En épilogue les auteurs tente de justifier leur sujet. Ils en dressent un enseignement universel sur la manipulation sectaire allant même jusqu’à faire le lien osé jusque Waco…Cela ne sauve pas l’ouvrage.
Alors, comme les grognards du Champs d’asile floués par Lallemand, le lecteur se sent lui aussi trompé par une promesse non tenue.
Les auteurs ne cachent en rien le peu d’intérêt que revêt le champs d’asile : "Le Champs d'asile, beaucoup de bruit pour rien ? Un voyage avorté, une citée mort-née, des illusions laminées. Un échec lamentable, un épisode pathétique, un évènement au fond anodin. Risquons le mot : insignifiant".
Il faut donc bien du talent pour transformer un évènement insignifiant en récit de 262 pages qui intéresse le lecteur. Anne Boquel et Etienne Kern échouent malheureusement et ce pour plusieurs raisons.
Il y a tout d’abord un choix narratif peu judicieux. Ce n’est ni un roman historique, et contrairement à ce que promet la 4ème de couverture il ne se lit pas comme tel, ni un ouvrage historique malgré la qualité du travail de recherche. Là aussi les auteurs sont honnêtes avec le lecteur et assument leur parti pris l’expliquant longuement en post-scriptum. On ressent une certaine humilité d’ailleurs. Leur ouvrage serait un « non fiction narrative book ». Ils ne cherchent donc ni à faire du Champs d’asile une aventure de personnages romanesques (point de dialogues par exemple) ni à dresser la chronologie complète des faits historiques dans toute la rigueur de leurs sources. Ces dernières bien maigres n’auraient peut être pas suffit. C’est donc un entre-deux peu valorisant.
L’organisation du livre en 5 actes d’une tragédie n’aide pas. On comprend le fil conducteur mais il est un peu factice. Contrairement à la tragédie il n’y a point de fatalité dans le désastre du Champs d’asile. Le découpage en pas moins de 70 chapitres ne parvient pas non plus à donner du rythme à un récit ou rien ne se passe en réalité. Le style enfin s’enfle de mots, de réitérations, de répétitions, de transitions poussives. Certains y verront peut être du souffle, j’y trouve du remplissage.
En épilogue les auteurs tente de justifier leur sujet. Ils en dressent un enseignement universel sur la manipulation sectaire allant même jusqu’à faire le lien osé jusque Waco…Cela ne sauve pas l’ouvrage.
Alors, comme les grognards du Champs d’asile floués par Lallemand, le lecteur se sent lui aussi trompé par une promesse non tenue.
Après une "Histoire des haines d’écrivains", Anne Boquel et Etienne Kern récidivent et poursuivent l’exploration de l’histoire littéraire anecdotique.
Dans cet ouvrage, ils relatent avec la même verve croustillante les réactions de parents d’écrivains du 19ème et du 20ème face à la vocation de leurs rejetons. Franche hostilité, rejet total, reconnaissance absolue, admiration sans vergogne ou bien hantise d’une déchéance sociale, ces hommes et femmes de lettres en herbe déclinent chez leurs ascendants tout un panel de sentiments qui n’ont pas fini de faire couler de l’encre.
Enquête sociologique, récit de vie intimiste, Anne Boquel et Etienne Kern ont puisé leurs sources dans les correspondances et les journaux pour nous permettre d’entrer par la petite porte dans l’histoire de la grande littérature.
(Karine)
Dans cet ouvrage, ils relatent avec la même verve croustillante les réactions de parents d’écrivains du 19ème et du 20ème face à la vocation de leurs rejetons. Franche hostilité, rejet total, reconnaissance absolue, admiration sans vergogne ou bien hantise d’une déchéance sociale, ces hommes et femmes de lettres en herbe déclinent chez leurs ascendants tout un panel de sentiments qui n’ont pas fini de faire couler de l’encre.
Enquête sociologique, récit de vie intimiste, Anne Boquel et Etienne Kern ont puisé leurs sources dans les correspondances et les journaux pour nous permettre d’entrer par la petite porte dans l’histoire de la grande littérature.
(Karine)
Après avoir lu et adoré "Une histoire des haines d'écrivains", je ne pouvais que me précipiter pour lire ce livre qui est, on peut le dire d'emblée, tout aussi génial. Car, on s'en doute un peu, les parents ont une influence énorme sur leur rejeton, qu'il soit écrivain ou autre. Dans le cas présent, il est curieux voire délectable de constater que les réactions quant à la vocation de leur fils, fille sont on ne peut plus contrastées. Entre les parents de Robbe-Grillet qui jubilent des publications de leur fils et les parents de Lamartine ou Baudelaire qui, au contraire sont déçus du choix de carrière de leur fils, il y a un monde. En effet, choisir d'être écrivain n'est pas anodin surtout pour des parents espérant un salaire assuré dans des métiers plus convenables, plus établis aux yeux de la société.
Outre les réactions épidermiques de ces parents tourmentées, il y a ceux qui collent à la trace à la réputation faite dans les livres comme la mère de Jules Renard avec qui les relations sont tendues comme il l'exprime dans Poil de carotte. Et encore plus poussé, il y a Hervé Bazin dont la mère semble bien être une Folcoche des plus détestables. Par ailleurs, il y a aussi des parents qui lisent avec attention toutes les œuvres parues et qui s'offusquent lorsque la fiction ne rejoint pas la réalité. Ainsi, la mère de Sartre nie l'enfance telle qu'elle est racontée dans Les mots.
D'un autre point de vue, j'ai adoré la réaction de Madame de Lamartine (encore elle) à la lecture de ses vers :
Déjà l'herbe qui croît sur les dalles antiques
Efface autour des murs les sentiers domestiques
Et le lierre flottant comme un manteau de deuil,
Couvre à demi la porte et rampe sur le seuil.
Où celui-ci est-il allé pêcher l'idée du lierre? Pour ne pas laisser courir les commérages sur l'infidélité à la réalité, Madame de Lamartine décide donc de planter du lierre. C'est assez touchant de prêter tant de crédit aux mots !
Tout au long de cet essai, on constate que les écrivains ne sont pas égaux devant la littérature ni surtout devant leurs géniteurs. Tandis que certains sont soutenus (ainsi de Pierre Verne qui peu à peu laisse sa chance à Jules et le corrige même dans ses innombrables fautes d'orthographe), d'autres suscitent l'indifférence (comme la mère d'Apollinaire qui disait que "rien [ne la poussait] à s'intéresser à la littérature, surtout à la[si]ienne") voire l'hostilité pure et dure.
J'ai appris beaucoup de choses avec ce livre et ai trouvé particulièrement instructives les notices biographiques, en fin de livre, qui donnent un autre éclairage sur l'écrivain engendré ainsi que sur ses œuvres. En effet, ces repères concrets m'ont permis de mieux cerner le contexte dans lequel évoluent ces écrivains de tout temps mais tous influencés par une famille omniprésente.
Outre les réactions épidermiques de ces parents tourmentées, il y a ceux qui collent à la trace à la réputation faite dans les livres comme la mère de Jules Renard avec qui les relations sont tendues comme il l'exprime dans Poil de carotte. Et encore plus poussé, il y a Hervé Bazin dont la mère semble bien être une Folcoche des plus détestables. Par ailleurs, il y a aussi des parents qui lisent avec attention toutes les œuvres parues et qui s'offusquent lorsque la fiction ne rejoint pas la réalité. Ainsi, la mère de Sartre nie l'enfance telle qu'elle est racontée dans Les mots.
D'un autre point de vue, j'ai adoré la réaction de Madame de Lamartine (encore elle) à la lecture de ses vers :
Déjà l'herbe qui croît sur les dalles antiques
Efface autour des murs les sentiers domestiques
Et le lierre flottant comme un manteau de deuil,
Couvre à demi la porte et rampe sur le seuil.
Où celui-ci est-il allé pêcher l'idée du lierre? Pour ne pas laisser courir les commérages sur l'infidélité à la réalité, Madame de Lamartine décide donc de planter du lierre. C'est assez touchant de prêter tant de crédit aux mots !
Tout au long de cet essai, on constate que les écrivains ne sont pas égaux devant la littérature ni surtout devant leurs géniteurs. Tandis que certains sont soutenus (ainsi de Pierre Verne qui peu à peu laisse sa chance à Jules et le corrige même dans ses innombrables fautes d'orthographe), d'autres suscitent l'indifférence (comme la mère d'Apollinaire qui disait que "rien [ne la poussait] à s'intéresser à la littérature, surtout à la[si]ienne") voire l'hostilité pure et dure.
J'ai appris beaucoup de choses avec ce livre et ai trouvé particulièrement instructives les notices biographiques, en fin de livre, qui donnent un autre éclairage sur l'écrivain engendré ainsi que sur ses œuvres. En effet, ces repères concrets m'ont permis de mieux cerner le contexte dans lequel évoluent ces écrivains de tout temps mais tous influencés par une famille omniprésente.
Affaire de goût : j'aurais préféré une biographie auteur par auteur, car, à la fin de la lecture, le lecteur se voit mélanger les anecdotes et ne plus savoir à qui elles font références. Les recherches sont tout de même bien menées et on apprend beaucoup pour un ouvrage de vulgarisation qui s'attache à aborder ce thème sous un angle léger et non trop universitaire.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur
Auteurs proches de Anne Boquel
Lecteurs de Anne Boquel (182)Voir plus
Quiz
Voir plus
Quiz sur des classiques connus
Victor Hugo:
Atlantide
Notre-Dame de Paris
La mer rouge
20 questions
12861 lecteurs ont répondu
Créer un quiz sur cet auteur12861 lecteurs ont répondu