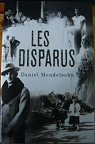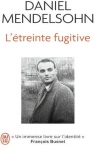Citations de Daniel Adam Mendelsohn (214)
Pour le bénéfice de qui, exactement, suis-je en train de chercher désespérément cette totalité ? Les morts n'ont pas besoin d'histoires ; c'est le fantasme des vivants qui, à la différence des morts, se sentent coupables. Même s'ils avaient besoin d'histoires complètes, mes morts, Shmiel, Ester et les filles, avaient certainement plus d'une histoire à présent et s'étaient enrichis de bien plus de détails que quiconque aurait pu l'imaginer, ne serait-ce qu'il y a deux ans ; sans doute cela comptait-il pour quelque chose, à supposer, comme le pensent certains, que les morts ont besoin d'être apaisés. Mais, bien entendu, je ne le crois pas : les morts reposent dans leurs tombes, dans les cimetières ou les forêts ou les fossés au bord des routes, et tout cela ne présente aucun intérêt pour eux, dans la mesure où ils n'ont plus désormais d'intérêt pour rien. C'est bien nous les vivants, qui avons besoin des détails, des histoires, parce que ce dont les morts ne se soucient plus, les simples fragments, une image qui ne sera jamais complète, rendra fous les vivants.
p. 519 - 520
p. 519 - 520
Moi-même, j'ai donné tout à l'Holocaust Museum de Washington, je n'ai presque plus un original. Vous savez, je pense... je pense, quelle était la raison pour ma survie, c'était quoi? Pourquoi des gens plus âgés que moi, plus intelligents que moi, mieux éduqués que moi n'ont pas survécu, mais moi je survis? (...) "Je pense qu'il y a deux raisons : la première, c'est pour prendre ma revanche. Et la seconde, c'est pour dire, pour dire à qui veut bien entendre l'histoire de ce qui s'est passé.
Pendant des années, j'ai cru que cette vie n'était pas la vraie vie - que j'allais lever les yeux et que ma famille serait là. Je ne voulais pas faire naître des enfants dans ce monde. Le grand changement s'est produit, je pense, quand j'ai fait le voyage en 96 à Bolechow. Quand j'ai vu que rien, rien n'était resté, ni nos maisons ni rien de nos tanneries, rien n'était resté, même du jardin avec le bassin... Ok j'ai pensé, c'est ça : je ne peux pas retourner. le passé ne peut pas revenir. Je dois l'admettre. Alors j'ai commencé à écrire.
Pendant des années, j'ai cru que cette vie n'était pas la vraie vie - que j'allais lever les yeux et que ma famille serait là. Je ne voulais pas faire naître des enfants dans ce monde. Le grand changement s'est produit, je pense, quand j'ai fait le voyage en 96 à Bolechow. Quand j'ai vu que rien, rien n'était resté, ni nos maisons ni rien de nos tanneries, rien n'était resté, même du jardin avec le bassin... Ok j'ai pensé, c'est ça : je ne peux pas retourner. le passé ne peut pas revenir. Je dois l'admettre. Alors j'ai commencé à écrire.
C'était pendant que j'étais en train de penser à cette histoire d'imagination, d'extraction d'une histoire à partir de la chose la plus petite, la plus concrète que je me suis aperçu que Malcia et Shlomo, après notre énorme déjeuner, se souvenaient de certains aliments qu'ils avaient l'habitude de manger autrefois et que de moins en moins de gens savaient cuisiner. Ah, bulbowenik ! s'est exclamé Shlomo, Shumek faisait rouler ses yeux en signe d'approbation et les deux autres se lançaient dans une explication pour que je comprenne ce que c'était : un plat de pommes de terre râpées et d'œufs cuits au four et...
Attentez ! s'est exclamée Malcia. Je crois qu'elle était soulagée de ne plus avoir à parler du passé, après tout ce temps. Restez encore un petit moment et je vais vous en faire !
[...] Je me suis dit, pourquoi pas ? Ca aussi, ça fait partie de l'histoire. Et après tout, ce n'était pas arrivé si souvent qu'un aspect un peu abstrait de la civilisation perdue de Bolechow fût rendu aussi facilement concret. J'ai souri et hoché la tête. Ok, ai-je dit, faisons la cuisine.
Malcia m'a emmené dans la cuisine pour que je puisse la regarder faire. Nous avons râpé des pommes de terre, nous avons battu des œufs, nous avons tout mis dans un plat à gratin. Nous avons laissé cuire pendant quarante-cinq minutes. Nous l'avons sorti du four pour le laisser refroidir. Une fois le plat refroidi, je me suis dit que nous venions de faire un énorme repas, avec beaucoup de vin ; je m'attendais à faire un énorme repas pour le dîner.
Toutefois, j'avais été élevé dans un certain type de famille et je savais quoi faire. Je me suis assis à la table et j'ai mangé. C'était délicieux. Malcia était aux anges. C'est un vrai plat de Bolechow ! a-t-elle dit.
Ce n'est qu'après nous être resservis que nous avons pu nous lever pour partir.
Attentez ! s'est exclamée Malcia. Je crois qu'elle était soulagée de ne plus avoir à parler du passé, après tout ce temps. Restez encore un petit moment et je vais vous en faire !
[...] Je me suis dit, pourquoi pas ? Ca aussi, ça fait partie de l'histoire. Et après tout, ce n'était pas arrivé si souvent qu'un aspect un peu abstrait de la civilisation perdue de Bolechow fût rendu aussi facilement concret. J'ai souri et hoché la tête. Ok, ai-je dit, faisons la cuisine.
Malcia m'a emmené dans la cuisine pour que je puisse la regarder faire. Nous avons râpé des pommes de terre, nous avons battu des œufs, nous avons tout mis dans un plat à gratin. Nous avons laissé cuire pendant quarante-cinq minutes. Nous l'avons sorti du four pour le laisser refroidir. Une fois le plat refroidi, je me suis dit que nous venions de faire un énorme repas, avec beaucoup de vin ; je m'attendais à faire un énorme repas pour le dîner.
Toutefois, j'avais été élevé dans un certain type de famille et je savais quoi faire. Je me suis assis à la table et j'ai mangé. C'était délicieux. Malcia était aux anges. C'est un vrai plat de Bolechow ! a-t-elle dit.
Ce n'est qu'après nous être resservis que nous avons pu nous lever pour partir.
... les morts reposent dans leurs tombes, dans les cimetières ou les forêts ou les fossés au bord des routes, et tout cela ne présente aucun intérêt pour eux, dans la mesure où ils n'ont plus désormais d'intérêt pour rien. C'est bien nous, les vivants, qui avons besoin des détails, des histoires, parce que ce dont les morts ne se soucient plus, les simples fragments, une image qui ne sera jamais complète, rendra fous les vivants. Littéralement fous.
J’étais surtout captivé par les temps des verbes, avec leurs incroyables métastases, les changements de temps signalés par des préfixes qui s’agrégeaient comme des cristaux, par des suffixes qui perlaient à la fin des mots, comme du miel gouttant d’une cuillère sur une soucoupe.
paideu-ô j’éduque
e-paideu-on j’éduquais
paideu-s-ô j’éduquerai
e-paideu-sa j’éduquai
pe-paideu-ka j’ai éduqué
e-pe-paideu-ka j’avais éduqué
Je trouvais merveilleux que par de minuscules ajouts de part et d’autre du radical, -paideu-, l’on puisse faire de tels bonds dans le temps : le présent, se métamorphosant à la faveur d’un simple e au début du mot, pour glisser vers le passé flou de l’imparfait, ou, tout aussi facilement, s’insinuant vers l’avenir par l’imbrication d’un sigma, s, entre le radical et la terminaison personnelle ;
paideu-ô j’éduque
e-paideu-on j’éduquais
paideu-s-ô j’éduquerai
e-paideu-sa j’éduquai
pe-paideu-ka j’ai éduqué
e-pe-paideu-ka j’avais éduqué
Je trouvais merveilleux que par de minuscules ajouts de part et d’autre du radical, -paideu-, l’on puisse faire de tels bonds dans le temps : le présent, se métamorphosant à la faveur d’un simple e au début du mot, pour glisser vers le passé flou de l’imparfait, ou, tout aussi facilement, s’insinuant vers l’avenir par l’imbrication d’un sigma, s, entre le radical et la terminaison personnelle ;
Je ne croyais pas et je ne crois toujours pas que les morts, que Shmiel et Frydka, morts depuis longtemps et désintégrés, se sont penchés depuis l'éther et nous ont dirigés, ce jour, vers Bolekhiv puis vers Stepan et Prokopiv, et la maison, le trou dans la terre et l'horrible boîte, où ils s'étaient autrefois accroupis dans le froid et avaient finalement échoué dans leur tentative de survie.(...) je croyais et je crois encore, après tout ce que nous avons vu et fait, que si vous vous projetez dans la masse des choses, si vous cherchez, vous trouverez quelque chose, même quelque chose de petit, quelque chose de plus que si vous n'aviez rien cher pour commencer, que si vous n'aviez pas posé la moindre question à votre grand-père.
... l’Holocauste avait été tellement important, l’échelle avait été tellement gigantesque, tellement énorme, qu’il était facile d’y penser comme à quelque chose de mécanique. D’anonyme. Mais tout ce qui s’était passé s’était passé parce que quelqu’un avait pris une décision. Appuyer sur une gâchette, déclencher un commutateur, fermer la porte d’un fourgon à bestiaux, cacher, trahir. (p. 865)
Ce que je sais à présent, c’est ceci: il y a tant de choses que vous ne voyez pas vraiment, préoccupé comme vous l’êtes de vivre tout simplement; tant de choses que vous ne remarquez pas, jusqu’au moment où, pour une raison quelconque - vous ressemblez à quelqu’un qui est mort depuis longtemps; vous décidez tout à coup qu’il est important de faire savoir à vos enfants d’où ils viennent - vous avez besoin de l’information que les gens que vous connaissiez autrefois devaient toujours vous donner, si seulement vous l’aviez demandée. Mais au moment où vous pensez à le faire, il est trop tard. (p. 141)
Si elle ( L'Odyssée) est bien une histoire de maris et de femmes, cette épopée est tout autant, sinon plus, une histoire de pères et de fils. (p. 39)
Etre en vie, c'est avoir une histoire à raconter. Etre en vie, c'est précisément être le héros, le centre de l'histoire de toute une vie. Lorsque vous n'êtes rien de plus qu'un personnage mineur dans l'histoire d'un autre, cela signifie que vous êtes véritablement mort.
Nous sommes, chacun de nous, myopes, ai-je compris à cet instant-là; toujours au centre de nos propres histoires.
; il me vient à l'esprit que la différence entre Abraham et Ulysse, c'est la différence entre une émigration dangereuse et terrifiante et un retour vers le foyer qu'on connaît déjà. Quelles qu'en soient les raisons, en tout cas, l'Odyssée souligne quelque chose que Lech Lecha traite avec indifférence : il y a une autre récompense, plus grande encore, obtenue dans le fait de voyager à travers le monde et d'observer de nouveaux pays, de nouvelles cultures, de nouvelles civilisations, d'entrer en contact pour la première fois avec différentes sortes de peuples et de coutumes : la connaissance. La connaissance, par conséquent, est une autre bénédiction qui augmente avec les distances que vous franchissez.
Ou parfois non. Quiconque a beaucoup voyagé sait que, même si vous croyez savoir ce que vous cherchez et où vous allez quand vous décidez de partir, ce que vous apprenez en route est souvent tout à fait surprenant.
Ou parfois non. Quiconque a beaucoup voyagé sait que, même si vous croyez savoir ce que vous cherchez et où vous allez quand vous décidez de partir, ce que vous apprenez en route est souvent tout à fait surprenant.
La route que nous avions empruntée pour aller de l'appartement de Nina à la maison d'Olga, nous l'avons découvert par la suite, était la route qui conduit du centre de la ville au cimetière, en passant par la vieille scierie. Maintenant que nous marchions sur cette route et avant que Maria ne nous quitte, nous lui avons demandé comment les Juifs et les Ukrainiens s'entendaient avant la guerre. Nous avions, bien entendu, fait nos recherches et nous savions donc déjà tout concernant les siècles de compétition économique et sociale entre Juifs et Ukrainiens : les Juifs, sans nation, politiquement vulnérables, dépendants des aristocrates polonais qui étaient propriétaires de ces villes et pour qui les Juifs, afin d'assurer leur sécurité, travaillaient comme intendants, tout en leur prêtant de l'argent ; les Ukrainiens qui, pour la plupart, travaillaient la terre, qui se situaient au niveau le plus bas du totem économique, un peuple dont l'histoire, ironiquement, était à bien des égards comme une image dans un miroir, ou peut-être comme un négatif photographique, de celle des juifs : un peuple sans État-nation, vulnérable, oppressé par des maîtres cruels du même acabit – comtes polonais ou commissaires soviétiques. C'était en raison de cet étrange effet de miroir que, précisément, les choses avaient évolué, vers le milieu du XX° siècle, selon la terrible logique d'une tragédie grecque, de la manière suivante : ce qui était bon pour un de ces deux groupes, qui vivaient côte à côte dans ces villes minuscules depuis des siècles, était mauvais pour l'autre. Lorsque les Allemands, en 1939, avaient cédé la partie orientale de la Pologne (qu'ils venaient de conquérir) à l'Union soviétique au titre du pacte germano-soviétique, les Juifs de la région s'étaient réjouis, sachant qu'ils venaient d'être délivrés des Allemands ; mais les Ukrainiens, peuple farouchement nationaliste et fier, avaient souffert sous les Soviétiques, qui étaient alors décidés à écraser l'indépendance ukrainienne et les Ukrainiens. Parlez aux Ukrainiens du XX° siècle, comme nous l'avons souvent fait au cours de ce voyage, et ils évoquent leur holocauste à eux, la mort, dans les années 1930, de cinq à sept millions de paysans ukrainiens, affamés par la collectivisation forcée de Staline… la bonne chance miraculeuse des Juifs de Pologne orientale, en 1939, a donc été un désastre pour les Ukrainiens de la même Pologne orientale. À l'inverse, lorsqu'Hitler a trahi, deux ans plus tard, le pacte germano-soviétique et envahi la partie de la Pologne qu'il avait donnée à Staline, cela a constitué, évidemment un désastre pour les Juifs, mais une bénédiction pour les Ukrainiens, lesquels se sont réjouis de l'arrivée des nazis qui les libéraient de leurs oppresseurs soviétiques. Il est remarquable de penser que les deux groupes qui ont vécu dans une telle proximité pendant tant d'années aient pu être à ce point différents, souffrir et exulter de revers de fortune à ce point différents et même opposés.
p. 156 - 157
p. 156 - 157
Un livre fort, la quête d’un juif Américain pour retrouver son grand-oncle, sa femme et leur quatre filles tués en 1941, pour retrouver leur histoire et ainsi la sienne, celle de sa famille, pour éclairer tous ces non-dits de vérité de LA VERITE. Pour redonner à ces morts une identité, les faire vivre à nouveau, pour ne pas les oublier, pour pouvoir mettre sur ces vielles photos : un nom, un passé…Il y a eu tant de livres écrits sur cette période que vous allez vous dire : « un de plus », oui mais là c’est la petite histoire dans un petit village inconnu, à l’est de la Pologne où des atrocités ont été commises ignoré du reste du monde, ce sont toutes les petites histoires comme celle-ci qui ont fait la grande. Un TRES beau livre, une immersion dans l’histoire pour ne jamais oublier.
Le garçon, l’adulte, l’ancêtre ; les trois âges de « l’homme ». Ce qui revient à dire que, parmi les voyages que retrace ce poème, il y a aussi le voyage d’un homme d’un bout à l’autre de la vie, de la naissance à la mort.
Par un soir de janvier, il y a quelques années, juste avant le début du semestre de printemps au cours duquel je devais enseigner un séminaire de licence 1 sur l’Odyssée, mon père, chercheur scientifique à la retraite alors âgé de quatre-vingt-un ans, m’a demandé, pour des raisons que je pensais comprendre à l’époque, s’il pouvait assister à mon cours, et j’ai dit oui. Ainsi, pendant les seize semaines qui suivirent, il fit une fois par semaine le long trajet entre le pavillon de la banlieue de Long Island dans lequel j’ai grandi, une modeste maison à un étage où il vivait encore avec ma mère, et le campus en bordure de fleuve de la petite université où j’enseigne, qui s’appelle Bard College. Chaque vendredi matin à dix heures et demie, il prenait place parmi les étudiants de première année, des gamins de dix-sept ou dix-huit ans qui n’avaient pas le quart de son âge, et participait aux discussions sur ce vieux poème, une épopée où il est question de longs voyages et de longs mariages et de ce que peut signifier le mal du pays.
(INCIPIT)
(INCIPIT)
Ce n'est pas un hasard si le personnage de Aue que nous rencontrons au début du roman, au moment où, âgé, il commence à coucher sur le papier ses immenses souvenirs, mène exactement ce genre de vie : il est tranquille mais vide, il est désespéré, seul, et surtout s'ennuie énormément.
Les passages que j'ai cité ci-dessus montrent clairement que Blanchot, loin de désapprouver la pièce de Sartre, comme le suggère Aue dans sa brève référence à cet essai, l'admirait : et de fait, il commence son essai par un vibrant éloge de cette pièce « d'une valeur et d'une signification exceptionnelles ». Où donc est le « jugement sévère » de Blanchot dont parle Aue ?
La réponse à cette question permet de comprendre pourquoi le livre de Littell bascule dans la « pornographie » qui a choqué tant de critiques et de lecteurs. Car, ayant exposé sa théorie sur Les Mouches comme l'étude d'un homme qui a décidé de « porter atteinte au sacré», Blanchot fait remarquer que, pour que la pièce fonctionne, la « valeur sacrilège » doit être excessive, écrasante; et il craint que :
« cette impression de sacrilège [fasse] parfois défaut à la pièce qu'elle devrait soutenir. [... ] [Sartre] n'a-t-il pas poussé assez loin l'abjection qu'il dépeint? [...] À la grandeur d'Oreste, il manque d'être impie contre une piété véritable. »
Ainsi, au lieu d'utiliser simplement (et naïvement) les détails crus de violence et de sexe comme moyen facile de choquer son lecteur, Littell évoque sciemment la violence, et même la « pornographie de la violence », avec tout ce que cela comporte de détails baroques cauchemardesques, pour renforcer cette «impression de sacrilège» - non pas pour tenter de défendre Aue car il est en dehors de la moralité, mais pour nous faire ressentir par les cinq sens toute l'horreur d'une vie affranchie de toute morale. Le matériel « pornographique » n'est pas un symbole creux de la malfaisance de Max (ce qui ne serait tout au mieux qu'une lecture puritaine) : c'est plutôt Littell qui achève la tâche de Sartre, en « poussant assez loin l'abjection », en s'évertuant à montrer « l'impiété contre une piété véritable» - la « piété», dans ce cas précis, étant nos pruderies et attentes conventionnelles de ce que devrait être un roman sur les nazis.
En ce sens, Les Bienveillantes s'inscrit directement dans la tradition d'une « littérature de la transgression», et notamment dans la lignée française qui remonte au marquis de Sade et au comte de Lautréamont, et va jusqu'à Octave Mirbeau et Georges Bataille. L’influence de Bataille est flagrante dans les fantasmes sexuels complexes, dans les thèmes des rapports sexuels entre les frère et soeur adolescents, de la coprophilie et de l'inceste, et on reconnaît en particulier un renvoi à son oeuvre emblématique, Histoire de l'oeil, où un oeil violemment arraché devient un fétiche sexuel utilisé avec beaucoup d'inventivité, et à laquelle Littell semble faire allusion plus d'une fois dans les passages décrivant des yeux arrachés de têtes écrasées ou explosées. Littell pourrait, à mon avis, dire que c'est précisément pour réveiller notre sensibilité émoussée face aux représentations de l'ignominie nazie dans la littérature et au cinéma qu'il se devait de briser de nouveaux tabous afin de nous faire réfléchir sur le mal, sur une vie vouée au mal et sur un esprit disposé à, voire impatient d'accepter les conséquences de ce choix.
Le côté « kitsch» est donc inhérent aux visées moralisatrices du roman. Et pourtant, comme je l'ai expliqué, son efficacité sape la réussite de son autre grande composante, l'élément historico documentaire; soit Aue est un frère humain avec lequel nous pouvons ressentir une certaine affinité (et en cela je veux dire accepter qu'il ne soit pas tout bonnement « inhumain »), soit c'est un pervers sexuel, coprophage, matricide et incestueux; en tout état de cause, on ne peut pas avoir le Butterkuchen et l'argent du Butterkuchen. Ce qui ne signifie pas pour autant que l'objectif de l'un ou l'autre des éléments soit déplacé ou illégitime,comme ont pu l'avancer certains critiques: je ne le pense pas. (Mon seul grand reproche, étant donné la morale « grecque» de Aue, à sa détermination à assumer la responsabilité de ses actes, est que le matricide et le meurtre sont commis par un Aue qui se trouve dans une sorte d'état second, il n'est pas conscient de ce qu'il fait, ce qui ressemble fort à une pirouette caractérisée.) Mais c'est précisément parce que chaque élément fonctionne si bien en soi que le roman dans son ensemble est bancal.
Pourtant, malgré ce sérieux écueil, Les Bienveillantes rappelle le jugement de Blanchot - que Maximilien Aue approuve avec enthousiasme et, comme on ne peut s'empêcher de le penser avec éloquence - sur un autre colossal roman hybride, Moby Dick : «Ce livre impossible qui avait marqué un moment de ma jeunesse, de cet équivalent écrit de l’univers, mystérieusement, comme d'une oeuvre qui garde le caractère ironique d'une énigme et ne se révèle que par l'interrogation qu'elle propose. »
Comme continuent de nous le rappeler d'autres Bienveillantes- celles d'Eschyle -, il existe d'étranges créatures de fiction, des hybrides improbables, dont les deux faces semblent ne pas avoir beaucoup en commun et qui, même si nous avons peu de chance de les rencontrer dans la nature, peuvent nous donner des cauchemars qui continueront de nous hanter longtemps après le tomber du rideau.
Les passages que j'ai cité ci-dessus montrent clairement que Blanchot, loin de désapprouver la pièce de Sartre, comme le suggère Aue dans sa brève référence à cet essai, l'admirait : et de fait, il commence son essai par un vibrant éloge de cette pièce « d'une valeur et d'une signification exceptionnelles ». Où donc est le « jugement sévère » de Blanchot dont parle Aue ?
La réponse à cette question permet de comprendre pourquoi le livre de Littell bascule dans la « pornographie » qui a choqué tant de critiques et de lecteurs. Car, ayant exposé sa théorie sur Les Mouches comme l'étude d'un homme qui a décidé de « porter atteinte au sacré», Blanchot fait remarquer que, pour que la pièce fonctionne, la « valeur sacrilège » doit être excessive, écrasante; et il craint que :
« cette impression de sacrilège [fasse] parfois défaut à la pièce qu'elle devrait soutenir. [... ] [Sartre] n'a-t-il pas poussé assez loin l'abjection qu'il dépeint? [...] À la grandeur d'Oreste, il manque d'être impie contre une piété véritable. »
Ainsi, au lieu d'utiliser simplement (et naïvement) les détails crus de violence et de sexe comme moyen facile de choquer son lecteur, Littell évoque sciemment la violence, et même la « pornographie de la violence », avec tout ce que cela comporte de détails baroques cauchemardesques, pour renforcer cette «impression de sacrilège» - non pas pour tenter de défendre Aue car il est en dehors de la moralité, mais pour nous faire ressentir par les cinq sens toute l'horreur d'une vie affranchie de toute morale. Le matériel « pornographique » n'est pas un symbole creux de la malfaisance de Max (ce qui ne serait tout au mieux qu'une lecture puritaine) : c'est plutôt Littell qui achève la tâche de Sartre, en « poussant assez loin l'abjection », en s'évertuant à montrer « l'impiété contre une piété véritable» - la « piété», dans ce cas précis, étant nos pruderies et attentes conventionnelles de ce que devrait être un roman sur les nazis.
En ce sens, Les Bienveillantes s'inscrit directement dans la tradition d'une « littérature de la transgression», et notamment dans la lignée française qui remonte au marquis de Sade et au comte de Lautréamont, et va jusqu'à Octave Mirbeau et Georges Bataille. L’influence de Bataille est flagrante dans les fantasmes sexuels complexes, dans les thèmes des rapports sexuels entre les frère et soeur adolescents, de la coprophilie et de l'inceste, et on reconnaît en particulier un renvoi à son oeuvre emblématique, Histoire de l'oeil, où un oeil violemment arraché devient un fétiche sexuel utilisé avec beaucoup d'inventivité, et à laquelle Littell semble faire allusion plus d'une fois dans les passages décrivant des yeux arrachés de têtes écrasées ou explosées. Littell pourrait, à mon avis, dire que c'est précisément pour réveiller notre sensibilité émoussée face aux représentations de l'ignominie nazie dans la littérature et au cinéma qu'il se devait de briser de nouveaux tabous afin de nous faire réfléchir sur le mal, sur une vie vouée au mal et sur un esprit disposé à, voire impatient d'accepter les conséquences de ce choix.
Le côté « kitsch» est donc inhérent aux visées moralisatrices du roman. Et pourtant, comme je l'ai expliqué, son efficacité sape la réussite de son autre grande composante, l'élément historico documentaire; soit Aue est un frère humain avec lequel nous pouvons ressentir une certaine affinité (et en cela je veux dire accepter qu'il ne soit pas tout bonnement « inhumain »), soit c'est un pervers sexuel, coprophage, matricide et incestueux; en tout état de cause, on ne peut pas avoir le Butterkuchen et l'argent du Butterkuchen. Ce qui ne signifie pas pour autant que l'objectif de l'un ou l'autre des éléments soit déplacé ou illégitime,comme ont pu l'avancer certains critiques: je ne le pense pas. (Mon seul grand reproche, étant donné la morale « grecque» de Aue, à sa détermination à assumer la responsabilité de ses actes, est que le matricide et le meurtre sont commis par un Aue qui se trouve dans une sorte d'état second, il n'est pas conscient de ce qu'il fait, ce qui ressemble fort à une pirouette caractérisée.) Mais c'est précisément parce que chaque élément fonctionne si bien en soi que le roman dans son ensemble est bancal.
Pourtant, malgré ce sérieux écueil, Les Bienveillantes rappelle le jugement de Blanchot - que Maximilien Aue approuve avec enthousiasme et, comme on ne peut s'empêcher de le penser avec éloquence - sur un autre colossal roman hybride, Moby Dick : «Ce livre impossible qui avait marqué un moment de ma jeunesse, de cet équivalent écrit de l’univers, mystérieusement, comme d'une oeuvre qui garde le caractère ironique d'une énigme et ne se révèle que par l'interrogation qu'elle propose. »
Comme continuent de nous le rappeler d'autres Bienveillantes- celles d'Eschyle -, il existe d'étranges créatures de fiction, des hybrides improbables, dont les deux faces semblent ne pas avoir beaucoup en commun et qui, même si nous avons peu de chance de les rencontrer dans la nature, peuvent nous donner des cauchemars qui continueront de nous hanter longtemps après le tomber du rideau.
Comme de nombreux athées, je compense par la superstition et je crois au pouvoir des prénoms.
Etre en vie, c'est avoir une histoire à raconter. Etre en vie c'est précisément être le héros, le centre de l'histoire de toute une vie. Lorsque vous n'êtes rien de plus qu'une personne mineure dans l'histoire d'un autre, cela signifie que vous êtes mort.
Mon père aimait connaître les choses et ma mère aimait organiser les choses, et c'est peut-être pourquoi j'ai découvert en moi, à un âge précoce, un plaisir intense à organiser la connaissance. (…) C'était, je m'en aperçois aujourd'hui, la première expression d'une impulsion qui, en définitive, est la même que celle qui pousse quelqu'un à écrire — imposer un ordre au chaos des faits en les assemblant dans une histoire qui a un commencement, un milieu et une fin.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur
Auteurs proches de Daniel Adam Mendelsohn
Lecteurs de Daniel Adam Mendelsohn (1809)Voir plus
Quiz
Voir plus
Les Traîtres
Ephialtès ou Éphialte de Trachis, fils d'Eurydémos, est un Grec qui dévoila à Xerxès Ier:
la recette des spanakopitas
le sentier par lequel les Perses pouvaient prendre à revers les Spartiates du roi Léonidas Ier à la bataille des Thermopyles
la position des trières grecques dans la baie de Nauplie
8 questions
26 lecteurs ont répondu
Thèmes :
traîtres
, trahison
, trahison amoureuse
, histoire
, littérature
, culture générale
, cinemaCréer un quiz sur cet auteur26 lecteurs ont répondu