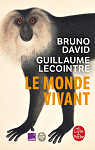Nationalité : France
Né(e) le : 28/02/1964
Ajouter des informations
Né(e) le : 28/02/1964
Biographie :
Guillaume Lecointre travaille au Muséum National d'Histoire Naturelle depuis 1988. Assistant, puis maître de conférences au Laboratoire d'Ichtyologie générale et appliquée, il est maintenant professeur au Département 'Systématique et évolution'. Sa spécialité : chercheur en systématique.
Sa recherche, telle qu’il la définit lui-même, « concerne les relations évolutives entre les êtres vivants. En d’autres termes, elle consiste à préciser, dans le 'grand arbre de la vie', les relations d’apparentement entre les espèces. Elle est divisée en deux parties. La première partie consiste à s’assurer que l’on ne se trompe pas lorsqu’on recherche « qui est plus proche de qui » entre les espèces ; c’est-à-dire lorsque l’on construit la phylogénie. La seconde partie consiste à appliquer ce travail aux 'poissons modernes', les téléostéens, dont le nombre d’espèces (25 000) constitue la moitié des espèces de vertébrés vivant aujourd’hui. »
+ Voir plusGuillaume Lecointre travaille au Muséum National d'Histoire Naturelle depuis 1988. Assistant, puis maître de conférences au Laboratoire d'Ichtyologie générale et appliquée, il est maintenant professeur au Département 'Systématique et évolution'. Sa spécialité : chercheur en systématique.
Sa recherche, telle qu’il la définit lui-même, « concerne les relations évolutives entre les êtres vivants. En d’autres termes, elle consiste à préciser, dans le 'grand arbre de la vie', les relations d’apparentement entre les espèces. Elle est divisée en deux parties. La première partie consiste à s’assurer que l’on ne se trompe pas lorsqu’on recherche « qui est plus proche de qui » entre les espèces ; c’est-à-dire lorsque l’on construit la phylogénie. La seconde partie consiste à appliquer ce travail aux 'poissons modernes', les téléostéens, dont le nombre d’espèces (25 000) constitue la moitié des espèces de vertébrés vivant aujourd’hui. »
Ajouter des informations
étiquettes
Videos et interviews (11)
Voir plusAjouter une vidéo
FESTIVAL DES UTOPIALES 2023 La science vise à établir une lecture cohérente du monde. Mais une nouvelle théorie scientifique provient souvent d'un pas de côté tel Einstein et sa théorie de la gravitation, réalisant qu'une personne en chute libre ne sentira plus son poids. La science-fiction déclenche des mécanismes cognitifs visant à reconstituer un monde cohérent. La SF serait-elle la continuation de la science ? Modérateur : François Bontems Les intervenants : Estelle Blanquet, Sylvie Lainé, Guillaume Lecointre, Audrey Pleynet
+ Lire la suite
Citations et extraits (37)
Voir plus
Ajouter une citation
Le grand flux généalogique passé s'est divisé longitudinalement en raison d'évènements variés, engendrant des rameaux frères, dont chacun est constitué de populations d'individus se croisant entre eux. Maintenus séparés suffisamment longtemps, ces rameaux ont fini par ne plus pouvoir se reproduire entre eux à nouveau. La raison en est que les changements subis par les individus de part et d'autre de l'obstacle ne sont pas les mêmes. Dès qu'on cesse d'échanger, on diverge. Dans la nature, il n'y a donc pas d'espèces, mais seulement des barrières à la reproduction, dont on se sert conventionnellement pour constituer des espèces dans nos têtes pour les besoins de notre langage.
C'est étrange cette manie qu'ont les théories ésotériques ou les médecines douces d'entretenir un rapport schizophrénique avec la science. D'un côté, elles la rejettent pour délit de 'rationalisme', mais, de l'autre, elles ne cessent de singer son langage.
(p. 46 - 'Parapsychologues, les faussaires de la science')
(p. 46 - 'Parapsychologues, les faussaires de la science')
« Entre Darwin et Hennig, on a conservé comme valides dans les classifications à la fois les groupes monophylétiques et paraphylétiques. (...) En fait, fonder un taxon sur son devenir, comme le font l'échelle des êtres et les groupes paraphylétiques (de Linné), est une grave faute logique en sciences de l'évolution, parce qu'aucun devenir n'a de sens : les organismes vivants ne sont porteurs que de leur passé. (...) Cette esquisse historique explique pourquoi la classification telle qu'elle est produite par les scientifiques est totalement laïcisée, tandis que celle qui est utilisée par le public subit encore le poids d'une histoire anté-évolutionniste. »
La croyance religieuse a ceci de particulier qu'elle est assumée à titre collectif (dans religion il y a "Religere" qui signifie relier). Comme toute autre croyance, elle n'a pas besoin d'être justifiée rationnellement pour être légitime aux yeux de ceux ou celles qui y adhèrent. Si vous demandez à une ou un croyant de justifier rationnellement sa foi, vous l’agressez - peut-être sans le savoir. Sa légitimité relève d’une introspection ( dans ce cas , la croyance perd son caractère collectif) ou d'un principe d'autorité, qui peut résider par exemple dans un texte (lequel est alors sacré) ou un personnage charismatique. Ce qui est cru soude le groupe. Si l'on questionne , ou si l'on demande justification rationnelle de ce qui est cru, nous semblons menacer la cohésion du groupe. D’où l'impossibilité de réfuter - par un dialogue contradictoire - une croyance religieuse.
Le travail de la science, comprise comme une approche rationnelle et expérimentale du monde réel, génère des connaissances objectives. Les connaissances objectives sont celles dont les expériences ont été reproduites et les résultats vérifiés par des observateurs indépendants.
« Les groupes ne prennent pas leur sens par rapport à une utilité quelconque, mais par rapport au déroulement de l'évolution biologique, cause de la hiérarchie observée dans la distribution de ces attributs. »
Ainsi, les sociétés patriarcales ont été intensément productrices de violence mortelle, jusqu'à l'émergence des Etats modernes. La première baisse de violence significativement enregistrée en Europe de l'Ouest suit de près la fin des guerres de Religion européennes. En France, dès le règne de Louis XIII, on assiste au désarmement des populations, à l'exception des nobles, des soldats et des policiers. Richelieu lutta contre le duel, et Louis XIV transforma l'armée de mercenaires en forces régulières. Il y a donc captation de la violence létale "légitime" par l'Etat et criminalisation de la violence civile des jeunes hommes. Au fil du temps, celle-ci a été détournée vers les exutoires massifs que sont la guerre à très grande échelle, le sport-défoulement encadré, et contrecarrée par les éthiques de la non-violence (à l'origine de la création de la Société des nations, par exemple).
Les sciences face aux créationnismes : Ré-expliciter le contrat méthodologique des chercheurs
Guillaume Lecointre
Guillaume Lecointre
Si l’évolution est contestée par les partis politiques européens traditionnels, par les marges les plus conservatrices des trois grands monothéismes, c’est qu’elle commet trois grandes transgressions, à leurs yeux.
La première est qu’à travers le phénomène de l’évolution biologique et humaine, les sciences s’émancipent vis-à-vis de l’essentialisme qui est le fondement philosophique de la plupart des conservatismes. […]
La seconde transgression est l’acceptation tranquille du hasard […]
La troisième transgression est quasiment un corollaire de la précédente. Elle réside dans la façon qu’ont les sciences de l’évolution de décrire des mécanismes du changement organique, biologique, humain et social sans jamais faire appel à la notion de destin. [...]
La première est qu’à travers le phénomène de l’évolution biologique et humaine, les sciences s’émancipent vis-à-vis de l’essentialisme qui est le fondement philosophique de la plupart des conservatismes. […]
La seconde transgression est l’acceptation tranquille du hasard […]
La troisième transgression est quasiment un corollaire de la précédente. Elle réside dans la façon qu’ont les sciences de l’évolution de décrire des mécanismes du changement organique, biologique, humain et social sans jamais faire appel à la notion de destin. [...]
[...] le gène est passé du statut de notaire tout-puissant, régissant à la fois tout ce qui se passe dans l'organisme présent et tout ce qui allait être légué à la descendance, au statut de partenaire ne générant que des impulsions.
Les sciences face aux créationnismes : Ré-expliciter le contrat méthodologique des chercheurs
Guillaume Lecointre
Guillaume Lecointre
Le rôle des sciences est de dire ce qui est du monde réel, et de l’expliquer par les moyens de la raison et d’un rapport à la nature appelé expérimentation. La science explique la nature avec les seuls moyens de la nature, comme le postulèrent les encyclopédistes. Cela signifie que, par contrat, on exclut tout recours à un principe extra-naturel (providence, miracle…) lorsqu’il s’agit d’expliquer scientifiquement une manifestation du monde réel. Cette exclusion n’est pas nécessairement une négation ; elle est une garantie méthodologique.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur
Auteurs proches de Guillaume Lecointre
Lecteurs de Guillaume Lecointre (204)Voir plus
Quiz
Voir plus
Le Petit Prince de Calais de Pascal Teulade
Quel âge a Jonas ?
15 ans
12 ans
18 ans
10 ans
12 questions
49 lecteurs ont répondu
Thème : Le Petit Prince de Calais de
Pascal TeuladeCréer un quiz sur cet auteur49 lecteurs ont répondu