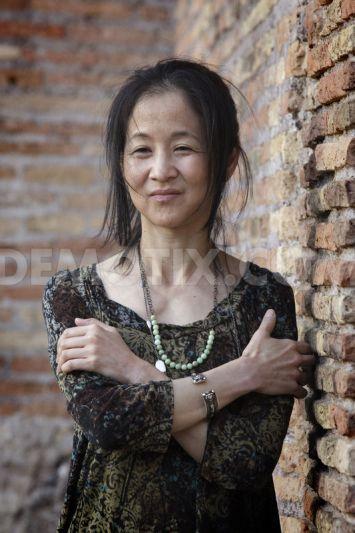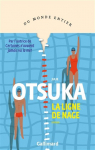Critiques de Julie Otsuka (930)
J'ai été incroyablement touchée par cette histoire complètement omise de l'Histoire. Ces japonaises qui ont bravé l'Atlantique pour se retrouver dans les champs californiens, pour beaucoup violées, maltraitées, ... Les roseaux se courbent mais ne cèdent jamais.
L'écriture est majestueuse, poétique, lyrique atténuant la violence et la cruauté de ce passage honteux de l'Histoire. On se doit de saluer la traduction magique qui arrive à nous retranscrire au plus près l'atmosphère de l'époque et l'émotion des jeunes filles.
Le travail d'investigation a dû être colossal compte tenu du peu de sources qui traitent de ce sujet délicat.
Ce livre m'a marquée et restera une de mes meilleures lectures.
L'écriture est majestueuse, poétique, lyrique atténuant la violence et la cruauté de ce passage honteux de l'Histoire. On se doit de saluer la traduction magique qui arrive à nous retranscrire au plus près l'atmosphère de l'époque et l'émotion des jeunes filles.
Le travail d'investigation a dû être colossal compte tenu du peu de sources qui traitent de ce sujet délicat.
Ce livre m'a marquée et restera une de mes meilleures lectures.
Après la lecture de « certaines n’avaient jamais vu la mer », où j’ai découvert l’immigration nippone aux États-Unis et où le sort qui attendait ces émigrants pendant la seconde guerre mondiale est un peu évoqué, j’ai eu envie de me plonger un peu plus sur cette partie de l’histoire inconnue pour moi.
Une curiosité satisfaite avec la lecture du premier roman de l’auteur qui nous fait remonter le temps.
Un retour aux sources pour découvrir les deux principales religions nippones, le shintoïsme (1) et le bouddhisme (2) et le rôle particulier qu’a jouer l’empereur du Japon et le culte qui y est (ou y était) associé (3).
L’écriture se cherche, on devine ce qui va devenir sa marque de fabrique, une écriture distanciée, froide qui cache sous les mots et les phrases des sentiments qui ne demandent qu’à exploser quand … la coupe est pleine !
La chronologie met en avant les moments importants, la situation d’une famille avant, le choc de l’annonce du départ, le trajet de déportation, le séjour dans le camp d’internement, le choc du retour dans un pays qui ne sera plus jamais le même et il faut parcourir les dernières pages pour assister impuissant à l’explosion des aveux.
Un livre puissant … une parole retrouvée qui enfin se libère !
(1)
Le shintoïsme est né au Japon d’un mélange entre animisme, chamanisme et culte des ancêtres. Peu à peu, tous ces cultes de la fertilité, ces vénérations de la nature, parfois capricieuse (tremblements de terre, typhons, tsunamis, etc), se sont amalgamés et codifiés pour former le shinto.
(2)
Le bouddhisme fut quant à lui importé de Chine et de Corée à partir des Ve et VIe siècles. En 592, après des luttes d'influence avec le shinto, le bouddhisme fut déclaré religion d'État. Le bouddhisme s'est introduit par le « haut », dans les classes sociales dominantes, avant d'atteindre le peuple, car ses enseignements relativement difficiles ne pouvaient pas encore être compris par l'ensemble de la population, non lettrée, du Japon.
(3)
L'empereur du Japon est le chef de l’état japonais. Selon la constitution promulguée en 1947 lors de l’occupation ayant suivi la seconde guerre mondiale, il a un rôle uniquement symbolique et détient sa fonction des citoyens japonais.
Une curiosité satisfaite avec la lecture du premier roman de l’auteur qui nous fait remonter le temps.
Un retour aux sources pour découvrir les deux principales religions nippones, le shintoïsme (1) et le bouddhisme (2) et le rôle particulier qu’a jouer l’empereur du Japon et le culte qui y est (ou y était) associé (3).
L’écriture se cherche, on devine ce qui va devenir sa marque de fabrique, une écriture distanciée, froide qui cache sous les mots et les phrases des sentiments qui ne demandent qu’à exploser quand … la coupe est pleine !
La chronologie met en avant les moments importants, la situation d’une famille avant, le choc de l’annonce du départ, le trajet de déportation, le séjour dans le camp d’internement, le choc du retour dans un pays qui ne sera plus jamais le même et il faut parcourir les dernières pages pour assister impuissant à l’explosion des aveux.
Un livre puissant … une parole retrouvée qui enfin se libère !
(1)
Le shintoïsme est né au Japon d’un mélange entre animisme, chamanisme et culte des ancêtres. Peu à peu, tous ces cultes de la fertilité, ces vénérations de la nature, parfois capricieuse (tremblements de terre, typhons, tsunamis, etc), se sont amalgamés et codifiés pour former le shinto.
(2)
Le bouddhisme fut quant à lui importé de Chine et de Corée à partir des Ve et VIe siècles. En 592, après des luttes d'influence avec le shinto, le bouddhisme fut déclaré religion d'État. Le bouddhisme s'est introduit par le « haut », dans les classes sociales dominantes, avant d'atteindre le peuple, car ses enseignements relativement difficiles ne pouvaient pas encore être compris par l'ensemble de la population, non lettrée, du Japon.
(3)
L'empereur du Japon est le chef de l’état japonais. Selon la constitution promulguée en 1947 lors de l’occupation ayant suivi la seconde guerre mondiale, il a un rôle uniquement symbolique et détient sa fonction des citoyens japonais.
Ce livre parle de toutes ces japonaises fiancées à des américains, qui ont quitté le Japon au début du 20eme siècle, pour retrouver leur fiancé dont elle avait une correspondance brève ou non.
Après une traversée de plusieurs jours très éprouvante, toutes ont déchantées : le fiancé n'était pas celui qu'elle avait vu en photo mais en plus c'est un agriculteur ou autre qui travaille dans des cultures toute la journée du matin au soir dans des conditions misérables et c'est ce sort qui attend toutes ces femmes.
L'auteur parle de toutes ces femmes, nous n'en suivons pas une seule en particulier et cela rend son récit très fort.
Ce livre est dur, magnifique, puissant, court et on ne peut que le recommander.
Après une traversée de plusieurs jours très éprouvante, toutes ont déchantées : le fiancé n'était pas celui qu'elle avait vu en photo mais en plus c'est un agriculteur ou autre qui travaille dans des cultures toute la journée du matin au soir dans des conditions misérables et c'est ce sort qui attend toutes ces femmes.
L'auteur parle de toutes ces femmes, nous n'en suivons pas une seule en particulier et cela rend son récit très fort.
Ce livre est dur, magnifique, puissant, court et on ne peut que le recommander.
Alice est une vieille dame qui nage très régulièrement. Elle y retrouve les mêmes personnes, mais nul ne se fréquente hors bassin. Chaque nageur a son couloir, ses habitudes, ses horaires, son temps de nage. Tout ce petit monde est bouleversé quand une fissure apparait au fond de la piscine. Que se passe-t-il ?
On nous invite à observer ce groupe, ce changement est vécu différemment, pour certains, c'est le mystère et pour d'autres la fin. L'autrice parle ensuite de sa grand-mère en maison de retraite, de la vie qu'elle mène.
Un roman orignal, avec une construction en trois temps, on est un peu dérouté au début et on se laisse prendre par cet univers et ce regard sur le monde, la fin de vie.
Lien : http://lespapotisdesophie.ha..
On nous invite à observer ce groupe, ce changement est vécu différemment, pour certains, c'est le mystère et pour d'autres la fin. L'autrice parle ensuite de sa grand-mère en maison de retraite, de la vie qu'elle mène.
Un roman orignal, avec une construction en trois temps, on est un peu dérouté au début et on se laisse prendre par cet univers et ce regard sur le monde, la fin de vie.
Lien : http://lespapotisdesophie.ha..
Ils nagent. Chacun sait ce qu'il doit faire. Le vestiaire, le bonnet, la ligne de nage. Les règles sont claires pour tous. Mais un jour, une fissure apparaît dans cette piscine si parfaite.
Ce roman est captivant du début à la fin. Grâce à un phrasé très particulier où les mots se succèdent les uns aux autres avec une grande fluidité, formant de longues constructions qui semblent ne jamais s'arrêter, l'autrice attire l'attention du lecteur et ne la lâche plus. Happé par ce flux inarrêtable de mots, on prend ainsi plaisir à s'immiscer d'abord dans la vie et l'intimité de tous ces nageurs puis, plus particulièrement, dans celle d'Alice, dont la mémoire lui fait peu à peu défaut. Le roman est subtil, le sujet fort et les dernières pages se lisent avec beaucoup d'émotions. Assurément un grand texte ; il serait dommage de passer à côté.
Lien : https://www.instagram.com/p/..
Ce roman est captivant du début à la fin. Grâce à un phrasé très particulier où les mots se succèdent les uns aux autres avec une grande fluidité, formant de longues constructions qui semblent ne jamais s'arrêter, l'autrice attire l'attention du lecteur et ne la lâche plus. Happé par ce flux inarrêtable de mots, on prend ainsi plaisir à s'immiscer d'abord dans la vie et l'intimité de tous ces nageurs puis, plus particulièrement, dans celle d'Alice, dont la mémoire lui fait peu à peu défaut. Le roman est subtil, le sujet fort et les dernières pages se lisent avec beaucoup d'émotions. Assurément un grand texte ; il serait dommage de passer à côté.
Lien : https://www.instagram.com/p/..
Je n'avais rien lu sur ce roman avant de le commencer, et la thématique m'a donc surprise.
Ou comment intéresser les lecteurs en parlant de...piscine...
Et c'est avec la description de ce monde « d'en bas » en opposition avec la vie réelle, en haut, que l'auteur nous accroche.
Les rites, les règles, les apparences, tout est différent à la piscine, les différences sociales ne se voient plus, ne restent que les nageurs, rapides ou pas, assidus ou non, qui respectent tous les mêmes codes.
Ces longueurs sont leur soupape à tous pour affronter la vie réelle.
Parmi eux, Alice.
Mais un jour une fissure apparaît au fond de la piscine, et c'est une partie de leur vie qui va changer.
Celle d'Alice notamment qui a aussi une fissure en elle, qui perd peu à peu le sens du réel et va devoir intégrer une institution.
L'auteur reprend la figure de style qu'elle avait utilisée dans « Certaines n'avaient jamais vu la mer », faite de « litanies », sorte de catalogue à la Prévert qui s'étire à l'infini.
Cela donne un effet hypnotique au récit qui n'est pas déplaisant au début mais dont le systématisme m'a, je l'avoue, lassée.
Pourtant la seconde partie, complètement différente, et qui met en scène Alice dans son institution ainsi que sa fille et son mari, dans les rôle difficiles d'accompagnants, apporte son lot d'émotions.
Un livre déconcertant donc, sur lequel il m'est difficile d'avoir un avis tranché, tant certaines parties m'ont amusée, d'autres agacée d'autres émue, et dont j'aurais bien du mal à conseiller la lecture...
Les avis sur Babelio sont aussi très partagés...
Ou comment intéresser les lecteurs en parlant de...piscine...
Et c'est avec la description de ce monde « d'en bas » en opposition avec la vie réelle, en haut, que l'auteur nous accroche.
Les rites, les règles, les apparences, tout est différent à la piscine, les différences sociales ne se voient plus, ne restent que les nageurs, rapides ou pas, assidus ou non, qui respectent tous les mêmes codes.
Ces longueurs sont leur soupape à tous pour affronter la vie réelle.
Parmi eux, Alice.
Mais un jour une fissure apparaît au fond de la piscine, et c'est une partie de leur vie qui va changer.
Celle d'Alice notamment qui a aussi une fissure en elle, qui perd peu à peu le sens du réel et va devoir intégrer une institution.
L'auteur reprend la figure de style qu'elle avait utilisée dans « Certaines n'avaient jamais vu la mer », faite de « litanies », sorte de catalogue à la Prévert qui s'étire à l'infini.
Cela donne un effet hypnotique au récit qui n'est pas déplaisant au début mais dont le systématisme m'a, je l'avoue, lassée.
Pourtant la seconde partie, complètement différente, et qui met en scène Alice dans son institution ainsi que sa fille et son mari, dans les rôle difficiles d'accompagnants, apporte son lot d'émotions.
Un livre déconcertant donc, sur lequel il m'est difficile d'avoir un avis tranché, tant certaines parties m'ont amusée, d'autres agacée d'autres émue, et dont j'aurais bien du mal à conseiller la lecture...
Les avis sur Babelio sont aussi très partagés...
Voici un énième livre que je lis dans le cadre de la rentrée littéraire (même si cette dernière s’éloigne de plus en plus, tandis qu’approche peu à peu celle d’hiver !), encore une fois grâce à l’important choix de livres inspirants au catalogue de Lirtuel – la bibliothèque belge francophone gratuite virtuelle !
On commence par être interpelé par sa note assez faible (surtout chez Babelio), et le fait que les commentaires sont très contrastés : soit on adore, soit on déteste, et pour le peu de commentaires que j’ai survolés, c’est toujours pour des raisons très personnelles !
Alors, bien sûr, le but de cet avis n’est pas de faire un commentaire sur les commentaires – ce serait le comble ! – mais plutôt de m’inscrire dans cette continuité : si ce (petit) livre m’a tant touchée, c’est aussi pour des raisons, en partie du moins, assez personnelles.
C’est que ce livre se divise clairement en deux parties : la partie « nage » au sens propre, avec cette fissure incompréhensible et jamais expliquée qui apparaît dans le fond de la piscine, puis toute la partie métaphorique et la fin de vie d’Alice en maison de retraite – oui, oui, j’ai bien dit « maison de retraite », je reviens là-dessus plus loin ! Il est à noter cependant que, même si la plupart des lecteurs, y compris les avis « officiels » publiés ici ou là, voient un lien qu’ils tentent de décrypter entre ces deux parties, l’autrice quant à elle est extrêmement évasive sur un tel lien, ne le fait tout simplement pas ! Ce lien est comme « suspendu », et seul le lecteur peut l’interpréter selon son propre ressenti. La seule chose explicite qu’on a entre les deux parties, c’est que Alice, notre « héroïne », faisait partie du groupe des nageurs… et que, après son départ vers sa fin de vie, lesdits nageurs (qui dès lors ne sont plus nommés) font partie des derniers qui continuent à lui rendre visite… et rien que ça, c'est tout simplement beau !
Tout ça pour dire : il se trouve que je suis moi aussi nageuse, depuis l’enfance, et les piscines ont (presque) toujours fait partie de ma vie, de façon plus ou moins intensive selon les époques. De plus, je suis passée par plusieurs « profils » tels que décrits dans ce livre : nageuse compétitrice, nageuse loisirs qui allait au couloir des « rapides », puis à nouveau compétitrice en club pendant quelques années, et désormais nageuse loisirs occasionnelle mais encore au couloir des « moyens » (même si, parfois, je me dis que je devrais passer aux « lents »). Je peux donc dire que, à un moment ou un autre, j’ai vécu tout ce que l’autrice raconte ici, et notamment : ce sentiment, quel que soit notre profil ou la piscine qu’on fréquente, d’appartenir à un cercle particulier – ce fait, qui m’a bien fait rire, qu’on se reconnaît en tenue de nage, qu’on se salue, qu’on a nos petits rites… mais qu’on se sent presque perdus quand on se croise par hasard, ici ou là, en étant « habillés » ! Et ce n’était là qu’un exemple, parmi bien d’autres où je me suis tellement retrouvée !
Alors, soit Julie Otsuka est une sociologue particulièrement avertie, soit elle est tout simplement nageuse elle aussi (et bonne observatrice), pour avoir su rendre cela avec une telle justesse ! et un humour sous-jacent, notamment à travers ces « listes » qui rendent l’écriture assez nerveuse, un peu à la Amélie Poulain (certains parlent d’inventaire à la Prévert, mais j’avoue que je ne connais pas assez !), de façon toujours très maîtrisée, et qui m’ont fait sourire plus d’une fois.
Et puis on passe, presque abruptement, à l’histoire d’Alice. Elle faisait partie de ce « club » non-dit des nageurs de cette piscine fissurée, mais peu à peu elle oublie… jusqu’à ce que, désormais officiellement malade (d’une de ces nombreuses maladies proches d’Alzheimer, avec des symptômes semblables, mais qui n’est pas ça quand même), se voit conduite en maison de retraite par ses proches, qui ne peuvent plus la gérer, à la suite de trop nombreux petits incidents qui ont fini par s’accumuler.
Et c’est là que je m’agace une première fois ! Ce livre est américain, écrit par une autrice très clairement d’origine japonaise, et Gallimard le publie dans sa collection « du monde entier » : on est en plein international ! Alors, expliquez-moi pourquoi le lieu où Alice va désormais vivre a été traduit par un acronyme strictement franco-français ? Par « chance », j’ai déjà entendu ce mot (si l’on peut dire), car j’ai une amie infirmière française qui travaille avec des personnes âgées ; autrement, j’aurais été bien en peine de savoir de quoi on parlait…
Car, oui, Ehpad n’est même pas un substantif, c’est l’acronyme de (j’ai dû chercher) « Établissement d’Hébergement pour les Personnes Âgées Dépendantes » - qui le sait encore, d’ailleurs, même en France ? mais donc, c’est typiquement franco-français : en Belgique (et au Luxembourg semble-t-il), ce mot n'existe tout simplement pas! on parle de maison de retraite, on ajoute « et de soins » si c’est explicitement médicalisé ; on a aussi le terme « séniorie » (ou parfois « foyer seniors ») qui regroupe tous ces types d’établissements. Je serais curieuse de savoir comment on dit en Suisse, ou au Québec… (Je ne parlerai pas de l’Afrique francophone qui, je crois, compte beaucoup moins d’établissements du genre que dans nos pays occidentaux, mais c’est un autre sujet !). En outre, il paraît – ai-je lu sur l’un ou l’autre site - que « Ehpad » est différent de « maison de retraite », dans la mesure où ça désigne un établissement médicalisé – ce que ne dit pourtant pas l’acronyme, à moins que « (personnes âgées) dépendantes » signifie « ayant besoin de soins médicaux » ?...
Bref, je ne vais pas épiloguer plus longtemps là-dessus, mais je reste toujours profondément choquée quand une traduction, qui en plus ici se veut explicitement « du monde entier », s’adresse exclusivement à un lectorat hexagonal, au mépris de tous les autres francophones… du monde entier !
Cela étant dit, dans cette seconde partie, l’écriture de l’autrice perd de sa nervosité - même si elle garde une manie de lister certaines choses, mais désormais ça ne fait plus sourire, au contraire, on est bien plus proche d’une certaine émotion. Peut-être pas pour les personnages du livre, même si pour ma part j’ai trouvé Alice très touchante du début à la fin, mais parce que chaque situation décrite nous renvoie à notre propre vécu (et ici, plus besoin d’être nageur !) : on a tous eu un proche qui a peu à peu perdu de son autonomie, sa mémoire, et même son bonheur de vivre…
Ainsi, Julie Otsuka nous entraîne dans une espèce de mélancolie : dans le chef du mari qui se retrouve seul et voit sa moitié tant aimée s’étioler petit à petit, dans le chef de la fille qui s’est éloignée de sa mère depuis tant d’années, et oscille entre ce qui ressemble à de la culpabilité, et un vraisemblable désir de ne pas trop s’approcher quand même.
Les établissements précités y sont aussi très fortement dénoncés, de façon toujours indirecte mais tellement acerbe, pour leur souci commercial avant le bien-être des patients ; un « bien-être » qui est trop souvent asséné à coup de tranquillisants peu à peu déshumanisants. Les soignants en tant que personnes ne sont pas dénigrés, mais on entend clairement qu’ils ont des diplômes et compétences variables, et qu’ils sont choisis pour tel ou tel patient varie selon ce que la famille du veut bien payer.
Ici aussi, j’ai lu certains commentaires, notamment de personnes travaillant dans ce genre d’établissements, tout à fait outrés, disant que ça ne se passe pas comme ça, que c’est sans doute une particularité américaine, etc. J’espère tant qu’ils disent vrai ! Pourtant, des scandales récents ayant éclaté, en Belgique et en France, sur une « chaîne » (oups, pardon, on dit « groupe » ! je ne dirai pas le nom, qui commence par O.) ; bref, ce scandale récent dans certaines maisons de retraite semble prouver que cette réalité-là existe bel et bien ! Alors, est-ce vraiment une particularité américaine, ou un coup de malchance pour Alice qui s’est retrouvée justement dans le « mauvais » établissement ? Nous ne le saurons jamais, le traducteur s’étant cantonné à la facilité française de l’Ehpad, au lieu de creuser un peu les choses, et proposer une petite note ici ou là, qui aurait tranquillisé bien des lecteurs francophones, réellement soucieux du bien-être de l’une ou l’autre personne âgée de leur entourage !
Si ces deux parties font l’essentiel du livre, et devraient suffire pour mon commentaire, j’ajouterai toutefois un élément récurrent, qui me laisse quelque peu perplexe. Il s’agit de ces allusions, toujours discrètes mais assez nombreuses, à l’internement en camp dans le désert que la famille d’Alice – une famille japonaise vivant aux États-Unis, faut-il le préciser ? – pendant la deuxième guerre mondiale. Il est question, çà et là du désert, des scorpions, du départ obligatoire et quelque peu précipité, du voyage en train, des possessions perdues du jour au lendemain, des bijoux volés qui devaient pourtant assurer l’avenir, etc.
J’avoue que, pour ma part, c’est un épisode de la guerre dont on ne m’avait jamais parlé à l’école, par exemple, car on en parle assez peu de ce côté-ci du globe – et pourtant, c’est une période de l’histoire à laquelle je m’intéresse, mais en Europe, on est tellement plus centrés sur l’avancée nazie à travers nos pays, qu’aux événements « annexes » qui ont eu lieu ailleurs dans le monde… Je suppose que c’est normal ! Ainsi, ce n’est que très récemment, dans un documentaire vu à la télé (mais j’ai complètement oublié de quelle émission il s’agissait !), que j’ai appris que les citoyens américains d’origine japonaise avaient été internés dans des camps (Wikipédia parle explicitement de « camps de concentration » !) après Pearl Harbour, déracinant des familles entières dans des lieux éloignés - et, pour la famille d’Alice, carrément désertique.
Or, je n’ai pas bien compris l’intérêt de ces allusions dans ce livre – à part le fait qu’elles enracinent la famille d’Alice dans une Histoire bien précise, je ne vois pas ce que ça apporte réellement à l’histoire de notre héroïne, ni en tant que nageuse, ni dans le contexte de sa fin de vie, d’autant plus qu’elle ne se souvient peu à peu de plus rien, pas de ça davantage que du reste ! Ressentiment de l’autrice, qui dans sa culpabilité envers sa mère qui s’éloigne, ressasse aussi des souvenirs familiaux plus anciens ? Il y a là quelque chose qui continue de m’échapper…
Bref, ce livre est en quelque sorte « à tiroirs », en deux parties principales dont le lien subtil ne doit pas forcément être explicité : j’ai beaucoup apprécié et me suis reconnue dans bien des passages en tant que nageuse, avec en plus un humour à la Prévert assez nerveux mais toujours juste ; j’ai été touchée par toute la partie, beaucoup plus mélancolique, sur la fin de vie déshumanisée d’Alice. Je reste perplexe face aux allusions à l’internement des Nippo-américains, et je suis très déçue d’une traduction bien trop franco-française pour un livre « du monde entier ». Ça n’en reste pas moins une belle découverte, une plume à suivre !
On commence par être interpelé par sa note assez faible (surtout chez Babelio), et le fait que les commentaires sont très contrastés : soit on adore, soit on déteste, et pour le peu de commentaires que j’ai survolés, c’est toujours pour des raisons très personnelles !
Alors, bien sûr, le but de cet avis n’est pas de faire un commentaire sur les commentaires – ce serait le comble ! – mais plutôt de m’inscrire dans cette continuité : si ce (petit) livre m’a tant touchée, c’est aussi pour des raisons, en partie du moins, assez personnelles.
C’est que ce livre se divise clairement en deux parties : la partie « nage » au sens propre, avec cette fissure incompréhensible et jamais expliquée qui apparaît dans le fond de la piscine, puis toute la partie métaphorique et la fin de vie d’Alice en maison de retraite – oui, oui, j’ai bien dit « maison de retraite », je reviens là-dessus plus loin ! Il est à noter cependant que, même si la plupart des lecteurs, y compris les avis « officiels » publiés ici ou là, voient un lien qu’ils tentent de décrypter entre ces deux parties, l’autrice quant à elle est extrêmement évasive sur un tel lien, ne le fait tout simplement pas ! Ce lien est comme « suspendu », et seul le lecteur peut l’interpréter selon son propre ressenti. La seule chose explicite qu’on a entre les deux parties, c’est que Alice, notre « héroïne », faisait partie du groupe des nageurs… et que, après son départ vers sa fin de vie, lesdits nageurs (qui dès lors ne sont plus nommés) font partie des derniers qui continuent à lui rendre visite… et rien que ça, c'est tout simplement beau !
Tout ça pour dire : il se trouve que je suis moi aussi nageuse, depuis l’enfance, et les piscines ont (presque) toujours fait partie de ma vie, de façon plus ou moins intensive selon les époques. De plus, je suis passée par plusieurs « profils » tels que décrits dans ce livre : nageuse compétitrice, nageuse loisirs qui allait au couloir des « rapides », puis à nouveau compétitrice en club pendant quelques années, et désormais nageuse loisirs occasionnelle mais encore au couloir des « moyens » (même si, parfois, je me dis que je devrais passer aux « lents »). Je peux donc dire que, à un moment ou un autre, j’ai vécu tout ce que l’autrice raconte ici, et notamment : ce sentiment, quel que soit notre profil ou la piscine qu’on fréquente, d’appartenir à un cercle particulier – ce fait, qui m’a bien fait rire, qu’on se reconnaît en tenue de nage, qu’on se salue, qu’on a nos petits rites… mais qu’on se sent presque perdus quand on se croise par hasard, ici ou là, en étant « habillés » ! Et ce n’était là qu’un exemple, parmi bien d’autres où je me suis tellement retrouvée !
Alors, soit Julie Otsuka est une sociologue particulièrement avertie, soit elle est tout simplement nageuse elle aussi (et bonne observatrice), pour avoir su rendre cela avec une telle justesse ! et un humour sous-jacent, notamment à travers ces « listes » qui rendent l’écriture assez nerveuse, un peu à la Amélie Poulain (certains parlent d’inventaire à la Prévert, mais j’avoue que je ne connais pas assez !), de façon toujours très maîtrisée, et qui m’ont fait sourire plus d’une fois.
Et puis on passe, presque abruptement, à l’histoire d’Alice. Elle faisait partie de ce « club » non-dit des nageurs de cette piscine fissurée, mais peu à peu elle oublie… jusqu’à ce que, désormais officiellement malade (d’une de ces nombreuses maladies proches d’Alzheimer, avec des symptômes semblables, mais qui n’est pas ça quand même), se voit conduite en maison de retraite par ses proches, qui ne peuvent plus la gérer, à la suite de trop nombreux petits incidents qui ont fini par s’accumuler.
Et c’est là que je m’agace une première fois ! Ce livre est américain, écrit par une autrice très clairement d’origine japonaise, et Gallimard le publie dans sa collection « du monde entier » : on est en plein international ! Alors, expliquez-moi pourquoi le lieu où Alice va désormais vivre a été traduit par un acronyme strictement franco-français ? Par « chance », j’ai déjà entendu ce mot (si l’on peut dire), car j’ai une amie infirmière française qui travaille avec des personnes âgées ; autrement, j’aurais été bien en peine de savoir de quoi on parlait…
Car, oui, Ehpad n’est même pas un substantif, c’est l’acronyme de (j’ai dû chercher) « Établissement d’Hébergement pour les Personnes Âgées Dépendantes » - qui le sait encore, d’ailleurs, même en France ? mais donc, c’est typiquement franco-français : en Belgique (et au Luxembourg semble-t-il), ce mot n'existe tout simplement pas! on parle de maison de retraite, on ajoute « et de soins » si c’est explicitement médicalisé ; on a aussi le terme « séniorie » (ou parfois « foyer seniors ») qui regroupe tous ces types d’établissements. Je serais curieuse de savoir comment on dit en Suisse, ou au Québec… (Je ne parlerai pas de l’Afrique francophone qui, je crois, compte beaucoup moins d’établissements du genre que dans nos pays occidentaux, mais c’est un autre sujet !). En outre, il paraît – ai-je lu sur l’un ou l’autre site - que « Ehpad » est différent de « maison de retraite », dans la mesure où ça désigne un établissement médicalisé – ce que ne dit pourtant pas l’acronyme, à moins que « (personnes âgées) dépendantes » signifie « ayant besoin de soins médicaux » ?...
Bref, je ne vais pas épiloguer plus longtemps là-dessus, mais je reste toujours profondément choquée quand une traduction, qui en plus ici se veut explicitement « du monde entier », s’adresse exclusivement à un lectorat hexagonal, au mépris de tous les autres francophones… du monde entier !
Cela étant dit, dans cette seconde partie, l’écriture de l’autrice perd de sa nervosité - même si elle garde une manie de lister certaines choses, mais désormais ça ne fait plus sourire, au contraire, on est bien plus proche d’une certaine émotion. Peut-être pas pour les personnages du livre, même si pour ma part j’ai trouvé Alice très touchante du début à la fin, mais parce que chaque situation décrite nous renvoie à notre propre vécu (et ici, plus besoin d’être nageur !) : on a tous eu un proche qui a peu à peu perdu de son autonomie, sa mémoire, et même son bonheur de vivre…
Ainsi, Julie Otsuka nous entraîne dans une espèce de mélancolie : dans le chef du mari qui se retrouve seul et voit sa moitié tant aimée s’étioler petit à petit, dans le chef de la fille qui s’est éloignée de sa mère depuis tant d’années, et oscille entre ce qui ressemble à de la culpabilité, et un vraisemblable désir de ne pas trop s’approcher quand même.
Les établissements précités y sont aussi très fortement dénoncés, de façon toujours indirecte mais tellement acerbe, pour leur souci commercial avant le bien-être des patients ; un « bien-être » qui est trop souvent asséné à coup de tranquillisants peu à peu déshumanisants. Les soignants en tant que personnes ne sont pas dénigrés, mais on entend clairement qu’ils ont des diplômes et compétences variables, et qu’ils sont choisis pour tel ou tel patient varie selon ce que la famille du veut bien payer.
Ici aussi, j’ai lu certains commentaires, notamment de personnes travaillant dans ce genre d’établissements, tout à fait outrés, disant que ça ne se passe pas comme ça, que c’est sans doute une particularité américaine, etc. J’espère tant qu’ils disent vrai ! Pourtant, des scandales récents ayant éclaté, en Belgique et en France, sur une « chaîne » (oups, pardon, on dit « groupe » ! je ne dirai pas le nom, qui commence par O.) ; bref, ce scandale récent dans certaines maisons de retraite semble prouver que cette réalité-là existe bel et bien ! Alors, est-ce vraiment une particularité américaine, ou un coup de malchance pour Alice qui s’est retrouvée justement dans le « mauvais » établissement ? Nous ne le saurons jamais, le traducteur s’étant cantonné à la facilité française de l’Ehpad, au lieu de creuser un peu les choses, et proposer une petite note ici ou là, qui aurait tranquillisé bien des lecteurs francophones, réellement soucieux du bien-être de l’une ou l’autre personne âgée de leur entourage !
Si ces deux parties font l’essentiel du livre, et devraient suffire pour mon commentaire, j’ajouterai toutefois un élément récurrent, qui me laisse quelque peu perplexe. Il s’agit de ces allusions, toujours discrètes mais assez nombreuses, à l’internement en camp dans le désert que la famille d’Alice – une famille japonaise vivant aux États-Unis, faut-il le préciser ? – pendant la deuxième guerre mondiale. Il est question, çà et là du désert, des scorpions, du départ obligatoire et quelque peu précipité, du voyage en train, des possessions perdues du jour au lendemain, des bijoux volés qui devaient pourtant assurer l’avenir, etc.
J’avoue que, pour ma part, c’est un épisode de la guerre dont on ne m’avait jamais parlé à l’école, par exemple, car on en parle assez peu de ce côté-ci du globe – et pourtant, c’est une période de l’histoire à laquelle je m’intéresse, mais en Europe, on est tellement plus centrés sur l’avancée nazie à travers nos pays, qu’aux événements « annexes » qui ont eu lieu ailleurs dans le monde… Je suppose que c’est normal ! Ainsi, ce n’est que très récemment, dans un documentaire vu à la télé (mais j’ai complètement oublié de quelle émission il s’agissait !), que j’ai appris que les citoyens américains d’origine japonaise avaient été internés dans des camps (Wikipédia parle explicitement de « camps de concentration » !) après Pearl Harbour, déracinant des familles entières dans des lieux éloignés - et, pour la famille d’Alice, carrément désertique.
Or, je n’ai pas bien compris l’intérêt de ces allusions dans ce livre – à part le fait qu’elles enracinent la famille d’Alice dans une Histoire bien précise, je ne vois pas ce que ça apporte réellement à l’histoire de notre héroïne, ni en tant que nageuse, ni dans le contexte de sa fin de vie, d’autant plus qu’elle ne se souvient peu à peu de plus rien, pas de ça davantage que du reste ! Ressentiment de l’autrice, qui dans sa culpabilité envers sa mère qui s’éloigne, ressasse aussi des souvenirs familiaux plus anciens ? Il y a là quelque chose qui continue de m’échapper…
Bref, ce livre est en quelque sorte « à tiroirs », en deux parties principales dont le lien subtil ne doit pas forcément être explicité : j’ai beaucoup apprécié et me suis reconnue dans bien des passages en tant que nageuse, avec en plus un humour à la Prévert assez nerveux mais toujours juste ; j’ai été touchée par toute la partie, beaucoup plus mélancolique, sur la fin de vie déshumanisée d’Alice. Je reste perplexe face aux allusions à l’internement des Nippo-américains, et je suis très déçue d’une traduction bien trop franco-française pour un livre « du monde entier ». Ça n’en reste pas moins une belle découverte, une plume à suivre !
Première partie
L’héritage familiale… les mots d’adieux … « tu verras : les femmes sont faibles, mais les mères sont fortes. ».
Un voyage à l’autre bout du monde … là, où tout est mieux … des maris ayant réussis ... de belles maisons … un avenir …
Une arrivée dans cet autre monde … où tout n’est pas si rose … des hommes vieillis … des logis immondes … des conditions de vie lamentables …
Le prix à payer pour cette escapade au pays des illusions … la sexualité dans toute sa bestialité …ils ont payer pour ça … ils veulent en profiter !
Que ce livre est dur …
Il nous montre sans artifice le commerce des corps féminins …
Ces femmes qui sont vendues par leurs familles … pour épargner les autres … pour sauver celle qui part ?
Une écriture au scalpel qui déchire les chairs et nos neurones pour nous montrer l’envers du décor de l’exil de ces Japonaises qui ont quitté leur pays au début du XXe siècle pour épouser aux Etats-Unis un homme qu'elles ont choisi sur catalogue.
L’emploi du « nous »donne de l’ampleur à la description de l’enfer vécue par une collectivité formée malgré elle.
Terrifiant épisode décrit avec une intensité remarquable servi par une écriture qui donne sens aux drames vécus par toutes ces femmes.
Deuxième partie
Quand un homme et une femme finissent par former une famille et que les habitudes prennent le pas sur le futur…
La guerre définit un nouveau monde où les japonais qu’ils soient hommes, femmes ou enfants deviennent le représentant de l’ennemi …et peut être simplement l’ennemi …
L’Amérique prépare la déportation de ces jaunes … comme d’autres en Europe les juifs … convoi … camps … et la société laisse faire…on ne sait jamais ce qu’ils auraient pu faire …
Le temps passe et l’oubli prend toute la place … qui était ces gens … que sont ils devenus … on ne se pose plus la question …
Et finalement ont ils vraiment exister !
Terrifiant épisode décrit comme une amnésie collective, que l’écriture détachée qui nous montre comment l’amnésie peut aussi être collective sans être pour autant non répréhensible.
Julie Otsuka, une auteure à découvrir et à suivre !
L’héritage familiale… les mots d’adieux … « tu verras : les femmes sont faibles, mais les mères sont fortes. ».
Un voyage à l’autre bout du monde … là, où tout est mieux … des maris ayant réussis ... de belles maisons … un avenir …
Une arrivée dans cet autre monde … où tout n’est pas si rose … des hommes vieillis … des logis immondes … des conditions de vie lamentables …
Le prix à payer pour cette escapade au pays des illusions … la sexualité dans toute sa bestialité …ils ont payer pour ça … ils veulent en profiter !
Que ce livre est dur …
Il nous montre sans artifice le commerce des corps féminins …
Ces femmes qui sont vendues par leurs familles … pour épargner les autres … pour sauver celle qui part ?
Une écriture au scalpel qui déchire les chairs et nos neurones pour nous montrer l’envers du décor de l’exil de ces Japonaises qui ont quitté leur pays au début du XXe siècle pour épouser aux Etats-Unis un homme qu'elles ont choisi sur catalogue.
L’emploi du « nous »donne de l’ampleur à la description de l’enfer vécue par une collectivité formée malgré elle.
Terrifiant épisode décrit avec une intensité remarquable servi par une écriture qui donne sens aux drames vécus par toutes ces femmes.
Deuxième partie
Quand un homme et une femme finissent par former une famille et que les habitudes prennent le pas sur le futur…
La guerre définit un nouveau monde où les japonais qu’ils soient hommes, femmes ou enfants deviennent le représentant de l’ennemi …et peut être simplement l’ennemi …
L’Amérique prépare la déportation de ces jaunes … comme d’autres en Europe les juifs … convoi … camps … et la société laisse faire…on ne sait jamais ce qu’ils auraient pu faire …
Le temps passe et l’oubli prend toute la place … qui était ces gens … que sont ils devenus … on ne se pose plus la question …
Et finalement ont ils vraiment exister !
Terrifiant épisode décrit comme une amnésie collective, que l’écriture détachée qui nous montre comment l’amnésie peut aussi être collective sans être pour autant non répréhensible.
Julie Otsuka, une auteure à découvrir et à suivre !
C’est une histoire de délitement. De temps qui passe et du mystère qui l’entoure. De désagrégation. À la piscine, les nageurs suivent chacun leurs petites manies, celles qui leur assurent que tout ira bien. Que tout est maitrisé. Et puis, un jour, une fissure apparaît dans le fond de la piscine et les certitudes coulent, chacun perd pied. Ces lignes de nage ne sont plus qu’angoisse et incertitude. Et c’est la césure. La fermeture. Parmi les nageurs, il y a Alice. Et à mesure que la fissure prend forme, elle perd ses repères.
À l’image de cette craquelure, le roman se scinde en deux parties bien distinctes. La première, dans le monde d’en-bas, où l’on vogue au gré des nages de chacun, bercé par leurs contemplations intérieures. Et, la suivante, au cours de laquelle on suit la lente coulée d’Alice alors que son esprit se délite et disparaît.
Alors que la première partie revêt certains aspects presque mystiques par moment, teintée de quelques traits d’humour. La deuxième, quant à elle, est à la fois terrifiante et empathique; tout en mettant à nu la triste réalité de ces personnes démentes et leur quotidien en institution. Au fil des pages, la fracture se fait béante, prend toute la place. Alice s’y noie et s’y perd, pour finalement basculer de l’autre côté, dans un monde à peine palpable pour ceux restés sur l’autre rive. Le repli se fait. Et la ligne de nage se referme, inlassablement. Emprisonnant Alice dans un monde nébuleux et mystérieux, inconnu de tous.
Avec "La ligne de nage", Julie Otsuka signe un roman mélancolique et magnifique qui retrace la dernière ligne droite, la dernière longueur, d’une vie qui finit par sombrer.
À l’image de cette craquelure, le roman se scinde en deux parties bien distinctes. La première, dans le monde d’en-bas, où l’on vogue au gré des nages de chacun, bercé par leurs contemplations intérieures. Et, la suivante, au cours de laquelle on suit la lente coulée d’Alice alors que son esprit se délite et disparaît.
Alors que la première partie revêt certains aspects presque mystiques par moment, teintée de quelques traits d’humour. La deuxième, quant à elle, est à la fois terrifiante et empathique; tout en mettant à nu la triste réalité de ces personnes démentes et leur quotidien en institution. Au fil des pages, la fracture se fait béante, prend toute la place. Alice s’y noie et s’y perd, pour finalement basculer de l’autre côté, dans un monde à peine palpable pour ceux restés sur l’autre rive. Le repli se fait. Et la ligne de nage se referme, inlassablement. Emprisonnant Alice dans un monde nébuleux et mystérieux, inconnu de tous.
Avec "La ligne de nage", Julie Otsuka signe un roman mélancolique et magnifique qui retrace la dernière ligne droite, la dernière longueur, d’une vie qui finit par sombrer.
Tout est dit dans la quatrième de couverture : "Ces Japonaises on tout abandonné au début du 20 ème siècle pour épouser aux Etats-Unis, sur la foi d'un portrait, un inconnu. Celui dont elles ont tant rêvé, qui va tant les décevoir. Coeur vibrant, leurs voix s'élèvent pour raconter l'exil : la nuit de noces, les journées aux champs, la langue revêche, l'humiliation, les joies aussi. Puis le silence de la guerre. Et l'oubli.
D'une écriture incantatoire, Julie Otsuka redonne chair à ces héroïnes anonymes dans une mosaïque de la mémoire éblouissante."
Ce texte me fait plus penser à un récit qu'à un roman car il est la compilation de témoignages et d'écrits historiques, la "petite histoire" celle de l'immigration de ces femmes plus où moins vendues par leurs parents à des compatriotes installés aux Etats-Unis depuis plusieurs années. Un marché de dupes le plus souvent, réalisé par l'entremise d'agences matrimoniales peu scrupuleuses. Le déracinement, l'adaptation difficile et la vie qui l'est aussi.
Beaucoup de tristesse tout au long des chapitres. Un livre très dur qui engendre la mélancolie.
Cependant, malgré toute cette noirceur, j'ai beaucoup apprécié cette oeuvre qui a largement mérité en 2012 son prix fémina étranger.
Belle rencontre avec un auteur.
D'une écriture incantatoire, Julie Otsuka redonne chair à ces héroïnes anonymes dans une mosaïque de la mémoire éblouissante."
Ce texte me fait plus penser à un récit qu'à un roman car il est la compilation de témoignages et d'écrits historiques, la "petite histoire" celle de l'immigration de ces femmes plus où moins vendues par leurs parents à des compatriotes installés aux Etats-Unis depuis plusieurs années. Un marché de dupes le plus souvent, réalisé par l'entremise d'agences matrimoniales peu scrupuleuses. Le déracinement, l'adaptation difficile et la vie qui l'est aussi.
Beaucoup de tristesse tout au long des chapitres. Un livre très dur qui engendre la mélancolie.
Cependant, malgré toute cette noirceur, j'ai beaucoup apprécié cette oeuvre qui a largement mérité en 2012 son prix fémina étranger.
Belle rencontre avec un auteur.
Un petit peu déçue par cette lecture que j’ai au départ beaucoup appréciée. Le thème est intéressant, on se sent tout de suite proche de ces femmes. Le style d’écriture était un peu surprenant mais agréable au départ. Malheureusement ce même style assez particulier a fait que j’ai décroché vers la moitié du livre. Finalement on ne se rapproche pas d’un personnage en particulier, on n’a pas d’histoires continues mais des bribes de tous les côtés. Ce n’est pas très dynamique, comme une longue énumération, sans de réelles actions, et sans dialogues.
Intégration aux Etats-Unis de centaines de familles japonaises dont les épouses avaient quitté leur Japon, appâtées par de trop séduisantes promesses. Beaucoup échouèrent dans des plantations, certaines dans le sous-sol des blanchisseries, d'autres exploitées dans les cuisines des restaurants ou comme bonnes à tout faire.
Etonnement et regrets de centaines d'habitants en 1941 quand disparurent en une nuit ces Japonais travailleurs, polis, discrets, accusés de collaboration, déportés de l'autre côté des montagnes.
Enumérations sans fin, style original mais dont, j'ai parfois décroché.
Etonnement et regrets de centaines d'habitants en 1941 quand disparurent en une nuit ces Japonais travailleurs, polis, discrets, accusés de collaboration, déportés de l'autre côté des montagnes.
Enumérations sans fin, style original mais dont, j'ai parfois décroché.
Mon ressenti est assez différent entre la première et la deuxième partie du livre.
Le premier tiers du roman sur les rites, habitudes et relations des habitués d'une piscine, m'a semblé trop long malgré la beauté de l’écriture et de nombreux traits humoristiques. Je me demandais quel était le propos de Julie Otsuka.
Je l’ai compris avec la deuxième partie, arrivée à point nommé (mon intérêt s’émoussait …). Le changement brutal de thème m’a d’ailleurs surprise. J’ai eu le sentiment de lire deux textes différents, juxtaposés l’un à côté de l’autre, de manière un peu artificielle.
Et tout a changé.
Cette deuxième partie sur la démence sénile, la fin de vie et la relation mère-fille qui en résulte m’a totalement happée. Je n’ai plus réussi à lâcher le livre.
Malgré le sujet difficile, les faits sont exposés sans pathos, presque sans émotion, de manière quasi documentaire, avec une précision infinie, comme s’il était nécessaire d’évoquer tous les détails, d’épuiser toutes les informations, pour faire face à la mémoire qui s’en va.
Cette mise à distance semble être le seul moyen pour la narratrice d’admettre que la vie de sa mère s’épuise, d’accepter cette situation compliquée qui échappe à son contrôle sans s’effondrer, avec la pudeur d’une femme et l’amour d’une fille.
Les fissures dans le fond de la piscine ont alors pris tout leur sens. S’accrocher aux rituels, à la répétition des jours et des gestes. Tenter de rester à flot sans couler.
Le premier tiers du roman sur les rites, habitudes et relations des habitués d'une piscine, m'a semblé trop long malgré la beauté de l’écriture et de nombreux traits humoristiques. Je me demandais quel était le propos de Julie Otsuka.
Je l’ai compris avec la deuxième partie, arrivée à point nommé (mon intérêt s’émoussait …). Le changement brutal de thème m’a d’ailleurs surprise. J’ai eu le sentiment de lire deux textes différents, juxtaposés l’un à côté de l’autre, de manière un peu artificielle.
Et tout a changé.
Cette deuxième partie sur la démence sénile, la fin de vie et la relation mère-fille qui en résulte m’a totalement happée. Je n’ai plus réussi à lâcher le livre.
Malgré le sujet difficile, les faits sont exposés sans pathos, presque sans émotion, de manière quasi documentaire, avec une précision infinie, comme s’il était nécessaire d’évoquer tous les détails, d’épuiser toutes les informations, pour faire face à la mémoire qui s’en va.
Cette mise à distance semble être le seul moyen pour la narratrice d’admettre que la vie de sa mère s’épuise, d’accepter cette situation compliquée qui échappe à son contrôle sans s’effondrer, avec la pudeur d’une femme et l’amour d’une fille.
Les fissures dans le fond de la piscine ont alors pris tout leur sens. S’accrocher aux rituels, à la répétition des jours et des gestes. Tenter de rester à flot sans couler.
Très beau roman, émouvant et mélancolique, sur la glissement très lent vers la de fin et la perte de mémoire. L'auteure nous amène dans ses souvenirs, et ceux de sa mère, qui accompagne la perte de ceux-ci. Malgré une partie plus "molle" dans le roman, sur l'arrivé dans l'EPHAD et le descriptif acide mais nécessaire, ce récit vous plonge dans un cette univers de l'oubli, qui nous effraie tous.
Livre très déroutant par le choix de la métaphore : la piscine et ses lignes de nage pour la vie, le destin??, la fissure pour la fuite des neurones avant la maladie et la fermeture de la piscine pour l'enfermement en milieu spécialisé.
Récit (qui sent le vécu) glaçant sur la fin de vie.
Récit (qui sent le vécu) glaçant sur la fin de vie.
Court roman qui évoque un événement que je ne connaissais absolument pas: l'immigration de japonais aux Etats-Unis et leur triste réalité de vie à l'arrivée puis leur déportation dans des camps pendant la seconde guerre mondiale.
J'imaginais ce roman comme un livre détente, mais il n'en est rien. Il est dur et difficile à lire tant au niveau du fond que de la forme. Le fond est dur pour les conditions de travail qu'il décrit mais aussi la condition de la femme et la condition de mépris des américains envers les japonais.
La forme est difficile à lire. C'est un roman à la première personne du pluriel qui par énumération annihile l'individu dans un grand groupe. Le groupe porte la voix de chacune des femmes et montre les différentes vies. Cela demande un grand effort de concentration, et à force cela m'a agacée.
Une lecture triste.
J'imaginais ce roman comme un livre détente, mais il n'en est rien. Il est dur et difficile à lire tant au niveau du fond que de la forme. Le fond est dur pour les conditions de travail qu'il décrit mais aussi la condition de la femme et la condition de mépris des américains envers les japonais.
La forme est difficile à lire. C'est un roman à la première personne du pluriel qui par énumération annihile l'individu dans un grand groupe. Le groupe porte la voix de chacune des femmes et montre les différentes vies. Cela demande un grand effort de concentration, et à force cela m'a agacée.
Une lecture triste.
C'est un récit très déroutant que je suis contente d'avoir lu mais tout aussi contente d'avoir terminé et de pouvoir passer à autre chose! Car l'auteure y décrit minutieusement les dégâts causés par une forme de démence sénile sur sa propre mère...c'est à la fois très touchant, très angoissant et d'une profonde tristesse.La forme du récit est elle aussi particulière et parfois très agaçante, surtout dans sa 1ère partie : l'auteure fait une sorte de liste géante de tout ce qui a trait aux nageurs d'une certaine piscine, précisément celle dans laquelle sa mère avait l'habitude de nager... Je n'ai pas vraiment vu l'intérêt de cette 1ère partie. Dans la 2ème partie , celle où Alice se retrouve dans un Ephad spécialisé Alzheimer, l'auteure égraine de nouvelles listes ( celle des oublis de sa mère, du règlement de l'Ephad, etc.) mais tout en y ajoutant des touches plus personnelles, comme des souvenirs de la jeunesse de sa mère ou ses rapports plutôt froids avec elle."Elle", "nous", "vous": les narrateurs se multiplient pour mieux nous dérouter.
C'est donc un texte très émouvant, un hommage plein de regrets que Julie Otsuka rend à sa mère. A ne surtout pas lire un jour de grisaille...
J'avais préféré Certaines n'avaient jamais vu la mer, du même auteur.
C'est donc un texte très émouvant, un hommage plein de regrets que Julie Otsuka rend à sa mère. A ne surtout pas lire un jour de grisaille...
J'avais préféré Certaines n'avaient jamais vu la mer, du même auteur.
L’eau est limpide sous l’habitude d’une nage régulière. Le corps se meut échappant à la vie trépidante de l’extérieur, à l’hyper sollicitation, aux soucis. Le bruit, la pollution, les courses à faire, les enfants, un job sont portés par un esprit sain, un esprit sans fissure, des pensées ordonnées, des gestes sûrs. Mais le lieu se disloque fendu de toute part laissant à chacun une réalité à affronter.
Alice nageait. Des mètres et des mètres de glissade dans la ligne. Elle oubliait les brèches.
Métaphore de la vie, la piscine casse tel le cerveau d’Alice dont la fille, narratrice de ce superbe roman, raconte les failles. L’absence se dessine au-delà du corps assis dans le fauteuil d’une maison de retraite. Qui était Alice ? Le « vous » succède au « tu » mêlant les dommages d’une vie qui part sur la démence d’une atrophie du lobe frontal. Les proches s’épuisent, le cœur souffre.
Si j’ai mis quelques pages pour m’immerger dans ce roman surprise par les répétitions des faits autour de la piscine, j’ai vite été happée par la profondeur de ces mots passée sa première partie. En effet, divisé en deux volets bien distincts, il m’a fallu attendre le second passage pour mesurer la richesse du premier. D’une grande finesse et sans pathos, l’écrit relate peu à peu l’effacement de la mémoire, la vieillesse, la culpabilité des proches, la résignation, les souvenirs laissant une trace - la trace de celle qui fût.
Une lecture bouleversante et humaine.
Lien : https://aufildeslivresbloget..
Alice nageait. Des mètres et des mètres de glissade dans la ligne. Elle oubliait les brèches.
Métaphore de la vie, la piscine casse tel le cerveau d’Alice dont la fille, narratrice de ce superbe roman, raconte les failles. L’absence se dessine au-delà du corps assis dans le fauteuil d’une maison de retraite. Qui était Alice ? Le « vous » succède au « tu » mêlant les dommages d’une vie qui part sur la démence d’une atrophie du lobe frontal. Les proches s’épuisent, le cœur souffre.
Si j’ai mis quelques pages pour m’immerger dans ce roman surprise par les répétitions des faits autour de la piscine, j’ai vite été happée par la profondeur de ces mots passée sa première partie. En effet, divisé en deux volets bien distincts, il m’a fallu attendre le second passage pour mesurer la richesse du premier. D’une grande finesse et sans pathos, l’écrit relate peu à peu l’effacement de la mémoire, la vieillesse, la culpabilité des proches, la résignation, les souvenirs laissant une trace - la trace de celle qui fût.
Une lecture bouleversante et humaine.
Lien : https://aufildeslivresbloget..
L'auteure est une nageuse, d’abord de pleine mer quand elle était adolescente dans l’Océan Pacifique de la Californie, puis dans une piscine new-yorkaise à l’âge adulte. Elle connait donc bien cette pratique particulière, à mi-chemin entre loisir et sport, et a eu le temps d’enregistrer les rituels et les petites manies des nageurs qu’elle nous restitue avec une pointe de malice.
Elle a souvent expliqué être venue à la littérature après avoir voulu être peintre, ne se trouvant pas assez douée dans cet art. Rien d’étonnant à ce qu’elle décrive chaque scène à la perfection.
J'avais énormément apprécié Celles qui n'avaient jamais vu la mer, que j'ai recommandé à moult reprises et j'étais déçue de ne rien lire de plus de cette auteure si sensible. Dix ans de silence, c'est énorme. La ligne de nage ne pouvait que retenir mon attention alors que la natation n'est absolument pas mon activité favorite, loin de là.
(…)
Il n’empêche que mon état d’esprit m’a permis de prendre beaucoup de plaisir à la lecture de la première partie de ce roman qui, ne se déroule pas « que » dans une piscine. Je précise d’ailleurs qu’il n’est absolument pas nécessaire d’être bon nageur pour se plonger avec délice entre ses lignes. Julie Otsuka fait preuve d’humour autant que de philosophie. Et les remarques intérieures qu’elle ajoute en italiques sont très pertinentes.
Sous prétexte de nous narrer le quotidien d’un groupe de personnes en pointant aussi bien ce qui les rassemble (la piscine) que ce qui les sépare (leur vie en haut) elle aborde des sujets qui nous préoccupent tous et qui sont plus ou moins tabous, comme la fin inéluctable de la vie, les compromissions avec soi-même, les bons et les mauvais côtés des relations humaines.
Tout glisse. C’est passionnant comme un thriller. On sait la Californie (où elle réside) construite sur la faille de San Andreas et on se dit qu’il se pourrait que la catastrophe finisse par advenir. Mais alors comment expliquer qu’elle soit encore de notre monde pour en témoigner ?
On se surprend à élucubrer tout un tas de suppositions. Bref, on se passionne pour ce qui démarre tout de même comme un non-évènement. Et pour cause, puisque Julie Otsuka affirme en interview ne pas être une écrivaine métaphorique. La fissure qui apparaît dans le fond du bassin annonce pour elle bel et bien la fin de cette piscine idyllique mais cela ne la dérange pas qu’on en fasse une autre interprétation.
Le titre français est excellent. Le titre original, the Swimmers, était moins fort et moins énigmatique, trop concentré me semble-t-il sur le groupe, même si le roman parle essentiellement -dans la première partie- de ces hommes et de ces femmes. Cependant le pluriel correspondait à une des spécificités de son style est d’utiliser la première personne du pluriel, ce qui donne un aspect choral à son écriture en insufflant une forme de musicalité car les phrases sont courtes et déclaratives. Le nous renvoie à un collectif qui est plus puissant que l’individuel. Mais si dans la première partie il est sympathique, il bascule dans le chapitre intitulé Bellavista et devient autoritaire et oppressant car c’est la voix de dominants, qui plus est invisibles, faisant penser à l'univers de Big Brother.
(…)
La couverture est admirablement choisie pour symboliser la défaillance qui est le coeur de l’histoire. Un déchirement dont la fermeture éclair d’un maillot de bains est l’allégorie parfaite.
Lire la totalité de la chronique sur le blog A bride abattue :
http://abrideabattue.blogspot.com/2022/10/la-ligne-de-nage-de-julie-otsuka.html
Lien : http://abrideabattue.blogspo..
Elle a souvent expliqué être venue à la littérature après avoir voulu être peintre, ne se trouvant pas assez douée dans cet art. Rien d’étonnant à ce qu’elle décrive chaque scène à la perfection.
J'avais énormément apprécié Celles qui n'avaient jamais vu la mer, que j'ai recommandé à moult reprises et j'étais déçue de ne rien lire de plus de cette auteure si sensible. Dix ans de silence, c'est énorme. La ligne de nage ne pouvait que retenir mon attention alors que la natation n'est absolument pas mon activité favorite, loin de là.
(…)
Il n’empêche que mon état d’esprit m’a permis de prendre beaucoup de plaisir à la lecture de la première partie de ce roman qui, ne se déroule pas « que » dans une piscine. Je précise d’ailleurs qu’il n’est absolument pas nécessaire d’être bon nageur pour se plonger avec délice entre ses lignes. Julie Otsuka fait preuve d’humour autant que de philosophie. Et les remarques intérieures qu’elle ajoute en italiques sont très pertinentes.
Sous prétexte de nous narrer le quotidien d’un groupe de personnes en pointant aussi bien ce qui les rassemble (la piscine) que ce qui les sépare (leur vie en haut) elle aborde des sujets qui nous préoccupent tous et qui sont plus ou moins tabous, comme la fin inéluctable de la vie, les compromissions avec soi-même, les bons et les mauvais côtés des relations humaines.
Tout glisse. C’est passionnant comme un thriller. On sait la Californie (où elle réside) construite sur la faille de San Andreas et on se dit qu’il se pourrait que la catastrophe finisse par advenir. Mais alors comment expliquer qu’elle soit encore de notre monde pour en témoigner ?
On se surprend à élucubrer tout un tas de suppositions. Bref, on se passionne pour ce qui démarre tout de même comme un non-évènement. Et pour cause, puisque Julie Otsuka affirme en interview ne pas être une écrivaine métaphorique. La fissure qui apparaît dans le fond du bassin annonce pour elle bel et bien la fin de cette piscine idyllique mais cela ne la dérange pas qu’on en fasse une autre interprétation.
Le titre français est excellent. Le titre original, the Swimmers, était moins fort et moins énigmatique, trop concentré me semble-t-il sur le groupe, même si le roman parle essentiellement -dans la première partie- de ces hommes et de ces femmes. Cependant le pluriel correspondait à une des spécificités de son style est d’utiliser la première personne du pluriel, ce qui donne un aspect choral à son écriture en insufflant une forme de musicalité car les phrases sont courtes et déclaratives. Le nous renvoie à un collectif qui est plus puissant que l’individuel. Mais si dans la première partie il est sympathique, il bascule dans le chapitre intitulé Bellavista et devient autoritaire et oppressant car c’est la voix de dominants, qui plus est invisibles, faisant penser à l'univers de Big Brother.
(…)
La couverture est admirablement choisie pour symboliser la défaillance qui est le coeur de l’histoire. Un déchirement dont la fermeture éclair d’un maillot de bains est l’allégorie parfaite.
Lire la totalité de la chronique sur le blog A bride abattue :
http://abrideabattue.blogspot.com/2022/10/la-ligne-de-nage-de-julie-otsuka.html
Lien : http://abrideabattue.blogspo..
MA-GNI-FI-QUE
Un roman ma-gni-fi-que sur la ligne que l'on suit tous, qui un jour se fissure, se craquèle sous nos yeux, résonne en nous... et nous pousse à un aveu d'impuissance...
Le roman se déroule en deux temps.
Tout d'abord dans le huit clos d'une piscine municipale, on y découvre les habitudes, les rituels, les codes des nageurs "d'en bas". Leur psychologie est explorée avec tact, précision et une pointe d'humour.
Parce qu'il y a ceux "d'en haut" qui luttent contre les problèmes de la vie, et il y a ceux "d'en bas" qui nagent pour les oublier.
Audrey, brasse indienne, Charlotte, ligne six, Jonathan... et Alice suivent la ligne de nage comme on suit une ligne de conduite pour tenir, mettre de l'ordre dans sa vie, ses pensées. Un dérivatif à la vie "d'en haut", si imprévisible...
Puis une fissure vient couper cette ligne au semblant d'infini, comme une vie toute tracée tordue sous l'effet de la vieillesse, comme les marbrures dessinées dans le cerveau d'Alice...., une ligne conductrice qui s'efface au fil du temps, comme la mémoire d'Alice...
Le second temps du roman, est consacré à la nouvelle vie d'Alice qui ne peut plus se rendre à la piscine, qui ne peut plus suivre la ligne de nage, qui ne peut pas reconnaître cet EHPAD où son mari épuisé, l'a déposée avec ses valises...
La fille d'Alice tente de sauver quelques lambeaux de cette mémoire maintenant éphémère...
Un roman ma-gni-fi-que sur la ligne que l'on suit tous, qui un jour se fissure, se craquèle sous nos yeux, résonne en nous... et nous pousse à un aveu d'impuissance...
Le roman se déroule en deux temps.
Tout d'abord dans le huit clos d'une piscine municipale, on y découvre les habitudes, les rituels, les codes des nageurs "d'en bas". Leur psychologie est explorée avec tact, précision et une pointe d'humour.
Parce qu'il y a ceux "d'en haut" qui luttent contre les problèmes de la vie, et il y a ceux "d'en bas" qui nagent pour les oublier.
Audrey, brasse indienne, Charlotte, ligne six, Jonathan... et Alice suivent la ligne de nage comme on suit une ligne de conduite pour tenir, mettre de l'ordre dans sa vie, ses pensées. Un dérivatif à la vie "d'en haut", si imprévisible...
Puis une fissure vient couper cette ligne au semblant d'infini, comme une vie toute tracée tordue sous l'effet de la vieillesse, comme les marbrures dessinées dans le cerveau d'Alice...., une ligne conductrice qui s'efface au fil du temps, comme la mémoire d'Alice...
Le second temps du roman, est consacré à la nouvelle vie d'Alice qui ne peut plus se rendre à la piscine, qui ne peut plus suivre la ligne de nage, qui ne peut pas reconnaître cet EHPAD où son mari épuisé, l'a déposée avec ses valises...
La fille d'Alice tente de sauver quelques lambeaux de cette mémoire maintenant éphémère...
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur
Auteurs proches de Julie Otsuka
Lecteurs de Julie Otsuka Voir plus
Quiz
Voir plus
Testez-vous ...😊
Que signifie le mot " coruscant" ?
Qui est indiscipliné, brouillon
Qui suit toujours l'avis de la majorité
Qui préfère la nature et les animaux aux êtres humains
Qui vit dans l'écorce des arbres
Qui est imprécis, vague
Qui est brillant, éclatant
Qui ne supporte pas la lumière du jour
Qui est trop difficile à comprendre
1 questions
102 lecteurs ont répondu
Thèmes :
culture générale
, vocabulaireCréer un quiz sur cet auteur102 lecteurs ont répondu