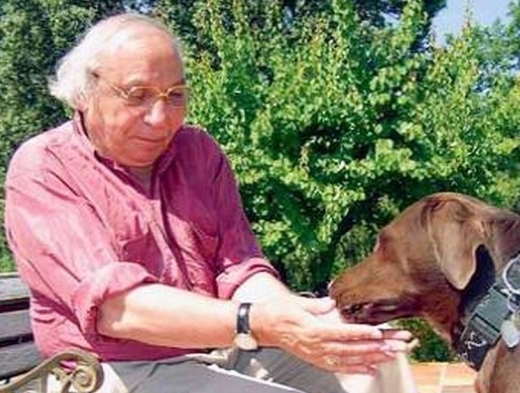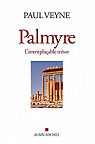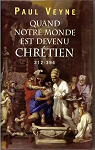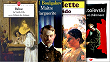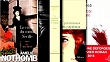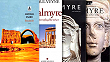Critiques de Paul Veyne (150)
J’aime bien ce bouquin pour deux raisons. D’une part, il est intéressant. D’autre part, il s’agit d’un cas rarissime où le résumé te spoile direct la question posée en titre. Du pain béni pour les flemmards, qui peuvent s’épargner la lecture des 170 pages entre la première et la quatrième de couverture.
Dans les grandes lignes, certains Grecs ont cru à leurs mythes, d’autres non… ce qui ne fait pas avancer le schmilblick. Le vrai propos de Veyne interroge la notion de croyance et, surtout, celle de vérité. Pour en arriver à la thèse d’une vérité comme construction culturelle et évolutive dans le temps, avec laquelle les Grecs entretenaient des rapports ambivalents. On pouvait très bien accepter le mythe à travers ce qu’il représentait (la grandeur d’une cité, une forme de mémoire historique, une explication du monde, une justification de l’ordre social…), sans pour autant accorder de crédit à toutes les fantaisies qui sont devenues notre fantasy (magie, créatures monstrueuses, deus ex machina…). Mélange entre adhésion à la valeur du mythe et regard critique envers sa mise en scène, pleine d’éléments WTF qui défient la raison.
Qui dit vérité construite dit vérité utilisée “pour la bonne cause”, quand il s’agit de vendre quelque chose. Les mythes fondateurs permettent de se la péter auprès des cités voisines dans un concours de qui a la plus grosse divinité. Qu’ils soient authentiques ou fictifs, on s’en tamponne, l’important c’est la dimension mythique, du moment que ça claque et que ça en met plein la vue.
Dans la série “j’y crois quand ça m’arrange”, Veyne cite Galien, toubib grec à cheval sur les IIe et IIIe siècles après l’invention du pin’s. Quand il s’agit de médecine pratique, Galien réfute l’existence des centaures, créatures aussi merveilleuses qu’invraisemblables. Pour défendre son art et gagner de nouveaux disciples, ce même Galien évoque le savoir médical de Chiron, se plaçant ainsi sous le patronnage d’un centaure. Pure rhétorique et usage intéressé du mythe : de la langue de bois.
L’ouvrage est parfois redondant, souvent velu (on se situe dans l’universitaire, pas dans la vulgarisation) mais indispensable à lire pour questionner ensuite notre propre rapport à la vérité et à toutes celles qu’on nous sert. Ce qui valait pour les Grecs reste d’actualité. Entre fake news, légendes urbaines, enlèvements extraterrestres, roman national, Terre plate, réalité déformée par les discours politiques ou religieux, on nage en permanence dans les mythes, les inventions, les délires bon enfant ou malsains. Autant de “vérités” qui n’en sont pas et demandent qu’on s’interroge sur nos propres croyances.
Lien : https://unkapart.fr/les-grec..
Dans les grandes lignes, certains Grecs ont cru à leurs mythes, d’autres non… ce qui ne fait pas avancer le schmilblick. Le vrai propos de Veyne interroge la notion de croyance et, surtout, celle de vérité. Pour en arriver à la thèse d’une vérité comme construction culturelle et évolutive dans le temps, avec laquelle les Grecs entretenaient des rapports ambivalents. On pouvait très bien accepter le mythe à travers ce qu’il représentait (la grandeur d’une cité, une forme de mémoire historique, une explication du monde, une justification de l’ordre social…), sans pour autant accorder de crédit à toutes les fantaisies qui sont devenues notre fantasy (magie, créatures monstrueuses, deus ex machina…). Mélange entre adhésion à la valeur du mythe et regard critique envers sa mise en scène, pleine d’éléments WTF qui défient la raison.
Qui dit vérité construite dit vérité utilisée “pour la bonne cause”, quand il s’agit de vendre quelque chose. Les mythes fondateurs permettent de se la péter auprès des cités voisines dans un concours de qui a la plus grosse divinité. Qu’ils soient authentiques ou fictifs, on s’en tamponne, l’important c’est la dimension mythique, du moment que ça claque et que ça en met plein la vue.
Dans la série “j’y crois quand ça m’arrange”, Veyne cite Galien, toubib grec à cheval sur les IIe et IIIe siècles après l’invention du pin’s. Quand il s’agit de médecine pratique, Galien réfute l’existence des centaures, créatures aussi merveilleuses qu’invraisemblables. Pour défendre son art et gagner de nouveaux disciples, ce même Galien évoque le savoir médical de Chiron, se plaçant ainsi sous le patronnage d’un centaure. Pure rhétorique et usage intéressé du mythe : de la langue de bois.
L’ouvrage est parfois redondant, souvent velu (on se situe dans l’universitaire, pas dans la vulgarisation) mais indispensable à lire pour questionner ensuite notre propre rapport à la vérité et à toutes celles qu’on nous sert. Ce qui valait pour les Grecs reste d’actualité. Entre fake news, légendes urbaines, enlèvements extraterrestres, roman national, Terre plate, réalité déformée par les discours politiques ou religieux, on nage en permanence dans les mythes, les inventions, les délires bon enfant ou malsains. Autant de “vérités” qui n’en sont pas et demandent qu’on s’interroge sur nos propres croyances.
Lien : https://unkapart.fr/les-grec..
.Ce livre , écrit par un grand historien, voisin et ami du poète , ne se veut pas une biographie . Il s’agit plus d’élucider à travers les textes du poète ,assez hermétiques pour la plupart , ce que signifie pour lui son aventure poétique . Immense poète, chef de guerre , amoureux dévorant ,le stature de cet homme a de quoi impressionner . Veyne nous aide à approcher le sens de son entreprise. Il m’a ,personnellement , aidé à mieux apprécier des textes que j’admirais éperdument sans toujours en percevoir l’arrière-plan.
Attirée par les mémoires d'un homme cultivé ,spécialiste de l'histoire romaine ,j'ai d'abord été étonnée par quelques naÏvetés . Mais la fin ou l'auteur se répand sur son mariage à trois ,avec une femme alcoolique,névrosée et suicidaire,un fils et un beau fils également névrosés et suicidaires ,fait penser à du radotage d'un vieillard un peu sénile.
René CHAR se méfiait des critiques littéraires, des enseignants et des journalistes qui triturent et dissèquent les œuvres littéraires. Selon lui, un seul sens possible à donner au texte : le sien, celui que l'auteur a voulu y mettre. Ce qu'il met en mots dans Allégeance :
"Dans les rues de la ville il y a mon amour. Peu importe où il va dans le temps divisé. Il n'est plus mon amour, chacun peut lui parler. Il ne se souvient plus ; qui au juste l'aima ?"
Paul VEYNE réussit à se faire accepter par le Géant, dans le but non d'expliquer, d'analyser, mais d'éclairer les textes et la langue de René CHAR. Une belle réussite qui permet une approche de l'homme et de l'oeuvre originale et sans trahison.
"Dans les rues de la ville il y a mon amour. Peu importe où il va dans le temps divisé. Il n'est plus mon amour, chacun peut lui parler. Il ne se souvient plus ; qui au juste l'aima ?"
Paul VEYNE réussit à se faire accepter par le Géant, dans le but non d'expliquer, d'analyser, mais d'éclairer les textes et la langue de René CHAR. Une belle réussite qui permet une approche de l'homme et de l'oeuvre originale et sans trahison.
Le grand historien Paul Veyne ne livre pas une oeuvre érudite de synthèse - bien que la volonté pédagogique soit bien présente. Plus que la somme des recherches historiques et archéologiques, il nous livre ici un hommage poignant à la culture face à la barbarie. L'historien raconte la beauté de la Palmyre antique, ses banquets, sa colonnade, ses temples où Bâl devenait Zeus selon l'alphabet. C'était la ville de l'Occident, romaine mais surtout grecque, et c'était la ville de l'Orient, arabe et araméenne. Les Barbares ont passé, tout est ruine et deuil, les ruines elles-mêmes sont ruinées. Mais grâce à Paul Veyne, DAECH ne peut la détruire totalement. L'Humanité se souviendra de Palmyre, cette ville qui était un symbole de mixité et d'échanges entre les cultures, dans un Proche-Orient creuset de toute notre civilisation.
Livre érudit mais facile à lire. On aimerait visiter les ruines de Palmyre avec un guide de cette qualité.
Autobiographie franche et étonnante ! C'est celle d'un érudit de 84 ans, spécialiste en histoire romaine. A priori donc, peu de chances d'y trouver le récit d'une existence rock'n'roll. Et bien, c'est le cas. Le projet de Veyne est bien celui de "se peindre soi même" sans éviter les épisodes peu flatteurs. Il y a peut être une forme d'exhibitionnisme dans cela (et les inévitables "j'ai connu Truc et Machin, qui m'adoraient"...) mais le ton paraît sincère. Une chose est sûre : Veyne adore la vie (malgré son handicap) et elle lui rend bien : il n'a visiblement jamais renoncé au plaisir du corps. Pour s'en convaincre, il suffira de préciser qu'il a vécu en "ménage à trois" pendant quinze ans, entre ses 65 et 80 ans, à peu près.
Qu'il est difficile de saisir ce Veyne.
On voit l'énergie déployée par ce prince gréco-romain pour trouver, en creux des pratiques religieuses grecques, des angles d'attaque et faire flèche de toute colonne corinthienne.
Pour autant, l'ouvrage tombe des mains en même temps qu'il tend à tomber dans la bis repetita.
Bien trop, l'alléchante question initiale, se noie dans des considérations certes intéressantes, mais éloignées mentalement.
On voit l'énergie déployée par ce prince gréco-romain pour trouver, en creux des pratiques religieuses grecques, des angles d'attaque et faire flèche de toute colonne corinthienne.
Pour autant, l'ouvrage tombe des mains en même temps qu'il tend à tomber dans la bis repetita.
Bien trop, l'alléchante question initiale, se noie dans des considérations certes intéressantes, mais éloignées mentalement.
Cette étude se compose de deux parties que tout distingue. Dans un premier temps, P. Veyne nous démontre les raisons pour lesquelles l'empereur Constantin s'est converti au christianisme. À la lumière de l'époque dans laquelle cet évènement s'insère, celle-ci nous paraît plausible et compréhensible. Grâce à un language qui pourrait surprendre, voire faire rire son lectorat, P. Veyne nous donne des explications simples et quasiment irréfutables. Il est dès lors facile de comprendre la portée d'un tel chamboulement.
Puis, dans un deuxièmement temps, l'auteur nous embarque vers des réflexions philosophiques complexes. Il est alors difficile de le suivre de rester concentré face à qu'il nous expose. J'ai trouvé ça dommage car cela contraste avec la simplicité abordé dans la première partie.
Puis, dans un deuxièmement temps, l'auteur nous embarque vers des réflexions philosophiques complexes. Il est alors difficile de le suivre de rester concentré face à qu'il nous expose. J'ai trouvé ça dommage car cela contraste avec la simplicité abordé dans la première partie.
Palmyre, L’irremplaçable trésor. Paul Veyne, dans ce petit livre remarquable avec un cahier central de photos couleur, replace cette cité détruite par l’organisation terroriste Daech au centre de notre héritage culturel : « Malgré mon âge avancé, c’était de mon devoir d’ancien professeur et d’être humain de dire ma stupéfaction devant ce saccage incompréhensible… »
Utilisant un style simple, concis, Paul Veyne rappelle d’abord le supplice, la torture, la décapitation, le 18 août 2015, de l’archéologue palmyrénien, Khalet al-Assaad, resté jusqu’au bout sur place pour tenter de sauver ce patrimoine de l’humanité.
En plein désert, Palmyre est un site gréco-romain aussi somptueux que Pompéi ou Éphèse en Turquie. On y parlait l’araméen, parfois le grec et le temple de Bêl dont l’architecture rappelle la Perse et d’autres cultures, était le plus important de la ville.
Alors, l’auteur nous emmène là-bas, après 4 heures d’avion et 200 km de route goudronnée à travers le désert. « Les Palmyréniens n’étaient pas des barbares et ne voulaient pas l’être. » Cette ville comptait quelques dizaines de milliers d’habitants et la majorité du trafic caravanier venant de l’Inde et de l’Arabie passait par là.
Son origine remonte à plus 4 000 ans mais les monuments connus ont été élevés vers l’an 100 et 200 de notre ère. Dix-sept tribus connues ont vécu là. Ce sont les riches et les notables qui, comme ailleurs, étaient les maîtres de la cité et cherchaient à s’helléniser.
Ce livre se lit avec un immense plaisir mais avec une douleur immense au fond du cœur en pensant à ce qui s’est passé là-bas. Paul Veyne conte l’épopée palmyrénienne et ne manque pas de s’arrêter sur l’histoire de Zénobie qui tenta d’imposer son fils, Wahballat, comme empereur d’Orient. Zénobie a esquissé le partage entre Orient et Occident et si l’empereur Aurélien a mis fin à son aventure, elle est restée légendaire.
Paul Veyne n’oublie pas de détailler les sculptures découvertes sur le site. Il précise : « Dieux araméens, mésopotamiens, arabes et même perses ou égyptiens…Tout est venu à Palmyre qui a emprunté de tous côtés. » Le Louvre conserve deux grandes vitrines avec des bustes palmyréniens.
Palmyre représentait la liberté, le non-conformisme, le multiculturalisme et « …ne connaître, ne vouloir connaître qu’une seule culture, la sienne, c’est se condamner à vivre sous un éteignoir », conclut Paul Veyne.
Lien : http://notre-jardin-des-livr..
Utilisant un style simple, concis, Paul Veyne rappelle d’abord le supplice, la torture, la décapitation, le 18 août 2015, de l’archéologue palmyrénien, Khalet al-Assaad, resté jusqu’au bout sur place pour tenter de sauver ce patrimoine de l’humanité.
En plein désert, Palmyre est un site gréco-romain aussi somptueux que Pompéi ou Éphèse en Turquie. On y parlait l’araméen, parfois le grec et le temple de Bêl dont l’architecture rappelle la Perse et d’autres cultures, était le plus important de la ville.
Alors, l’auteur nous emmène là-bas, après 4 heures d’avion et 200 km de route goudronnée à travers le désert. « Les Palmyréniens n’étaient pas des barbares et ne voulaient pas l’être. » Cette ville comptait quelques dizaines de milliers d’habitants et la majorité du trafic caravanier venant de l’Inde et de l’Arabie passait par là.
Son origine remonte à plus 4 000 ans mais les monuments connus ont été élevés vers l’an 100 et 200 de notre ère. Dix-sept tribus connues ont vécu là. Ce sont les riches et les notables qui, comme ailleurs, étaient les maîtres de la cité et cherchaient à s’helléniser.
Ce livre se lit avec un immense plaisir mais avec une douleur immense au fond du cœur en pensant à ce qui s’est passé là-bas. Paul Veyne conte l’épopée palmyrénienne et ne manque pas de s’arrêter sur l’histoire de Zénobie qui tenta d’imposer son fils, Wahballat, comme empereur d’Orient. Zénobie a esquissé le partage entre Orient et Occident et si l’empereur Aurélien a mis fin à son aventure, elle est restée légendaire.
Paul Veyne n’oublie pas de détailler les sculptures découvertes sur le site. Il précise : « Dieux araméens, mésopotamiens, arabes et même perses ou égyptiens…Tout est venu à Palmyre qui a emprunté de tous côtés. » Le Louvre conserve deux grandes vitrines avec des bustes palmyréniens.
Palmyre représentait la liberté, le non-conformisme, le multiculturalisme et « …ne connaître, ne vouloir connaître qu’une seule culture, la sienne, c’est se condamner à vivre sous un éteignoir », conclut Paul Veyne.
Lien : http://notre-jardin-des-livr..
Dans les interviews qu'il a données à la télévision pour évoquer son roman Le Royaume, Emmanuel Carrère avoue avoir été influencé par la lecture de Paul Veyne. Il est vrai que les deux hommes ont la même intention : comprendre comment une secte religieuse a pu devenir l'une des religions dominantes de notre monde contemporain.
Si Emmanuel Carrère indique avoir été croyant, puis avoir abandonné toute pratique religieuse, Paul Veyne, lui, se définit comme incroyant. Incroyant, mais pas irrespectueux envers les religions, puisqu'il défend ardemment l'existence du sentiment religieux, existant pour lui-même et non pas en raison de considérations relatives à la mort ou à l'incompréhension des événements naturels. Dans ce livre, Paul Veyne concentre son propos sur les années 312-394, un siècle presque, durant lequel le christianisme va s'affirmer comme la religion dominante de l'empire romain finissant. Plus encore, Paul Veyne se concentre sur la figure centrale de Constantin qui, non content d'unifier l'empire sous son autorité unique, favorise le christianisme auquel, à la veille de la bataille du Pont Milvius, il se convertit.
Les historiens ont souvent compris cette conversion comme un geste politique : un Dieu, un empire, un prince. L'idéologie chrétienne servirait les intérêts de Constantin. Pour Paul Veyne, il n'en est rien : la conversion de Constantin est un acte de foi authentique. En épousant la religion d'un dixième de la population de l'empire, religion déjà organisée en une Eglise qui n'entend pas se soumette à l'autorité de son nouveau et tout-puissant bienfaiteur, Constantin s'inscrit clairement dans une histoire chrétienne qui transcende la vie humaine. Constantin prend donc un rôle à la mesure de l'homme littéralement extraordinaire qu'il est : à la foi authentique s'ajoute donc l'orgueil personnel. Mais ne pas prendre en compte la complexité de l'âme humaine, les multiples ressorts qui l'animent, ce serait simplifier les choses et, donc, se tromper.
A plusieurs reprises, Paul Veyne s'interroge sur les raisons du succès du christianisme. Pourquoi Constantin s'est-il converti ? Pourquoi la religion personnelle de l'empereur devient-elle la religion de la majorité des habitants de l'empire romain à la fin du IVème siècle ? Quelques longueurs viennent ici tenter quelques explications : le dynamisme du christianisme, son exigence envers les fidèles, sa transcendance, son culte de l'amour, la relation privilégiée qu'il consacre entre Dieu et les fidèles. Quant à parler de monothéisme, ce serait oublier un peu vite la structure fondamentale de Dieu, qui est Un en trois Personnes.
Évidemment, il est question aussi du paganisme. La religion romaine considérait les dieux comme une espèce à part, avec laquelle les hommes devaient entretenir des relations au moins cordiales. La religion païenne est importante, mais elle n'est pas tout : le christianisme, au contraire, englobe la vie en entier.
Le génie de Constantin est celui de la liberté : celle d'un homme qui épouse une religion à sa mesure, qui ne se préoccupe pas de l'avis de ses contemporains. Face au paganisme, Constantin n'impose rien : le réalisme domine sa politique. Peu à peu, l'élitisme originel du christianisme disparaît au profit d'une religiosité populaire qui ne s'embarrasse pas forcément des problèmes théologiques. Par ses actes (adoption du chrisme comme emblème personnel à la bataille du pont Milvius en 312, édit de Milan en 313, convocation du concile de Nicée en 325 mais aussi construction d'églises, règlement de la question donatiste, support financier à l'Eglise, dispense de rites païens et publics aux chrétiens ...), Constantin assure à l'Eglise une visibilité officielle, sans parvenir à l'imposer définitivement : c'est seulement à la succession de Julien l'Apostat, dans les années 363-364, que l'armée romaine imposera un empereur chrétien, sans que la religion n'ait été une part importante dans ce choix.
Un peu bavard, voire verbeux, le livre de Paul Veyne a un grand mérite : celui d'être très pédagogique. Car appréhender le IVème siècle romain, c'est aller à la rencontre d'un autre monde mental. Le pouvoir est attaché à la personne, la religion (le paganisme) est d'abord une affaire de rites. Paul Veyne procède par analogie, privilégiant la compréhension de son lecteur à l'exactitude historique. Pour autant, on regrette que le livre ne soit pas un peu plus contextualisé (sur l'évolution historique du christianisme depuis les origines) et que le IVème siècle, hormis la période constantinienne, soit à peu près passée sous silence. L'érudition et les questionnements, tant historiques que philosophiques voire métaphysiques, donnent enfin une densité savante à l'ouvrage.
Si Emmanuel Carrère indique avoir été croyant, puis avoir abandonné toute pratique religieuse, Paul Veyne, lui, se définit comme incroyant. Incroyant, mais pas irrespectueux envers les religions, puisqu'il défend ardemment l'existence du sentiment religieux, existant pour lui-même et non pas en raison de considérations relatives à la mort ou à l'incompréhension des événements naturels. Dans ce livre, Paul Veyne concentre son propos sur les années 312-394, un siècle presque, durant lequel le christianisme va s'affirmer comme la religion dominante de l'empire romain finissant. Plus encore, Paul Veyne se concentre sur la figure centrale de Constantin qui, non content d'unifier l'empire sous son autorité unique, favorise le christianisme auquel, à la veille de la bataille du Pont Milvius, il se convertit.
Les historiens ont souvent compris cette conversion comme un geste politique : un Dieu, un empire, un prince. L'idéologie chrétienne servirait les intérêts de Constantin. Pour Paul Veyne, il n'en est rien : la conversion de Constantin est un acte de foi authentique. En épousant la religion d'un dixième de la population de l'empire, religion déjà organisée en une Eglise qui n'entend pas se soumette à l'autorité de son nouveau et tout-puissant bienfaiteur, Constantin s'inscrit clairement dans une histoire chrétienne qui transcende la vie humaine. Constantin prend donc un rôle à la mesure de l'homme littéralement extraordinaire qu'il est : à la foi authentique s'ajoute donc l'orgueil personnel. Mais ne pas prendre en compte la complexité de l'âme humaine, les multiples ressorts qui l'animent, ce serait simplifier les choses et, donc, se tromper.
A plusieurs reprises, Paul Veyne s'interroge sur les raisons du succès du christianisme. Pourquoi Constantin s'est-il converti ? Pourquoi la religion personnelle de l'empereur devient-elle la religion de la majorité des habitants de l'empire romain à la fin du IVème siècle ? Quelques longueurs viennent ici tenter quelques explications : le dynamisme du christianisme, son exigence envers les fidèles, sa transcendance, son culte de l'amour, la relation privilégiée qu'il consacre entre Dieu et les fidèles. Quant à parler de monothéisme, ce serait oublier un peu vite la structure fondamentale de Dieu, qui est Un en trois Personnes.
Évidemment, il est question aussi du paganisme. La religion romaine considérait les dieux comme une espèce à part, avec laquelle les hommes devaient entretenir des relations au moins cordiales. La religion païenne est importante, mais elle n'est pas tout : le christianisme, au contraire, englobe la vie en entier.
Le génie de Constantin est celui de la liberté : celle d'un homme qui épouse une religion à sa mesure, qui ne se préoccupe pas de l'avis de ses contemporains. Face au paganisme, Constantin n'impose rien : le réalisme domine sa politique. Peu à peu, l'élitisme originel du christianisme disparaît au profit d'une religiosité populaire qui ne s'embarrasse pas forcément des problèmes théologiques. Par ses actes (adoption du chrisme comme emblème personnel à la bataille du pont Milvius en 312, édit de Milan en 313, convocation du concile de Nicée en 325 mais aussi construction d'églises, règlement de la question donatiste, support financier à l'Eglise, dispense de rites païens et publics aux chrétiens ...), Constantin assure à l'Eglise une visibilité officielle, sans parvenir à l'imposer définitivement : c'est seulement à la succession de Julien l'Apostat, dans les années 363-364, que l'armée romaine imposera un empereur chrétien, sans que la religion n'ait été une part importante dans ce choix.
Un peu bavard, voire verbeux, le livre de Paul Veyne a un grand mérite : celui d'être très pédagogique. Car appréhender le IVème siècle romain, c'est aller à la rencontre d'un autre monde mental. Le pouvoir est attaché à la personne, la religion (le paganisme) est d'abord une affaire de rites. Paul Veyne procède par analogie, privilégiant la compréhension de son lecteur à l'exactitude historique. Pour autant, on regrette que le livre ne soit pas un peu plus contextualisé (sur l'évolution historique du christianisme depuis les origines) et que le IVème siècle, hormis la période constantinienne, soit à peu près passée sous silence. L'érudition et les questionnements, tant historiques que philosophiques voire métaphysiques, donnent enfin une densité savante à l'ouvrage.
Je m'attendais à un ouvrage plus historique que philosophique, je suis donc déçu. Néanmoins le livre est écrit dans une langue relativement simple, même si j'ai eu du mal à le comprendre parfois.
L'auteur defend la thèse que la conversion de Constantin est bien une conversion d'adhésion et non un calcul géopolitique. La deuxième partie est un panégyrique de l'universalisme, qui ne serais pas plus d'héritage chrétiens que des philosophes récent (spinoza) le tout saupoudré de Marxisme Leninisme...
L'auteur defend la thèse que la conversion de Constantin est bien une conversion d'adhésion et non un calcul géopolitique. La deuxième partie est un panégyrique de l'universalisme, qui ne serais pas plus d'héritage chrétiens que des philosophes récent (spinoza) le tout saupoudré de Marxisme Leninisme...
Veyne, que j'aime deux fois, comme expert de la Rome antique et de René Char, est érudit et perspicace. Ironique aussi : « En ces temps-là, l'astrologie, fondée sur de solides connaissances astronomiques, était en crédit, comme chez nous la psychanalyse » (p 178). Il nous donne ici un document impeccable avec plan détaillé, index nominal et thématique, carte et bibliographie. Pour inciter à sa lecture, voici les traces de deux thèmes dominants :
« Les Tranquillisations ». Ce chapitre du livre suffit à en justifier la lecture. Il traite des relations entre la divinité, la philosophie et les sectes. Le dieu singulier (local, national, tutélaire) est d'une race supérieure à la race animale (mortelle, sans raison) et à la race humaine (mortelle, raisonnable). Il appartient tout de même au monde, à une race sexuée, faillible, imprévisible, qui vit ses aventures dans l'indifférence aux races inférieures. Le dieu n'est jamais le maître d'un drame cosmique où l'homme joue son salut. À la rigueur pour les hommes instruits, les dieux dans leur ensemble sont les images ou les facettes d'une Providence ou d'une Fatalité. On les honore comme on honore la Sagesse ou la Cité. Pour qui se respecte, les rites funéraires sont une nécessité consolatrice, mais l'immortalité de l'âme n'est pas un concept raisonnable : « Chez nous, la philosophie est une matière universitaire et une partie de la culture ; c'est un savoir qu'apprennent les étudiants et auquel des personnes cultivées s'intéressent par haute curiosité (...). Chez les Anciens, règles de vie et exercices spirituels étaient l'essence de la « philosophie », non de la religion, et la religion était à peu près séparée des idées sur la mort et sur l'au-delà. Il existait des sectes mais elles étaient philosophiques, car la philosophie était la matière des sectes qui proposaient, aux individus que cela pouvait intéresser, des convictions et des règles de vie ; on se faisait stoïcien ou épicurien et on se conformait plus ou moins à ses convictions, de même que chez nous on est chrétien ou marxiste, avec le devoir de vivre sa foi ou de militer » (p 207-8).
Le cynisme. Le Haut Empire était un monde plus arbitraire et plus inégalitaire que le tiers-monde d'aujourd'hui, une société militaire mais sans police, un monde de spéculation, de violence judiciaire, de vendetta. « Trop d'historiens (...) se sont écriés qu'à Rome la corruption, le bakchich et le clientélisme étaient partout, ou encore ils n'en ont rien dit du tout, estimant que ces « abus » n'avaient d'intérêt qu'anecdotique (...). C'est oublier que l'Etat moderne n'est pas la seule forme efficace de domination : un racket, une mafia le sont tout autant » (p 98).
« Les Tranquillisations ». Ce chapitre du livre suffit à en justifier la lecture. Il traite des relations entre la divinité, la philosophie et les sectes. Le dieu singulier (local, national, tutélaire) est d'une race supérieure à la race animale (mortelle, sans raison) et à la race humaine (mortelle, raisonnable). Il appartient tout de même au monde, à une race sexuée, faillible, imprévisible, qui vit ses aventures dans l'indifférence aux races inférieures. Le dieu n'est jamais le maître d'un drame cosmique où l'homme joue son salut. À la rigueur pour les hommes instruits, les dieux dans leur ensemble sont les images ou les facettes d'une Providence ou d'une Fatalité. On les honore comme on honore la Sagesse ou la Cité. Pour qui se respecte, les rites funéraires sont une nécessité consolatrice, mais l'immortalité de l'âme n'est pas un concept raisonnable : « Chez nous, la philosophie est une matière universitaire et une partie de la culture ; c'est un savoir qu'apprennent les étudiants et auquel des personnes cultivées s'intéressent par haute curiosité (...). Chez les Anciens, règles de vie et exercices spirituels étaient l'essence de la « philosophie », non de la religion, et la religion était à peu près séparée des idées sur la mort et sur l'au-delà. Il existait des sectes mais elles étaient philosophiques, car la philosophie était la matière des sectes qui proposaient, aux individus que cela pouvait intéresser, des convictions et des règles de vie ; on se faisait stoïcien ou épicurien et on se conformait plus ou moins à ses convictions, de même que chez nous on est chrétien ou marxiste, avec le devoir de vivre sa foi ou de militer » (p 207-8).
Le cynisme. Le Haut Empire était un monde plus arbitraire et plus inégalitaire que le tiers-monde d'aujourd'hui, une société militaire mais sans police, un monde de spéculation, de violence judiciaire, de vendetta. « Trop d'historiens (...) se sont écriés qu'à Rome la corruption, le bakchich et le clientélisme étaient partout, ou encore ils n'en ont rien dit du tout, estimant que ces « abus » n'avaient d'intérêt qu'anecdotique (...). C'est oublier que l'Etat moderne n'est pas la seule forme efficace de domination : un racket, une mafia le sont tout autant » (p 98).
Ce Paul Veyne s'avère assez décevant.
Ceux qui viennent y chercher une formidable narration de l'antique cité riche en brillantes extrapolations y trouveront un réel plaisir.
Ceux qui, comme moi, pensaient y trouver un réquisitoire contre ce pseudo-Etat islamique seront déçus. La critique est là, mais ce n'est pas le sujet premier de ce livre.
Ceux qui viennent y chercher une formidable narration de l'antique cité riche en brillantes extrapolations y trouveront un réel plaisir.
Ceux qui, comme moi, pensaient y trouver un réquisitoire contre ce pseudo-Etat islamique seront déçus. La critique est là, mais ce n'est pas le sujet premier de ce livre.
Bill Gates était certes féru d'informatique, mais il a surtout été le grand champion de la commercialisation de ses concepts. Son discernement lui a permis d'en inonder la planète et devenir ainsi le maître incontesté du système d'exploitation de l'ordinateur de monsieur-tout-le-monde.
Si je me risque à un préambule aussi décalé pour aborder le sujet développé par l'ouvrage de Paul Veyne Quand notre monde est devenu chrétien, c'est d'une part parce que j'y suis encouragé par l'auteur lui-même, lequel fait à plusieurs reprises dans son ouvrage de tels parallèles aussi hasardeux. Comme par exemple entre le christianisme et le communisme, leur impérialisme sur les esprits et les consciences. Ce qui leur a permis d'atteindre la popularité, certes déclinante, qu'on leur connaît aujourd'hui. Évoquant au passage les mêmes travers qui ont pu pervertir l'une et l'autre doctrine, lorsque la pureté originelle des intentions a été confrontée à la corruption inhérente à la nature humaine.
La seconde raison qui fonde la hardiesse de ma comparaison de ces deux thèmes aux antipodes l'un de l'autre, tant par l'époque qui les vu naître que par la finalité qui les motivent, porte sur le parallèle que je fais de leur intention commune de dominer le monde, l'un matérialiste, l'autre spirituel.
Bill Gates a été le propagateur planétaire de concepts dont il n'était pas forcément l'auteur. Constantin, empereur romain au début du quatrième siècle de notre ère, n'a certes pas été l'inventeur du christianisme, il a été celui qui, du fait de sa position dans le monde, a permis au christianisme, qui vivotait alors, de se répandre à la surface de la planète et devenir ce qu'il est aujourd'hui. Sa conversion en l'an 312, l'intelligence avec laquelle il en a fait la promotion jusqu'à la fin de sa vie, ont été déterminantes pour la survie et l'expansion du christianisme.
Il est vain de se livrer à l'exercice de l'histoire alternative. Paul Veyne, dont le socle de connaissances historiques est pour le moins suffisant, peut quant à lui se risquer à échafauder certaines thèses et nous affirmer que sans le rôle déterminant de l'empereur Constantin, le christianisme ne serait certainement pas ce qu'il est aujourd'hui.
Qui mieux qu'un agnostique pour décoder les événements de ce tournant décisif de l'histoire du monde chrétien. Pour nous faire comprendre comment une secte peut devenir une religion. Je n'ai quant à moi pas l'érudition suffisante pour évaluer ses allégations, mais, séduit que je suis par ses thèses et son talent pour les enseigner, je vais poursuivre mon chemin dans la connaissance de cette sommité en me laissant décrypter par elle Comment on écrit l'histoire. C'est le titre d'un autre de ses ouvrages dont j'ai fait l'acquisition.
Si je me risque à un préambule aussi décalé pour aborder le sujet développé par l'ouvrage de Paul Veyne Quand notre monde est devenu chrétien, c'est d'une part parce que j'y suis encouragé par l'auteur lui-même, lequel fait à plusieurs reprises dans son ouvrage de tels parallèles aussi hasardeux. Comme par exemple entre le christianisme et le communisme, leur impérialisme sur les esprits et les consciences. Ce qui leur a permis d'atteindre la popularité, certes déclinante, qu'on leur connaît aujourd'hui. Évoquant au passage les mêmes travers qui ont pu pervertir l'une et l'autre doctrine, lorsque la pureté originelle des intentions a été confrontée à la corruption inhérente à la nature humaine.
La seconde raison qui fonde la hardiesse de ma comparaison de ces deux thèmes aux antipodes l'un de l'autre, tant par l'époque qui les vu naître que par la finalité qui les motivent, porte sur le parallèle que je fais de leur intention commune de dominer le monde, l'un matérialiste, l'autre spirituel.
Bill Gates a été le propagateur planétaire de concepts dont il n'était pas forcément l'auteur. Constantin, empereur romain au début du quatrième siècle de notre ère, n'a certes pas été l'inventeur du christianisme, il a été celui qui, du fait de sa position dans le monde, a permis au christianisme, qui vivotait alors, de se répandre à la surface de la planète et devenir ce qu'il est aujourd'hui. Sa conversion en l'an 312, l'intelligence avec laquelle il en a fait la promotion jusqu'à la fin de sa vie, ont été déterminantes pour la survie et l'expansion du christianisme.
Il est vain de se livrer à l'exercice de l'histoire alternative. Paul Veyne, dont le socle de connaissances historiques est pour le moins suffisant, peut quant à lui se risquer à échafauder certaines thèses et nous affirmer que sans le rôle déterminant de l'empereur Constantin, le christianisme ne serait certainement pas ce qu'il est aujourd'hui.
Qui mieux qu'un agnostique pour décoder les événements de ce tournant décisif de l'histoire du monde chrétien. Pour nous faire comprendre comment une secte peut devenir une religion. Je n'ai quant à moi pas l'érudition suffisante pour évaluer ses allégations, mais, séduit que je suis par ses thèses et son talent pour les enseigner, je vais poursuivre mon chemin dans la connaissance de cette sommité en me laissant décrypter par elle Comment on écrit l'histoire. C'est le titre d'un autre de ses ouvrages dont j'ai fait l'acquisition.
L'homme au faciès dissymétrique, spécialiste de l'antiquité gréco-romaine, Paul Veyne, l'homme de société qui se défend, se préserve même, d'être homme public, se confie à coeur ouvert dans ce recueil de souvenirs. Il nous dit tout, ou presque, de sa vie privée.
Il a été "communiste sous protection américaine", anticolonialiste par bon sens, soixante-huitard par sympathie pour une jeunesse utopiste. Il est resté sur la réserve à l'égard des pouvoirs politiques successifs et de l'establishment, y compris et surtout dans son domaine universitaire. Mais toujours bienveillant à l'égard des autres et respectueux des avis divergents.
Outre l'antiquité, dont il s'est fait une spécialité, il nous dit sa passion pour la poésie, René Char en particulier, au point d'en retenir des extraits entiers dès la première lecture. Agnostique sans répulsion pour les dévots, précurseur de l'égalité des sexes, il voue aux femmes de sa vie un amour fidèle, une abnégation sans faille, en particulier envers celle qu'il a connue dans la détresse d'un chagrin muet.
On peut faire référence en son domaine, en être glorifié et connaître une vie privée émaillée de drames. Son mérite aura été de les avoir affrontés sans épanchement geignard, ni trahison des siens, encore moins de soi-même.
Belle leçon de vie de la part de ce personnage atypique, au mental comme au physique. Je l'ai découvert dans un échange avec Emmanuel Carrère au cours d'une émission télévisée bien connue des "accros" de littérature. J'ai aimé son parler franc et direct, aux antipodes de la flatterie de son auditoire. Bien sûr mes connaissances comparées me disqualifient pour juger de ses prises de position historique, mais je n'ai pas été déçu par cet ouvrage à la sa sincérité évidente. Il nous fait comprendre que le temps était venu pour lui de l'écrire. le temps de verser dans la confidence à l'égard de ceux à qui, en professeur émérite, il avait destiné ses doctes ouvrages. Se disait-il qu'il leur devait bien cela, à ses fidèles lecteurs ?
Excellent ouvrage qui me donne le goût de faire connaissance avec ses écrits historiques ceux-là. Peut-être même avec René Char, dont cette citation ne serait sans doute pas pour déplaire à Paul Veyne : "Dès lors que les routes de la mémoire se sont couvertes de la lèpre infaillible des monstres, je trouve refuge dans une innocence où l'homme qui rêve ne peut vieillir."
Il a été "communiste sous protection américaine", anticolonialiste par bon sens, soixante-huitard par sympathie pour une jeunesse utopiste. Il est resté sur la réserve à l'égard des pouvoirs politiques successifs et de l'establishment, y compris et surtout dans son domaine universitaire. Mais toujours bienveillant à l'égard des autres et respectueux des avis divergents.
Outre l'antiquité, dont il s'est fait une spécialité, il nous dit sa passion pour la poésie, René Char en particulier, au point d'en retenir des extraits entiers dès la première lecture. Agnostique sans répulsion pour les dévots, précurseur de l'égalité des sexes, il voue aux femmes de sa vie un amour fidèle, une abnégation sans faille, en particulier envers celle qu'il a connue dans la détresse d'un chagrin muet.
On peut faire référence en son domaine, en être glorifié et connaître une vie privée émaillée de drames. Son mérite aura été de les avoir affrontés sans épanchement geignard, ni trahison des siens, encore moins de soi-même.
Belle leçon de vie de la part de ce personnage atypique, au mental comme au physique. Je l'ai découvert dans un échange avec Emmanuel Carrère au cours d'une émission télévisée bien connue des "accros" de littérature. J'ai aimé son parler franc et direct, aux antipodes de la flatterie de son auditoire. Bien sûr mes connaissances comparées me disqualifient pour juger de ses prises de position historique, mais je n'ai pas été déçu par cet ouvrage à la sa sincérité évidente. Il nous fait comprendre que le temps était venu pour lui de l'écrire. le temps de verser dans la confidence à l'égard de ceux à qui, en professeur émérite, il avait destiné ses doctes ouvrages. Se disait-il qu'il leur devait bien cela, à ses fidèles lecteurs ?
Excellent ouvrage qui me donne le goût de faire connaissance avec ses écrits historiques ceux-là. Peut-être même avec René Char, dont cette citation ne serait sans doute pas pour déplaire à Paul Veyne : "Dès lors que les routes de la mémoire se sont couvertes de la lèpre infaillible des monstres, je trouve refuge dans une innocence où l'homme qui rêve ne peut vieillir."
Comment faire la plus attirante et belle introduction à un livre scientifique?
En méditant sur la plèbe et l'émergence des classes moyennes: tout est affaire de plebs sordida et media. (l'introduction est disponible gratuitement en ligne).
Comment conjuguer littérature et histoire?
En analysant la vie de Trimalcion dans un éblouissant premier chapitre.
Par cet ouvrage résonnera encore longtemps le difforme et prodigieux Paul Veyne... Ce sera lui, pour l'éternité, la société romaine.
En méditant sur la plèbe et l'émergence des classes moyennes: tout est affaire de plebs sordida et media. (l'introduction est disponible gratuitement en ligne).
Comment conjuguer littérature et histoire?
En analysant la vie de Trimalcion dans un éblouissant premier chapitre.
Par cet ouvrage résonnera encore longtemps le difforme et prodigieux Paul Veyne... Ce sera lui, pour l'éternité, la société romaine.
Livre un peu difficile qui se mérite par son sujet: Comment par la volonté d'un seul homme un courant de pensée somme toute élitiste et terriblement intellectuel devint une religion de masse qu'il fallut alors adapter au plus grand nombre.
Ce livre historique remet les choses en place en toute honnêteté et décrit sans aucun apriori le contexte historique de l'avènement de la religion chrétienne par la décision de l'empereur Constantin par l'édit de milan en 312. Paul Veyne nous présente d'une manière précise et bien écrite la volonté politique de Constantin et se servir de cette nouvelle religion pour assoir son pouvoir. Tout personne se posant la question fondamentale de ce qu'est une religion et notamment la religion chrétienne doit lire se livre car derrière chaque religion il y a un grand homme et des buts non avoués car çà c'est de l'histoire et non de la croyance qui est autre chose.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur
Auteurs proches de Paul Veyne
Lecteurs de Paul Veyne (1039)Voir plus
Quiz
Voir plus
Histoire et civilisation grecque antique
Quel nom donne t-on à la grande place publique présente dans chaque cité grecque ?
L'agora
L'acropole
Le temenos
La pnyx
12 questions
416 lecteurs ont répondu
Créer un quiz sur cet auteur416 lecteurs ont répondu