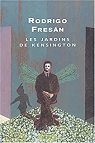Critiques de Rodrigo Fresan (47)
Il existe des livres dont parler semble vain ;
parmi eux, La Vitesse des choses ;
doué d'une substance dont l'encre et le papier ne peuvent complètement rendre compte ;
une vibration sourde, un fond diffus primordial, un avant-après insaisissable ;
ce qui se rapprocherait le plus de cette théorie quantique ;
non, les choses n'ont pas une existence magique ou relative ;
elles sont simplement trop rapides pour qu'une conscience ne passe par là sans les influencer.
…
Que faire de tout ceci ?
Vous aimez les nouvelles ?
Cela tombe bien, moi non plus.
…
Il faudrait trouver, comme là, ce ton juste, pour parler de la mort, de la fin, comme celle qui se vit à la fermeture de ce livre des morts, sans que l'on puisse parler à votre oreille.
…
On pourrait la laisser passer, l'oublier, se gausser d'une ambition qui finira par disparaître ;
or la Vitesse des choses continuera sans nous, quoiqu'il arrive dans cette boite.
…
La parole se libérera lorsque les temps s'inverseront ;
dès lors que le livre « Mantra », sa suite commencée bien avant, permettra d'y voir un peu plus clair, et d'y retourner.
…
Temps cyclique ou linéaire, simultanéité des singularités, ne partez pas…
Voici les fantômes de Beckett et Bolaño qui jouent au polo, captivés qu'ils sont de rouler encore comme cette balle, celle d'un écrivain qui arrive à nous parler de choses impossibles mais réelles ;
sans que le temps ne puisse s'écouler normalement ;
sans que l'agacement de l'expérience jamais ne se présente ;
la fin de toute chose ne s'approchant irrémédiablement.
…
La Vitesse des choses.
parmi eux, La Vitesse des choses ;
doué d'une substance dont l'encre et le papier ne peuvent complètement rendre compte ;
une vibration sourde, un fond diffus primordial, un avant-après insaisissable ;
ce qui se rapprocherait le plus de cette théorie quantique ;
non, les choses n'ont pas une existence magique ou relative ;
elles sont simplement trop rapides pour qu'une conscience ne passe par là sans les influencer.
…
Que faire de tout ceci ?
Vous aimez les nouvelles ?
Cela tombe bien, moi non plus.
…
Il faudrait trouver, comme là, ce ton juste, pour parler de la mort, de la fin, comme celle qui se vit à la fermeture de ce livre des morts, sans que l'on puisse parler à votre oreille.
…
On pourrait la laisser passer, l'oublier, se gausser d'une ambition qui finira par disparaître ;
or la Vitesse des choses continuera sans nous, quoiqu'il arrive dans cette boite.
…
La parole se libérera lorsque les temps s'inverseront ;
dès lors que le livre « Mantra », sa suite commencée bien avant, permettra d'y voir un peu plus clair, et d'y retourner.
…
Temps cyclique ou linéaire, simultanéité des singularités, ne partez pas…
Voici les fantômes de Beckett et Bolaño qui jouent au polo, captivés qu'ils sont de rouler encore comme cette balle, celle d'un écrivain qui arrive à nous parler de choses impossibles mais réelles ;
sans que le temps ne puisse s'écouler normalement ;
sans que l'agacement de l'expérience jamais ne se présente ;
la fin de toute chose ne s'approchant irrémédiablement.
…
La Vitesse des choses.
Avant de vous parler de « La Vitesse des choses », j'aurais peut-être eu intérêt à évoquer « Mantra », mais j'aurais sûrement raté quelque chose… Un livre écrit avant (et après) l'autre, mais sorti plus tard tout en l'annonçant à l'avance… un peu compliqué tout cela…
...
Rassurons nous, le grand Enrique Vila-Matas est là pour tout nous expliquer, dans sa préface de la Vitesse des choses, qu'il aurait mieux fait d'écrire avant celle d'Alan Pauls, ouvrant le présent Mantra.
L'espagnol ayant l'air plus à l'aise que l'argentin au pays des singularités.
Autant, il ne me parait pas du tout nécessaire d'avoir lu l'un avant l'autre pour s'y retrouver. Je pense même qu'il faudrait essayer de les lire en même temps, un pour chaque hémisphère.
Alan Pauls donne l'impression d'avoir entre ses mains gantées de blanc un livre lui brulant les doigts, nous donnant quelques pistes d'interprétations plutôt bancales, avant de carrément s'écraser, employant le désormais fameux point « Lynch-Marley »*, pratique écran de fumée lorsque l'on a rien compris…
De mon côté, je ne vous engage à fumer quoique ce soit lors de la lecture de ce livre. À la rigueur, le port d'un masque de catch, ou la mastication d'une poignée de jalapeños pourraient aider… mais la seule chose comptant vraiment reste de bien se souvenir de son alphabet, et d'accepter la Vitesse des choses comme source de mouvement universel en littérature.
…
Avez-vous déjà vu Mexico ?
L'auteur non plus.
D'ailleurs, c'est sûrement lui qui y détruira la première pierre, après y avoir déterré tout un cimetière aztèque, se sacrifiant à notre place sur l'autel du dieu Soleil.
La date du prochain tremblement de terre y est déjà connue, mais tout le monde l'a encore oubliée.
…
Philip K. Dick n'a toujours pas rendu ses lunettes à Stanley Kubrick.
Roberto Bolaño a fini par prêter sa voix à la bande-originale ; il y a même écrit un joli petit poème avec des enfants qui vont mourrir ; et personne n'a pensé à le pousser dans cette piscine ; celle où la fille n'en finit plus de tomber dedans.
La famille Mantra a vraiment de drôles de manières, mais je ferais mieux d'arrêter d'en parler.
…
Je vous avais sûrement promis d'y comprendre quelque chose, et je pense bien ne pas vous avoir menti, non ?
…
* Point « Lynch-Marley » :
tel son cousin le point Goodwin pour ce qui est de son occurence, le point « Lynch-Marley », ( nommé d'après ces deux grands artistes incompris que sont David Lynch et Bob Marley ) désigne tout discours appelant à l'univers supposé du premier, ou bien se référant à ce que fumait le second, soulignant ainsi la faiblesse d'abstraction de l'individu l'employant.
Leur agrégation en un seul événement langagier nous a semblé inévitable : bien que leurs sources soient, vous en conviendrez, fort éloignées, leurs finalités s'y télescopent.
...
Rassurons nous, le grand Enrique Vila-Matas est là pour tout nous expliquer, dans sa préface de la Vitesse des choses, qu'il aurait mieux fait d'écrire avant celle d'Alan Pauls, ouvrant le présent Mantra.
L'espagnol ayant l'air plus à l'aise que l'argentin au pays des singularités.
Autant, il ne me parait pas du tout nécessaire d'avoir lu l'un avant l'autre pour s'y retrouver. Je pense même qu'il faudrait essayer de les lire en même temps, un pour chaque hémisphère.
Alan Pauls donne l'impression d'avoir entre ses mains gantées de blanc un livre lui brulant les doigts, nous donnant quelques pistes d'interprétations plutôt bancales, avant de carrément s'écraser, employant le désormais fameux point « Lynch-Marley »*, pratique écran de fumée lorsque l'on a rien compris…
De mon côté, je ne vous engage à fumer quoique ce soit lors de la lecture de ce livre. À la rigueur, le port d'un masque de catch, ou la mastication d'une poignée de jalapeños pourraient aider… mais la seule chose comptant vraiment reste de bien se souvenir de son alphabet, et d'accepter la Vitesse des choses comme source de mouvement universel en littérature.
…
Avez-vous déjà vu Mexico ?
L'auteur non plus.
D'ailleurs, c'est sûrement lui qui y détruira la première pierre, après y avoir déterré tout un cimetière aztèque, se sacrifiant à notre place sur l'autel du dieu Soleil.
La date du prochain tremblement de terre y est déjà connue, mais tout le monde l'a encore oubliée.
…
Philip K. Dick n'a toujours pas rendu ses lunettes à Stanley Kubrick.
Roberto Bolaño a fini par prêter sa voix à la bande-originale ; il y a même écrit un joli petit poème avec des enfants qui vont mourrir ; et personne n'a pensé à le pousser dans cette piscine ; celle où la fille n'en finit plus de tomber dedans.
La famille Mantra a vraiment de drôles de manières, mais je ferais mieux d'arrêter d'en parler.
…
Je vous avais sûrement promis d'y comprendre quelque chose, et je pense bien ne pas vous avoir menti, non ?
…
* Point « Lynch-Marley » :
tel son cousin le point Goodwin pour ce qui est de son occurence, le point « Lynch-Marley », ( nommé d'après ces deux grands artistes incompris que sont David Lynch et Bob Marley ) désigne tout discours appelant à l'univers supposé du premier, ou bien se référant à ce que fumait le second, soulignant ainsi la faiblesse d'abstraction de l'individu l'employant.
Leur agrégation en un seul événement langagier nous a semblé inévitable : bien que leurs sources soient, vous en conviendrez, fort éloignées, leurs finalités s'y télescopent.
Post-magique et néo-pop, schizo-critique et logico-chaotique, irréaliste-virtuelle et comico-paranoïde, l'oeuvre de l'argentin Rodrigo Fresán, l'une des plus brillantes, originales et jouissives de la postmodernité latino-américaine, invite le lecteur à un jeu de rapprochements et de syncrétismes inouïs et amusants entre éléments d'ordre divers entrant dans sa composition – historiques et symboliques, imaginaires et iconographiques, oniriques et factuels - dont l'agencement définitif impliquerait d'ailleurs, à l'instar des expériences mettant en oeuvre des particules subatomiques en accélération, une participation active de la part de son observateur-lecteur...
Décapant au vitriol de vieux mythes fondateurs de la culture populaire argentine, dans lesquels le lugubre côtoie volontiers le pathétique et le tragicomique, tout en les remixant de manière décomplexée avec les sonorités et les «vibes» d'une modernité tapageuse et cacophonique, ou bien en exhumant des épisodes traumatiques de l'histoire nationale vis-à-vis desquels le tissu de la mémoire collective, oblitéré par effraction, résiste toujours à subir une greffe définitive de repentir envers leurs victimes, la réactualisant en même temps sous la forme d'un «retour du refoulé» dans la subjectivité et dans les névroses actuelles de ses personnages borderline, Rodrigo Fresán bâtit une oeuvre qui, sous une surface en apparence déjantée, fractionnaire, désinvolte, très souvent dérisoire et comique, propose une approche critique des effets de déréliction provoqués par une société globalisée, multi-compartimentée, volubile et narcissique, assénant aux individus, à l'aube du troisième millénaire et au nom d'une postmodernité faisant table rase de tout héritage légué par le passé, la promesse d'un bonheur nouveau dérivé essentiellement d'un état de «présentification» permanente, sorte d'ataraxie à la portée de tous, aux ramifications virtuelles inépuisables et immédiates, et dont les corollaires inévitables seront un sentiment insidieux de vide et de mal-être, de désappropriation et de désinvestissement de la réalité environnante.
«Esperanto porta son attention sur l'écran du téléviseur. M.T.V. Couleur. Noir et blanc. Ralenti et accéléré. Nichons et culs. Rires et larmes. Chair, os et dessins animés. U.K. et U.S.A. Guitares acoustiques et guitares électriques. Village planétaire et fin de millénaire. Messages universalistes et messages codés pour une minorité sélecte dont les neurones avaient eu le bonheur de syntoniser les derniers quarts d'heure de gloire. Rien ne finissait parce que rien ne semblait avoir commencé. Jamais on ne parvenait à faire le tour d'une idée parce que ce qui importait ici c'était d'épuiser les possibilités sans en écarter aucune. Accumuler vide sur vide. Elvis aurait déchargé toutes les balles et la grande fureur de son .38 sur le téléviseur. Sans hésiter une seconde. Sans arrêter d'engloutir des pastilles de couleur et des tonneaux de poulet rôti.»
Puisant directement dans les codes, dans le réservoir d'icônes et dans le langage même forgés par une modernité qu'il essaie de décortiquer de l'intérieur, l'auteur aspire en quelque sorte, à l'instar de l'héros mythique de son enfance et adolescence, Lawrence d'Arabie, - selon lui paradigme absolu en la matière-, à se situer en même temps «dedans et dehors», sur les bords pour ainsi dire de son propos et de ses avatars littéraires, projections auxquelles il donnera corps, à la fois sous les auspices de cette maxime poétique qui voudrait que «je est toujours un autre» et sans les faire se départir complètement de ce regard aiguisé sur soi et sur le monde qui rend conscient du fait qu'il subsistera toujours une part d'imaginaire et d'illusion dans nos certitudes les plus solides et les mieux ancrées.
C'est ainsi, aussi, que la réalité elle-même apparaît dans son oeuvre souvent «en transit», comme suspendue entre différents registres, se nourrissant frugalement des visions éphémères et de la distanciation «brechtienne» pratiquée par moments par ses personnages, tamisée par des digressions métaphysiques ou des parenthèses oniriques insérées par l'auteur, miroir parfait en tout cas pour les anti-héros de Fresán, losers dans l'âme, très attachants, eux aussi «arrêtés sur image», «êtres coincés entre un endroit ou un autre», rattrapés régulièrement par les fantômes de leur passé, subissant un présent qu'ils ne maîtrisent plus, et chérissant au fond d'eux-mêmes l'espoir d'une évasion possible face aux «canciones tristes» (« chansons tristes ») qui, pour reprendre une métaphore au diapason de l'univers musical omniprésent dans le livre, gravées sur de vieux vinyles rayés par le regret et le ressentiment, tournent en boucle dans les esprits désenchantés par l'entropie du monde et de leur existence propre.
« Simpla, fleksebla, praktiva, solva de la problema de universala interkompreno, Esperanto meritas seriosan konsideron». «Inter-langue universelle», créée en 1887 par le polonais Lazarus Ludwig Zamenhof, archi-morte depuis, emblématique s'il en est, de l'échec d'une certaine conception de l'universalisme paradoxalement de moins en moins opérante sur le terrain à mesure que le monde se serait transformé progressivement, selon l'expression consacrée, en un immense «village global», «Esperanto» donne le titre à ce qu'on considère comme le vrai « premier roman » publié de l'auteur (1995) - « Histoire Argentine », premier livre édité de Rodrigo Fresán, consistant plutôt, il est vrai, en un drôle de mouton à cinq pattes, ni tout à fait roman, ni simplement recueil de nouvelles.
Federico Esperanto, lui, issu du cercle réduit de ces familles «porteñas» traditionnelles dont les ancêtres firent partie des pères fondateurs de la nation argentine, ancienne rock-star de années 70, auteur d'un tube planétaire, « Les Intermittences du coeur», ne se sent pourtant, malgré tout le poids symbolique de son nom, «compris de personne»!
Le roman retrace, jour par jour, une semaine particulière dans sa vie, «une de ces semaines» pendant lesquelles tout semble basculer, où le passé refait violemment surface et le présent se disloque sans appel. À la fin, émergeant enfin le dimanche d'après du cauchemar qu'était devenue sa vie, Esperanto entendra retentir dans sa tête le motif de Marius Constant composé pour la mythique série télévisée de son enfance, juste avant de visualiser l'image de Rod Sterling annonçant l'épisode d'un homme «fatigué de courir en rond et auquel il ne restait plus que se lancer dans la quatrième dimension».
Truffé de références à l'imaginaire populaire urbain et à l'industrie culturelle de masse du XXe – notamment de citations musicales autour de l'univers pop et rock n'roll -, parcouru par une galerie de personnages singuliers, pour la plupart drolatiques et hauts en couleur (parmi lesquels l'on pourrait évoquer son associé et ami proche, La Montaña Garcia, publicitaire gigantesque obsédé par l'utilisation musicale de ses flatulences, l'une de ses ex-femmes, ancienne top-modèle habitée par des délires mystiques, son psychanalyste, Dr Lombroso, pâtissant lui aussi des stigmates d'un patronyme prédestiné, un vieil oncle spécialiste de sciences occultes, un ex-tortionnaire amateur de disco ou le jeune demi-frère décérébré et idole de séries télévisées argentines pour ados...), ESPERANTO est une expérience de lecture absolument jubilatoire, un premier roman qui préfigure la construction à la fois cérébrale et survoltée des grands romans qui consolideraient quelques années plus tard la renommée hors frontières de l'auteur, dont notamment «Mantra»(2006) et «La Vitesse des Choses» (2008).
Décapant au vitriol de vieux mythes fondateurs de la culture populaire argentine, dans lesquels le lugubre côtoie volontiers le pathétique et le tragicomique, tout en les remixant de manière décomplexée avec les sonorités et les «vibes» d'une modernité tapageuse et cacophonique, ou bien en exhumant des épisodes traumatiques de l'histoire nationale vis-à-vis desquels le tissu de la mémoire collective, oblitéré par effraction, résiste toujours à subir une greffe définitive de repentir envers leurs victimes, la réactualisant en même temps sous la forme d'un «retour du refoulé» dans la subjectivité et dans les névroses actuelles de ses personnages borderline, Rodrigo Fresán bâtit une oeuvre qui, sous une surface en apparence déjantée, fractionnaire, désinvolte, très souvent dérisoire et comique, propose une approche critique des effets de déréliction provoqués par une société globalisée, multi-compartimentée, volubile et narcissique, assénant aux individus, à l'aube du troisième millénaire et au nom d'une postmodernité faisant table rase de tout héritage légué par le passé, la promesse d'un bonheur nouveau dérivé essentiellement d'un état de «présentification» permanente, sorte d'ataraxie à la portée de tous, aux ramifications virtuelles inépuisables et immédiates, et dont les corollaires inévitables seront un sentiment insidieux de vide et de mal-être, de désappropriation et de désinvestissement de la réalité environnante.
«Esperanto porta son attention sur l'écran du téléviseur. M.T.V. Couleur. Noir et blanc. Ralenti et accéléré. Nichons et culs. Rires et larmes. Chair, os et dessins animés. U.K. et U.S.A. Guitares acoustiques et guitares électriques. Village planétaire et fin de millénaire. Messages universalistes et messages codés pour une minorité sélecte dont les neurones avaient eu le bonheur de syntoniser les derniers quarts d'heure de gloire. Rien ne finissait parce que rien ne semblait avoir commencé. Jamais on ne parvenait à faire le tour d'une idée parce que ce qui importait ici c'était d'épuiser les possibilités sans en écarter aucune. Accumuler vide sur vide. Elvis aurait déchargé toutes les balles et la grande fureur de son .38 sur le téléviseur. Sans hésiter une seconde. Sans arrêter d'engloutir des pastilles de couleur et des tonneaux de poulet rôti.»
Puisant directement dans les codes, dans le réservoir d'icônes et dans le langage même forgés par une modernité qu'il essaie de décortiquer de l'intérieur, l'auteur aspire en quelque sorte, à l'instar de l'héros mythique de son enfance et adolescence, Lawrence d'Arabie, - selon lui paradigme absolu en la matière-, à se situer en même temps «dedans et dehors», sur les bords pour ainsi dire de son propos et de ses avatars littéraires, projections auxquelles il donnera corps, à la fois sous les auspices de cette maxime poétique qui voudrait que «je est toujours un autre» et sans les faire se départir complètement de ce regard aiguisé sur soi et sur le monde qui rend conscient du fait qu'il subsistera toujours une part d'imaginaire et d'illusion dans nos certitudes les plus solides et les mieux ancrées.
C'est ainsi, aussi, que la réalité elle-même apparaît dans son oeuvre souvent «en transit», comme suspendue entre différents registres, se nourrissant frugalement des visions éphémères et de la distanciation «brechtienne» pratiquée par moments par ses personnages, tamisée par des digressions métaphysiques ou des parenthèses oniriques insérées par l'auteur, miroir parfait en tout cas pour les anti-héros de Fresán, losers dans l'âme, très attachants, eux aussi «arrêtés sur image», «êtres coincés entre un endroit ou un autre», rattrapés régulièrement par les fantômes de leur passé, subissant un présent qu'ils ne maîtrisent plus, et chérissant au fond d'eux-mêmes l'espoir d'une évasion possible face aux «canciones tristes» (« chansons tristes ») qui, pour reprendre une métaphore au diapason de l'univers musical omniprésent dans le livre, gravées sur de vieux vinyles rayés par le regret et le ressentiment, tournent en boucle dans les esprits désenchantés par l'entropie du monde et de leur existence propre.
« Simpla, fleksebla, praktiva, solva de la problema de universala interkompreno, Esperanto meritas seriosan konsideron». «Inter-langue universelle», créée en 1887 par le polonais Lazarus Ludwig Zamenhof, archi-morte depuis, emblématique s'il en est, de l'échec d'une certaine conception de l'universalisme paradoxalement de moins en moins opérante sur le terrain à mesure que le monde se serait transformé progressivement, selon l'expression consacrée, en un immense «village global», «Esperanto» donne le titre à ce qu'on considère comme le vrai « premier roman » publié de l'auteur (1995) - « Histoire Argentine », premier livre édité de Rodrigo Fresán, consistant plutôt, il est vrai, en un drôle de mouton à cinq pattes, ni tout à fait roman, ni simplement recueil de nouvelles.
Federico Esperanto, lui, issu du cercle réduit de ces familles «porteñas» traditionnelles dont les ancêtres firent partie des pères fondateurs de la nation argentine, ancienne rock-star de années 70, auteur d'un tube planétaire, « Les Intermittences du coeur», ne se sent pourtant, malgré tout le poids symbolique de son nom, «compris de personne»!
Le roman retrace, jour par jour, une semaine particulière dans sa vie, «une de ces semaines» pendant lesquelles tout semble basculer, où le passé refait violemment surface et le présent se disloque sans appel. À la fin, émergeant enfin le dimanche d'après du cauchemar qu'était devenue sa vie, Esperanto entendra retentir dans sa tête le motif de Marius Constant composé pour la mythique série télévisée de son enfance, juste avant de visualiser l'image de Rod Sterling annonçant l'épisode d'un homme «fatigué de courir en rond et auquel il ne restait plus que se lancer dans la quatrième dimension».
Truffé de références à l'imaginaire populaire urbain et à l'industrie culturelle de masse du XXe – notamment de citations musicales autour de l'univers pop et rock n'roll -, parcouru par une galerie de personnages singuliers, pour la plupart drolatiques et hauts en couleur (parmi lesquels l'on pourrait évoquer son associé et ami proche, La Montaña Garcia, publicitaire gigantesque obsédé par l'utilisation musicale de ses flatulences, l'une de ses ex-femmes, ancienne top-modèle habitée par des délires mystiques, son psychanalyste, Dr Lombroso, pâtissant lui aussi des stigmates d'un patronyme prédestiné, un vieil oncle spécialiste de sciences occultes, un ex-tortionnaire amateur de disco ou le jeune demi-frère décérébré et idole de séries télévisées argentines pour ados...), ESPERANTO est une expérience de lecture absolument jubilatoire, un premier roman qui préfigure la construction à la fois cérébrale et survoltée des grands romans qui consolideraient quelques années plus tard la renommée hors frontières de l'auteur, dont notamment «Mantra»(2006) et «La Vitesse des Choses» (2008).
Fiction biographique inspirée par la vie et l'oeuvre d'un des plus grands écrivains américains de tous temps, Herman Melville, peuplée cependant majoritairement par des fantômes et des visions chimériques plutôt que par de vrais personnages en chair et os.
Roman formellement exigeant et osé, construit comme un jeu de miroirs dans lequel les niveaux de narration s'enchevêtrent, créant des compositions virtuoses, quelquefois déconcertantes pour les capacités de discrimination cognitive bousculées du lecteur, ou bien s'amusant à le dérouter, lorsque ce dernier, par exemple, jugeant commencer enfin à s'habituer aux ruptures régulières de rythme et aux différentes voix narratives proposées par l'auteur, verra un peu étonné l'une de celles-ci prendre les rênes, s'élevant par un élan littéro-acrobatique, pour sauter sans crier gare d'une note de bas de page et s'emparer seule du texte principal !
Exégèse érudite et très personnelle de l'oeuvre de Melville (et plus particulièrement de son «chef» absolu, «Moby Dick», cétacé le plus célèbre de la littérature mondiale !), proposant une hypothèse originale, fictive - quoique pas tout à fait improbable !- sur ce qui aurait pu être à l'origine de la vocation littéraire de Herman Melville et s'inspirant d'un souvenir d'enfance attesté par ses biographes : la traversée épique réalisée par le père de l'écrivain, à pied, lors d'une nuit glaciale du mois de décembre 1831, du lit gelé du fleuve Hudson, afin de regagner sur la rive opposée le domicile de la famille à Albany, juste avant de tomber gravement malade d'une pneumonie et de décéder par la suite, après plus d'un mois de délires fiévreux ayant amené l'entourage proche et les médecins à conclure entretemps qu'il avait définitivement «perdu la raison».
Fresán imagine Herman Melville, âgé de 12 ans à ce moment-là, au chevet de son père, Allan Melvill (sans «e», voyelle rajoutée par la mère après le décès de son mari, supposant pouvoir de cette manière, au-delà d'apporter une touche chic et «francisante» au patronyme, suite aux très nombreuses dettes laissées par son défunt mari, surtout «éviter et désorienter ses créanciers» !).
L'enfant consignera alors scrupuleusement, sur un cahier, les divagations et propos saugrenus de son père. Ce dernier, tout en mêlant souvenirs de jeunesse, visions hallucinées et fantasmes personnels à sa traversée récente de l'Hudson gelé, échafaudera une étrange construction délirante autour des propriétés de la glace, qu'il appelle le «Gelum melvillium» .
Sans savoir alors que cette expérience serait plus tard déterminante dans la genèse d'une oeuvre littéraire magistrale, très en avance par rapport à son époque, longtemps dédaignée par la critique et considérée à son tour comme relevant d'un esprit dérangé, Herman Melville, ou plutôt son fantôme, ou son esprit «incorporé» par Fresán (sa compatriote Mariana Enriquez définit le roman, dans une citation reproduite en quatrième de couverture, comme étant le résultat d'une «séance» de spiritisme !) rédige, ou plutôt «rédigent», depuis un «présent continu» détaché de références chronologiques précises, un récit biographique qu'on pourrait dans le meilleur des cas situer dans une sorte de « futur du passé composé », et dans lequel, entre autres, tout en revenant en arrière depuis un présent donc «non spécifié», le futur et la postérité de l'écrivain auraient été pressenties, préconfigurées avant même que celui-ci ait véritablement commencé à écrire (Gloups.. !)
C'est ainsi qu'après une vie marquée par des échecs à répétition, sans avoir jamais réussi aucun des exploits auxquels il s'était pourtant senti prédestiné durant sa jeunesse, Melvill père, voyant ses jours approcher leur terme, semblerait implorer à son fils de noter ce qu'il entend (un récit magnifié des aventures extraordinaires vécues soi-disant par le père lors d'un tour en Europe durant ses jeunes années) pour, dit-il, «qu'à l'avenir, il commence une histoire qu'[il] écrira au présent tout en regardant en arrière, mais en voyant les mots se précipiter en avant» afin que le père puisse au moins, couché sur le papier, «être écrit», dans l'espoir «que cette déposition, si elle ne le dédouane pas, le libère, lui donne un sens, une explication et une raison d'être».
Depuis la publication d'«HISTOIRE ARGENTINE» (1991), Rodrigo Fresán bâtit une oeuvre singulière et irrévérente, très critique vis-à-vis des dérives de la postmodernité et en même temps pratiquant volontiers un forme très salutaire d'autodérision.
L'auteur réussit à chaque fois à nous surprendre par des histoires tenues en équilibre entre ce qu'il appelle «les bords» de la réalité, manifestant un sens quasiment intuitif de l'instantanéité de l'écriture, proposant des récits « en train de s'écrire » d'une façon absolument pas artificielle, « abstraite », d'une écriture cursive, très ludique et pleine d'humour. Grâce à ce style original de raconter une histoire, auteur, personnages et lecteurs accèdent à une sorte de «zone frontalière» : l'auteur s'y voit de l'extérieur en train de l'écrire, ou bien, si l'envie lui prend, n'hésite pas à sauter ponctuellement dedans et à se placer parmi ses personnages ; les personnages de leur côté sont parfois invités à s'en extraire et à se regarder depuis l'autre bord, d'en infléchir le cours, par exemple, ou d'en prendre provisoirement les commandes ; le lecteur, lui, avançant sur tous les fronts à la fois, a le sentiment royal, exaltant, telle Alice, excentré et décentré, de passer tout à fait de l'autre côté du miroir !
Dans un registre nouveau ici (pour moi), celui de la fiction biographique, Rodrigo Fresán tente d'identifier à partir d'un épisode particulier, la traversée d'une rive à l'autre de l'Hudson gelé, et dans une métaphore récurrente et abondamment déclinée, de la transparence de la glace et de la blancheur du paysage l'entourant, le noeud imaginaire fondamental à l'origine d'une oeuvre littéraire.
Je dois avouer que cet exercice me laissera plutôt perplexe. Quoique très admiratif devant l'audace de sa construction formelle, ainsi que par les envols toujours inspirés de la prose de Rodrigo Fresán, globalement, en tant que lecteur, j'ai eu trop souvent le sentiment d'être largué au milieu du gué, en l'occurrence au milieu d'un fleuve gelé, très cérébral, au lieu de me retrouver, comme d'habitude placé confortablement sur «les bords» du récit. Je n'y ai retrouvé qu'à de trop rares occasions cette sensation agréable éprouvée lors de mes lectures précédentes de l'auteur, celle de contempler à perte de vue, et avec une grande clarté de vue en même temps, un paysage imaginaire curieux et exotique sans me sentir aucunement perdu ou dépaysé...
Un degré très élevé d'expérimentation formelle, pas toujours justifiée à mes yeux -notamment pendant toute la première partie du livre, où à pratiquement chaque paragraphe viennent systématiquement se greffer des notes de bas de page la plupart du temps très bavardes, infléchissant et multipliant sans raison apparente les commentaires et les focalisations-, gênant ma lecture et impactant par ailleurs sévèrement l'effort d'immersion nécessaire pour essayer d'adhérer à l'incorporéité fantomatique qui semble traverser tout le roman; une ambition radicale à ne considérer la réalité que comme «un outil de la fiction », à vouloir la mettre tout le temps sur le même plan qu'une omniprésente « entéléchie délirante», à abolir toute frontière historique ou chronologique dans les visions et hallucinations des deux personnages, contribuant à augmenter chez le lecteur cette sensation d'immatérialité qu'on vient d'évoquer se dégageant du récit, m'ont finalement amené à me demander sérieusement si, consciemment ou inconsciemment, volontairement ou involontairement, Rodrigo Fresán n'aurait cherché à écrire lui aussi un livre risquant d'être jugé « incompréhensible» ou de déplaire certains de ses potentiels lecteurs, « les lecteurs de son temps »? À l'instar de son modèle vénéré, Herman Melville, trop collé à lui, reprenant, pourquoi pas, sur son compte, dans son propre roman, une composante même de la névrose d'échec héritée par Melville de son père, en même temps que certains des mécanismes de compensation auxquels les uns et les autres auraient pu faire appel pour essayer d'y faire face...? (Ou au fond délirerais-je peut-être, moi aussi... ???)
« Incapable d'écrire autrement – ne fait-il dire après tout à Melville – ma signature serait condamnée à devenir un spécimen confus, peu abouti, indomptable (...) taxée d'incompréhensible par les critiques, genre de plumitifs qui attaquent tout texte un tant soit peu talentueux, le talent qu'ils n'auront jamais, raison pour laquelle ils finissent par devenir des critiques méprisant les dons d'autrui, car tel est leur seul talent »
(Re-gloups : Ne serait-ce par hasard ce que je serais en train de faire là avec cette critique !?)
( Sacré Fresán !!!)
Toujours est-il que, à l'image du texte que je reproduirai ci-dessous, à titre d'illustration et en concluant (enfin !) ce billet où j'espère très sincèrement ne pas figurer dans un rôle de « mauvais critique », moi aussi (toute l'admiration que je voue à Fresán, je tiens à le préciser, reste pour moi absolument inentamée après cette lecture!), ou dans celui d'un drôle de spécimen aussi, « fan-pire » de base (« fantôme et vampire ») de ce même Fresán (!)... enfin, toujours est-il, disais-je, que quand il me fallait lire et relire plusieurs fois des passages tel celui qui suit à titre d'exemple, j'avoue que je ne savais plus très bien sur quel bord me situer :
« Oh, ce qu'on redoute le plus, je le répète, c'est la distance entre le point de départ et la destination finale. La vie vulnérable considérée comme une traversée où ne manquent ni les tempêtes jouissives, ni les plages de calme désespérant. Ce qui viendra et qui est survenu quand et là où (du début vers la fin, déjà) le bonheur présent dépend autant du passé venant jusqu'ici que du futur partant par là-bas, en sachant que si on ne le manie pas avec une extrême prudence, le passé peut devenir le livre d'heures des tyrans et le futur la bible des hommes libres».
CQFD ?
(* «Ici et maintenant », en tout cas, je tiens à remercier vivement l'opération Masse Critique de Babelio et les Editions du Seuil pour l'envoi du livre)
Roman formellement exigeant et osé, construit comme un jeu de miroirs dans lequel les niveaux de narration s'enchevêtrent, créant des compositions virtuoses, quelquefois déconcertantes pour les capacités de discrimination cognitive bousculées du lecteur, ou bien s'amusant à le dérouter, lorsque ce dernier, par exemple, jugeant commencer enfin à s'habituer aux ruptures régulières de rythme et aux différentes voix narratives proposées par l'auteur, verra un peu étonné l'une de celles-ci prendre les rênes, s'élevant par un élan littéro-acrobatique, pour sauter sans crier gare d'une note de bas de page et s'emparer seule du texte principal !
Exégèse érudite et très personnelle de l'oeuvre de Melville (et plus particulièrement de son «chef» absolu, «Moby Dick», cétacé le plus célèbre de la littérature mondiale !), proposant une hypothèse originale, fictive - quoique pas tout à fait improbable !- sur ce qui aurait pu être à l'origine de la vocation littéraire de Herman Melville et s'inspirant d'un souvenir d'enfance attesté par ses biographes : la traversée épique réalisée par le père de l'écrivain, à pied, lors d'une nuit glaciale du mois de décembre 1831, du lit gelé du fleuve Hudson, afin de regagner sur la rive opposée le domicile de la famille à Albany, juste avant de tomber gravement malade d'une pneumonie et de décéder par la suite, après plus d'un mois de délires fiévreux ayant amené l'entourage proche et les médecins à conclure entretemps qu'il avait définitivement «perdu la raison».
Fresán imagine Herman Melville, âgé de 12 ans à ce moment-là, au chevet de son père, Allan Melvill (sans «e», voyelle rajoutée par la mère après le décès de son mari, supposant pouvoir de cette manière, au-delà d'apporter une touche chic et «francisante» au patronyme, suite aux très nombreuses dettes laissées par son défunt mari, surtout «éviter et désorienter ses créanciers» !).
L'enfant consignera alors scrupuleusement, sur un cahier, les divagations et propos saugrenus de son père. Ce dernier, tout en mêlant souvenirs de jeunesse, visions hallucinées et fantasmes personnels à sa traversée récente de l'Hudson gelé, échafaudera une étrange construction délirante autour des propriétés de la glace, qu'il appelle le «Gelum melvillium» .
Sans savoir alors que cette expérience serait plus tard déterminante dans la genèse d'une oeuvre littéraire magistrale, très en avance par rapport à son époque, longtemps dédaignée par la critique et considérée à son tour comme relevant d'un esprit dérangé, Herman Melville, ou plutôt son fantôme, ou son esprit «incorporé» par Fresán (sa compatriote Mariana Enriquez définit le roman, dans une citation reproduite en quatrième de couverture, comme étant le résultat d'une «séance» de spiritisme !) rédige, ou plutôt «rédigent», depuis un «présent continu» détaché de références chronologiques précises, un récit biographique qu'on pourrait dans le meilleur des cas situer dans une sorte de « futur du passé composé », et dans lequel, entre autres, tout en revenant en arrière depuis un présent donc «non spécifié», le futur et la postérité de l'écrivain auraient été pressenties, préconfigurées avant même que celui-ci ait véritablement commencé à écrire (Gloups.. !)
C'est ainsi qu'après une vie marquée par des échecs à répétition, sans avoir jamais réussi aucun des exploits auxquels il s'était pourtant senti prédestiné durant sa jeunesse, Melvill père, voyant ses jours approcher leur terme, semblerait implorer à son fils de noter ce qu'il entend (un récit magnifié des aventures extraordinaires vécues soi-disant par le père lors d'un tour en Europe durant ses jeunes années) pour, dit-il, «qu'à l'avenir, il commence une histoire qu'[il] écrira au présent tout en regardant en arrière, mais en voyant les mots se précipiter en avant» afin que le père puisse au moins, couché sur le papier, «être écrit», dans l'espoir «que cette déposition, si elle ne le dédouane pas, le libère, lui donne un sens, une explication et une raison d'être».
Depuis la publication d'«HISTOIRE ARGENTINE» (1991), Rodrigo Fresán bâtit une oeuvre singulière et irrévérente, très critique vis-à-vis des dérives de la postmodernité et en même temps pratiquant volontiers un forme très salutaire d'autodérision.
L'auteur réussit à chaque fois à nous surprendre par des histoires tenues en équilibre entre ce qu'il appelle «les bords» de la réalité, manifestant un sens quasiment intuitif de l'instantanéité de l'écriture, proposant des récits « en train de s'écrire » d'une façon absolument pas artificielle, « abstraite », d'une écriture cursive, très ludique et pleine d'humour. Grâce à ce style original de raconter une histoire, auteur, personnages et lecteurs accèdent à une sorte de «zone frontalière» : l'auteur s'y voit de l'extérieur en train de l'écrire, ou bien, si l'envie lui prend, n'hésite pas à sauter ponctuellement dedans et à se placer parmi ses personnages ; les personnages de leur côté sont parfois invités à s'en extraire et à se regarder depuis l'autre bord, d'en infléchir le cours, par exemple, ou d'en prendre provisoirement les commandes ; le lecteur, lui, avançant sur tous les fronts à la fois, a le sentiment royal, exaltant, telle Alice, excentré et décentré, de passer tout à fait de l'autre côté du miroir !
Dans un registre nouveau ici (pour moi), celui de la fiction biographique, Rodrigo Fresán tente d'identifier à partir d'un épisode particulier, la traversée d'une rive à l'autre de l'Hudson gelé, et dans une métaphore récurrente et abondamment déclinée, de la transparence de la glace et de la blancheur du paysage l'entourant, le noeud imaginaire fondamental à l'origine d'une oeuvre littéraire.
Je dois avouer que cet exercice me laissera plutôt perplexe. Quoique très admiratif devant l'audace de sa construction formelle, ainsi que par les envols toujours inspirés de la prose de Rodrigo Fresán, globalement, en tant que lecteur, j'ai eu trop souvent le sentiment d'être largué au milieu du gué, en l'occurrence au milieu d'un fleuve gelé, très cérébral, au lieu de me retrouver, comme d'habitude placé confortablement sur «les bords» du récit. Je n'y ai retrouvé qu'à de trop rares occasions cette sensation agréable éprouvée lors de mes lectures précédentes de l'auteur, celle de contempler à perte de vue, et avec une grande clarté de vue en même temps, un paysage imaginaire curieux et exotique sans me sentir aucunement perdu ou dépaysé...
Un degré très élevé d'expérimentation formelle, pas toujours justifiée à mes yeux -notamment pendant toute la première partie du livre, où à pratiquement chaque paragraphe viennent systématiquement se greffer des notes de bas de page la plupart du temps très bavardes, infléchissant et multipliant sans raison apparente les commentaires et les focalisations-, gênant ma lecture et impactant par ailleurs sévèrement l'effort d'immersion nécessaire pour essayer d'adhérer à l'incorporéité fantomatique qui semble traverser tout le roman; une ambition radicale à ne considérer la réalité que comme «un outil de la fiction », à vouloir la mettre tout le temps sur le même plan qu'une omniprésente « entéléchie délirante», à abolir toute frontière historique ou chronologique dans les visions et hallucinations des deux personnages, contribuant à augmenter chez le lecteur cette sensation d'immatérialité qu'on vient d'évoquer se dégageant du récit, m'ont finalement amené à me demander sérieusement si, consciemment ou inconsciemment, volontairement ou involontairement, Rodrigo Fresán n'aurait cherché à écrire lui aussi un livre risquant d'être jugé « incompréhensible» ou de déplaire certains de ses potentiels lecteurs, « les lecteurs de son temps »? À l'instar de son modèle vénéré, Herman Melville, trop collé à lui, reprenant, pourquoi pas, sur son compte, dans son propre roman, une composante même de la névrose d'échec héritée par Melville de son père, en même temps que certains des mécanismes de compensation auxquels les uns et les autres auraient pu faire appel pour essayer d'y faire face...? (Ou au fond délirerais-je peut-être, moi aussi... ???)
« Incapable d'écrire autrement – ne fait-il dire après tout à Melville – ma signature serait condamnée à devenir un spécimen confus, peu abouti, indomptable (...) taxée d'incompréhensible par les critiques, genre de plumitifs qui attaquent tout texte un tant soit peu talentueux, le talent qu'ils n'auront jamais, raison pour laquelle ils finissent par devenir des critiques méprisant les dons d'autrui, car tel est leur seul talent »
(Re-gloups : Ne serait-ce par hasard ce que je serais en train de faire là avec cette critique !?)
( Sacré Fresán !!!)
Toujours est-il que, à l'image du texte que je reproduirai ci-dessous, à titre d'illustration et en concluant (enfin !) ce billet où j'espère très sincèrement ne pas figurer dans un rôle de « mauvais critique », moi aussi (toute l'admiration que je voue à Fresán, je tiens à le préciser, reste pour moi absolument inentamée après cette lecture!), ou dans celui d'un drôle de spécimen aussi, « fan-pire » de base (« fantôme et vampire ») de ce même Fresán (!)... enfin, toujours est-il, disais-je, que quand il me fallait lire et relire plusieurs fois des passages tel celui qui suit à titre d'exemple, j'avoue que je ne savais plus très bien sur quel bord me situer :
« Oh, ce qu'on redoute le plus, je le répète, c'est la distance entre le point de départ et la destination finale. La vie vulnérable considérée comme une traversée où ne manquent ni les tempêtes jouissives, ni les plages de calme désespérant. Ce qui viendra et qui est survenu quand et là où (du début vers la fin, déjà) le bonheur présent dépend autant du passé venant jusqu'ici que du futur partant par là-bas, en sachant que si on ne le manie pas avec une extrême prudence, le passé peut devenir le livre d'heures des tyrans et le futur la bible des hommes libres».
CQFD ?
(* «Ici et maintenant », en tout cas, je tiens à remercier vivement l'opération Masse Critique de Babelio et les Editions du Seuil pour l'envoi du livre)
"Le chasseur de saints se souviendra d'avoir lu quelque part que la mère de Dan Brown était spécialiste en musique religieuse et, qui sait, peut-être que Dan Brown a écrit une stupidité pareille pour se venger inconsciemment de sa génitrice". Nul Da Vinci Code, ici, nulle hagiographie, dans ces Vies de saints. Pas de Passio. Ni Vita, ni Miracula. Point de grandes figures bibliques non plus comme dans le génial Objet du scandale de Robertson Davies.
Le lire c'est accepter de se perdre dans un labyrinthe dont la porte d'entrée serait le Saint-Siège, que quitte le dernier Chasseur de saints après la mort du pape Jesus II, originaire de Mexico D.F...
Rodrigo Fresan offre au lecteur un réflexion freaky ( et un flamboyant personnage, El Freako, du village Canciones Tristes) sur l'existence de Dieu et la recherche du sacré, avec en filigrane la phrase d'un vagabond "Dieu n'existe pas, mais c'est un grand personnage".
Digressions, collages, références cinématographiques, playlist (in "Un hymnarium", où "Personal Jesus" de Depeche Mode côtoie "Losing my religion" de R.E.M.). Lire Vies de saints c'est accepter de s'abandonner à une liberté totale, de chercher sur le globe les traces laissées par Canciones Tristes, la ville à géographie mouvante, le Macondo de Fresan, présente dans d'autres oeuvres de l'auteur, et de trouver dans l'épilogue, les clés de cette oeuvre inclassable.
Le lire c'est accepter de se perdre dans un labyrinthe dont la porte d'entrée serait le Saint-Siège, que quitte le dernier Chasseur de saints après la mort du pape Jesus II, originaire de Mexico D.F...
Rodrigo Fresan offre au lecteur un réflexion freaky ( et un flamboyant personnage, El Freako, du village Canciones Tristes) sur l'existence de Dieu et la recherche du sacré, avec en filigrane la phrase d'un vagabond "Dieu n'existe pas, mais c'est un grand personnage".
Digressions, collages, références cinématographiques, playlist (in "Un hymnarium", où "Personal Jesus" de Depeche Mode côtoie "Losing my religion" de R.E.M.). Lire Vies de saints c'est accepter de s'abandonner à une liberté totale, de chercher sur le globe les traces laissées par Canciones Tristes, la ville à géographie mouvante, le Macondo de Fresan, présente dans d'autres oeuvres de l'auteur, et de trouver dans l'épilogue, les clés de cette oeuvre inclassable.
Rodrigo Fresan revisite, à sa façon, Mexico, ville de volcans et de séismes, des anciens dieux Aztèques puis des conquistadors, que l’auteur compare désormais à une tumeur, ville des excès et des morts, des rêves et des hallucinations, laquelle ressemble parfois à un mutant de S.F. ou un personnage de série Z , avec ses combats de catcheurs masqués, ses fratries décadentes et tragiques, ses feuilletons à multiple rebondissements, sa sensualité mais aussi son cannibalisme… le roman de Fresan est à l’image de la ville, multiple et déroutant, avec des voix venues de l’inframonde et des téléviseurs omniscients, des airs de Dylan ou de Gainsbourg, des souvenirs de la Beat Génération, de films de Bunuel, d’Eisenstein et de Peckinpah, souvenirs de Frida Kalho, de Diégo Rivera, de Trotsky, de Breton, du voyage épique et délirant d’Artaud, des lectures de Traven et de Lowry… de nombreuses références qui s’imbriquent dans cet ovni littéraire.
Roman éclaté sous forme de nouvelles courtes qui, tout en aspirant à exister séparément, tenteraient en même temps de converger - sans jamais y réussir complètement- vers un seul et même lit romanesque, HISTOIRE ARGENTINE- L'HOMME DU BORD EXTERIEUR fait penser à un kaléidoscope que le lecteur ferait tourner, constitué de fragments aux motifs symétriques à combiner et à emboîter les uns dans les autres au fur et à mesure que celui-ci avance dans sa lecture. Construction prodigieuse étayée par quelques-uns des principaux mythes de l'imaginaire et la culture populaire argentines, ainsi par des épisodes marquants de l'histoire contemporaine du pays, servant de motif et de toile de fond aux seize nouvelles («chapitres») qui le composent (les gauchos, le foot, les vicissitudes connues par la dépouille d'Eva Péron, les actions terroristes des Montoneros, le retour de Juan Péron en Argentine, le coup d'état militaire, la torture et les disparitions, la guerre des Malouines..) HISTOIRE ARGENTINE est une oeuvre que l'on pourrait qualifier comme étant le résultat d'une sorte «hybridation », où les niveaux de fiction se superposent et les intrigues et les temporalités se structurent et s'imbriquent à la manière d'unités organiques différenciées, quoique solidaires d'une même et étrange créature pluricellulaire : une sorte d'ornithorynque littéraire, et quoi qu'on en penserait en fin de compte, une preuve incontestable de l'intelligence et de l'humour du Créateur..!
Les scories de l'Histoire avec un grand «h» s'immiscent ici constamment dans la «petite histoire», dans le flux de conscience des personnages, dont certains incarnent des doubles plus ou moins avérés de l'auteur (le personnage, par exemple, du «fils qui voulait être écrivain» dans le chapitre intitulé «La Vocation Littéraire ») ; à d'autres moments encore, c'est l'auteur lui-même, en chair et en os, qui fait subitement irruption dans le récit en tant que personnage de sa fiction, ou tout simplement en tant que figurant accessoire, tel un Hitchcock traversant son écran («Le Système Éducatif»).Dans tous les cas, la production et l'accumulation de sédiments mélangeant éléments fictionnels, réflexions sur la création littéraire, souvenirs d'enfance, et résidus historiques se juxtaposent et s'interpénètrent d'une nouvelle à l'autre de manière tentaculaire, pour ensuite bifurquer et brouiller à nouveau les pistes, l'écrivain semblant jouer à désorienter volontairement son lecteur dès que ce dernier s'imagine être enfin arrivé à une destination narrative stable…Non, ce ne sont que des escales provisoires! Pas de bord pour le lecteur non plus où pouvoir s'installer confortablement «à l'intérieur» du récit!
Quelle entrée en matière pour l'auteur! Inclassable et pourtant accessible, drôle et incisif, roman «en désagrégation constante» selon les mots même de son auteur, le livre rencontre dès sa parution un succès immédiat auprès du public et de la critique argentine. Brillant disciple de ses compatriotes émérites, grands maîtres du réalisme magique argentin, Bioy Casares, Borges et Cortázar, auxquels il ne cesse de rendre hommage, Rodrigo Fresán est devenu depuis la publication d'HISTOIRE ARGENTINE en 1991 l'une des voix les plus originales de la littérature contemporaine de son pays. Par l'intelligence de la construction formelle, par la finesse de ses réflexions sur l'inconsistance d'une représentation commune de la réalité environnante partagée par tous, par la transitivité mise en oeuvre entre univers imaginaires parallèles et le monde réel et tangible, par la mise en abîme de différents niveaux de narration, par l'humour pince-sans-rire dont il fait constamment preuve, Rodrigo Fresán, par ailleurs grand copain du chilien Roberto Bolaño qui appréciait aussi énormément son travail, m'a personnellement beaucoup fait penser au grand Julio Cortázar.
L'auteur ne souhaite pourtant pas (et là où probablement on l'aurait attendu «du dehors») être reconnu comme représentant d'un renouveau du réalisme magique argentin. Fresán revendique son appartenance à un autre mouvement ( «pratiqué par un seul auteur : moi-même») qu'il dénomme «l'irréalisme logique». Si l'on considère le réalisme magique en littérature comme «l'irruption du magique dans le réel», nous dit-il, l'irréalisme logique voudrait à l'opposé «faire apparaître des lueurs sporadiques de logique dans l'irréalité du monde».
En l'occurrence, ici, de celle qui avait marqué l'histoire de son pays, notamment dans les années 1970 et 80, au moment de son enfance et adolescence (l'écrivain est né en 1963). «L'histoire argentine est si tumultueuse, si désordonnée, si soumise à des cycles, si intermittente, si amnésique qu'elle prend la forme de nouvelles : elle recommence sans cesse, se réécrit et, lorsqu'elle s'achève, le final est toujours ouvert».
En ce 2 avril 2022, quarante ans donc après la fin de la guerre qui avait opposé le pays à la Grande-Bretagne, les images du discours de l'actuel président argentin réaffirmant la souveraineté de son pays sur les îles Malouines, ou celle de cette grande banderole («MALVINAS NOS UNE») dépliée il y a à peine quelques jours avant un match de l'équipe de foot porteña du Boca Juniors, semblent donner pleinement raison à l'écrivain lorsqu'il déclarait, dans sa postface de 1999, que «L'Argentine comme pays est un très mauvais roman»...
Rodrigo Fresán a réussi avec HISTOIRE ARGENTINE le pari fou d'écrire un livre en train de s'écrire, toujours «du bord extérieur» de l'histoire qu'il raconte, un livre sans véritable incipit et sans point final, sans unité temporelle précise, installé plutôt dans une sorte d'instantanéité de l'écriture, érigée et maintenue en constant devenir. «Open work» d'un écrivain essayant de se regarder «du dehors» en train d'échafauder son récit, et en même temps d'entraîner son lecteur aussi vers une zone liminaire de lecture…
Capisce? Non? Qu'importe : ce puzzle endiablé aux multiples entrées et au découpage surprenant, est en même temps une lecture fort agréable et pas du tout indigeste, qu'on savourera pleinement, certes « du bord extérieur» et devant néanmoins renoncer à la faire rentrer à tout prix dans des cases. Roman de la déconstruction, postmoderne et expérimental ? HISTOIRE ARGENTINE est avant tout, à mon sens, une oeuvre intrigante, un coup de génie littéraire, intelligent et ludique, totalement «suis generis» et, plus important que tout, pour des lecteurs en quête de sensations nouvelles, une lecture absolument jouissive !
Les scories de l'Histoire avec un grand «h» s'immiscent ici constamment dans la «petite histoire», dans le flux de conscience des personnages, dont certains incarnent des doubles plus ou moins avérés de l'auteur (le personnage, par exemple, du «fils qui voulait être écrivain» dans le chapitre intitulé «La Vocation Littéraire ») ; à d'autres moments encore, c'est l'auteur lui-même, en chair et en os, qui fait subitement irruption dans le récit en tant que personnage de sa fiction, ou tout simplement en tant que figurant accessoire, tel un Hitchcock traversant son écran («Le Système Éducatif»).Dans tous les cas, la production et l'accumulation de sédiments mélangeant éléments fictionnels, réflexions sur la création littéraire, souvenirs d'enfance, et résidus historiques se juxtaposent et s'interpénètrent d'une nouvelle à l'autre de manière tentaculaire, pour ensuite bifurquer et brouiller à nouveau les pistes, l'écrivain semblant jouer à désorienter volontairement son lecteur dès que ce dernier s'imagine être enfin arrivé à une destination narrative stable…Non, ce ne sont que des escales provisoires! Pas de bord pour le lecteur non plus où pouvoir s'installer confortablement «à l'intérieur» du récit!
Quelle entrée en matière pour l'auteur! Inclassable et pourtant accessible, drôle et incisif, roman «en désagrégation constante» selon les mots même de son auteur, le livre rencontre dès sa parution un succès immédiat auprès du public et de la critique argentine. Brillant disciple de ses compatriotes émérites, grands maîtres du réalisme magique argentin, Bioy Casares, Borges et Cortázar, auxquels il ne cesse de rendre hommage, Rodrigo Fresán est devenu depuis la publication d'HISTOIRE ARGENTINE en 1991 l'une des voix les plus originales de la littérature contemporaine de son pays. Par l'intelligence de la construction formelle, par la finesse de ses réflexions sur l'inconsistance d'une représentation commune de la réalité environnante partagée par tous, par la transitivité mise en oeuvre entre univers imaginaires parallèles et le monde réel et tangible, par la mise en abîme de différents niveaux de narration, par l'humour pince-sans-rire dont il fait constamment preuve, Rodrigo Fresán, par ailleurs grand copain du chilien Roberto Bolaño qui appréciait aussi énormément son travail, m'a personnellement beaucoup fait penser au grand Julio Cortázar.
L'auteur ne souhaite pourtant pas (et là où probablement on l'aurait attendu «du dehors») être reconnu comme représentant d'un renouveau du réalisme magique argentin. Fresán revendique son appartenance à un autre mouvement ( «pratiqué par un seul auteur : moi-même») qu'il dénomme «l'irréalisme logique». Si l'on considère le réalisme magique en littérature comme «l'irruption du magique dans le réel», nous dit-il, l'irréalisme logique voudrait à l'opposé «faire apparaître des lueurs sporadiques de logique dans l'irréalité du monde».
En l'occurrence, ici, de celle qui avait marqué l'histoire de son pays, notamment dans les années 1970 et 80, au moment de son enfance et adolescence (l'écrivain est né en 1963). «L'histoire argentine est si tumultueuse, si désordonnée, si soumise à des cycles, si intermittente, si amnésique qu'elle prend la forme de nouvelles : elle recommence sans cesse, se réécrit et, lorsqu'elle s'achève, le final est toujours ouvert».
En ce 2 avril 2022, quarante ans donc après la fin de la guerre qui avait opposé le pays à la Grande-Bretagne, les images du discours de l'actuel président argentin réaffirmant la souveraineté de son pays sur les îles Malouines, ou celle de cette grande banderole («MALVINAS NOS UNE») dépliée il y a à peine quelques jours avant un match de l'équipe de foot porteña du Boca Juniors, semblent donner pleinement raison à l'écrivain lorsqu'il déclarait, dans sa postface de 1999, que «L'Argentine comme pays est un très mauvais roman»...
Rodrigo Fresán a réussi avec HISTOIRE ARGENTINE le pari fou d'écrire un livre en train de s'écrire, toujours «du bord extérieur» de l'histoire qu'il raconte, un livre sans véritable incipit et sans point final, sans unité temporelle précise, installé plutôt dans une sorte d'instantanéité de l'écriture, érigée et maintenue en constant devenir. «Open work» d'un écrivain essayant de se regarder «du dehors» en train d'échafauder son récit, et en même temps d'entraîner son lecteur aussi vers une zone liminaire de lecture…
Capisce? Non? Qu'importe : ce puzzle endiablé aux multiples entrées et au découpage surprenant, est en même temps une lecture fort agréable et pas du tout indigeste, qu'on savourera pleinement, certes « du bord extérieur» et devant néanmoins renoncer à la faire rentrer à tout prix dans des cases. Roman de la déconstruction, postmoderne et expérimental ? HISTOIRE ARGENTINE est avant tout, à mon sens, une oeuvre intrigante, un coup de génie littéraire, intelligent et ludique, totalement «suis generis» et, plus important que tout, pour des lecteurs en quête de sensations nouvelles, une lecture absolument jouissive !
Roman-monde, roman-monstre, roman-fleuve, Melvill est un livre vertigineux, stupéfiant d'érudition et de culture.
Par un procédé proche de la mise en abyme, Rodrigo Fresan nous livre ses interrogations et ses réflexions sur l'écriture et la littérature au travers de la vie d'Hermann Melville et de sa relation à son père Allan Melvill (l'orthographe de leur nom est différente, la mère ayant ajouté un "e" à la mort de son mari).
Il faut prendre sa respiration et entrer progressivement dans l'ouvrage pour éviter de s'y perdre.
La première partie du livre qui en comporte trois, est la plus étonnante et la plus expérimentale sur le plan formel. Fresan y relate la biographie d'Allan Melvill, père du célèbre écrivain américain, sous forme de fragments. Ces fragments sont entrecoupés de notes de bas de page plus ou moins importantes qui permettent à Hermann Melville de prendre la parole et de faire des commentaires. Cette alternance est déroutante au départ, certaines notes étant plus importantes que le texte, mais elle offre une scansion intéressante et ouvre un dialogue entre les deux voix qui se répondent, font écho et se perdent l'une dans l'autre. Fresan évoque, à ce titre, un contrepoint, une double personnalité.
Nous apprenons ici qu'Allan Melvill, aventurier dont toutes les affaires commerciales ont échoué, meurt à l'âge de cinquante ans d'une pneumonie, de retour de New-York, après avoir traversé le fleuve Hudson gelé. Cet évènement traumatique pour le jeune Hermann sera un moment fondateur dans sa vocation littéraire.
Les deux autres parties du livre sont de facture plus classique. La deuxième est consacrée au récit du père agonisant, et la dernière voit les deux personnages se rejoindre et entamer ensemble la traversée rêvée de la rivière gelée.
Au delà des péripéties des trajectoires de ces deux hommes, qui ont connu bien des aventures et des revers de fortune, que dire de ce que Fresan a voulu mettre dans ce livre ?
Il s'agit d'un passage de témoin, de relais, entre un homme qui a rêvé sa vie et son fils qui endosse son ambition, mais également ses fautes, péchés, échecs et culpabilité.
Ce sont des variations autour de la création, de la mémoire dont la glace serait la matière, de la thématique de la traversée, entre deux rives, deux continents, deux temporalités -l'auteur avance à reculons et se projette dans plusieurs temps en même temps-.
Comment résumer plus avant Melvill, dans lequel Fresan a voulu faire entrer la totalité de son univers, sans évoquer la baleine de Moby Dick dont la blancheur rappelle les nuances de la glace de l'Hudson, cette baleine, monstre mythologique et métaphore universelle selon l'auteur ?
Ce billet n'a fait qu'effleurer ce livre dense, difficile d'accès, "monstrueuse gueule de bois" comme dit Fresan, qui donne néanmoins envie de découvrir son oeuvre, et surtout de lire Moby Dick.
Je remercie Babelio et les éditions du Seuil de m'avoir permis de lire Melvill.
Par un procédé proche de la mise en abyme, Rodrigo Fresan nous livre ses interrogations et ses réflexions sur l'écriture et la littérature au travers de la vie d'Hermann Melville et de sa relation à son père Allan Melvill (l'orthographe de leur nom est différente, la mère ayant ajouté un "e" à la mort de son mari).
Il faut prendre sa respiration et entrer progressivement dans l'ouvrage pour éviter de s'y perdre.
La première partie du livre qui en comporte trois, est la plus étonnante et la plus expérimentale sur le plan formel. Fresan y relate la biographie d'Allan Melvill, père du célèbre écrivain américain, sous forme de fragments. Ces fragments sont entrecoupés de notes de bas de page plus ou moins importantes qui permettent à Hermann Melville de prendre la parole et de faire des commentaires. Cette alternance est déroutante au départ, certaines notes étant plus importantes que le texte, mais elle offre une scansion intéressante et ouvre un dialogue entre les deux voix qui se répondent, font écho et se perdent l'une dans l'autre. Fresan évoque, à ce titre, un contrepoint, une double personnalité.
Nous apprenons ici qu'Allan Melvill, aventurier dont toutes les affaires commerciales ont échoué, meurt à l'âge de cinquante ans d'une pneumonie, de retour de New-York, après avoir traversé le fleuve Hudson gelé. Cet évènement traumatique pour le jeune Hermann sera un moment fondateur dans sa vocation littéraire.
Les deux autres parties du livre sont de facture plus classique. La deuxième est consacrée au récit du père agonisant, et la dernière voit les deux personnages se rejoindre et entamer ensemble la traversée rêvée de la rivière gelée.
Au delà des péripéties des trajectoires de ces deux hommes, qui ont connu bien des aventures et des revers de fortune, que dire de ce que Fresan a voulu mettre dans ce livre ?
Il s'agit d'un passage de témoin, de relais, entre un homme qui a rêvé sa vie et son fils qui endosse son ambition, mais également ses fautes, péchés, échecs et culpabilité.
Ce sont des variations autour de la création, de la mémoire dont la glace serait la matière, de la thématique de la traversée, entre deux rives, deux continents, deux temporalités -l'auteur avance à reculons et se projette dans plusieurs temps en même temps-.
Comment résumer plus avant Melvill, dans lequel Fresan a voulu faire entrer la totalité de son univers, sans évoquer la baleine de Moby Dick dont la blancheur rappelle les nuances de la glace de l'Hudson, cette baleine, monstre mythologique et métaphore universelle selon l'auteur ?
Ce billet n'a fait qu'effleurer ce livre dense, difficile d'accès, "monstrueuse gueule de bois" comme dit Fresan, qui donne néanmoins envie de découvrir son oeuvre, et surtout de lire Moby Dick.
Je remercie Babelio et les éditions du Seuil de m'avoir permis de lire Melvill.
Parfait interprète de sa génération, Rodrigo Fresán symbolise, au moyen de la citation hermétique, de l'énumération précipitée et du récit extravagant, les années pop, leur liberté suicidaire, leur infantilisme nihiliste et leur kitsch halluciné. Ses personnages, des maniaques délirants, se révèlent tueurs ou criminels, paranoïaques ou égarés, cultivant le traumatisme d'enfance. Ils habitent des récits habilement construits sur la base du fragment, où l'énigme policière et littéraire ainsi que son coup de théâtre révélateur représentent un tribut parodique au récit traditionnel.
Avouons : ce recueil de nouvelles est sans doute l'un des plus grands romans contemporains.
Publié en 1998 (en 2008 en français par le Passage du Nord-Ouest), recueil de nouvelles total ou roman-phare à éclipses, « La vitesse des choses » est sans doute la clé de voûte de l’édifice littéraire de Rodrigo Fresan, une cathédrale dans laquelle on n’entre pas en procession cardinalesque vaguement compassée ou faussement respectueuse, mais en horde bigarrée et cosmopolite, apportant avec soi ses propres munitions et artifices, pour une retentissante explosion de sens, de saveurs et de pensées, dans une festive et songeuse allégresse.
Des titres de nouvelles, déjà, comme une puissante invitation à la folie : « Notes pour une théorie du lecteur », Preuves irréfutables de vie intelligente sur d’autres planètes », « Signaux captés au cœur d’une fête », « Petit manuel d’étiquette funéraire », Sans titre : autres digressions sur la vocation littéraire », « Notes pour une théorie de la nouvelle », « Monologue pour salaud avec baleines et petite sieur fantôme », « Les amoureux de l’art : une « memoir » amnésique », « Dernière visite au cimetière des éléphants », « Histoire avec monstres », « La fille qui est tombée dans la piscine ce soir-là », « Cartes postales envoyées depuis le pays des hôtels », La substitution des corps », « Chivas Gonçalves Chivas : l’art raffiné d’écrire des nécrologies », « Notes pour une théorie de l’écrivain », et bien sûr, « Note finale ».
Une magnifique et forte préface d’Enrique Vila-Matas, « Le Facteur Fresan ».
Remontant en une autre scène des éléments déjà préparés dans « Vies de saints », annonçant, à grand renfort de citations anticipées, le cataclysme « Mantra », ce recueil foisonne, mutant et augmentant à chaque nouvelle édition ou traduction, déroulant ses enchâssements borgésiens, ses récits renvoyant à d’autres récits, sans existence autre que mentionnée, ou au contraire apparaissant tout à coup, à la joyeuse incrédulité du lecteur, au détour d’une autre nouvelle, incarnation vivante d’un espoir littéraire permanent, celui où l’invention, le mythe, le récit et l’imagination parviennent à s’arracher au pesant pouvoir du réel qui étouffe et tue – et bien entendu pas uniquement les écrivains.
Même s’il faut pour cela se donner régulièrement rendez-vous à Canciones Tristes (Patagonie), Sad Songs (Texas – ou Iowa), Chansons Tristes (France) ou Traurige Lieder (Allemagne).
Publié en 1998 (en 2008 en français par le Passage du Nord-Ouest), recueil de nouvelles total ou roman-phare à éclipses, « La vitesse des choses » est sans doute la clé de voûte de l’édifice littéraire de Rodrigo Fresan, une cathédrale dans laquelle on n’entre pas en procession cardinalesque vaguement compassée ou faussement respectueuse, mais en horde bigarrée et cosmopolite, apportant avec soi ses propres munitions et artifices, pour une retentissante explosion de sens, de saveurs et de pensées, dans une festive et songeuse allégresse.
Des titres de nouvelles, déjà, comme une puissante invitation à la folie : « Notes pour une théorie du lecteur », Preuves irréfutables de vie intelligente sur d’autres planètes », « Signaux captés au cœur d’une fête », « Petit manuel d’étiquette funéraire », Sans titre : autres digressions sur la vocation littéraire », « Notes pour une théorie de la nouvelle », « Monologue pour salaud avec baleines et petite sieur fantôme », « Les amoureux de l’art : une « memoir » amnésique », « Dernière visite au cimetière des éléphants », « Histoire avec monstres », « La fille qui est tombée dans la piscine ce soir-là », « Cartes postales envoyées depuis le pays des hôtels », La substitution des corps », « Chivas Gonçalves Chivas : l’art raffiné d’écrire des nécrologies », « Notes pour une théorie de l’écrivain », et bien sûr, « Note finale ».
Une magnifique et forte préface d’Enrique Vila-Matas, « Le Facteur Fresan ».
Remontant en une autre scène des éléments déjà préparés dans « Vies de saints », annonçant, à grand renfort de citations anticipées, le cataclysme « Mantra », ce recueil foisonne, mutant et augmentant à chaque nouvelle édition ou traduction, déroulant ses enchâssements borgésiens, ses récits renvoyant à d’autres récits, sans existence autre que mentionnée, ou au contraire apparaissant tout à coup, à la joyeuse incrédulité du lecteur, au détour d’une autre nouvelle, incarnation vivante d’un espoir littéraire permanent, celui où l’invention, le mythe, le récit et l’imagination parviennent à s’arracher au pesant pouvoir du réel qui étouffe et tue – et bien entendu pas uniquement les écrivains.
Même s’il faut pour cela se donner régulièrement rendez-vous à Canciones Tristes (Patagonie), Sad Songs (Texas – ou Iowa), Chansons Tristes (France) ou Traurige Lieder (Allemagne).
Inracontable, ce livre l'est – comme peut l'être un rêve ou une hallucination.
La première partie du roman, « AVANT : L'ami mexicain » est très classique – mais déjà totalement géniale. Le narrateur y raconte sa rencontre d'enfance avec son ami Martin Mantra - personnage autour duquel on va tourner comme un cyclone autour de son œil – et avec le clan Mantra, totalité mexicaine portée à l'écran par l'œil-caméra de Martin Mantra.
« Une multitude charnelle, liquide, océanique, végétale, faite de sang, d'eau et de sève envahissait l'écran, ignorant tout ce qui ne les impliquait ou ne les incluait pas. La réalité était inexistante pour les Mantra, qui sautaient d'une branche à l'autre. »
Mexico, le DF, apparait dans cette première partie comme un lieu rêvé, le lieu d'origine de Martin Mantra, dans lequel le narrateur n'est jamais allé.
Avec la deuxième partie, on laisse derrière soi la rivière d'un récit qui guide le lecteur au long de son cours, pour pénétrer un récit kaléidoscopique d'une virtuosité inouïe, sous la forme de l'abécédaire d'un mort, dont le sujet est Mexico. Toute l'histoire de la ville depuis Moctezuma 1er, l'histoire des hommes et des femmes célèbres qui sont passés dans cette ville, ont écrit sur elle, traversent ces pages. Incroyablement érudit, ce récit déstructuré, comme le reflet de l'impossible cartographie de la ville de Mexico forme un ensemble démesuré mais cohérent.
« Peut-on raconter une ville comme on conte une histoire, Maria-Marie ? Je n'en suis pas tout à fait sûr. Surtout si cette ville est désarticulée, sans plan, comme un roman invertébré. »
Le Mexico, mantra de ce livre, est un lieu magique, une espèce d'archétype de toute l'humanité, un lieu mutant, paradisiaque et infernal, ou tout semble s'être déjà produit, un lieu dans lequel « le temps est comme une maison en constante réfection ».
« Le Mexique a son utilité car on peut lui attribuer n'importe quoi. Ici, il est difficile qu'il ne t'arrive rien, et si c'est le cas, tu peux toujours inventer car, dans ce pays, même l'histoire la plus délirante devient vraisemblable. »
A peine refermé, « Mantra » est un livre qu'on meurt d'envie de reprendre, comme une drogue.
La première partie du roman, « AVANT : L'ami mexicain » est très classique – mais déjà totalement géniale. Le narrateur y raconte sa rencontre d'enfance avec son ami Martin Mantra - personnage autour duquel on va tourner comme un cyclone autour de son œil – et avec le clan Mantra, totalité mexicaine portée à l'écran par l'œil-caméra de Martin Mantra.
« Une multitude charnelle, liquide, océanique, végétale, faite de sang, d'eau et de sève envahissait l'écran, ignorant tout ce qui ne les impliquait ou ne les incluait pas. La réalité était inexistante pour les Mantra, qui sautaient d'une branche à l'autre. »
Mexico, le DF, apparait dans cette première partie comme un lieu rêvé, le lieu d'origine de Martin Mantra, dans lequel le narrateur n'est jamais allé.
Avec la deuxième partie, on laisse derrière soi la rivière d'un récit qui guide le lecteur au long de son cours, pour pénétrer un récit kaléidoscopique d'une virtuosité inouïe, sous la forme de l'abécédaire d'un mort, dont le sujet est Mexico. Toute l'histoire de la ville depuis Moctezuma 1er, l'histoire des hommes et des femmes célèbres qui sont passés dans cette ville, ont écrit sur elle, traversent ces pages. Incroyablement érudit, ce récit déstructuré, comme le reflet de l'impossible cartographie de la ville de Mexico forme un ensemble démesuré mais cohérent.
« Peut-on raconter une ville comme on conte une histoire, Maria-Marie ? Je n'en suis pas tout à fait sûr. Surtout si cette ville est désarticulée, sans plan, comme un roman invertébré. »
Le Mexico, mantra de ce livre, est un lieu magique, une espèce d'archétype de toute l'humanité, un lieu mutant, paradisiaque et infernal, ou tout semble s'être déjà produit, un lieu dans lequel « le temps est comme une maison en constante réfection ».
« Le Mexique a son utilité car on peut lui attribuer n'importe quoi. Ici, il est difficile qu'il ne t'arrive rien, et si c'est le cas, tu peux toujours inventer car, dans ce pays, même l'histoire la plus délirante devient vraisemblable. »
A peine refermé, « Mantra » est un livre qu'on meurt d'envie de reprendre, comme une drogue.
La critique va pas être facile.
Ce roman est curieux, en faite je ne sais pas l'expliquer, peut-être que si je disais que j'avais chialé, ça vous donnerait une idée approximative de la chose...ainsi J'éviterais d'écrire une critique méga barbante truffée de mots et de phrases tirés de la "bourgeoisie littéraire" dont un grand nombre d'entre vous détiennent le secret...Mais je n'ai pas pleurniché, par contre j'ai beaucoup aimé : une écriture plaisante et riche, une histoire mélangeant passé, présent et futur, des évènements réels ou irréels sans morale ni jugement, juste en pointant du bout de sa plume certains dysfonctionnements de l'être humain... C'est comme si l'auteur vous racontait un truc vraiment moche en vous faisant aimer ça... (hum, je vous l'avais dit que c'était pas simple...) Bref c'est pas un roman comme les autres c'est un OLNI (objet littéraire non identifié) venu d'ailleurs (Pléonasme) qui vous transporte au delà d'un tout... (Je sais : je raconte n'importe quoi...)
A plus les copains
Ce roman est curieux, en faite je ne sais pas l'expliquer, peut-être que si je disais que j'avais chialé, ça vous donnerait une idée approximative de la chose...ainsi J'éviterais d'écrire une critique méga barbante truffée de mots et de phrases tirés de la "bourgeoisie littéraire" dont un grand nombre d'entre vous détiennent le secret...Mais je n'ai pas pleurniché, par contre j'ai beaucoup aimé : une écriture plaisante et riche, une histoire mélangeant passé, présent et futur, des évènements réels ou irréels sans morale ni jugement, juste en pointant du bout de sa plume certains dysfonctionnements de l'être humain... C'est comme si l'auteur vous racontait un truc vraiment moche en vous faisant aimer ça... (hum, je vous l'avais dit que c'était pas simple...) Bref c'est pas un roman comme les autres c'est un OLNI (objet littéraire non identifié) venu d'ailleurs (Pléonasme) qui vous transporte au delà d'un tout... (Je sais : je raconte n'importe quoi...)
A plus les copains
Mantra
Traduction : Isabelle Gugnon
Préface : Alan Pauls
ISBN : 9782757841679
A l'origine, cette espèce d'OVNI littéraire, très difficile à étiqueter (encore plus si l'on déteste les étiquettes ), avait été commandé pour une collection de guides de voyage. Objectif : Mexico, l'Etat et la Ville.
Au résultat, une fresque - c'est indiscutable - écrite par un Argentin sur un pays que, manifestement, il adore, mais une fresque un peu à la Diego Rivera, qui part dans tous les sens, éclate, fulgure, scintille, s'entortille sans aucune sommation dans sa cape, ténébreuse et glauque, tissée de smog mexicain, paraît s'escamoter tandis que, tout au fond, sur leurs chevaux étiques, s'avancent, tout souriants (il est vrai qu'il leur serait difficile de ne pas l'être) tout un groupe de mariachis-squelettes, chantant passion et douceur, mais aussi couteau qui donne le coup de grâce et Mort Toute-Puissante.
Le Mexique est peut-être le seul pays au monde où, tout en étant la compagne de tous les jours que font Dieu et Diable (chose banale que l'on voit partout sur la planète), tout le monde plaisante, rit, gémit et pleure avec la Mort, tout à fait comme si celle-ci était la voisine d'à-côté. Pour un peu, on irait lui demander un peu de sucre si, d'aventure, il nous arrive d'en manquer à la maison . Sous ces latitudes ensoleillées et joyeuses, le 2 novembre, Fête traditionnelle des Morts, est vraiment une fête où des marionnettistes invisibles font danser leurs pantins tout en os, coiffés du classique (et souvent somptueux) sombrero, un violon dans leurs tarses gauches et un archet dans ceux de la main droite. On les voit boire la non moins célèbre tequila sans, pour autant, en tomber raides et, aux enfants qui quémandent, on offre de petits crânes en sucre, qu'ils s'empressent de croquer à moins qu'ils ne les conservent en souvenirs. Notez d'ailleurs que les adultes, y compris les plus âgés, ne se gênent pas pour passer la même commande et en faire leurs délices. La Mort est la compagne éternelle de la Vie et, au Mexique, on ne saurait l'oublier.
Il faut bien dire que, bien avant Christophe et son oeuf ;O) , les peuples indiens du pays, notamment les Aztèques, manifestaient déjà un goût prononcé pour la Mort. L'un de leurs dieux les plus vénérés était Huitzilipotchli, Père de la Guerre, auquel on offrait le coeur des guerriers faits prisonniers en sacrifice. Il y avait aussi, encore plus redouté si l'on peut dire car l'on n'avait guère de moyen de pression sur ses humeurs, Tlaloc ou Dieu de l'Eau, qui dispensait sécheresse ou récoltes grasses et bénéfiques selon ses désirs impénétrables ... Ma foi, les Aztèques prenaient leurs précautions : sacrifices humains, souvent d'enfants, par la noyade ou, plus pacifiquement, "mise à mort" symbolique d'idoles d'amarante qu'on se faisait ensuite un plaisir ... de manger . Les fameux chac mool découverts à la fin du XIXème siècle, qui représentent tous un homme allongé, avec un plateau en creux sur le ventre, seraient par contre d'origine toltèque mais auraient servi, eux aussi, au culte de Tlaloc puisque les coeurs des suppliciés était déposé dans le "plateau." Passons sur les atrocités réservées au culte de Xipe Totec, qui s'arrachait la peau chaque année pour permettre de saines récoltes ...
Quand les Espagnols arrivèrent, on eût pu penser que le dieu des Chrétiens, mort supplicié dans des circonstances horribles sur la croix, s'attirerait très vite la faveur des Aztèques. La bêtise des hommes y fit barrage, comme chacun sait. Mais le Christ, qui s'offrait lui aussi en victime (comme Xipe Totec, en somme), parvint à se faire sa place aux côtés de sa mère, Marie, qui s'identifia très vite à la déesse majeure de la Fertilité, dite d'ailleurs "Mère des Dieux", Coatlicue.
De nos jours, les siècles ont passé mais les croyances ont perduré et fusionné. Les fêtes religieuses mexicaines, et notamment la Fête des Morts, sont des spectacles d'une rare beauté qui allient l'extraversion fleurie des anciens peuples à la réserve sévère mais vibrante des Espagnols et qui, alors que ces deux peuples vécurent en ennemis, s'unissent depuis longtemps dans les célébrations divines en une réussite absolue, un art visuel tout bonnement époustouflant et une éthique spirituelle qui fait rêver.
Si je vous parle autant de la Mort, c'est que le narrateur qui nous tient en haleine pendant près de 550 pages est mort - enfin, c'est ce qu'il nous affirme en s'adressant, dans une sorte de journal-dictionnaire, à sa petite amie mexicaine (morte elle aussi d'ailleurs), María-Marie Mantra. Assassiné et même carrément massacré par une bande de catcheurs et de supporters de catcheurs en colère, sur un ring où il avait osé arborer le masque du catcheur plus que célèbre, Jésús Nazáréen de Tous les Martyrs de ... (je vous épargne la suite, qui est plutôt longue), que lui-même venait de décapiter. (Signalons-le en effet, ce livre peut également se lire comme la descente d'un homme vers la Folie, une folie à la Jérôme Bosh, revue en quelque sorte par Diego Rivera.) Car, dans ces pages, à la fois si glauques et si lumineuses, Fresán développe bien d'autres thématiques propres au Mexique : le culte du masque (si vous voulez savoir qui fut le premier catcheur à se produire masqué dans les années trente, eh ! bien, lisez "Mantra" ) dont on peut dire qu'il vient, lui aussi, en ligne droite, des civilisations anciennes, la corruption omniprésente dans le pays, ses révolutions toujours plus ou moins brisées à cause du "Grand Frère" trop proche qui exploite le Mexique mais aimerait pouvoir le faire en paix, l'art enfin, littérature et cinéma essentiellement, avec une vaste partie réservée au catch mexicain.
En fait, il semblerait plus ou moins que le narrateur soit, consciemment ou non, venu chercher sa Mort au Mexique. Pourquoi ? Mystère . Le pays idéal pour mourir peut-être, en tous cas à ses yeux ? Mais qui est-il, justement, ce narrateur ? Un individu X - il a d'ailleurs un faible marqué pour cette lettre - à moins qu'il ne soit plutôt Martín Mantra, descendant richissime et complètement cinglé d'une dynastie d'affaires polyvalentes, fondée par un personnage rien moins qu'honorable, Máximo Mantra, son grand-père, lequel serait jailli un jour d'on ne sait trop où, au beau milieu des buissons éternellement roulants, éternellement desséchés de la campagne mexicaine ? Máximo Mantra, capable de tuer et de faire tuer, capable des plus grands gestes de générosité comme des plus féroces vengeances, Máximo Mantra, abattu avec toute sa famille (dont, tout le monde l'assure, justement son petit-fils) par les tueurs à gages du milieu du catch, auto-surnommés "les Vierges de Guadalupe" ?
Je parlais d'OVNI au début de cette fiche et la fin du livre est digne d'un roman de S. F. - on perçoit d'ailleurs çà et là l'influence de Philip K. Dick, dont un extrait est cité en tête du roman. Et, avant cela, il y a cet étonnant dictionnaire alphabétique qui tente de dresser le portrait de Mexico, du Mexique et de leurs habitants et coutumes. On en apprend énormément - sur ce plan, l'objectif du guide de voyage est atteint - mais d'une manière totalement déjantée, originale, anticonformiste et à nulle autre pareille, je puis vous l'assurer.
Beaucoup détesteront. Certains ne dépasseront pas les toutes premières pages. D'autres enfin - dont je suis - auront découvert un auteur qui sort de l'ordinaire et dont on a hâte d'explorer l'oeuvre (qui ne parle pas toujours du Mexique). A vous de voir. C'est vous qui déciderez : de toutes façons, si le début de "Mantra" vous paraît insupportable, incompréhensible, complètement à la masse, eh ! bien, tant pis. Sinon, j'espère que vous vous amuserez bien. Bonne lecture à tous ceux qui se lanceront ! ;O)
Traduction : Isabelle Gugnon
Préface : Alan Pauls
ISBN : 9782757841679
A l'origine, cette espèce d'OVNI littéraire, très difficile à étiqueter (encore plus si l'on déteste les étiquettes ), avait été commandé pour une collection de guides de voyage. Objectif : Mexico, l'Etat et la Ville.
Au résultat, une fresque - c'est indiscutable - écrite par un Argentin sur un pays que, manifestement, il adore, mais une fresque un peu à la Diego Rivera, qui part dans tous les sens, éclate, fulgure, scintille, s'entortille sans aucune sommation dans sa cape, ténébreuse et glauque, tissée de smog mexicain, paraît s'escamoter tandis que, tout au fond, sur leurs chevaux étiques, s'avancent, tout souriants (il est vrai qu'il leur serait difficile de ne pas l'être) tout un groupe de mariachis-squelettes, chantant passion et douceur, mais aussi couteau qui donne le coup de grâce et Mort Toute-Puissante.
Le Mexique est peut-être le seul pays au monde où, tout en étant la compagne de tous les jours que font Dieu et Diable (chose banale que l'on voit partout sur la planète), tout le monde plaisante, rit, gémit et pleure avec la Mort, tout à fait comme si celle-ci était la voisine d'à-côté. Pour un peu, on irait lui demander un peu de sucre si, d'aventure, il nous arrive d'en manquer à la maison . Sous ces latitudes ensoleillées et joyeuses, le 2 novembre, Fête traditionnelle des Morts, est vraiment une fête où des marionnettistes invisibles font danser leurs pantins tout en os, coiffés du classique (et souvent somptueux) sombrero, un violon dans leurs tarses gauches et un archet dans ceux de la main droite. On les voit boire la non moins célèbre tequila sans, pour autant, en tomber raides et, aux enfants qui quémandent, on offre de petits crânes en sucre, qu'ils s'empressent de croquer à moins qu'ils ne les conservent en souvenirs. Notez d'ailleurs que les adultes, y compris les plus âgés, ne se gênent pas pour passer la même commande et en faire leurs délices. La Mort est la compagne éternelle de la Vie et, au Mexique, on ne saurait l'oublier.
Il faut bien dire que, bien avant Christophe et son oeuf ;O) , les peuples indiens du pays, notamment les Aztèques, manifestaient déjà un goût prononcé pour la Mort. L'un de leurs dieux les plus vénérés était Huitzilipotchli, Père de la Guerre, auquel on offrait le coeur des guerriers faits prisonniers en sacrifice. Il y avait aussi, encore plus redouté si l'on peut dire car l'on n'avait guère de moyen de pression sur ses humeurs, Tlaloc ou Dieu de l'Eau, qui dispensait sécheresse ou récoltes grasses et bénéfiques selon ses désirs impénétrables ... Ma foi, les Aztèques prenaient leurs précautions : sacrifices humains, souvent d'enfants, par la noyade ou, plus pacifiquement, "mise à mort" symbolique d'idoles d'amarante qu'on se faisait ensuite un plaisir ... de manger . Les fameux chac mool découverts à la fin du XIXème siècle, qui représentent tous un homme allongé, avec un plateau en creux sur le ventre, seraient par contre d'origine toltèque mais auraient servi, eux aussi, au culte de Tlaloc puisque les coeurs des suppliciés était déposé dans le "plateau." Passons sur les atrocités réservées au culte de Xipe Totec, qui s'arrachait la peau chaque année pour permettre de saines récoltes ...
Quand les Espagnols arrivèrent, on eût pu penser que le dieu des Chrétiens, mort supplicié dans des circonstances horribles sur la croix, s'attirerait très vite la faveur des Aztèques. La bêtise des hommes y fit barrage, comme chacun sait. Mais le Christ, qui s'offrait lui aussi en victime (comme Xipe Totec, en somme), parvint à se faire sa place aux côtés de sa mère, Marie, qui s'identifia très vite à la déesse majeure de la Fertilité, dite d'ailleurs "Mère des Dieux", Coatlicue.
De nos jours, les siècles ont passé mais les croyances ont perduré et fusionné. Les fêtes religieuses mexicaines, et notamment la Fête des Morts, sont des spectacles d'une rare beauté qui allient l'extraversion fleurie des anciens peuples à la réserve sévère mais vibrante des Espagnols et qui, alors que ces deux peuples vécurent en ennemis, s'unissent depuis longtemps dans les célébrations divines en une réussite absolue, un art visuel tout bonnement époustouflant et une éthique spirituelle qui fait rêver.
Si je vous parle autant de la Mort, c'est que le narrateur qui nous tient en haleine pendant près de 550 pages est mort - enfin, c'est ce qu'il nous affirme en s'adressant, dans une sorte de journal-dictionnaire, à sa petite amie mexicaine (morte elle aussi d'ailleurs), María-Marie Mantra. Assassiné et même carrément massacré par une bande de catcheurs et de supporters de catcheurs en colère, sur un ring où il avait osé arborer le masque du catcheur plus que célèbre, Jésús Nazáréen de Tous les Martyrs de ... (je vous épargne la suite, qui est plutôt longue), que lui-même venait de décapiter. (Signalons-le en effet, ce livre peut également se lire comme la descente d'un homme vers la Folie, une folie à la Jérôme Bosh, revue en quelque sorte par Diego Rivera.) Car, dans ces pages, à la fois si glauques et si lumineuses, Fresán développe bien d'autres thématiques propres au Mexique : le culte du masque (si vous voulez savoir qui fut le premier catcheur à se produire masqué dans les années trente, eh ! bien, lisez "Mantra" ) dont on peut dire qu'il vient, lui aussi, en ligne droite, des civilisations anciennes, la corruption omniprésente dans le pays, ses révolutions toujours plus ou moins brisées à cause du "Grand Frère" trop proche qui exploite le Mexique mais aimerait pouvoir le faire en paix, l'art enfin, littérature et cinéma essentiellement, avec une vaste partie réservée au catch mexicain.
En fait, il semblerait plus ou moins que le narrateur soit, consciemment ou non, venu chercher sa Mort au Mexique. Pourquoi ? Mystère . Le pays idéal pour mourir peut-être, en tous cas à ses yeux ? Mais qui est-il, justement, ce narrateur ? Un individu X - il a d'ailleurs un faible marqué pour cette lettre - à moins qu'il ne soit plutôt Martín Mantra, descendant richissime et complètement cinglé d'une dynastie d'affaires polyvalentes, fondée par un personnage rien moins qu'honorable, Máximo Mantra, son grand-père, lequel serait jailli un jour d'on ne sait trop où, au beau milieu des buissons éternellement roulants, éternellement desséchés de la campagne mexicaine ? Máximo Mantra, capable de tuer et de faire tuer, capable des plus grands gestes de générosité comme des plus féroces vengeances, Máximo Mantra, abattu avec toute sa famille (dont, tout le monde l'assure, justement son petit-fils) par les tueurs à gages du milieu du catch, auto-surnommés "les Vierges de Guadalupe" ?
Je parlais d'OVNI au début de cette fiche et la fin du livre est digne d'un roman de S. F. - on perçoit d'ailleurs çà et là l'influence de Philip K. Dick, dont un extrait est cité en tête du roman. Et, avant cela, il y a cet étonnant dictionnaire alphabétique qui tente de dresser le portrait de Mexico, du Mexique et de leurs habitants et coutumes. On en apprend énormément - sur ce plan, l'objectif du guide de voyage est atteint - mais d'une manière totalement déjantée, originale, anticonformiste et à nulle autre pareille, je puis vous l'assurer.
Beaucoup détesteront. Certains ne dépasseront pas les toutes premières pages. D'autres enfin - dont je suis - auront découvert un auteur qui sort de l'ordinaire et dont on a hâte d'explorer l'oeuvre (qui ne parle pas toujours du Mexique). A vous de voir. C'est vous qui déciderez : de toutes façons, si le début de "Mantra" vous paraît insupportable, incompréhensible, complètement à la masse, eh ! bien, tant pis. Sinon, j'espère que vous vous amuserez bien. Bonne lecture à tous ceux qui se lanceront ! ;O)
Des histoires de fantômes, de mémoires, de début de fin du monde, de monstres, d'écrivains légendaires, de fiction devenues réalité à moins que ce ne soit l'inverse. Dans une série de nouvelles, d'instantanées et d'épiphanies, de déclarations théoriques contradictoires, Rodrigo Fresán signe un texte captivant, saturé d'écho et de coïncidences. La vitesse des choses est l'un de ses livres-monde dont une seule lecture ne suffit à capter les interprétations plurielles et changeantes. À découvrir de toute urgence.
Lien : https://viduite.wordpress.co..
Lien : https://viduite.wordpress.co..
Ce texte oscille entre fiction et (fausse) biographie de l'auteur de "Taïpi" et "Moby Dick". Rodrigo Fresan, auteur argentin nous livre un texte foisonnant sur l'écriture et la pulsion créatrice notamment. Ce roman est une prolongation d'une nouvelle déjà présente dans "La Parte recordada", le dernier volet de la trilogie composée de "La part inventée" et de "La part rêvée". Malheureusement, je suis restée assez hermétique à ce texte labyrinthique où les trop nombreuses notes de bas de pages m'ont perdues... Je suis persuadée que les fans d'Herman Melville et de proses ambitieuses ou loufoques sauront se laisser séduire. Un texte pointu pour les plus lettrés et les plus coriaces d'entre vous.
Y' a t-il un pilote dans l'avion??!!! J'ai lu 100 pages et j'ai arrêté épuisée de ne rien comprendre. Il ne s'agit que d'un fouillis de mots et de divagations sans aucun sens, si le livre a été écrit pour qu'il ne soit compris que par l'auteur, je ne vois pas l'intérêt, j'étais constamment perdue étant obligée de revenir sur des pages d'avant. Ce livre me donne l'impression qu'il a été écrit sous l'emprise d'une sérieuse dose de LSD. Je pense qu'il faut même avoir connu un shoot pour comprendre ce livre. Je ne peux même pas essayer de résumer l'histoire si tant est qu'il y' en ait une, cela me serait impossible. Je ne suis pas la cible pour ce genre de bouquin.
Celui-là, je l’ai tellement aimé que je l’ai choisi pour l’offrir à une lectrice acharnée et bien plus difficile que moi ! C’est psychédélique, franchement frappé, et tous les adjectifs et figures de style que vous pourrez trouver sur le labyrinthe et les serpents se mordant la queue. Les années 70 se mêlent à l’Angleterre Victorienne, tandis qu’un écrivain pour enfants ; fils d’un rival malheureux des Beatles, conte à un jeune garçon la vie de Barrie, auteur de Peter Pan. J’ai trouvé qu’il y avait quelques passages un peu long, mais je crois que c’est surtout dû à mon manque de culture sur les années 70, à ne plus savoir trier le vrai du faux entre ce qui est vrai, ce qu’il invente…
voir la critique d'Austerlitz de Sebald.
Les Jardins de Kensington est un livre inclassable, qui effleure le genre biographique pour mieux en détourner les codes, les mâtiner de roman noir.
C'est un livre qui se joue de l'Histoire pour mieux inventer des histoires, et constamment remettre en question les frontières entre réalité et fiction. Entre personnage, auteur et acteur.
Un livre sur l'enfance - et sur la littérature qui s'adresse à elle, s'en inspire, la rêve et la recrée.
Un livre sur la folie, créatrice et destructrice à la fois.
Un hommage aux charmes vénéneux de l'époque victorienne, et à ceux, psychotiques, des glorieuses années 60.
Bien d'autres choses encore, mues par la puissance d'une écriture percutante et belle.
Un très grand livre.
C'est un livre qui se joue de l'Histoire pour mieux inventer des histoires, et constamment remettre en question les frontières entre réalité et fiction. Entre personnage, auteur et acteur.
Un livre sur l'enfance - et sur la littérature qui s'adresse à elle, s'en inspire, la rêve et la recrée.
Un livre sur la folie, créatrice et destructrice à la fois.
Un hommage aux charmes vénéneux de l'époque victorienne, et à ceux, psychotiques, des glorieuses années 60.
Bien d'autres choses encore, mues par la puissance d'une écriture percutante et belle.
Un très grand livre.
Reprenons depuis le début. Mantra est un livre sud-américain (ça commençait bien), à la structure narrative innovante (ah intéressant, je suis toujours preneur), recommandé par Roberto Bolaño, citant Lowry, Nabokov, Cortazar (quatre auteurs de mon Top 10), Kerouac, Philip K. Dick et 2001, l'odyssée de l'espaceil et qui, last but not least, bénéficie d'une moyenne alléchante sur SensCritique (8), qui atteint 8.3 chez mes éclaireurs. Voilà donc un livre que j'aurais dû et aimé aimer. Or, non seulement ce ne fut pas tout à fait le cas, mais sa lecture a même été parfois assez pénible. Essayons d'expliquer de manière rationnelle cet implacable (et regrettable) ressenti.
L'une des raisons me semble être précisément la structure narrative de Mantra. Enfin, celle de la deuxième partie, qui raconte l'histoire sous la forme d'un lexique, fort habilement fait par ailleurs. Ce genre d'aventure formelle (dont je peux être très friand, là n'est pas la question) est à double tranchant. Elle peut livrer des oeuvres incomparables, surprenantes, ludiques mais également des pensums stériles et alambiqués . Or, Mantra me paraît plutôt intégrer la seconde catégorie... Non seulement le recours au lexique n'est jamais justifié et arrive comme un cheveu sur la soupe, mais j'avoue ne pas avoir retiré grand-chose de ces 500 pages. Le postulat de départ est séduisant, mais le traitement m'a laissé sur ma faim, oscillant sans trouver le juste milieu entre l'anecdotique et le sentencieux.
Aussi, la première partie (où est passé l'humour des premiers chapitres ?) et les toutes dernières pages m'ont paru être les meilleurs moments du livre. Entre eux, malheureusement, j'ai eu la douloureuse sensation de me débattre dans un océan glacé, dont je ne crois pas avoir jamais lu plus de dix pages d'affilée. On me dira que c'était sans doute en partie l'effet recherché (livre tentaculaire où il faut accepter de se perdre), et je veux bien l'accorder, j'étais même partant, mais je ne peux pas mentir non plus : je m'y suis surtout ennuyé.
Mais le plus agaçant est peut-être le côté m'as-tu-vu du livre. Chaque page semble crier : "ceci est un livre dément écrit sur une ville démente (Mexico)", et cela justifierait toute les coquetteries, les longueurs (livre bieeeeeen trop long) et les pénibles digressions existentialisto-surréalistes (le mauvais côté des romans de Cortazar, en encore moins bien ici car déjà vu) de la deuxième partie. A quoi il faut ajouter le name-dropping incessant et les réécritures sans grand intérêt - j'en ai identifié deux : celle de La nuit face au ciel de Cortazar et celle du début de Pedro Paramo de Juan Rulfo, dans une ambiance post-apocalyptique (!), au début de la troisième partie. Inutile de préciser que j'aime mille fois mieux lire les originaux.
Ces remarques négatives ne doivent pas faire oublier certaines trouvailles géniales (la première partie, le personnage de Martin Mantra, les tumeurs "Sea Monkeys", les passages sur l'amnésie, et j'en passe) un style follement inventif, la maîtrise de la narration discontinue - on reconstitue l'intrigue centrale au fur et à mesure, dans le désordre, au gré des entrées du lexique, et c'est plutôt intéressant. Un délire maîtrisé, donc, mais dont le principal défaut serait peut-être justement le fait de clamer haut et fort que c'est un délire, un livre mutant sous drogues dures, et ainsi de légitimer, de manière un peu facile, le fait qu'il parte dans toutes les directions en épuisant le lecteur.
On en arrive à l'ultime paradoxe de ce livre : à trop chercher l'originalité, à trop vouloir étonner, à trop jouer le "grand roman sud-américain postmoderne halluciné", Mantra ennuie par ses errements abscons, ses pages ultra-référencées et ses effets finalement prévisibles, le tout servi avec une sauce science-fiction plutôt indigeste. Qui m'est restée sur l'estomac.
L'une des raisons me semble être précisément la structure narrative de Mantra. Enfin, celle de la deuxième partie, qui raconte l'histoire sous la forme d'un lexique, fort habilement fait par ailleurs. Ce genre d'aventure formelle (dont je peux être très friand, là n'est pas la question) est à double tranchant. Elle peut livrer des oeuvres incomparables, surprenantes, ludiques mais également des pensums stériles et alambiqués . Or, Mantra me paraît plutôt intégrer la seconde catégorie... Non seulement le recours au lexique n'est jamais justifié et arrive comme un cheveu sur la soupe, mais j'avoue ne pas avoir retiré grand-chose de ces 500 pages. Le postulat de départ est séduisant, mais le traitement m'a laissé sur ma faim, oscillant sans trouver le juste milieu entre l'anecdotique et le sentencieux.
Aussi, la première partie (où est passé l'humour des premiers chapitres ?) et les toutes dernières pages m'ont paru être les meilleurs moments du livre. Entre eux, malheureusement, j'ai eu la douloureuse sensation de me débattre dans un océan glacé, dont je ne crois pas avoir jamais lu plus de dix pages d'affilée. On me dira que c'était sans doute en partie l'effet recherché (livre tentaculaire où il faut accepter de se perdre), et je veux bien l'accorder, j'étais même partant, mais je ne peux pas mentir non plus : je m'y suis surtout ennuyé.
Mais le plus agaçant est peut-être le côté m'as-tu-vu du livre. Chaque page semble crier : "ceci est un livre dément écrit sur une ville démente (Mexico)", et cela justifierait toute les coquetteries, les longueurs (livre bieeeeeen trop long) et les pénibles digressions existentialisto-surréalistes (le mauvais côté des romans de Cortazar, en encore moins bien ici car déjà vu) de la deuxième partie. A quoi il faut ajouter le name-dropping incessant et les réécritures sans grand intérêt - j'en ai identifié deux : celle de La nuit face au ciel de Cortazar et celle du début de Pedro Paramo de Juan Rulfo, dans une ambiance post-apocalyptique (!), au début de la troisième partie. Inutile de préciser que j'aime mille fois mieux lire les originaux.
Ces remarques négatives ne doivent pas faire oublier certaines trouvailles géniales (la première partie, le personnage de Martin Mantra, les tumeurs "Sea Monkeys", les passages sur l'amnésie, et j'en passe) un style follement inventif, la maîtrise de la narration discontinue - on reconstitue l'intrigue centrale au fur et à mesure, dans le désordre, au gré des entrées du lexique, et c'est plutôt intéressant. Un délire maîtrisé, donc, mais dont le principal défaut serait peut-être justement le fait de clamer haut et fort que c'est un délire, un livre mutant sous drogues dures, et ainsi de légitimer, de manière un peu facile, le fait qu'il parte dans toutes les directions en épuisant le lecteur.
On en arrive à l'ultime paradoxe de ce livre : à trop chercher l'originalité, à trop vouloir étonner, à trop jouer le "grand roman sud-américain postmoderne halluciné", Mantra ennuie par ses errements abscons, ses pages ultra-référencées et ses effets finalement prévisibles, le tout servi avec une sauce science-fiction plutôt indigeste. Qui m'est restée sur l'estomac.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur
Auteurs proches de Rodrigo Fresan
Lecteurs de Rodrigo Fresan (175)Voir plus
Quiz
Voir plus
Le suivant sur la liste
Quel est nom de la clinique où se trouve Timothée?
La clinique des Colombes
La clinique des Pélicans
La clinique des Cigognes
La clinique des Vautours
6 questions
62 lecteurs ont répondu
Thème : Le suivant sur la liste de
Manon FargettonCréer un quiz sur cet auteur62 lecteurs ont répondu